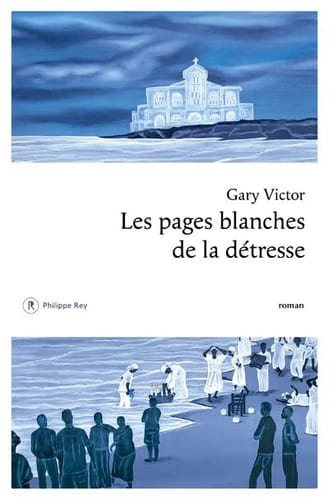(Première partie)
La Révolution haïtienne est un procès d’institution du corps-propre de l’esclave par le travail pour soi. Ce procès passe par un mode d’appropriation du corps par la propriété qui, étant devenue ce que l’on possède en propre, a partie liée avec le corps libéré de l’emprise du maître-colon, et donc du mors qui servait à l’embrigader, le bestialiser, mais surtout à le massifier, et ainsi le décorporéiser, autrement dit le désincarner. En effet, ce que l’on possède en propre, avant de posséder tous les biens, c’est son corps. Évidemment, il s’agit du corps vivant, du corps qui est déjà moulé dans l’éthicité de la vie et notamment celle du bien-vivre. D’abord, poser la conservation de la vie et de la vie bonne comme condition du corps é-mancipé, capable dès lors d’être joyeux. La Révolution haïtienne est une promesse de joie – un hymne à la joie au sens plein du terme –, mais les interprétations habituelles l’enferment dans des symbolisations trop simplistes. La lecture que je propose dans cette réflexion méritera sans doute d’être corrigée du fait de son caractère incomplet et de ses enjeux dépolitisants.
On a souvent considéré la geste de 1804 comme une révolution « anticapitaliste » « antiesclavagiste » et « antiraciste ». Si l’on tient compte à la fois du contexte sociohistorique de la colonie de Saint-Domingue et des relations internationales définies en cette période par le racisme, l’esclavagisme et le déploiement du régime économique d’exploitation de l’homme et de la terre par l’homme dans un projet d’accumulation d’une part et d’appauvrissement d’autre part, cette thèse populaire pourrait être retenue. Par contre, si l’on prend la révolution dans ce qu’elle présuppose, l’institution d’un régime de liberté politique, ses aspects anti-esclavagistes, antiracistes et anticapitalistes sont secondaires et ne lui restituent ce qui, en elle, est révolu.
Un rappel permettra de se faire une idée plus claire de ce dispositif international et du sens de l’esclavage. Il mettra l’accent sur le discours anthropologique qu’a inspiré la réalité économique de l’époque. D’abord, je dois souligner que l’invention de l’autre qu’a occasionnée la « poétique de la relation » des Européens avec les autres peuples est créée par le besoin matériel d’existence qui se justifie par l’infériorisation des altérités non européennes, non chrétiennes, non blanches. Continent relativement pauvre en ressources naturelles, frappé d’épidémies et de famines, l’Europe trouva des solutions pour continuer d’exister dans l’exploitation des autres continents. Pour ce faire, les Européens ont dû prendre le large afin de s’approvisionner en matières premières et profiter des forces de travail des autres peuples. Ce contexte de famine a pu favoriser le développement de compétences scientifiques et techniques, grâce auxquelles ils ont inventé des artefacts qui ont profité à l’exploration et à la maîtrise des mers, à la conquête de terres lointaines et nouvelles et à la soumission d’autres peuples.
C’est pour cette raison que je considère que l’invention des altérités non européennes depuis le 15e siècle est une incitation anthropologique venue de l’économie qui a pris dès le début la forme d’un calcul ou d’une logique (voire d’une rationalité particulière) dont la finalité est d’assurer la « grandeur nationale ». C’est le sens fondamental du mercantilisme (et de ses variantes dans d’autres États-nations européens) qui, n’étant pas un simple moment inaugural du capitalisme tel que le croit le marxisme, élabore le sens fondamental de l’économie moderne : continuer les manœuvres d’agrandir son pays par la dépendance des autres. L’économie européenne a procédé dans cette perspective à l’invention de l’anthropologie et de la politique internationale d’exploitation et d’asservissement. L’anthropologie est dès lors devenue le discours de la classification et de la hiérarchisation de la diversité des hommes selon le marqueur de la « race ». Elle justifie par cet ordre hiérarchisé l’exploitation d’un groupe d’hommes par un autre au nom d’une supposée « supériorité ». La politique, elle, prend la forme du dispositif juridico-administratif de la domination, de l’exploitation et de l’asservissement.
L’esclavagisme, le racisme et le capitalisme forment des instruments théorico-pratiques des relations internationales des 16e, 17e et 18e siècles.
La Révolution haïtienne prend donc la forme d’un procès de déconstruction de ce dispositif global de racisme, de capitalisme et d’esclavagisme. Par déconstruction, j’entends, non l’effondrement ou la destruction du dispositif raciste, esclavagiste et capitaliste, mais l’évidement de ce qui constitue son noyau phénoménologique : ne pas travailler pour autrui ; lequel travail est à comprendre comme condition de l’expropriation, de la dépossession ou de la perte de soi. Cependant, il faut revenir à la linguistique sémantique qui présente la place de la présupposition dans le travail de pensée pour constater que la révolution présuppose davantage la liberté que le travail pour soi, qui se révèle davantage une entrave à l’idéal fondamental de la révolution.
Si j’ai effectué ce détour, ce n’est nullement pour justifier la thèse qui consiste à soutenir que la révolution haïtienne fut contre l’esclavagisme, le racisme et le capitalisme. Dans la perspective de la linguistique sémantique de la présupposition que j’adopte ici, je propose d’aller au-delà de celle-ci. Car, s’il est, un tant soit peu, aisé de montrer que cette révolution fut anticapitaliste, il est plus difficile de justifier son caractère intrinsèquement antiraciste et anti-esclavagiste, en tenant compte de la reconduction des formes d’asservissement qui rappellent ou s’apparentent à l’esclavage. Donc il suffit de montrer comment certaines formes coloniales ont été sédimentées et constamment réactivées pour se poser la question de la pertinence de cette thèse. J’en prends pour preuve la vie paysanne et la figure du « restavèk », le récit anthropologique ou populaire sur la zombification. La dernière réflexion qui cherche à fonder cette thèse s’est heurtée à l’inévitable retour de la colonialité, désignée comme « fantôme ». Évidemment, la Révolution, par son « esprit », ne cesse de faire signe sur les possibles à actualiser. En liant perspective fantomatique de la sédimentation des pratiques coloniales dans le corps de l’esclave et phénoménologie de l’esprit[i], qui montre que les possibles ne sont pas entièrement épuisés, le problème prend l’aspect de la sortie de la colonialité et non de la radicalité posée par la Révolution. Ce qui est radical, c’est l’idéalité de la révolution et son effectivité. Si l’effectivité semble prendre la forme de l’anticapitalisme, l’antiracisme et l’antiesclavagisme, qui ne sont que des sous-entendus de la révolution, ce que celle-ci a rencontré au passage dans son déploiement complexe, sa radicalité s’exprime dans le présupposé même de la révolution : la liberté, la position de la capacité à participer à l’institution de la commun-auté politique.
Le racisme, le sous-racisme pour citer le sociologue Laënnec Hurbon, n’a pas pris fin avec la révolution. L’organisation sociale, la politique d’éducation, le rapport à la langue créole, au vodou ou aux « survivances africaines » témoignent d’un racisme structurel et colonial. L’aspect anticapitaliste peut à peine tenir la route, mais ce ne sont pas par les arguments généralement avancés. On le justifie donc rarement par de bons arguments. On se rabat au système de cour (lakou) et à la petite plantation terrienne comprise comme modes de résistance au capitalisme de la bourgeoisie marchande naissante et de l’État prédateur. Ces arguments tiennent très peu la route, puisqu’au fond une remise en cause du capitalisme devrait s’attaquer à ce qui en constitue le cœur, le travail.
Pour arriver à mon hypothèse fondamentale et originelle, je cesse de prendre la révolution comme une évidence et son « esprit » comme réalité pure sans relation avec les déterminations passées. Comme Alexis de Tocqueville dans L’ancien et la révolution, je pars du soupçon, celui de la révolution elle-même, comprise comme « changement radical » d’un système socio-politique et économique. Les partisans de la révolution se livrent à des analyses des matérialités politiques, sociologiques et économiques sans prendre en compte les imaginaires retors qui résistent à l’idéal nouveau que propose la révolution. Ainsi s’intéressent-ils aux pratiques institutionnelles, administratives et juridiques et se réjouissent de la prétendue destruction ou table rase de ces institutions administratives et juridiques. Ils négligent en retour les dimensions symboliques et imaginaires de ces pratiques ou des conditions anthropologiques des dispositifs juridico-administratifs qui sous-tendent ces dispositifs. Le soupçon auquel j’ai fait allusion consiste à supposer que la Révolution haïtienne, telle qu’elle est comprise par nombre d’historiens ou sociologues, ne contient pas toujours quelque chose de révolu.
L’enjeu de ma question vise à m’intéresser au concept de révolu, qui oriente la réflexion davantage du côté de l’ordre de discours où se jouent des glissements de sens, des changements de perspective plus nette qui peuvent mettre à jour ce qu’il y a de plus radical de la Révolution haïtienne. Diriger ma compréhension vers cette perspective, c’est chercher ce qu’il y a de plus radical de la révolution de 1804.
Mon point de vue consiste à soutenir que ce n’est ni la question de la « race », ni celle du travail servile, ayant repris des formes autres dans les préjugés de couleur et le travail pour soi la propriété, ni celle de la confusion de la liberté et de la propriété, qui donnent le sens véritable de la Révolution haïtienne. Ce qu’il y a de révolu dans cette révolution concerne, en un premier temps, le rapport au travail, qui prend un sens particulier dans l’esclavage et le capitalisme, le travail pour le bénéfice ou le profit d’autrui. Ainsi, je soutiens d’abord, dans une perspective plus radicale et précise, que le sens de la Révolution haïtienne est dans le travail pour soi. L’enjeu d’un tel point de vue porte sur l’institution de la politique comme modalité de mise en commun et de son administration. Si le travail pour soi, étant considéré comme l’intentionnalité de la Révolution haïtienne et comme condition phénoménologique de l’expérience de son corps-propre, préalable à toute relation aux autres, comment prendre en charge l’institution du corps-propre comme commencement d’un monde pour soi et pour les autres ? Cette question montre implicitement l’insuffisance de la thèse du travail pour soi. Ainsi devrai-je montrer toutes les impasses du travail pour soi à fonder une communauté politique. C’est pourquoi en cours de chemin, je serai amené à abandonner cette thèse pour ne retenir que la liberté comme idéalité de la Révolution tout en précisant le malentendu qui s’impose sans la compréhension du concept de liberté.
Je procéderai, d’une part, à la reprise critique du point de vue qui fait de la Révolution une affaire anticapitaliste, antiraciste et antiesclavagiste, à une précision du concept de travail et, de l’autre, je montrerai les enjeux anthropologiques et politiques du travail pour soi, forme radicale de la politique et de l’économie coloniale en en venant à la conclusion de la liberté, comprise comme condition de la constitution de la communauté politique. Cette liberté ne sera détruite de la révolution que comme un sous-entendu : quelque chose qu’elle aurait rencontré en chemin. Ce qui est le présupposé de la révolution servile.
- Une révolution anticapitaliste, antiraciste et antiesclavagiste
Un grand nombre d’historiens, de sociologues ou d’économistes ayant travaillé sur la Révolution haïtienne ont soutenu que celle-ci a eu des portées qui contrevenaient au capitalisme, au racisme et à l’esclavagisme. Je vais tour à tour exposer le cadre historico-théorique du contexte d’irruption des masses serviles sur la « scène » révolutionnaire[ii].
-
- Une révolution anticapitaliste
Qu’est-ce que le capitalisme ? En quoi la Révolution haïtienne s’est-elle imposée contre l’ordre du monde capitaliste ? Je retiens un concept fondamental mis en lumière depuis Max Webber dans l’Éthique protestante et l’esprit du capitalisme. J’ai exposé en détail dans un autre article[iii] tous les aspects du capitalisme naissant. Je ne fais que rappeler ici les grandes lignes de cette réflexion qui a abouti à une vue cohérente et complexe du capitalisme et de sa manière d’exploiter les corps asservis.
Max Webber a vu dans le « profit » ce que je nommerai l’eidétique du capitalisme. Son intentionnalité qui inspire toutes les autres modalités. Le capitalisme est donc un système de monde lié au profit et à sa maximalisation, qui entraîne un rapport calculé au temps qui, étant argent, doit être intensifié et conduire à la vitesse vertigineuse que décrit Paul Virilio[iv] depuis 1977. De cette considération selon laquelle la dynamique du profit génère une économie du flux et de la vitesse, je retiens que le capitalisme est un « système-monde » fondamentalement marqué par l’économie et la logique de la rareté, du besoin et de la production rentable, qui suscitent un rapport d’urgence avec le temps. Quelque chose est en retrait dans la définition, où il serait question du simple, qui mérite d’être explicité, c’est le « pauvre » ou l’appauvri, pourvoyeur de force de travail, transmué en esclave ou travailleur.
Le capitalisme dont les attributs sont le profit et l’appauvrissement des altérisés est à comprendre d’abord comme un dispositif qui procède à un partage du sensible social et mondial. Il place d’une part le capitaliste, celui qui investit son « capital » dans la production de biens et de services en vue du profit maximal, d’autre part, celui qui n’a que sa force de travail à vendre afin de survivre et qui se voit frappé de dénuement chronique jusqu’à l’épuisement vampiriste.
Ce partage des eaux, le capitalisme naissant, l’a fondé sur un partage plus fondamental lié à la structure mentale des Européens, qui a avant tout divisé le monde en eux, civilisés, détenteurs de la vertu instrumentalisante de la rationalité européenne et les autres, simples musculatures pour le travail générateur de profit. Un ordre dual se forme : l’humanité européenne et la barbarisation des non-Européens. L’esclave, installé du côté de la barbarie ou de la sauvagerie, est mis au travail au nom de son salut. Le travail servile est devenu une modalité de l’exploitation des Amérindiens, des Africains, des Asiatiques par les Européens et leur infériorisation anthropologique. La rhétorique de la justification prend la « race » comme fondement de la domination. Dans les colonies, particulièrement à Saint-Domingue, le système capitaliste fait chou gras de l’esclave, dresse son appartenance raciale en valeur d’exploitation. On connait le système de travail éreintant et le peu de cas qui a été accordé à la vie de l’esclave qu’on a préféré exploiter jusqu’à la mort (même après la promulgation du Code noir) au lieu de lui garantir une condition de vie décente. Les colons, en règle générale, ont préféré renouveler leur cheptel d’esclaves que de leur accorder de bonnes conditions d’existence.
Le capitalisme se déploie donc par un mode d’appropriation qui consiste à jouir de l’énergie de l’autre, à le vampiriser et le laisser pour mort. Implicitement, Webber a suggéré cet aspect chosifiant du capitalisme. Le dispositif capitaliste part d’un fond psychologique constitué de désir, de désir d’accumulation in(dé)finie qui porte le capitaliste à être insatiable et à ne pas voir dans le travailleur un être humain, mais un produit de jouissance ou de consommation de son désir d’accumuler. L’autre, le travailleur ou l’esclave, n’est plus pris dans son altérité-mêmeté. Il est enfermé dans l’altérité-différence qui le transforme en force inerte de consumation. Objet-sujet à consommer, sa dignité n’est plus prise en compte. Il est inséré au « système des objets » et donc réifié. Le capitalisme, n’établissant pas de relation symétrique ou d’égalité, détruit des estimes-de-soi, violente les affectivités en les abandonnant aux déchèteries sociales de l’« insignifiance »[v]. L’autre devient l’« homme jetable[vi] », l’homme exploité jusqu’à l’exsanguïté. Enfermé dans les habitations, aujourd’hui, dans les usines, l’autre du capitaliste ne sait quoi faire de sa vie vidée de son sens, de son utilité.
Le capitalisme est donc le dispositif philosophico-politique et économique de réification des vies humaines qu’il vide de leur substance d’estime-de-soi et qu’il enfonce dans l’invisibilisation ou la mort sociale, dans l’indignité et la fatigue existentielle[vii]. C’est ce dispositif que la Révolution semble avoir dérouté en détruisant les champs de production et les formes d’exploitation. Est-ce vraiment le cas ?
Plusieurs éléments forcent de prendre avec plus de prudence l’idée d’une révolution anticapitaliste sachant que dès la sortie du capitalisme servile nombre des chefs d’État haïtien ont reconduit, par des variantes diverses, le système d’exploitation fondé sur l’expropriation, le mépris de la vie paysanne, l’enfermement aux terres et la soumission à l’autorité du fermier. Du point de vue de l’anthropologie de l’imaginaire, les récits sur la zombification occupent une double fonction, celle de raconter l’histoire symbolique de l’esclavage et de dénoncer la persistance du dispositif réifiant, asservissant de l’exploitation outrancière de l’homme par l’homme. Les contestations paysannes contre ce nouveau régime d’exploitation des corps et de domination rappelant l’esclavage, les revendications paysannes pour accéder à des terres indiquent qu’un reste colonial gît dans les décombres de la révolution et diminuent sa force de radicalité émancipatoire. Le système économique, attribuant aux étrangers les avantages du commerce avec les anciennes métropoles esclavagistes, place la révolution dans une ambiance sociale et économique qui répète la structure de travail pour autrui d’accumulation et de jouissance des paysans. La Révolution n’a pas changé le système de jouissance et d’asservissement fondé sur l’avatar raciste de la couleur de peau, et la logique de justification par la supériorisation d’une « race » sur d’autres. Si anticapitalisme, il y a, il faudrait le trouver ailleurs, dans le refus de travailler pour autrui, d’être objet de jouissance de l’autre, les autorités politiques et économiques ; du paysan, qui jouit de ses zombis ; des citadins qui jouissent du restavèk.
-
- Révolution antiraciste
Le racisme est une vision du règne animal. En tant que tel, il est aussi une vision de la place de l’homme dans le monde naturel ; il est conséquence d’une vision du monde des êtres de la nature. Toutefois, il a pris forme dans un contexte économique, de politique internationale, des relations euro-chrétiennes aux autres peuples. Ce que les historiens ont appelé à tort la « découverte » fut un événement qui produisit un avant et un après dans l’historicité mondiale. Ce fut l’enrichissement des Européens, l’expansion du christianisme ou la tentative d’une uniformisation des sociétés à une unique vision de l’histoire, la théologie chrétienne de la rédemption par un sauveur en impliquant la mise au pas des autres peuples ou sociétés à cette vision globalisée du monde.
La théologie chrétienne de l’histoire n’a pas apporté la seule vision globalisée, elle a informé l’identité européenne qui se définit désormais comme « unique » voie de salut et de civilisation. Pris dans la logique théologique du salut, l’Euro-chrétien se dresse en modèle d’humanité et organise toute l’espèce humaine en fonction de son ordre hiérarchique. Le racisme est la mise en œuvre de cette anthropologie théologique où l’euro-chrétien tient lieu et place de l’Être. De l’Être entendu comme le plus d’Être. Lié à la vision théologique de l’histoire et la hiérarchie des êtres, elle aussi imitant la hiérarchie des êtres célestes (de la mystique chrétienne), le racisme est une vision de l’homme qui établit une échelle d’êtres humains allant du supérieur à l’inférieur déclaré ou inversement.
Il devient un mode de justification mis en place pour fonder l’exploitation capitaliste. Toutes les altérités non européennes ou non chrétiennes sont infériorisées, et placées de l’autre côté de la chaîne capitaliste de production. Elles sont exploitées, asservies et abruties au nom de la supériorisation inventée de toutes pièces.
Dans cette dynamique anthropologique, l’Africain est relégué au bas de la hiérarchie. Il est confondu aux singes, on doute de son humanité. On est tous persuadés de l’utilité de sa force pour le travail éreintant. Ainsi, il est réduit en esclavage. L’asservissement du noir et son infériorisation trouvent des échos dans les discours théologiques et philosophiques. Théologie et philosophie constituant les deux cadres de la pensée officielle fondent le racisme antinoir et justifient l’esclavage des Africains.
Certainement, en renversant l’ordre raciste qui a donné sens à l’esclavage des noirs, la révolution semble revêtir une portée contre le racisme occidental. Une bande de Noirs se sont battus pour restaurer leur dignité humaine et en sont venus à se défaire de ce système déshumanisant. Du point de vue macro-logique, il n’y a aucun doute à définir la révolution en termes de déconstruction de l’ordre anthropologique raciste. Mais en changeant de focal ou de point de vue, il est possible de se demander quelle est la pertinence de cet antiracisme, quand toute l’histoire culturelle et politique postrévolutionnaire est structurée par des pratiques racistes contre les survivances africaines. Le Concordat a eu pour mission de raturer les survivances africaines en inculquant aux gens frustes, les paysans, les rudimentaires de la civilisation européenne, particulièrement française. Ce même racisme a inspiré l’élaboration du système éducatif proposant deux régimes d’école, l’un urbain, l’autre rural. C’est de cette vision duale que les actes de naissance sont d’un côté sont libellés de la désignation de citadins pour ceux qui sont nés en ville, de paysans pour ceux qui sont nés à la campagne. Comme, autrefois, le pouvoir politique haïtien a l’épiderme lactifié par son appartenance aux valences culturelles ou biologiques occidentales. Un racisme que le sociologue Laënnec Hurbon a appelé, dans un article consacré à la situation des Haïtiens d’origine paysanne aux Antilles françaises, le « sous-racisme », hante le pouvoir politique haïtien. Le « gouvernement de doublure » n’est que le malaise qu’ont éprouvé les hommes de pouvoir face à ce racisme que la société haïtienne majoritairement composée de gens à la peau foncée supportait difficilement. Il s’agit d’une stratégie qui consiste à déployer le pouvoir par personnes de couleur interposées. On interpose entre la majorité des gens de couleur noire des politiciens de leur appartenance épidermique. Souligné-je que la doublure ne laisse pas moins des marges de manœuvre aux politiciens noirs, qui, par mulâtrisation, se virent plus proches des vrais détenteurs du pouvoir politique et économique, blancs ou mulâtres que du grand nombre de miséreux noirs. Ils adoptent le même cadre philosophique, anthropologique d’altérisation ou d’altération des différents qui sont méprisés, exploités, abrutis et bestialisés dans des conditions de vie inacceptables.
Il est difficile de soutenir jusqu’au bout l’aspect antiraciste de la révolution quand toutes les indications politiques, économiques, culturelles sont arrimées sur le racisme euro-chrétien antinoir. Évidemment, par une pirouette théorique, on peut se contenter que l’esprit de la révolution reste entier et semble inspirer les mouvements de revendication qui se voient constamment en butte avec des fantômes. En attendant de se rabattre au simple fait de la révolution toujours en chemin, il est important de penser les conditions des impasses dans lesquelles elle ne cesse de se perdre.
-
- Révolution anti-esclavagiste
L’esclavagisme est un système d’expropriation, d’exploitation et de dissolution du corps propre. En faisant de l’esclave un bien meuble, il est le dispositif d’altér(is)ation par lequel le corps de l’esclave devient la propriété du colon attachée à la machinerie coloniale comme une pièce parmi d’autres. La mise en place du capitalisme et du racisme n’est que le montage d’une machinerie de différenciation, qui vise à produire des différents propres à la servitude, à l’exploitation et à la jouissance du colon. Comprendre l’esclavage, c’est lier son institution dans le prolongement des institutions capitalistes et racistes qui sont autant de manières théoriques d’inventer une altérité serve, destinée au travail épuisant, à l’épuisement et à la mise à mort.
L’esclavage est la mise en pratique d’une vision du monde où les noirs n’étaient que moyens d’enrichissement du blanc. Il a pris forme dans la traite négrière, la traversée qui représentent des manières de métamorphoser l’Africain en bien meuble, en bête de somme, en pure corporéité à laquelle on cherche à enlever la capacité éthique de défendre la dignité et la vie bonne. La traversée le met en présence du processus de sa déchéance, de sa déshumanisation manifestée dans la cale puante du bateau. L’estampage traduit une étape supplémentaire dans cette alchimie de la déshumanisation. Le changement de son nom, sa conversion dans le christianisme manifeste le rituel mis en place pour cette œuvre de zombification, d’effacement de la volonté, de la capacité à prendre distance à sa situation servile pour défendre la vie bonne ou digne.
L’invisibilisation qui couvre les esclaves dit qu’ils ne sont pas comptés dans la communauté des hommes blancs. Même si le maître viole, violente la négresse, il a très peu d’estime pour elle. L’esclavage est le dispositif de la vie nue soumise à la violence crue du maître tout-puissant. La vie de l’esclave, dans le système d’exploitation esclavagiste, n’est couverte d’aucune protection face à l’avarice du colon inspirée par le profit, l’enrichissement et la haine de l’autre, noir. Dans ce système, le maître consomme, consume la chair de l’esclave. C’est un ordre de jouissance vampiriste, qui fait de la chair de l’esclave, un pur réservoir d’énergie pour l’entretien de la vie du maître. En ce sens, l’esclavage est un dispositif de zombification.
À la révolution, du point de vue de l’imaginaire, les héritiers des esclaves, les paysans, n’ont pas cessé de vivre l’indifférence des responsables politiques et économiques de la nouvelle communauté politique. Ils sont dépecés par les taxes, par les expropriations des notables et les conditions épuisantes de travail. Le système judiciaire crée peu d’espace de représentation pour eux. Le système judiciaire duquel il est écarté est représenté comme le lieu de l’ultime inimitié. L’État haïtien n’a jamais jugé bon de lui fournir des actes de naissance qui, par sa double formulation, une pour le citadin, l’autre pour le paysan, marquent l’insistance de l’imaginaire esclavagiste qui ne tient qu’à jouir jusqu’à ce que mort s’ensuive du paysan.
Un autre aspect de la persistance de ce système de travail servile est mis en valeur dans les récits sur la zombification. Selon Franck Degoul, la zombification traduit les étapes de la traite, qui vont de la captivité à l’esclavage en passant par les entrepôts où l’on gardait les Africains pris en captivité[viii]. En ce sens, la zombification, comme mémoire somatique de l’esclavage, dit bien l’aspect déshumanisant de l’esclavage et sa nature vampiriste, cannibale. Qu’elle se constitue de récits sans consistance réelle dans la vie sociale, il est clair que l’imaginaire de la zombification diffuse des états émotionnels, des compréhensions qui risquent de prendre corps dans la chair du social. La zombification, pratiques de morts-vivants ou discours de ces pratiques, témoigne d’une expérience historique et anthropologique, celle de l’esclavage. Elle établit un trait d’union entre le passé-pratique colonial et sa persistance dans le corps, la mémoire et le présent de la révolution. C’est que la révolution n’a pas mis fin aux pratiques serviles, qui se sont transmuées en légendes ou pratiques sociales, politiques dérivées. Aujourd’hui particulièrement, la gestion politique de la vie de la majorité des citoyens haïtiens réduits à la seule matérialité biologique, affamée, assassinée sans aucune indignation des dirigeants dit que la vie nue et exposée à la jouissance vorace des responsables blancs ou blanchis force de suspecter cette thèse de la radicalité de la révolution, qui a l’air d’une berceuse : elle ne rend pas attentif au drame de la répétition. Du moins, les arguments mobilisés pour décrire cette radicalité pèchent par manque de rigueur dans la construction d’une part du capitalisme, du racisme, de l’esclavage, d’autre part, du manque de prise en compte de la sédimentation dans l’expérience historique.
Je m’oriente sur une autre voie, celle de l’anthropologie de l’imaginaire qui prend en compte les formes de sédimentation et qui s’intéresse à la tension entre sédimentation et innovation. La voie que j’emprunte entend conduire à la conclusion que la force radicale de la révolution haïtienne est en apparence dans le projet du travail pour soi. Mais, en réalité, ce serait là qu’une demi-concession que je ferais, puisqu’en fin de compte, le travail pour soi se révèle de marquer une coupure radicale entre le système d’exploitation esclavagiste et le système de la petite propriété des paysans. Il s’est heurté à la persistance du paradigme capitaliste du travail pour autrui. Avant toute démonstration, je précise ma compréhension du concept de travail dans la tradition philosophique et théologique de l’Occident.
- Du travail dans la tradition philosophique et théologique
Le travail, concept central de la philosophie sociale d’inspiration marxiste, a occupé une place centrale dans la compréhension du capitalisme. En effet, cette association du travail et du capitalisme prend sens par la valorisation qu’a connue le travail avec l’émergence du capitalisme contre une acception chrétienne qui avait représenté le travail comme châtiment, tripalium.
Avant la naissance du capitalisme moderne, les pensées grecque et chrétienne, à l’exception des romains où le travail a reçu des sens divers faisant état de plusieurs activités humaines, ont présenté le travail comme une activité de déchéance liée à la nécessité biologique (pour les Grecs, et cette position sera reprise par Arendt) ou au châtiment divin lié au péché d’Adam. Le travail était donc la manifestation de la condition de l’homme déchu ou pris aux nécessités biologiques qu’il partage avec les animaux. Deux caractéristiques qui n’honorent pas l’homme dans sa condition intellectuelle et morale.
Le capitalisme naissant a changé la perspective. Au cours de ce changement de compréhension, à côté du travail, les figures du pauvre, du mendiant ou du vagabond ont aussi subi une réévaluation. Le travail étant devenu une nouvelle valeur, le capitalisme invente la nouvelle réalité de main-d’œuvre. Toutes anciennes pratiques qui entravent la constitution de ce nouveau corps d’hommes, les travailleurs, sont critiquées et policièrement chassées et réprimées. Il y a donc ce premier élément historique à prendre en compte dans l’institution capitaliste du travail et le sens de la relation que le marxisme établit entre capitalisme et travail.
La philosophie hégélienne a toutefois théorisé le travail d’un point de vue plus fondamental en lui attribuant une fonction expressément humaine et une force de libération de l’homme aux déterminations de la nature ou d’humanisation de la nature. Le travail est compris donc comme une activité produite par une conscience qui le conçoit préalablement avant sa mise en œuvre. On retrouve ce même aspect de la conscience et d’humanisation du travail chez Marx qui a enrichi sa conception du travail d’une sociologie du capitalisme en prenant en compte l’expérience réelle d’organisation du travail dans les usines, le capital et la fore de production du « prolétaire » qui le rendent possible.
La critique marxienne du travail prend son appui philosophique de la conviction que le travail permet à l’homme de s’humaniser et d’humaniser la nature. Il est le moyen par lequel l’homme crée un environnement moins hostile qui lui permet de vivre avec une certaine quiétude. Le système de travail mis en place par le capitalisme déroge à ce principe uniquement en refusant aux travailleurs de se réaliser par l’appropriation d’une partie du résultat de leur force de travail. N’étant pas payé justement du travail fourni du fait que le patron engrange la plus-value qu’il peut réinvestir tout en accroissant ses profits, le travailleur devient aliéné ; une partie de son travail ou de sa force de travail est confisquée. Il devient étranger à son travail et encourt le risque de se perdre, c’est-à-dire d’avoir une partie de lui captée par le capitaliste. Il se perd, le travail rate en conséquence sa vocation d’humanisation. Au contraire, l’aliénation produisant la dépossession évide le travailleur de son estime-de-soi, de son sentiment d’être en faisant l’expérience de son inutilité. Il devient l’« homme jetable ».
Un angle important de la critique de Marx retient mon attention. Marx présente une critique systématique du régime de travail mis place par le capitalisme. De cette critique, je dégage une équation qui fait ressortir une catégorie centrale du travail capitaliste et qui nourrit la pertinence de la critique marxienne. La force perturbatrice du travail dans le capitalisme est dans le mode de relation qui est établie à l’autre ; cette relation prend la forme du vampirisme. Dans le capitalisme, on travaille pour autrui et par autrui. Plusieurs enjeux sont à dégager de cette thèse. D’une part, dans ce type de travail le travailleur cesse de penser le sens de son travail puisqu’il n’a pas la clé du sens du travail qu’il effectue. Toute la dimension de conscience qui a caractérisé le travail chez Hegel ou Marx est étouffée ou subtilisée par le patron. D’autre part, autant que le travail favorise la réalisation de soi, l’appropriation du sens du travail par le patron constitue le nœud de la dépossession de soi. Dans la mesure que le sens renvoie au sentiment de soi, à son sentiment d’être capable, ce que j’appelle souvent la capabilité, le travail perd la relation à soi-même qui libère les énergies émancipatrices de soi. À force de se faire vampiriser le travailleur perd de son énergie vitale, de sa force d’être qui devrait se renforcer dans un travail à relation symétrique ou un travail pour soi. Enfin, évider de sa substance affective, le travailleur devient un être usé que le système, dans les institutions d’assistance sociale ou de solidarité d’hommes de précarité partagée, cherche à se corriger. Il est, par ailleurs, clair que l’assistance sociale ne peut restituer à quiconque l’estime de soi qu’un travail valorisé propose.
Marx apporte une terminologie stimulante pour décrire la condition d’existence des travailleurs. En rêvant de la fin du travail, il décrit de manière théorique ce que les esclaves ont mis passablement en forme dans la société haïtienne et que les sociologues et anthropologues ont désigné par le communautarisme égalitaire, le combitisme. Dans tous ces cas, on retrouve une tendance à refuser le travail pour les autres, et à travailler avec les autres. Vu que le travail a été pensé comme un processus de perte du corps vivant, du corps-propre de l’esclave, sa restitution à partir de la modalité du soi propre marque un renversement qui aurait pour sens l’institution du corps revitalisé ayant retrouvé du sens propre. Je propose cette perspective, celle que le travail pour soi permet de se restituer un corps-propre et faire l’expérience de sa capabilité. Pourtant, cette nouvelle perspective rencontre une difficulté sérieuse, qu’il faut surmonter pour désentraver la Révolution haïtienne de la lecture marxisante insuffisante et incomplète. La difficulté nouvelle consiste penser la capacité du travail pour soi à constituer une communauté politique, à instituer un monde commun.
Hannah Arendt montre comment la modernité occidentale a produit un renversement entre « vie contemplative » qui caractérisait la vie des Anciens et la « vie active » des Modernes. De ce constat principal, elle déduit que le travail, considéré comme une activité qui répond à la nécessité biologique et qui est exécutée dans la famille, sphère privée, activité domestique, a des conséquences importantes sur la vie politique moderne, sur la constitution d’un monde commun. Au regard de ce principe théorique, Arendt comprend que Marx n’a pas compris l’impossibilité du travail de faire advenir une véritable communauté politique. C’est un point de vue qui intéresse à plusieurs points de vue ma présente réflexion. D’abord, il inspire l’idée que l’importance accordée au travail pour soi par la pensée critique haïtienne l’a rendue incapable de penser la politique comme institution d’un monde commun. Ensuite, le spectre du travail étant présent dans la société haïtienne sous la forme du travail pour soi, il permet de comprendre comment cette critique rabat l’expérience politique à des rythmiques domestiques, à des réflexes de vie privée. Enfin, il force à changer de paradigme théorique en ouvrant la voie à une nouvelle manière d’interpréter la révolution haïtienne : s’il y a eu révolution, il faut la formuler dans les présuppositions des revendications. Par exemple, en revendiquant la terre les esclaves ont eu besoin de travailler pour eux-mêmes. Ils ont voulu récupérer les conditions de l’expérience du propre, de leur corps avec leur capabilité. Ainsi en se battant contre le système esclavagiste, style de vie domestique, les révolutionnaires se sont battus pour l’avènement de la vie politique, non de la vie atomisée, mais de la vie à plusieurs et de la constitution d’un monde commun. Avant d’arriver à ce point, je présenterai le sens du travail pour soi, considérée ici comme la première étape de la révolution que l’historiographie haïtienne n’a pas su repérer pour s’être enfermée dans les lieux communs du marxisme.
Dr Edelyn DORISMOND
Professeur de philosophie au Campus Henry Christophe de Limonade -UEH
Directeur du comité scientifique de CAEC
Responsable de l'axe 2 du laboratoire LADIREP.
[i] Jean Waddimir Gustinvil, La révolution servile et l’énigme du retour, Port-au-Prince, Presses de l’Université d’État d’Haïti, 2022. La thèse centrale de l’auteur, qui pense que l’« esprit » de la Révolution se voit constamment entravé par ses « fantômes », se trouve reformulée à la fin par la tension entre « esprit » et « fantômes ». Cette tension que j’avais signalée depuis la rédaction de ma thèse de doctorat (2010) ne cesse de m’interpeller. J’ai esquissé ailleurs plusieurs tentatives de son développement. C’est justement l’objet de mon article paru sur mon blog sur la décolonialisation par la réécriture de la « Référence » coloniale occidentale. Je souligne en fin de compte que le point de vue de Gustinvil conduit à une mystique de la Révolution par la fidélité qu’il invite à entretenir à l’esprit de la Révolution. Cette contemplation fidèle de l’esprit, toujours présente, diminue la tension entre sédimentation et créativité, qui ne cesse d’embarrasser l’auteur.
[ii] J’entends par scène l’espace d’irruption de l’action révolutionnaire où se jouent les contradictions et les perspectives. Cette expression a fait l’objet d’un article chez Jacques Rancière qui pense que la révolution comprend des scènes qui sont autant de perspectives sur la révolution. Je suis plus proche du concept de scène, tel qu’il est proposé par Pierre Legendre. Cette conception lie scène, dramaturgie et théâtralité, où il y a des spectateurs et des acteurs, qui n’occupent pas les mêmes places sur la scène de l’action sociale ou politique ; ils se trouvent sur la scène en train de jouer d’autres scènes. Donc une scène principale crée les conditions de la constitution de toutes les autres qui ne peuvent pas être compréhensibles, mêmes révolutionnaires, sans la textualité sociale primordiale. La scène révolutionnaire est celle de la théâtralité de l’action qui est vue et jouée selon une dramaturgie déjà mise en place par la Référence. Et cela concerne le concept de liberté-propriété défendu par les auteurs de la révolution comme prometteuse de la liberté, sans prendre le temps de préciser que cette liberté est liée à d’autres attributs à côté de la propriété, dont celui du pouvoir de penser, de commencer.
[iii] Edelyn Dorismond, « Critique caribéenne de la raison capitaliste. Le « fantôme » de la société haïtienne et la philosophie comme exorcisme», www.edelyndorismond.blogspot.com.
[iv] Paul Virilio, Vitesse et politique, Paris, Galilée, 1977.
[v] Cornélius Castoriadis, La montée de l’insignifiance. Les carrefours du labyrinthe IV, Paris, Seuil, 1996.
[vi] Bertrand Ogilvie, L’homme jetable. Sur l’exterminisme et la violence extrême, Paris, Amsterdam, 2012.
[vii] Edelyn Dorismond, « Comment nommer ce qui se vit en Haïti. Conceptualiser la fatigue haïtienne », in Ronald Jean-Jacques, Yves Lecomte (dir.) : La dépression en Haïti, Revue haïtienne de santé mentale, n° 8, 29-42.
[viii] Franck Degoul, « Du passé faisons table d’hôte. Le mode d’entretien du zombi dans l’imaginaire haïtien et ses filiations historiques », in Haïti, face cachée, Ethnologies, vol. 28, n° 1, 2006, p. 241-278.