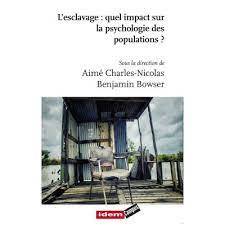Nous savons tous l’importance qu’a eue dans l’histoire, et plus encore dans notre histoire, la traite et la mise en esclavage de dizaines de millions d’Africains ; aussi sommes-nous bien conscients qu’un tel événement ne pouvait pas ne pas laisser de traces, non seulement chez ceux qui en furent victimes, mais pis encore chez leurs descendants, et ce, même après des siècles et des siècles, et un nombre encore plus grand de générations. Tout dans notre vie nous le rappelle suffisamment pour que nous ne puissions pas l’oublier. Reste à savoir si nos gènes en ont gardé la mémoire. C’est à ce délicat problème de génétique appliquée que des gens de science et de culture, réunis ces derniers temps en colloque en Martinique et Guadeloupe, ont tenté de répondre. S’il existe, sur l’esclavage et ses conséquences, quantité d’ouvrages, plus savants et plus documentés les uns que les autres, peu d’entre eux s’étaient attaqués à ce délicat problème de notre infortunée hérédité ; sans doute parce que la solution en est particulièrement difficile, sans doute aussi parce qu’on n’avait pas (ou trop peu) de moyens d’investigation en ce domaine pour proposer une réponse scientifique avec un degré suffisant de certitude.
Voici donc que vient à point nommé, dans le cadre de la Décennie des Nations unies pour les Afro-descendants : 2015-2024, un livre collectif publié sous la double direction de MM. Aimé Charles-Nicolas et Benjamin Bowser : L’esclavage : quel impact sur la psychologie des populations ? Éditions Idem, 2018.
Ce gros ouvrage de plus de 550 pages se présente comme un assemblage de contributions de plusieurs spécialistes, au premier rang desquels le professeur Aimé Charles-Nicolas, professeur de médecine, psychologie médicale et psychiatrie à la Faculté de Médecine des Antilles [françaises], spécialisé en addictologie, fondateur et président de l’association FIRST (Formation intervention recherche sur le sida et les toxicomanies), auteur de plusieurs ouvrages spécialisés et estimés ; Benjamin Bowser, professeur émérite de sociologie à la California State University, et à la Cornell University, aux États-Unis, lui aussi auteur de plusieurs ouvrages sur « le fardeau et les stigmates de l’esclavage ».
Ont à leur tour et successivement collaboré à la réalisation de l’ouvrage :
- François Sauvagnat, professeur de psychopathologie à l’Université de Rennes ;
- Ariane Giacobino, généticienne, agrégée à la Faculté de médecine de l’Université de Genève, membre des sociétés suisse, européenne et américaine de génétique humaine;
- Bernard Dossa, président du groupe universitaire de recherche en histoire et culture du Bénin ;
- Jean-Pierre Sainton, professeur d’histoire à l’Université des Antilles ;
- Frederick W. Hickling, professeur émérite de l’université des West Indies at Mona, pionnier de la thérapie culturelle ;
- Andréa Maris Campos Guerra, professeur de psychologie à l’université fédérale de Minas Gerais ;
- Ana Carolina Barbosa Cadar, psychologue et chercheuse en sciences humaines appliquées à l’université fédérale de Minas Gerais et de Rennes ;
- Elma Wittaker-Augustine, psychologue clinicienne ;
- Alexandra Escobar-Puche, anthropologue colombienne ;
- Bernard Yawching, journaliste et écrivain trinidadien ;
- Judite Blanc, professeur en psychologie à l’université d’État d’Haïti ;
- Edwin J. Nichols, philosophe et psychologue ;
- Gilbert Pago, professeur d’histoire en Martinique ;
- Patrick Chamoiseau, écrivain martiniquais ;
- Jeanne Wiltord, psychanalyste martiniquaise ;
- Hebe Mattos, professeur à l’université fédérale de Fluminense, au Brésil ;
- Ali Moussa Iye, docteur en sciences politiques ;
- Jean-Pierre Luauté, psychiatre honoraire des hôpitaux ;
- Myriam Cottias, historienne, directrice du Centre International de Recherches sur les esclavages et post-esclavages.
Chacun de ces auteurs entreprend donc de chercher, non seulement dans notre comportement et notre idiosyncrasie, mais jusqu’au cœur de nos cellules, les indices les plus secrets de notre identité, apporte sa pierre à l’édifice, y fait état, selon ses compétences et son travail, des conclusions auxquelles il est parvenu et des perspectives qu’elles ouvrent à notre réflexion, voire à nos choix ou modes de vie. La grande diversité des contributeurs permet une grande richesse de points de vue et des expériences, car même si au départ le choc est le même, ses effets et les réactions qu’il suscite sont multiples et variés.
La première idée qui se manifeste, avec une insistance redoublée, est la spécificité du traumatisme causé par l’esclavage qui est d’autant plus intense qu’outre sa si longue durée et sa si grande ampleur qui lui font dépasser tous les autres chocs de même nature, il est provoqué intentionnellement. C’est en effet une règle en cette matière ; ainsi le viol occasionne jusqu’à 80% d’états de stress post traumatique contre seulement 5 à 10 % après une catastrophe naturelle ! Autre trait spécifique remarquable, l’entreprise de légitimation de ce forfait par la société coloniale ou post-coloniale, à travers des arguments justificatifs et des dispositions juridiques, renforcés par l’usage et la coutume, sans compter l’histoire officielle et le cadre de vie ! Tout concourt donc à une perpétuation « structurelle » du phénomène.
En réponse, il apparaît que les victimes ont, de leur côté, mis en place des mécanismes de lutte, de protection et de résistance, qui, outre la fuite, le marronnage et, de nos jours, l’exil, peuvent se décliner de la sorte :
- déni et le refoulement, tentative d’oubli et refus de diffusion ou de transmission (notamment aux enfants) ;
- solidarité (parfois lourde à assumer) entre les membres de la communauté ;
- retournement contre autrui (et surtout contre ses propres congénères) de la violence dont on est victime ;
- mise en place d’une contre-culture (musique, chants, contes, arts, littérature…), voire de toute une nouvelle organisation sociale ;
- résilience propre à surmonter le choc et à permettre une réhabilitation ;
- recours exacerbé au surnaturel et à la religion, dans l’intention de conclure un pacte avec la ou les divinités protectrices, éventuellement sanctionné par un sacrifice ;
- enfin, effet de rémanence, d’hérédité et atavisme prolongeant les effets de stimulus bien au-delà de la durée réelle du traumatisme, et même de la génération qui en a été directement affectée.
La deuxième idée structurante de cet ouvrage est qu’au-delà des aspects les plus visibles de cette blessure d’autres, tout aussi réelles, ne sont pas… ou à peine, perceptibles à l’œil nu. Il faut, pour les déceler, les connaissances du savant, l’expertise du spécialiste et, peut-être, la sagacité et la sensibilité particulière de celui qui en ressent encore dans sa chair la douloureuse cicatrice. Ne dit-on pas couramment : « Jété blyé, ranmasé sonjé ! », voire, plus explicitement parfois, « bay kou blyé, pòté mak sonjé ! » ?
Cette réalité multiforme est abondamment illustrée par toute une variété de données, de faits et de cas véridiques et vérifiables que les auteurs s’appliquent à rapporter et à passer au crible du témoignage, de l’analyse, de l’expérience et du regard rétrospectif quand ce n’est pas tout simplement à travers les souvenirs d’anciens esclaves ou de leur postérité ! D’où l’importance des historiens qui peuvent, à plusieurs siècles de distance, porter la voix de ceux qui ne sont plus là pour se faire entendre.
C’est ainsi que les plus versés d’entre eux dans les intimes tréfonds de la biologie ont mis en évidence la possibilité de modification de l’ADN d’un individu ou de son expression sous l’effet d’un traumatisme grave ou d’un stress particulièrement intense, faisant apparaître la possibilité et la haute probabilité d’une transmission intergénérationnelle desdites modifications et de leurs effets ; étude certes difficile à cause, entre autres, de l’influence de l’environnement dès la phase intra-utérine, comme de l’absence de normalité épigénétique ou encore en raison de l’impossibilité de se livrer à une vérification expérimentale à partir d’une répétition systématique du même processus. Néanmoins, ces conclusions semblent fortement corroborées par l’observation méthodique des captifs ou déportés africains, notamment du Dahomey, des survivants des camps de concentration nazis, de la guerre du Congo, de génocides comme ceux du Rwanda, et autres cas similaires.
Outre la transmission épigénétique, on observe aussi, par un phénomène d’assuétude, une fréquence anormale des conduites addictives ou suicidaires relayées ou amplifiées par un traitement réglementaire, administratif ou judiciaire de la société. On en voit, parmi tant d’autres, un exemple édifiant dans la politique de santé mentale en Jamaïque qui, longtemps, n’a visé principalement sinon exclusivement qu’à séquestrer ou contrôler les éléments de la population qui avaient des croyances ou des idéologies opposées aux intérêts du colonialisme britannique ou étaient censées constituer un danger pour l’État britannique, masquant cette intention réelle sous le prétexte de sa « mission civilisatrice » !
D’ailleurs les faits montrent à l’évidence que les défenseurs de l’ordre ancien ne désarment pas facilement et s’ingénient par tous les moyens à perpétuer l’état antérieur. On le voit notamment à la persistance du ou des préjugés de couleur et au maintien, y compris par des lois, de l’ordre social esclavagiste ou colonialiste et ce, même après l’abolition de la traite, de l’esclavage, du régime colonial et de la ségrégation raciale, y compris après la reconnaissance explicite, législative et constitutionnelle de l’égalité de tous les citoyens. Au reste, cette entreprise réactionnaire se voit soutenue, contre toute attente, même par la police et la justice, au mépris de leur mission qui devrait normalement les amener à faire respecter les nouvelles dispositions !
N’oublions pas que des « suprémacistes » blancs et leurs acolytes, complices, suppôts et supplétifs s’efforcent de rétablir un rapport directement hérité de l’époque coloniale et que les mouvements revendicatifs du monde noir militent avec acharnement pour obtenir réparation de ce crime et des dommages qu’il a générés. C’est dans ce contexte que le professeur Charles-Nicolas président de l’association régionale FIRST pour les Caraïbes, fort de ses propres recherches cliniques et s’appuyant sur les travaux récents de chercheurs tels Rachel Yehuda de l’Icahn School of Medicine à Mount Sinai, New York, et Michael Meany de l’université McGill au Canada, qui ont démontré l’implication des mécanismes épigénétiques dans les effets du stress transgénérationnel chez les survivants de l’holocauste et leur descendance, affirme à son tour la persistance dans les gènes des contemporains antillais et afro-américains des séquelles de ce traumatisme.
D’où, par induction et extension de ce schéma, toute une série de conséquences plus dommageables les unes que les autres dont le détail est énuméré au fil des apports de chacun des contributeurs. En particulier est évoqué, sous la plume de J. Blanc, le cas d’Haïti, dévastée par toutes sortes de cataclysmes naturels et outrageusement sinistrée à la suite de fléaux épouvantables, qui font passer au second plan les préoccupations d’ordre psychique et, d’une façon générale tout ce qui ne relève pas de la survie immédiate, malgré l’importance, la prégnance et l’urgence dans tant de domaines, de tous ses autres problèmes qui la maintiennent en état chronique de crise ou, comme dit J. Blanc, « d’agonie psychique ». Devant ce constat, certains (comme Louidor et Madhère, apparemment rejoints par J. Blanc) ont alors émis l’hypothèse que l’indifférence des Haïtiens à la saleté, l’ordure et l’insalubrité est une séquelle des conditions et modalités du transport transatlantique lors de la traite[1] !
À l’inverse de cet abandon et de ce renoncement, on observe, chez d’autres sujets, un désir de sublimation, allant jusqu’à l’héroïsme, au sacrifice ou à l’engagement religieux quasi masochiste. Dans ce dernier cas, on ne peut que déplorer que tant de courage, de vertu et d’abnégation soient ainsi dépensés en pure perte et que, malgré le poids écrasant de la réalité et l’aveuglante clarté de l’évidence, quelques-uns puissent encore imaginer que la croyance en Dieu pourrait, si peu que ce soit, être d’une aide quelconque dans la résolution des problèmes découlant, directement ou non, de la société coloniale et de ses rapports d’oppression. Il est en effet douteux et hautement improbable que l’aliénation religieuse puisse aider à guérir d’une aliénation qu’elle a grandement contribué à générer, quand elle n’en est pas à l’origine directe !
On voit donc, à travers ces exemples de « post-mémoire » (terme justifié par l’écart de plusieurs générations qui nous sépare des événements de référence), à quel point ce traumatisme de l’esclavage est fondateur de notre histoire et des rapports sociaux dans les populations afro-américaines ; et ce, même si, par la suite, il a été plus ou moins soigneusement, ou maladroitement, masqué, dissimulé, occulté. Ainsi au terme de la lecture de ce livre, outre l’agrément que nous aurons pu y goûter et les enseignements que nous aurons pu y trouver, nous aurons aussi à cœur d’y rechercher des pistes en vue mieux comprendre notre situation et peut-être même y trouverons-nous un tremplin offert à notre réflexion, voire à notre émancipation.
La solution, dès lors, ne saurait être dans les incantations. Il n’y aura pas à l’avenir, si seulement il y a jamais eu dans le passé, de Bois-Caïman ! Et, si loin que nous portions nos regards nous ne saurions apercevoir que des Crête-à-Pierrot et des Ravine-à-couleuvres ! Et dans ces combats incertains, nous ne pourrons véritablement compter que sur nous-mêmes. Certes l’UNESCO et quelques ONG sont disposées, quelquefois même de façon désintéressée, à nous apporter leur soutien dans le travail d’enseignement, d’éducation et de sauvegarde de la mémoire… ; certes, quelques figures de proue de l’intelligentsia internationale font preuve de généreuse solidarité (à moins qu’ils ne soient en proie à un complexe de culpabilité), mais c’est en priorité à nous qu’il appartient de prendre en mains les instruments de notre redressement et de notre progrès.
« C’est d’une remontée jamais vue que je parle, Messieurs ! »
[1] On se demande alors pourquoi il n’en serait pas de même dans les autres colonies dont l’approvisionnement en esclaves n’était en rien différent !
Clément Relouzat
Source : berrouet-oriol.com, 10 mai 2019