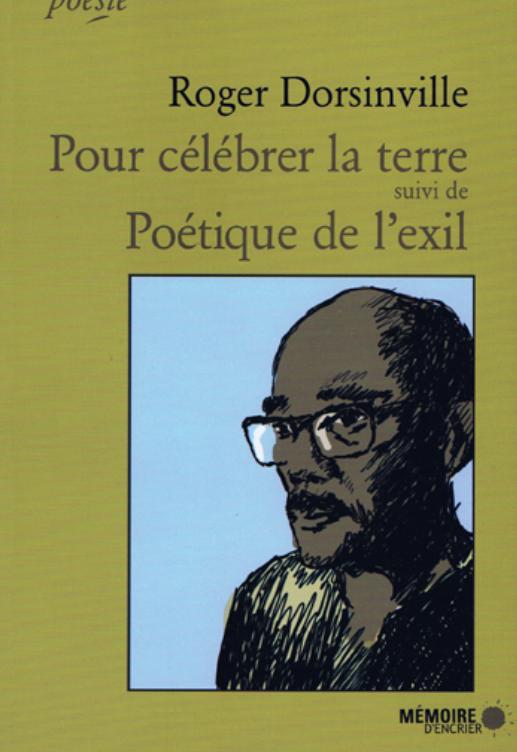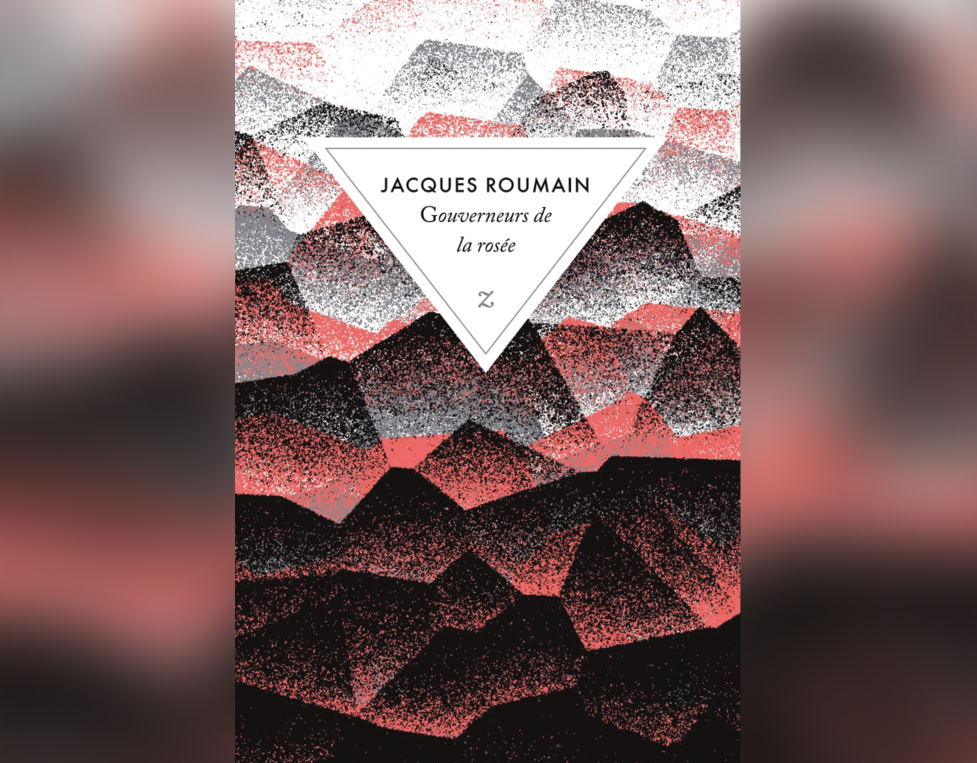Il marchait... cela faisait un bon moment. Les pas décidés et mesurés. Tournant son regard à de rares occasions afin de lire derrière soi la dernière ligne d’hommes et des saisons. Il scrutait et analysait tout pour mieux percer le secret des ruelles, savoir s’il n’y avait quelques de ces hommes au visage affreux qui le guettaient dans son dos ou dans un de ces coins. La peur au milieu des jambes. Il prit le détour au carrefour qui le conduisait habituellement vers le quartier et la solitude dont cet endroit ne se défait jamais depuis que les rues ont vécu sous la coupe réglée des truands. Pour qui la vie ne valait pas plus qu’une bouchée de pain. Pour envoyer habiter quatre pieds sous terre, un chrétien vivant. Il marchait... puis, il s’arrêta un instant.
L’après- midi coula sans peine sur la ville. Midi s’écoulait lentement. À travers les persiennes des maisons. Les secondes ainsi que les heures s’écoulèrent dans le silence le plus complet qui couvre les rues de ce dernier dimanche de Mars. Demain rappellera avril. Les gens, dans l’indifférence des jours qui courent, forment et cuisinent déjà le bon mensonge assaisonné de tous les ingrédients. Le gros poisson d’avril qu’on pêchera à la mer de toutes les imaginations, et que les gens débiteront, à toutes les portes, à pleins poumons, moisira peut-être au soir.
Haut comme le vent qui passe, témoin de la détresse quotidienne, le soleil trônant sur son siège doré, s’étalait dans sa gloire jaune, couronné de nuages et entouré de rayons. Midi s’enfuyait depuis quelques heures. L’astre renvoyait sur le sol ses légers rayons tels des flèches tirées d’un carquois immenses et infinies.
Lundi premier avril
Les rues étroites étaient à moitié désertes. Le soleil comme un rebelle pourchassaient les bêtes et les hommes. Tous se terrèrent dans leurs gîtes et tanières, et attendirent la chaude fureur passer. Un enragé d’une assemblée évangélique toute proche annonça sans preuve le retour de son Seigneur à qui veut l’entendre; vouant to de go à l’enfer éternel, les gens trop occupés à leurs affaires ou inattendus au message. L’enfer s’il existe tel dans le conte rapporté par le bonhomme, son pendant le plus vrai est ce foutu pays ou ce cruel soleil sur nos têtes et nos corps.
Sous un grand arbre, un groupe de jeunes tuent le temps. Jeu de cartes, quelques joints... et bouteilles de kleren pike à souhait. Ici la chaleur semble ne plus avoir une âme. Mais comment est-ce possible sous ce soleil amer comme la vie, que les jeunes s’y jettent ainsi les bras fous sans croire à une issue... La vie comme les vagues démontées de la mer laisse ici souvent une bosse fragile sur le dos des gens.
Le soleil essaimait ses rayons sur le macadam et les toits. Les dents enfoncées profondément dans les arbres.
****
Aujourd’hui c’est mieux qu’hier, même lorsque, sur la table, il n’y a plus de pain, balança Mariette Jules... Mais on a cette liberté sur notre bouche, la liberté de tourner notre langue sur tous les sujets, conclut la défenseure des droits humains, la langue bien fourchue.
"La Liberté est un bien joli mot! Je l’entends souvent dire. Mais, vous ne me croyez pas, lorsque je vous dis que je suis fatigué de cette liberté dessus-dessous qu’on se colle au dos, alors qu’on n’a pas quelques grains ou un bout de pain à porter à la bouche"... lança Marseau, enfilant la chemise sur son corps massif que le chômage a fini par broder d’amertume...
Marseau marcha depuis une dizaine de minutes, lorsqu’il tourna son regard pour admirer la jolie silhouette qui enjamba le carrefour perpendiculaire à la rue Charles Bel-Air. L’année 20.1 traversait le milieu du mois d’avril. Les jours ainsi que les secondes couraient lentement. On aurait dit qu’elle prenait son temps avant de s’envoler au pas de course. Marseau, tournant finalement son regard, poursuivit son chemin. Il entama le prochain carrefour qui, dans quelques minutes, devait le conduire chez son ami, le policier Fréro Dieujuste.
Personne ne viendra m’apprendre que la vie demeure meilleure comme ce chancre qui fleurit, ne pourrit l’existence ici. Je ne reviendrai pas de ce silence qui prend corps dans la ville. Avec tous ces corps étalés, la torse ou le crâne enfoncés d’une balle dans les rues et les carrefours de Port-au-Prince. On ne me fera point avaler la couleuvre du meilleur alors que le pire s’engraisse chaque jour dans le parfum grandissant du doute ou de la mort. Dites ce que vous voulez, vous me cassez assez les tympans lorsque vous rappelez que ce régime de père en fils a endeuillé le pays, la terre des hommes d’ici. Vous criez, et tonnez qu’ils ont commis le carnage, y ont installé la paix des cimetières. Ils ont fait creuser aux condamnés leurs propres tombeaux, et les torturés des camps de la mort... choisir leurs propres supplices...
Marseau poussa ses pas jusqu’à l’impasse Féquière où demeura Fréro. Le quartier ressemblait aux nombreux hubs de pauvres de la capitale et du pays avec la pauvreté comme une couronne de ronces et d’épines qui paraissait toujours gaie, florissante. Il y poussait sans doute plus d’épines que de roses chaque nuit. À l’image du délabrement dans lequel s’engraissa la ville. Le vide.
Mes deux premières décennies sur cette terre des Caraïbes, j’ai vu naître l’enfer dans les rues de ma ville. J’ai remarqué dans la fuite du jour monter quelque part l’arc-en-ciel de la honte, du précaire, la pauvreté prendre ici ses galons. J’ai souvent entendu dire que la vie fut de loin ce terreau englué dans la fange, ce bout infect où végète l’espérance. C’était moins un poème, jadis la vie ici. Mais pas ce grand désastre actuel, cette cruauté étalant ses tentacules à l’infini. Cette pieuvre aux mille ventouses qui aspire le sang, les souffles, les rêves et les folies de la ville.
Le jour entra dans sa moitié. Dehors, la clarté saignait. Blanche. Tel un tissu trop maculé de chlore. Le soleil renvoyait ses rayons sur les toits de la ville. Des branches de feu, tout à fait vraisemblables à regarder les grosses gouttes qui dégoulinaient, coulaient des visages. Et consumaient les toits de la Ville. La lumière du jour paraissait amère comme les privations sous lesquelles coulait le pays. Le jour se tissait d’abandon. La vie, on n’avait pas besoin de faire un poème tragique pour apprendre sous le soleil qu’elle était noire, terne. Un chancre à sa manière.
¤¤¤¤
J’ai entamé mes vingt ans sur ces notes amères, dissonantes, biscornues qui me trouent au plus profond de moi la petite fleur bleue de l’espérance. J’habite mal le jour ainsi que la voile de la nuit que je la sens si épaisse, qu’elle me pèse comme un couvercle. Ah! Dois-je maudire le manège qui a installé l’absence aux portes de la vie. Me faire de longues harangues, clouer au pilori le régime de ces hommes du début des années 1960 à la moitié des années 80, qui a muré la parole des rues... dans le silence…
Cinq-Six, le vieux du quartier, portait en lui cette habitude quand il rappelait d’un air songeur ces années d’autrefois. Autrefois, qui remonte là, au temps longtemps, où la vie rependait une odeur de jasmin. La vie coulait simple dans le bonheur des gens. Ce bonheur ne s’extériorisait point dans l’opulence, dans l’étalage de l’abondance, mais dans le respect de l’autre, même inconnu qui passait pour un improbable proche parent…
Des armes y circulaient, mais on gardait bien le contrôle, conclut Cinq-Six. Je ne sais pas s’il dit toute la vérité, ou offre le verre à moitié vide moitié rempli. Cacha-t-il, quelque chose aux jeunes pousses qui en avaient l’habitude de l’interroger en grand témoin de ce temps qui fut? J’avoue bien ce me fut une période inconnue… Cette parenthèse de vie, sous la papadocratie et le régime de son fils, demeure un temps que je n’ai pas vécu.
***
La sauce assaisonnée de tous les condiments de la mal-gouvernance. Du mal-être collectif. De l’insécurité ambiante qui gourd sauvagement les rues. Du kidnapping, du banditisme social et étatique dans laquelle bout et cuit ces vingt-sept mille kilomètres qui mouillent les pieds dans le bleu Caraïbe, du haut de ma vingtaine, je cloue et prends à faux- les gens n’ont jamais eu à humer ce parfum suant la mort et la désolation dans l’entracte de cette tragédie. Et le vent, et l’odeur de tous ces massacres. Si hier, n’était guère meilleur. Aujourd’hui coule bien pire. Que l’on me colle pas au cul, cette bourde qu’est la démocratie, cette forme de domination du peuple, importée dans les malles de l’Occident avec toutes les déformations qu’elle a connues ici.
Le vieux Cinq-Six a eu peut-être raison dans son récit. Même papa, dans la succession quotidienne des crimes et des crises, eut quelquefois attribué le bénéfice du doute à ce régime de père en fils. Lui, qui paraissait un opposant. Il était encore jeune au début des années 80 quand la barque de la « dictature» prenait l’eau de toute part. L’avenir comme une plante aux multiples fleurs à l’éclosion proche. L’abcès mûr a dû crever. Les écluses du barrage ont cédé. L’espoir bleu en des lendemains, qui portent la sève du progrès, gonflèrent le cœur des villes. Papa, les yeux criblés d’espérance, y aurait sans doute laissé sa vie. Peut-être, aujourd’hui, je ne courrais pas dans les rues de cette ville de Port-au-Prince, « cette grosse pute mal lavée qui prend son air de ville obèse» dans Les dits du fou de l’île.
Quelques têtes de faux culs, de démons, démocrates à la glu bavante, me colleront l’étiquette du panégyrique de ce régime de père en fils dont je n’absous point de ses crimes. Quelquefois, dans les envolées de rage qui coulent à la radio, j’entends rapporter comme une litanie infinie le spectacle de ces forfaits, des tortures à Fort-Dimanche, au Pénitencier, où dans ces casernes qui portent l’auguste nom du Fondateur de la patrie. Ils n’auront pas le culot, ce mâle courage de dénoncer le bazar qui, depuis, y court dans la ville. Ces cas d’assassinat que les rêves ont plein les bras. Ces bruits de massacres, ces rumeurs de tueries prochaines que les gangs fédérés accompliront au nom du Président. Mes deux décennies dans la vie m’ont laissé le goût sans doute que le meilleur avait longtemps fui. Ici, le parfum qu’il y reste ne demeure que l’odeur des volutes et des massacres à la pelle. La Scierie, La Saline, Carrefour-Feuilles et Bel-Air...
Quelques-uns de mes potes partagent aussi le mal du présent. Ils croient - peut-être, ont-ils raison- qu’ils sont venus trop tard. Ils empoignent mal l’espérance. Ils habitent dans une peau inconnue, chargée de toute la douleur, de toute la malchance d’être née sur une terre où on leur a volé sans crier garde : enfance, adolescence et leur début dans l’âge adulte. Le doute, en fait, a gagné toute sa place dans la parole des gens.
***
J’ai lu dans le regard des villes le vide remplir le regard terne des gens. L’absence trop fleurir. Les mots perdent leur charge de symboles. Tristement, j’ai regardé la vie s’éloigner de nos rivages. Et la mort gagnée s’installe dans nos quartiers. Un à un. Un quartier après l’autre. Plus de jeux, plus d’enfance. Nous avons grandi sans avoir savouré notre enfance, entre les billes et les cerfs-volants, entre le bleu frais de la mer qui miroite encore à quelques pas entre le boulevard Harry Truman et le Quai Colomb.
***
On comptait mal toutes ces armes. Ces armes qui nous enlèvent parfois cette misérable vie qui palpite sous la peau, et troublent -comme s’il nous n’était plus permis- le sommeil. Ces tirs nourris dans leurs folies meurtrières qui, à défaut de nous couper le souffle, font naître quelques fils blancs dans la marre noircie de notre chevelure. Il y a toutes ces rafales qui nous font tôt vieillir. Que la vie est amère dans nos rues!
Que l’on ne vient pas me gaver, semer en moi le doute, dire qu’aujourd’hui ne possède pas cette odeur du pire ! Cette parenthèse vécue, ce régime de père en fils a certes sa part dans la déroute. Mais, en ces temps-là, la ville ne s’enfonçait pas dans cette anomie. L’on dira c’était bien une paix de cimetière. Mais cette peur semée qui nous chasse dans les rues comme du vulgaire gibier, de quel nom la nommer?
Quand on habite un pays, on ne le fait pas pour attraper la mort au bout du compte. Quoique, bien un jour, la mort doit advenir. Ce n’est moins un polichinelle. On ne part pas certainement la débusquer dans son coin. Fermer la porte à la mort, le plus simple c’est de ne pas se donner la peine de naître!
¤¤¤¤
Ses pas avalaient chaque bout de centimètres de la route. Il s’arrêta un moment. Puis, quelque instant, après, il reprit le chemin. Retrouvera-t-il Fréro ? Mais il tenait encore... L’ atmosphère des rues était pleine de cris, de bruits et d’autres nuisances sonores qui muaient la vie dans les artères de la ville en une espèce de capharnaüm. Mais le citoyen vit ici comme bon lui semble ! Et ce qu’il reste de l’État laisse *brasser ce qu’il y a d’homme ou de citoyenneté ici. De s’en sortir comme le plus raffiné des coquins. Que le plus larron cherche à tondre jusqu’ au sang le citoyen mouton ! Cela ne constitue guère leurs soucis. Depuis la Guinée, les nègres trompent leurs semblables. Les autorités, elles ne casseront pour rien l’ambiance, cette symphonie trop heureuse. Que chacun cherche à tirer leur épingle de cette gaguère, quitte à sucer jusqu’à la moelle de ses compatriotes.
Il attaqua le dernier détour. Une rivière de sueur brûlante courait de la petite vallée creusée de sa colonne vertébrale. Le visage dégoulinant. Il essuya avec la paume droite, son visage. Le tissu du t-shirt vert pomme trempée lui colla sur la cire noire de sa peau.
Un vent sec jeta son haleine chaude sur la ville. À quelques mètres du prochain carrefour, une masse informe juchée sur un tas d’immondices. Une grande colonie de mouches bourdonnantes tournent, virevoltent et s’envolent. Des flaques d’eau noirâtres parsèment le macadam. Une odeur fétide verrouille l’air frais. Une fumée terne où s’envolent des volutes grises et noires parfume la rue de dioxyde de carbone. L’homme bute sur une découverte étrange. Le corps et le visage lui parurent familiers. Cette paire de lèvres ouvertes. Les pectoraux aux muscles détendus. Ce nez épaté et massif lui rappelle bien quelqu’un. Il s’approche de plus près. Le corps inerte gisait sur un pan du monticule de déchets. Deux impacts de douilles logées dans le crâne. Un autre dans le thorax côté droit…
Marseau venait retrouver le corps ensanglanté et sans vie de son ami Fréro dans une décharge improvisée de la ville.
James Saint Simon