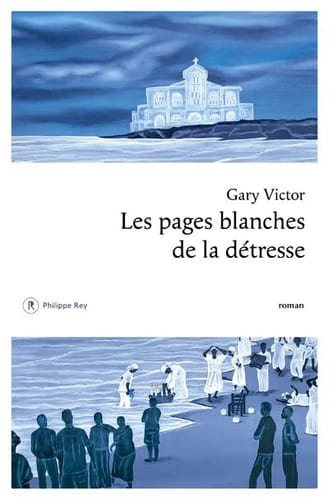Chaque jour un peu plus, quand j’écoute la radio, je suffoque de colère et de honte, mais d’abord de cette douleur permanente qu’inspire la souffrance de ceux qui subissent directement dans leur chair ou dans leurs affections proches notre situation d’otages. Une rage d’impuissance m’étreint en constatant comment la défaite et la reddition sur le terrain s’accompagnent de plus en plus, dans les discours, d’une forme contagieuse et pernicieuse de capitulation mentale et de soumission inconsciente à la volonté de nos bourreaux. Même chez des intervenants peu suspects de sympathie pour eux.
En effet quoi de plus banal, aujourd’hui, en début de journée que la concurrence que se font sur les ondes la prière du matin et « la météo des gangs » ? Des équipes de dévoués et courageux informateurs y dépeignent le visage des rues et indiquent les trajets à éviter ou à privilégier, aussi naturellement qu’ailleurs on suggère de se munir de parapluie ou d’imperméable par temps pluvieux. La chronique principale des différents journaux diffusés n’est-elle pas celle des ravages de l’insécurité ? Triste litanie d’actes criminels et liste toujours ouverte des victimes de la veille, de la nuit et des premiers moments du jour naissant. Qui aujourd’hui sort de chez lui ou voit sortir un des siens sans être étreint par une forme de peur plus ou moins bien surmontée ou refoulée ? Qui se sent en paix parce que rentré dans l’espace clos de sa résidence depuis que des gens sont victimes de kidnapping à leur domicile même ?
Après des semaines de tergiversations et d’innombrables coquetteries de langage, la plupart des intervenants médiatisés ont fini par désigner par son nom la situation que traverse notre pays : une guerre menée par de puissants groupes armés contre la société haïtienne dans ses différentes composantes de classes, contre les fondements de son économie et contre ce qui subsiste des institutions de l’État ou de la société civile censées la structurer et nous organiser en nation. Dans cette guerre non déclarée, les corps légalement constitués (PNH et FAD’H) ont étalé leur dénuement en ressources humaines et en équipement, et donc leur impuissance. Néanmoins, c’est un progrès conceptuel de cesser de confondre cet état de belligérance lié à la grande criminalité économico-politique et des formes de délinquance plus ordinaires favorisées par le terreau de la misère dans les zones défavorisées. Ceci devrait permettre de mieux ajuster la recherche de solutions adéquates.
N’ayons pas peur des mots. Si nous pouvons encore ne pas perdre totalement cette guerre__ à condition de choisir de résister et de la poursuivre__ nous avons déjà perdu la plupart des batailles menées. D’abord celle du contrôle et de la sécurisation de l’espace national : inexistence des frontières maritimes, extrême porosité de celles aériennes et terrestres. Les gangs armés étendent leurs conquêtes territoriales, notamment dans le département de l’Artibonite, les régions de Cabaret et de l’Arcahaie, ainsi que dans les quartiers de la périphérie de Pétionville et de Port-au-Prince, cette capitale assiégée et infiltrée, autour de laquelle l’étau se resserre pour produire à terme l’étranglement et l’asphyxie. Les gangs en contrôlent tous les accès, prélèvent des droits de passage sur les routes nationales et des impôts sur les marchés. Silencieusement, un transfert des pouvoirs régaliens et de différents attributs de souveraineté s’opère, au détriment de l’État haïtien et au profit de ces gangs et de leurs commanditaires nationaux ou étrangers, vivant souvent en dehors du pays. De plus, ces bandes kidnappent des gens, marchandent des rançons, imposent des zones d’exclusion et un couvre-feu de fait, tout en pratiquant la guérilla urbaine et les assassinats aveugles, les vols et viols systématiques pour briser par le stress traumatique les ressorts de notre résistance éventuelle. Bref, ils asseyent leur pouvoir de facto sur l’exercice d’une violence illégitime supérieure en moyens à la violence légitime d’un État rendu impuissant par nos inconséquences antérieures.
Présentement une bataille décisive se livre à l’insu de quasiment tous. De son issue dépendra notre capacité citoyenne à tenir bon, à résister et à lutter pour renverser en notre faveur le rapport de forces qui nous est aujourd’hui défavorable, et pour reconquérir ce qui a été perdu. Peu de gens en sont conscients, car, plus insidieuse, cette bataille s’inscrit dans le registre symbolique du langage. Son enjeu ? La conquête et la domination des esprits, après celle des territoires et la domestication des corps. Son enjeu ? Notre reddition morale et notre soumission mentale.
Sans penser à mal et par facilité, nous adoptons des tournures révérencieuses comme « Messieurs » (mesye bandi yo, mesye yo), « Commandant Un Tel » ou « les soldats de X » pour désigner des assassins. Ceci induit sans qu’on le veuille la reconnaissance tacite d’une sorte de respectabilité des criminels et le glissement implicite vers une acceptation morale de la capitulation. Ce danger est grand dans notre société marquée par une tradition de violence et porteuse d’une culture dans laquelle l’admiration et le ralliement vont si facilement et si ingénument aux plus forts. Notre histoire est là pour montrer, hélas, avec quelle régularité nous choisissons la force contre le droit, contre la vie et contre la dignité. Parler de population civile pour désigner les victimes confère en retour un embryon de statut militaro-officiel aux hommes armés qui les agressent. Paroles qui habituent à courber la tête et à se résigner d’avance au pire.
Voilà pourquoi, dans la douleur, l’angoisse et l’émotion qu’engendrent naturellement des kidnappings, on peut entendre des suppliques à l’endroit des chefs criminels, qui commencent par leur reconnaître une prééminence de « Chefs » du pays, étant donné que les dirigeants ont démissionné de leurs responsabilités… tout en conservant leurs postes. Voilà pourquoi on se sent tenu de justifier le droit à la liberté de tel ou tel kidnappé par un plaidoyer mettant en avant ses états de service, son utilité sociale, ses mérites ou son dévouement à la collectivité nationale. Le pire dans l’enchaînement de ces mots étant les horribles variations sur le thème de « Ce n’est pas ce genre de personnes qu’on devrait kidnapper. » Comme s’il existait un genre de personnes le méritant ! Voilà pourquoi on en est réduit à mettre en avant l’état de santé, les faibles moyens financiers des professionnels de tel secteur ou de leur famille, etc. Voilà enfin pourquoi, ayant adopté, dans les mots d’abord, cette posture de vaincus, on fait ensuite des appels à la compréhension et à la conscience, en créditant de sens civique et de souci patriotique des agents destructeurs de la république d’Haïti. Quelques fois même en les interpelant par leur petit nom de guerre ! Les exemples pourraient se poursuivre avec les demandes de pitié, les appels à la clémence, à la grâce et même à l’amour à l’occasion de la Saint Valentin ou avec la référence à un improbable sentiment de fraternité humaine.
C’est se laisser leurrer par ses propres mots qui ne peuvent que flatter l’ego de leurs destinataires (si jamais ils les écoutent) tout en leur offrant la jouissance procurée au pervers par le sentiment de sa puissance, ravivé par le mal qu’il fait, la souillure qu’il apporte et l’abaissement qu’il provoque. Mais c’est aussi donner à un probable chef cuisinier occulte l’instrument pour mesurer les degrés de notre descente collective vers la servitude consentie.
Qui se permettra de juger et encore moins de blâmer ces invocations ? Il ne faut y entendre que l’expression pathétiquement sincère de la souffrance et de la solidarité avec les personnes et les familles injustement soumises à ces épreuves traumatisantes et inhumaines. Il en va de même pour des pétitions, des déclarations demandant ou prétendant exiger (sans moyen de pression ni de sanction) des libérations d’otages. Pareillement pour les blocages de rues, les arrêts de travail, etc. Toutes ces initiatives n’auraient de sens qu’adressées à des puissances devant lesquelles on accepte de s’incliner. Légitimation involontaire, parce qu’inconsciente de l’oppresseur. Triste aveu de notre impuissance collective, d’autant que nous savons tous, au moment même où nous participons à ces réactions publiques, qu’en dehors du soutien moral aux familles, leur effet est quasi nul. Les kidnappés sont libérés contre rançon, jamais pour exaucer des prières.
Faut-il parler au risque de s’humilier devant des malfrats ? Faut-il se taire au risque de laisser une abomination nouvelle se noyer dans les faits divers, faute d’y avoir bruyamment réagi ? Et s’il faut parler, que dire et à qui s’adresser ? Dénoncer ? À quelle instance ? Crier sa colère et son indignation, et puis ? Dilemme né d’une situation dans laquelle faute de parvenir à nous unir pour une action concrète concertée, nous ne pouvons que brasser des mots.
Et parfois, dans cette situation, certains glosent en de doctes propos qui maquillent en victimes les agresseurs et culpabilisent leurs victimes. Pour complaire à certains milieux, une sorte de bien-pensance politique pose dans un discours sociologique primaire, sommairement déterministe, une équation dans laquelle misère égale destin criminel, insultant ainsi tous les pauvres gens fermes et dignes dans leur honnêteté et leur rigueur morale. N’est-ce pas se fourvoyer que d’adopter pour référence les bandits et non les pauvres qui auraient pu devenir bandits, mais s’y sont refusés ? Pleine de compassion et de compréhension pour les tueurs, cette approche suggère que leur engagement dans une vie criminelle ne serait que la résultante automatique d’un mauvais billet à la loterie de la naissance. Fatalité et sort qui auraient pu frapper chacun d’entre nous.
Ce sociologisme mécaniste dérisoire pense s’affiner en ne voyant dans ces agents de mort, armés de mitraillettes, que de pauvres marionnettes que sauveront la bonne parole, l’action éducative et la réinsertion sociale, puisqu’armes et munitions leur ont été fournies par de riches et puissants manipulateurs. Ne serait-il pas plus réaliste et plus franc de laisser à la justice le soin de décider du sort des survivants d’une lutte déjà sans merci, quelle que soit l’origine sociale de ceux-ci ? Et cela, dans l’hypothèse optimiste où la partie saine de la population gagnerait la guerre. Et sans que ceci lave de leurs torts ni ne décharge de leurs responsabilités passées, présentes et futures les élites haïtiennes, les classes dominantes, les politiciens et les idéologues de la haine.
D’autres bien-pensants tentent de donner un visage de justiciers à ces agents de mort qui n’ont d’autre politique que celle du vandalisme et de la terre brûlée et qui sèment deuil et désolation, détruisant le peu de services sociaux (écoles, hôpitaux, etc.) publics ou non, offerts à la population. Quand ils jouent à « faire du social » en abandonnant un peu de leurs prébendes aux habitants des quartiers sous leur coupe, c’est pour tenter de les acheter et renforcer ainsi leur mainmise. N’embellissons pas ces comportements mafieux, au risque de pousser des populations, déjà désabusées par l’abandon de l’État, à faire allégeance aux chefs de gangs et à se jeter dans leurs bras. Ces meneurs ne se réclament d’aucune idéologie, ni de revendication sociale, économique ou politique. Pourquoi leur en prêter une ? Pourtant, dans un discours humaniste dévoyé d’aucuns les créditent d’un rêve de justice sociale tant il leur est difficile d’identifier en eux cette manifestation de « la banalité du mal » et d’en tirer pragmatiquement les conséquences. Mais les têtes pensantes, cachées derrière le rideau, comptabilisent à leur profit les conséquences pratiques de ces démissions intellectuelles et morales induites par le laxisme de la parole.
Loin de moi l’idée que des faits sociaux tels que les diverses formes d’insécurité qui nous frappent de plein fouet ne doivent pas faire l’objet d’enquêtes et d’analyses sociologiques, anthropologiques, économiques, etc. Une explication aussi rigoureusement scientifique que possible de leur genèse et de leurs mécanismes est nécessaire pour penser politiquement, moralement et socialement les corrections et transformations structurelles indispensables pour plus de justice sociale. Mais il s’agit là d’actions à moyen et long terme dont la mention sert parfois d’alibi à l’inaction. Il importe dans l’urgence de l’heure que nos prises de paroles visent à soutenir ceux qui sont dans l’épreuve et à entretenir la révolte de l’opinion publique, non à miner son moral. Que les déclarations des patriotes exigent des gens au pouvoir (ou qui y aspirent) qu’ils arrêtent d’évoquer de nébuleux colloques sur l’insécurité, mais que de préférence ils utilisent leur position pour constituer un groupe de travail incluant les responsables sectoriels, les spécialistes et les compétences nationales en la matière. Qu’à ce « think tank » soit donné le mandat de produire dans un délai à fixer (aussi court que possible) l’indispensable plan de lutte contre l’insécurité. Ce plan dont le pays ne dispose toujours pas et qui seul permettra de coordonner les actions et de donner un contenu crédible, acceptable et concret aux demandes de support extérieur.
« Mal nommer les choses ajoute à la misère du monde », écrivait Albert Camus. Dans notre cas ce sont des chaînes mentales que nous nous forgeons en employant à la légère des mots et expressions qui concèdent une sorte de respectabilité et de légitimité à des associations de malfaiteurs qui veulent détruire notre pays. Or elles n’ont droit ni à l’une ni à l’autre. Elles nous spolient de presque tout, depuis nos biens jusqu’à la liberté et à la vie de ceux que nous aimons et peut-être bientôt à la nôtre. Elles nous privent de beaucoup de nos droits et libertés physiques. Sans y prendre garde, abdiquerons-nous notre liberté de penser ? Et nous laisserons-nous déposséder de notre dignité par une adhésion anticipée à la capitulation que nous proposera bientôt, sous couvert de négociation, le marionnettiste, le vrai chef d’orchestre, lorsqu’il jugera venu le temps pour lui de sortir des coulisses ?
Si la dictature « à vie, pou tout tan » a été renversée, c’est parce que des femmes et des hommes haïtiens sont parvenus à entretenir dans les cœurs la flamme du refus, même quand leur comportement avait l’apparence de la soumission. À ce jour, nous jouissons encore de la liberté de pensée et d’expression. N’abdiquons pas celle de choisir nos mots.
« Au commencement était la parole ». Par elle et en elle s’élabore la pensée, car les mots participent à la construction de notre perception du monde dans lequel nous vivons. Et par sa façon de nommer ce vécu et de désigner gens, choses et actions, la parole nous trace en pointillé une ligne de conduite. L’emploi routinier de certaines expressions projette un halo de connotations positives ou négatives sur nos réalités et sur nos choix. Dans la parole et par les mots s’élabore notre pensée. Pensée de capitulation et de défaitisme ou pensée résistante et combative ? Ceci dépendra quelque peu de nos habitudes de langage.
Et si en bout de ligne, tout doit être perdu, qu’au moins l’honneur ne le soit pas !
Patrice Dalencour