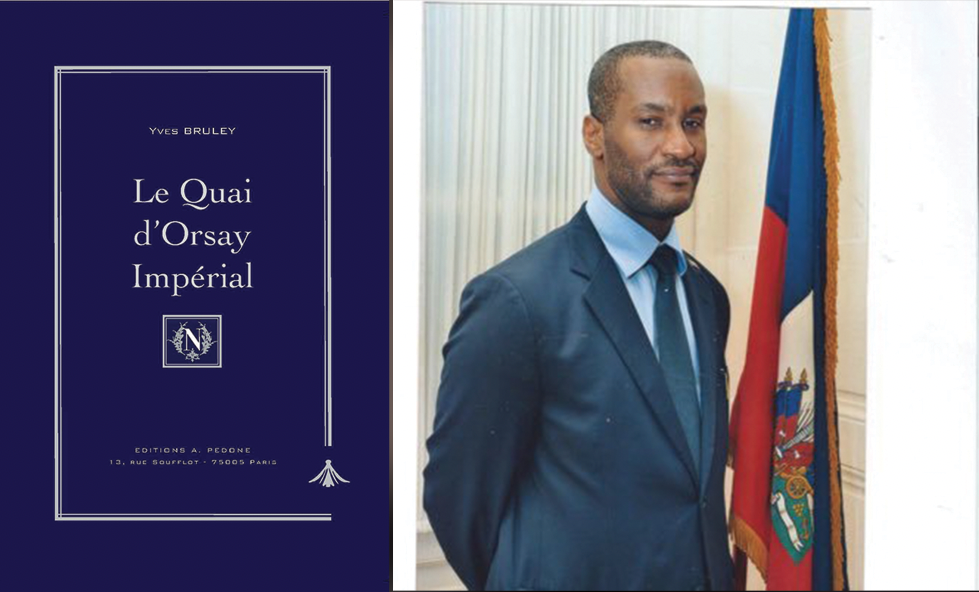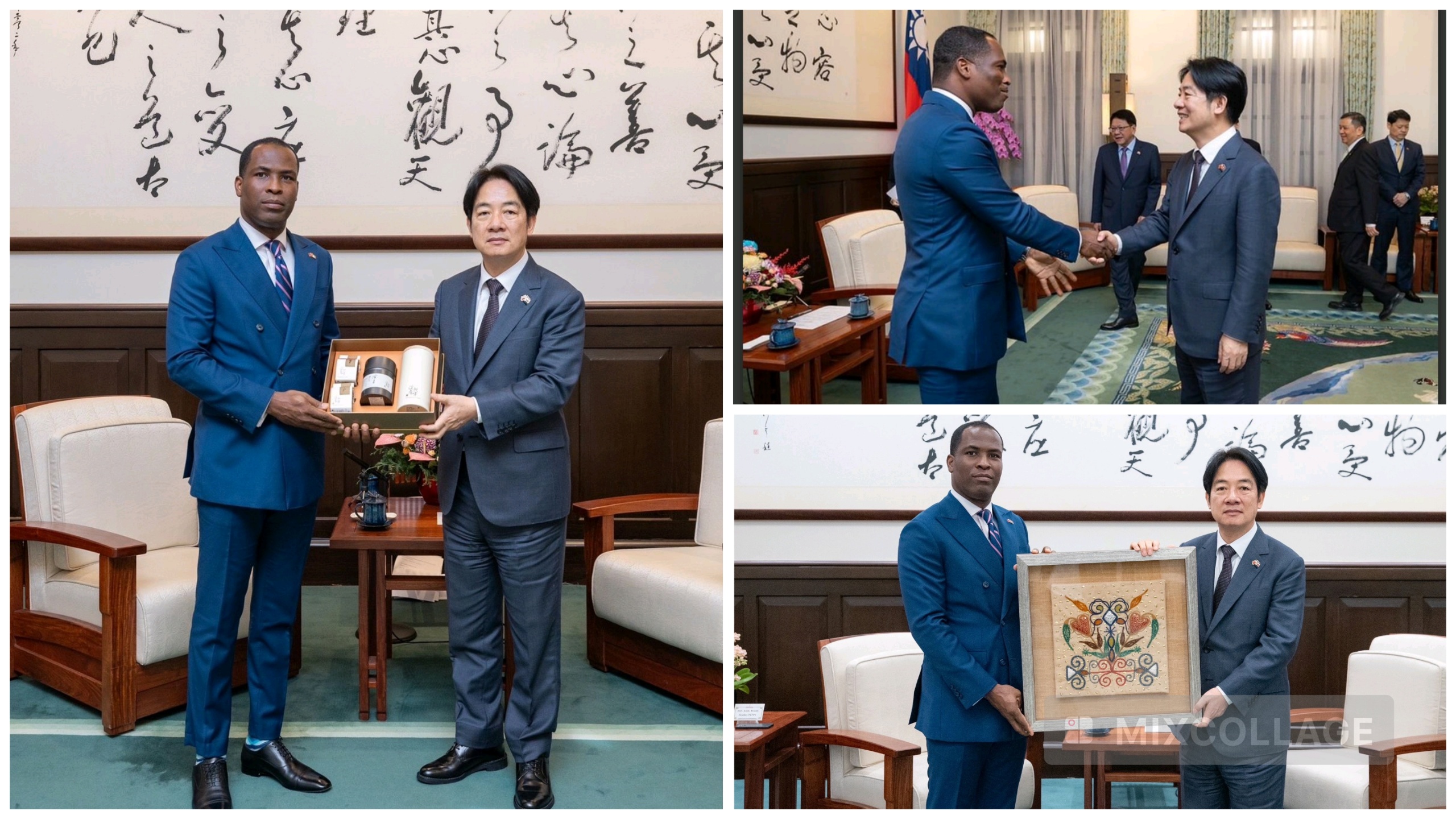« Le Quai d'Orsay Impérial » signé Yves Bruley, docteur en histoire des relations internationales, manquait à l’historiographie de la diplomatie française et sa parution en 2012 a incontestablement comblé un vide. Consacré à la politique étrangère de Napoléon III, cet ouvrage élaboré à partir de documents d’archives montre le rôle important du Quai d’Orsay dans la politique étrangère. Un travail de recherche que tout diplomate devrait lire.
En ce qui a trait à la politique étrangère de Napoléon III (1851-1873), elle a été abondamment étudiée, mais pas sa diplomatie, souligne Yves Bruley. La différence entre les deux termes fait toujours l'objet des concours d’entrée à Sciences-Po et dans les grandes écoles de diplomatie, surtout à l’Institut national des langues et civilisations orientales (INALCO). Il s’agit ici de différencier une politique menée par des politiciens et celle pratiquée par l’institution. Le rôle des hauts fonctionnaires de cette vénérable maison a toujours été pris en compte. D’autant plus que ceux-ci doivent non seulement avoir fréquenté une grande école, mais ils se doivent d’obtenir d’excellentes notes. Une exigence qui n’a pas changé depuis Jules Mazarin (1602-1961), ancien principal ministre d’État français.
L’opinion a surtout retenu le secret de l’Empereur d’Amélie de Bourbon Parme et bien entendu la débâcle de 1870, cette période historique qui a vu l'Empereur se faire prisonnier, son armée défaite, l'Alsace et une partie de la Lorraine occupées par les Prussiens. Sanction logique d’une diplomatie inadaptée. Bruley prend le contre-pied de cette vérité diplomatique en expliquant que la perte de L’Alsace et la Lorraine était inscrite dans un processus historique défavorable à la France. Son arsenal argumentaire vise non à réhabiliter une politique, mais pour établir le véritable rôle du ministère des Affaires étrangères à un tournant de son histoire.
Tout diplomate devrait lire cet ouvrage dans la mesure où il montre les bases d’une politique extérieure, ses points saillants dans un pays comme la France, le rôle de l’histoire dans sa mise en application, le fonctionnement du cabinet d’un ministre des Affaires extérieures, le rôle joue de la francophonie, etc. Bref, le lecteur apprend la manière dont les grandes et moyennes puissances défendent leurs intérêts dans le concert des nations. Il est aussi question du recrutement des fonctionnaires des Affaires étrangères et du déroulement des carrières des diplomates, etc.
Ce livre précise tous ces points d’une manière succincte, mais éclairante. L’auteur nous fait pénétrer dans les méandres des processus de décisions diplomatiques françaises et les rappels historiques formés des aléas de la vie internationale rappellent le fondement d’une diplomatie dont la colonne vertébrale a été longtemps la défense des droits de l’homme, conformément à l’esprit de la Révolution française de 1789.
Même si les choses ont bien changé, le réflexe des hauts fonctionnaires du Quai d’Orsay, lui, est resté pareil, si l’on en croit l’auteur qui énumère des prises de position diplomatiques souvent en porte-à-faux avec des positions officielles. Les méthodes de travail datant de Napoléon III et n’ont pas pris une ride, rappelle ce spécialiste. Tout ministre des Affaires étrangères français reçoit tous les matins un vade-mecum complet des missions diplomatiques françaises à l’étranger, à charge pour les différentes sections d’en faire un résumé. Les principaux responsables des dossiers des pays qualifiés « d’amis » sont répartis en cellules de travail dont les chefs ont pour mission d’alerter leurs hiérarchies sur tout ce qui irait à l’encontre des intérêts français.
Les grands responsables de la diplomatie
Quant au processus de décisions diplomatiques en France, depuis toujours, trois personnes sont chargées de les formuler avant de les proposer au parlement pour en faire des lois : le Président de la République, le Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères. Mais il existe un quatrième personnage toujours dans l’ombre, mais tout aussi efficace : le responsable des services secrets. Il est chargé de surveiller et défendre les intérêts français.
Dans l’organigramme du Quai d’Orsay, après le ministre, le patron des patrons est le directeur politique. Même si la globalisation lui a enlevé la plupart de ses prérogatives officielles et non officielles, il reste et demeure le fonctionnaire le plus influent du Quai.
Le chapitre consacré aux relations entre le ministre et son directeur de cabinet au début du Second Empire, est succulent. Nommé à cette fonction par Tocqueville en 1849, Arthur De Gobineau décrit ainsi sa vie quotidienne dans une lettre à son père « Je n’ai véritablement ni le temps de dormir, ni celui de manger, ni de boire. Je suis levé à 5 heures du matin et jusqu’au soir, je n’ai pas une minute à moi. Mais ce travail m’amuse extrêmement. Dans une autre lettre, il ajoute qu’il retient ses attachés jusqu’à 11 heures du soir ». Il travaillait quatorze à quinze heures par jour « au bonheur du peuple français » et ne rentrait dans ses foyers qu’à « l’état d’éreintement total ».
Principal conseiller du Ministre, Gobineau est l’auteur du tristement célèbre livre raciste Essai sur l’inégalité des races humaines auquel l’héritier de la révolution de 1804, Anténor Firmin, avait répondu par sa magistrale De l’égalité des races humaines (1885), un plaidoyer en forme de contre-arguments solidement étayés par des rappels historiques entre autres, surtout ceux de l’histoire de l’anthropologie sociale dont ce brillant intellectuel dominait les contours après des recherches effectuées en France. « S’inscrivant dans la lignée des grands résistants africains et descendants d’Afrique, un homme d’exception, haïtien, intellectuel et militant politique, précurseur du panafricanisme, seul contre tous, Anténor Firmin allait donner la réplique à une opinion acquise à l’idée que lui-même, comme les sujets de la thèse qu’il défendait, étaient des sous-hommes, admis par dérogation à la table des races à sapiens », écrit un intellectuel africain, pan-africaniste.
La continuité de l’État
Pour revenir au livre du professeur Bruley, on peut parler de régal. Une plongée historique qui rappelle entres faits que dès son avènement, Napoléon III a relancé le chantier du ministère où la diplomatie française s’installe enfin à l’été 1853. Cette belle architecture qui fait face à la Seine n'a pas perdu sa vocation d’exécuter avec doigté et diplomatie la politique extérieure de la France. Tous les grands dossiers de la diplomatie française de l’époque y sont concentrés, notamment la querelle franco-allemande qui a accaparé toute l’énergie des diplomates français pendant plus d’un demi-siècle. L’ouvrage traite de cette difficile période, alternant erreurs, réussites et percées diplomatiques. Et qui dit succès diplomatiques dit des hommes bien formés et bien informés. Parfois, la diplomatie échoue et c’est la guerre, comme il en a été le cas à trois reprises entre la France et l’Allemagne, en 1870, 1914 et 1940. Comme ces erreurs d’analyses qui avaient conduit à la Première Guerre Mondiale.
Cependant, le chapitre le plus intéressant est incontestablement celui qui évoque les influences savantes des hauts fonctionnaires. Plus que partout ailleurs, ceux-ci sont des missionnaires assurant la pérennité de l’État. Ce dévouement est encore aujourd'hui de mise, comme lorsque le Quai d'Orsay avait demandé à des diplomates d'aller en Irak en pleine occupation américaine et plus d'une centaine de diplomates y ont répondu favorablement. C'est une tradition bien ancrée: peu importent les dangers, la France doit être présente.
Le fonctionnement du cabinet d'un ministre des Affaires étrangères n'a pas non plus changé depuis, même si certains événements historiques - la révolution russe de 1917 et l'installation de l'ex-Union soviétique dans les jeux diplomatico-géostratégiques - ont considérablement modifié le travail des diplomates. La Deuxième Guerre mondiale et l'ère des espions pendant l'affrontement est-ouest constituent des avatars historiques qui ont sensiblement modifié les processus des décisions diplomatiques à la française. De même que la fin de la Guerre froide ayant abouti à la globalisation. En résumé, les politiques ont toujours baissé pavillon devant les analyses des diplomates.
Dans un pays habitué à des tumultes politiques et d’incessantes révolutions soldées par des instabilités chroniques, il est mieux de miser sur la continuité dans la gestion des affaires de l’État. Ainsi en 1848, une révolution a placé le poète Lamartine à la tête du Quai d’Orsay. À son propos, Bruley raconte une succulente histoire. Après sa nomination, un vieil employé du ministre, M. de Fontenay, est allé rendre visite à son nouveau chef, qu’il avait connu autrefois. « En montant l’escalier de l’ancien et vénérable hôtel des Affaires étrangères, au boulevard des Capucines, Fontenay se demandait quel accueil il allait recevoir. Lamartine, aussitôt qu’il l’aperçut, s’écria : ’’C’est vous, mon maître, qui devriez être ici, et non pas moi’’. » M. de Fontenay de répondre avec élégance et bon goût : « Des disciples comme vous valent mieux que des maîtres comme moi ». Pour l’auteur, « sous la forme d’une apostrophe courtoise, Lamartine avait reconnu l’influence capitale exercée par les hauts fonctionnaires des Affaires étrangères ».
Se référant à Bernard d’Harcourt de qui Bruley détient cette anecdote, il rappelle que « tant de démarches, de dépêches, d’événements décisifs ont été l’œuvre d’agents dont le public ignorait absolument l’existence. Aux époques tourmentées, le cours des évènements qui emportait les ministres, épargnait ordinairement les subordonnés, et le fil conducteur des affaires restait entre leurs mains ».
Maguet Delva
(1) Le monarque et homme d’État français, Napoléon III est né le 20 avril 1808 à Paris et décédé le 9 janvier 1873 à Chislehurst, un district du borough de Bromley dans le sud-est du Grand Londres.