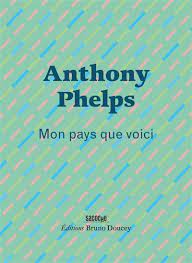Brunot Doucey, éditeur et lui-même poète, publie le chant de Phelps, Mon Pays que voici, rendant l’œuvre à nouveau disponible, dans un format propre à une grande diffusion. On aimerait ici rappeler combien cette œuvre est actuelle.
Dans le patrimoine littéraire haïtien, Mon Pays que voici, du poète Anthony Phelps, brille d’un éclat toujours vif. Écrit entre 1961 et 1964, entre Port-au-Prince et Montréal, publié à Paris en 1968, le poème a longtemps été connu par l’enregistrement partiel qu’en a fait Phelps lui-même et sa diffusion en disque dès 1966. Dans la postface à l’édition récente réalisée par Bruno Doucey, Dalembert rappelle le mot d’Ernest Pépin : le disque a longtemps été tenu serré par les étudiants antillais et guyanais venus faire leurs études en France, en compagnie du Cahier d’un retour au pays natal de Césaire et du Guerrillero Heroico, le portrait de Che Guevara pris en 1960 par Alberto Korda.
Mais ce voisinage imposant ne l’a pas édulcoré. Il s’en est même quelque peu détaché, vivant de sa propre vie, interrogeant de façon renouvelée lectrices et lecteurs, tant son titre conserve son actualité, tout comme sa charge d’énigmes. La première n’est pas la moindre, et touche la question de l’appartenance : une bonne partie du texte justement proteste contre l’altération généralisée depuis l’invasion : « le dieu de l’Espagnol était plus fort que les Zémès ». Dès lors, c’est jusqu’à la réalité même du « pays » qui est remise en jeu dans son établissement incertain. Le recueil de Phelps est à la fois une célébration et une quête, car d’évidence, le poète par sa capacité à figurer le palimpseste de misères et de combats qu’est devenu ce lieu, ne le nomme pas, même s’il célèbre sa possibilité à être, dans les quatre parties de son poème.
Il le désigne pourtant, comme ce qui fait face au regard : voici. Mais qui n’est jamais nommé, parce que ce pays est devenu, ou a toujours été, l’impossible même. Cependant, la poésie rend nécessaire le dépassement de cet impossible, par sa matière même, les mots. La désignation, nous disent les linguistes, permet à chacune et à chacun de construire la représentation de la réalité par un signe, la plupart du temps linguistique. La poésie est affaire de langue, certes. Mais la désignation est aussi un signe indicatif, un geste : voici, « Étranger qui marches dans ma ville », vois ici, « ma terre natale ». Le poète noue ainsi les mots et les gestes, et c’est sans doute ce qui étreint les lecteurs de ce texte si intense.
Et c’est maintenant la deuxième énigme : que voit-on, sauf le désastre présent à la conscience : « L’été s’achève / et ma mémoire se souvient » ? Remontent alors dans le poème « l’effroi » de la conquête par « ces Caraïbes d’une autre race / anthropophages à leur façon » ; la venue « à fond de cale » de « l’homme noir » ; les luttes libératrices menées par les « Pères de la patrie », invoqués, eux non plus nommés ; puis encore, les « adorateurs » du « dieu vert (…) plus fort que les loas » ; le temps contemporain du poète, quand « La vie partout est en veilleuse », et que les êtres sont devenus « aphones », rendus silencieux par la dictature. Le poème de Phelps devient déploration, presque le thrène pour les funérailles du pays. Ce dernier est donc à la fois désigné et absenté, et c’est depuis ce paradoxe que le poème fait sens, ce qui n’est pas mince gageure. Dans le poème « Il fait un temps de demoiselle », la frivolité apparente du titre dément l’évocation de l’impossible, réitérée à chaque vers, jusqu’au dernier, qui dit l’astreinte à l’aphasie : « Mon Pays a un caillot de sang dans la gorge ». Mais pour l’écrire, il faut éprouver le silence et le mal au plus profond de soi, comme une déchirure.
C’est ainsi : la représentation du pays aimé est avant tout un acte d’amour, c’est-à-dire un événement, et non une forme mécaniquement installée. Les vers, taillés dans une métrique rigoureuse, construisent cette dynamique, accentuée à l’entour de l’alexandrin, et de ses césures, propre au dire épique. L’insistance marquée par l’anaphore, souvent, imprime des couleurs particulières au texte : elle tient du refrain, et rappelle combien Mon Pays que voici est un chant, voire la célébration de l’absent, que le poème doit faire advenir, en des images surprenantes : « Terre déliée au cœur d’étoile chaude / Fille bâtarde de Colomb et de la mer / nous sommes du Nouveau Monde ». La juxtaposition et l’asyndète confèrent aux vers une qualité orale, et comme l’urgence à l’énonciation. L’anaphore est également un des signes (avéré) du sublime. On se souvient ici des vers de Gragnon-Lacoste, dont L’Haïtiade célébrait aussi le pays, né en 1804 : « Salut, fille du Ciel ! Salut, liberté sainte ! / Du malheur sur nos fronts viens effacer l’empreinte ». C’est aussi le registre par lequel le poète déplore les héros morts : Charlemagne Péralte, les milliers de cacos, Pierre Sully, les mitraillés de Marchaterre…
L’enjeu de ces combats, depuis l’invasion initiale, est la reconquête et la repossession de soi. Phelps rappelle que cette exigence de liberté n’est cependant pas pour tous, aussi qu’elle s’est restreinte, que les trahisons « des maîtres de chœur surannés et pervers (…) / ont maintenu le peuple / dans le mystère et l’ignorance ». Alors, oui, la question suinte de cette déploration : « À quoi bon ce passé de douleurs et de gloire / et à quoi bon dix-huit cent quatre ». Tous ces combats s’achèveraient-ils ainsi, dans l’inaccomplissement, voire une non-histoire ? Il faut entendre ici la critique assez radicale du recours à l’argument des Pères fondateurs, à l’insurrection héroïque, à la proclamation de 1804. Cette histoire-là aussi a été dévoyée, et ce que donne à lire et à entendre Phelps est que la révolution se déroule d’abord dans l’intériorité des êtres, dans l’exigence de vertu.
La force de la poésie tient sans doute à cela, qu’elle se tient sur la crête : d’un côté le fossé du silence, l’aphasie poétique, ce qui est advenu à certains poètes haïtiens, non des moindres, qui sont devenus silencieux, parfois par obscurité ; de l’autre, les précipices de la gratuité et de l’instrumentation sociale de la poésie, l’obscurantisme. Le poète, lui, se revendique de celles et de ceux qui ont « acquis ce port altier / ces gestes lents : à force de lever la tête ». Le poète avance, dans la nuit, arpente même « le règne des vaisseaux de mort », à la fois dans l’intérieur, mais aussi, c’est là sa très grande force, comme étranger, « l’aubain / dans la cité des hommes de ma race », lui qui sait la valeur de l’attachement sans faille ni distraction, comme du détachement, qui rend possible l’objectivation, c’est-à-dire la capacité à se défaire de l’aveuglement : « Ô mon Pays / je t’aime comme un être de chair / et je sais ta souffrance et je vois ta misère ».
La démarche poétique ici est sans relâche fondée et refondée, démarche tout autant politique, car c’est bien parce qu’il y a l’attachement viscéral et charnel que la poésie s’autorise à célébrer le possible, l’espoir, ce qui parviendra à desserrer « L’inévitable en nous comme un coin de silex ! », et de refonder sans relâche le « nous » à la fois exigeant et nécessaire, si souvent émietté et disséminé. Le poète assume alors la résolution majeure, qui vient démentir la généralité du négatif : « ô mon Pays / nous pétrissons pour toi des visages nouveaux / Il te faut des héros vivants et non des morts ». Et pour accomplir cette tâche, le poète avance sa posture ultime, et qui se décale, un peu, de la parole fondatrice prononcée par Toussaint, lors de son enlèvement : « Je suis greffé sur l’arbre de l’amour / entre l’écorce et l’aubier / Je grandis de chaque couche annuelle de bois vivant ». La « fleur-soleil » célèbre le renouveau perpétuel de l’être à sa naissance dans le regard de l’autre qui le regarde, à l’infini : « et je bénis le jour où nos yeux s’allumèrent ». Ce poème dit assurément l’espérance vitale de l’amour, et c’est un des plus beaux poèmes de la poésie haïtienne.
C’en est désormais fini des croissances souterraines, le Pays a désir de soleil, de sel, de fleurs et de promesse : « le grain nouveau croîtra ». La nuit n’a que trop duré. Il faut se forger la conscience nouvelle : « L’été est dépassé c’est le temps de l’espoir ».
C’est à chacune et à chacun d’entendre encore résonner ce dernier vers du chant. Ce Pays le vaut bien. Il ne saurait demeurer dans les ténèbres. Il faut que le jour se lève.
Yves Chemla