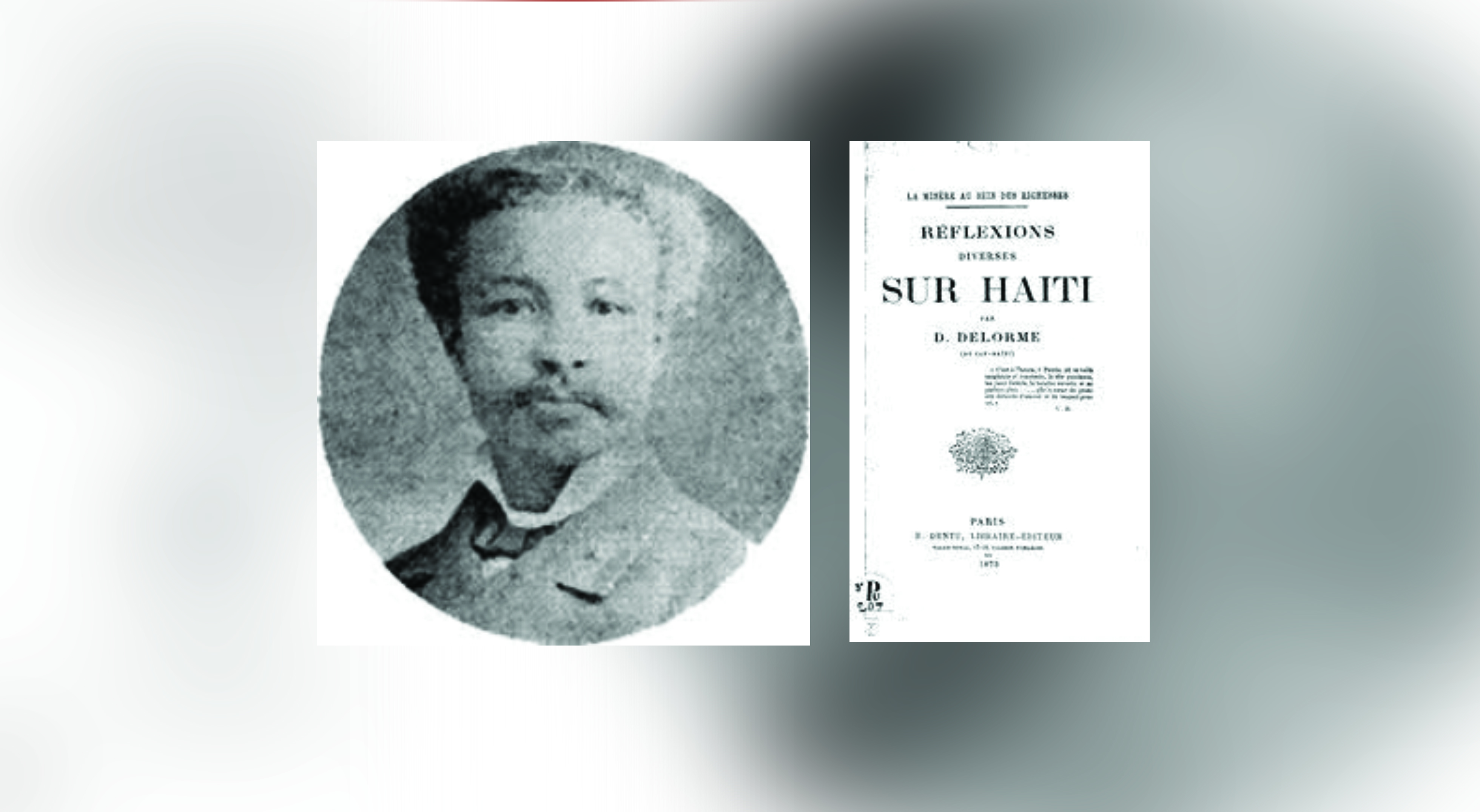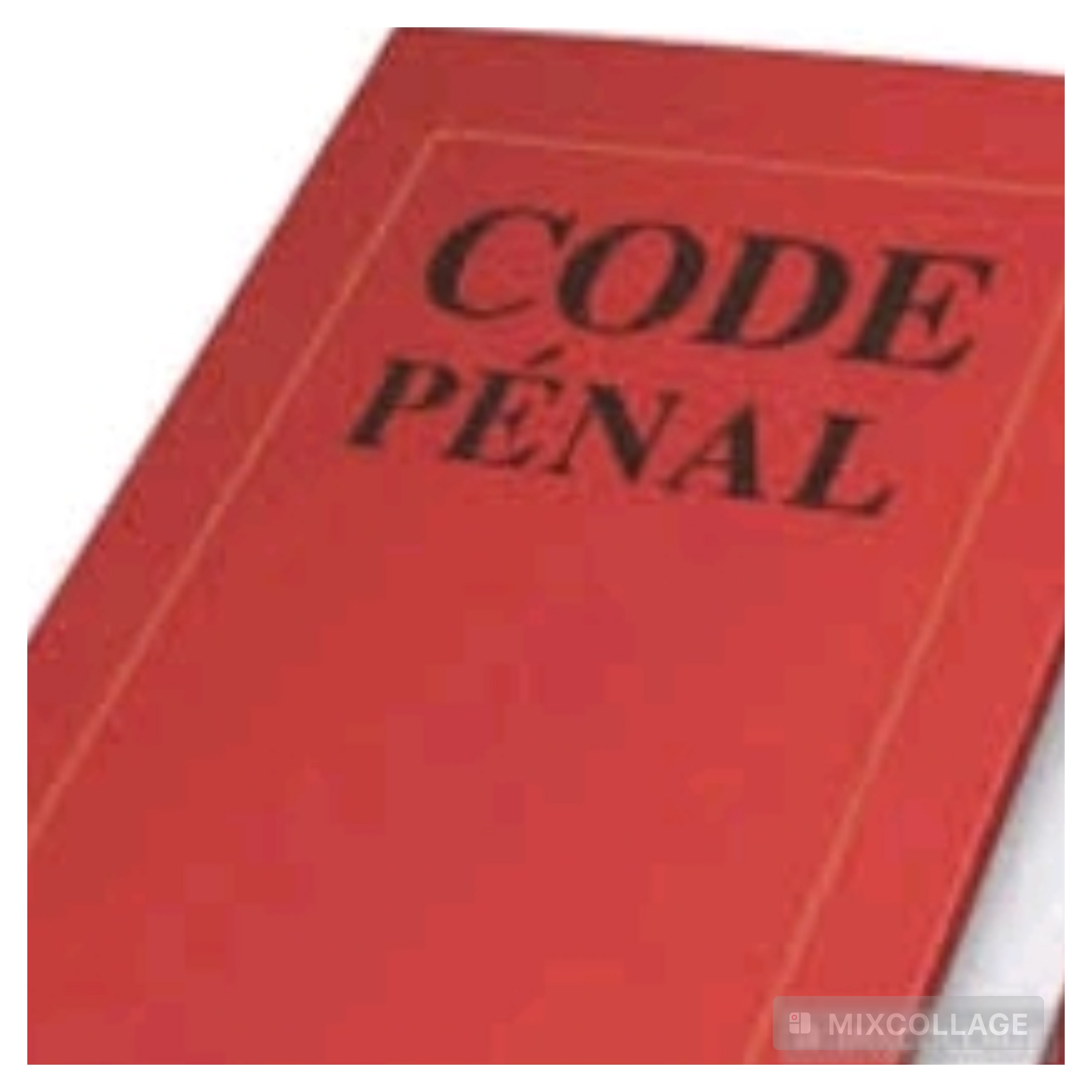1ère. Partie
Déjà à onze ans Demesvar Delorme (1831-1901) avait son destin clair d’écrivain. A cet âge, il savait la grammaire par cœur, et sentit l’attraction de l’écriture, et un peu plus tard la fièvre dure de la politique. Comment quelqu’un tellement obsédé par la culture et les lettres, quelqu’un qui prenait le pouls de la parole - comme disait Anténor Firmin, « la parole qui émane inépuisable de sa personne comme une entaille » - a-t-il pu se laisser complètement attraper par la politique jusqu’au moment même de sa mort ? La réponse est dans l’histoire d’Haïti durant le XIXe (hormis le long règne de Boyer, 1818-1843) et une bonne partie du XXe siècle marquée par la guerre civile à répétition et dans la manière de se regarder dans ce miroir qui était propre à l’écrivain, son charisme aidant. Ce jeune de la classe moyenne, destiné aux lettres et à la culture par formation et par inclination (l’Anthropologie et l’Histoire), avait très proche, dans la réalité du moment, et plus tard dans la figure de Sylvain Salnave, son ami politique, dont il était devenu le ministre, les clés de la vie politique. Déjà dès son entrée dans le gouvernement, il disait que, comme le président, homme très influençable, voire manipulable, en campagne dans le Nord pour soumettre les Cacos, était entouré d’hommes de mauvais aloi (un nommé Saint-Lucien Emmanuel, entre autres), lui, comme ministre, à qui le président avait remis les rênes du gouvernement, il devait employer tact et intelligence à l’écarter de l’influence de ces hommes, pour lui faire adopter des positions justes. Comme le général, qui avait passé toute sa jeunesse dans l’armée, accusait un manque de formation et le jeune Demesvar, placé dans ce moment-là par les circonstances à la tête de l’administration de l’État, le sachant, sentit une impulsion patriotique qui se convertit en engagement ferme. Cela le conduisit, à ce qui est perçu par ses ennemis politiques, en l’absence du président Salnave, engagé sur les champs de bataille au Cap-Haitien à soumettre les Cacos, à organiser même dans sa résidence privée des réunions, à entreprendre des actions visant la préparation des projets qui le tenaient à cœur, la réconciliation des partis au gouvernement, le ralliement des honnêtes gens, des gens éclairés; un engagement total hors du temps et des circonstances, tandis qu’il consentait à toute sorte de sacrifice, y compris le dialogue avec ceux-là mêmes qui l’avaient persécuté et qui craignaient des représailles suivant les habitudes politiques de ce pays. Jusqu’à prendre sur lui malheureusement de laisser tranquilles, et dans leurs familles et leurs affaires, ceux-là qui, dans l’armée ou la garde nationale mobilisée, lui étaient désignés comme agitateurs, alors qu’il avait l’ordre du président de les lui envoyer en hâte dans le Nord, en plus d’avoir publié dans Le Moniteur, sous forme de programmes, un article dans lequel il laissait voir le déshonneur pour un chef d’État à gouverner au moyen du pouvoir absolu, sans contrôle parlementaire. Il n’en fallait pas tant pour que cette sensibilité et les efforts consciencieux consentis pour la chose publique soient injustement manifestés contre lui. Ainsi, donc, grâce à l’intermédiaire de Saint-Lucien, homme à poigne, on fit croire au président que Delorme avait usé du pouvoir à son profit en son absence. On le persuada même que, sous cette activité qu’il mettait au service de l’administration, il cachait un but personnel : celui de le montrer comme incapable, de le discréditer, d’arriver enfin à le supplanter. Cela mit vite Delorme en disgrâce auprès du président qui, à son retour du champ de bataille, le pria d’accepter une mission diplomatique en Angleterre, en attendant que le calme fut revenu pour le rappeler à son poste, mais avant même d’atteindre son nouveau poste à l’extérieur, le diplomate nommé, est brutalement révoqué. Son impulsion patriotique l’amena à une sorte d’activisme et militance depuis l’exil (le second, 1868-1877) jusqu’à son retour au pays, quoiqu’il endurât certaines privations, sauf l’interruption de ses publications sur Haïti, pays qu’il porte dans son cœur, et qui tombait de déliquescence en décrépitude, ne parvenant jusqu’alors à trouver sa vraie voie.
Toute la vie de Delorme fut un mouvement en parfaite collusion avec ses conventions antinomiques. « Cette patrie plus elle est malheureuse plus je l’aime, plus je sens pour elle d’affection et de dévouement », se démarquant ainsi de ceux qui profèrent emphatiquement par un geste romain ce grand mot : le patriotisme. L’une et l’autre fois, il se délectait presque du spectacle même du jeu de la vie politique sur le terrain et de ses départs intempestifs pour l’exil, comme « celui qui niant tout, et que tout affirme ». Curieusement, il avait fondé un médium dont la raison sociale est « L’Avenir » : Journal politique et littéraire, auquel il mit pour épitaphe « le progrès par l’ordre et par la liberté ». Alexandre Dumas, père, qui n’était ni trop près ni trop loin de sa trajectoire, le décrivit pour « Les Théoriciens au Pouvoir » comme quelqu’un aussi littéraire que politique, et ainsi, la raillerie lui est incontournable, puisque Delorme, à l’instar de Périclès, Démosthènes, Solon, Cicéron, Mirabeau, et Lamartine, embrasse en même temps les deux expressions de la réalité. Alexandre Dumas, père, voit la réalité et la fiction qui accaparent l’homme ; le creux derrière le masque sans que celui-ci ne disparaisse ni ne se fasse inconnaissable. L’antiquité, a dit Delorme, pour justifier son antinomie, « formait ces grands hommes entiers et complets, propres à l’action comme au conseil, à la spéculation comme aux affaires. « Pline, Tacite, Cicéron, César, de même que Solon, Périclès, Démosthènes, Xénophon, Thucydide, ont écrit et commandé ».
De ministre accusé d’avoir usé du pouvoir à son profit - quand la providence le fit échapper plus d’une fois à la mort en prison durant sa vie politique, en passant par d’autres fonctions occupées ici et à l’étranger, y compris membre influent du parti libéral (et non national comme mentionné dans certains Manuels de Littérature Haïtienne) – à Directeur du Journal officiel Le Moniteur, il eut la possibilité de publier une série d’articles importants qu’il réunit plus tard sous le titre « Le pays », en 1898. Et lui, qui, la vingtaine avancée, parcourait déjà des pays étrangers, en quête des grandes valeurs spirituelles et morales léguées par le passé ou offertes par le présent pour les offrir - véritable miroir aux alouettes - en exemple à son pays, a dit : « Je suis né (…) pour être utile à mon pays (…). Je dévoue ma vie entière à ma patrie, en particulier à la race africaine en général ». Ou ailleurs : « Les patriotes dont je parle, sont ceux qui, admirant le progrès humain chez l’étranger, n’aspirent pas à pouvoir en jouir personnellement loin des lieux où ils sont nés, mais s’attristent de le voir absent dans leur pays ». Quoique son admiration et son amour du progrès pour son pays ne laissent aucun doute, il y a ici un exemple de la ligne sereine et sévère qu’adoptait son regard face à la réalité, appelant toujours à plus de retenue et toujours se posant lui-même en exemple. Tel qu’il appelle de ses vœux la ligne de conduite à adopter face à la chose publique : « Je ne suis pas, moi, un de ceux qui doivent tout ce qu’ils sont à la caisse publique insolemment dépouillée ». Pédant et imbu de sa supériorité, on a raconté une scène dans laquelle le geôlier de la prison où il est incarcéré dit au doctrinaire : « Delorme, yo pote mange pou ou… », et Delorme, blessé dans son amour propre, lui répond, « Monsieur de Lamartine m’appelait monsieur D’lorme, et voici que ti Joseph m’appelle Delorme tout court ! Preuves, l’une et l’autre fois, du profil politique gardé et de la cohérence de sa pensée littéraire projetée, cependant, sur une action politique et intellectuelle que ses détracteurs n’ont pas comprise et pour laquelle il est jugé. Ces derniers, y compris Salnave, avaient cherché par cette accusation portée contre lui à créer un personnage Delorme dont l’action politique ne correspondait pas à la pensée littéraire, capable de dire : « Je suis resté au pouvoir, simple et ouvert, comme dans la vie privée. Je craignais de passer pour un de ces hommes auxquels une charge publique donne une valeur que ne comporte pas leur propre personne. J’aurais eu honte de paraître infatué de la position que j’occupais. Je tenais à valoir par moi-même et ne voulais rien devoir à cet égard à une action accidentelle ». Et encore : « Quand on a les goûts auxquels toute ma vie j’ai été livré à cette passion exclusive de l’étude qui ne m’a jamais quitté même au milieu des plus grandes souffrances, une âme impressionnable jusqu’à l’excès, un respect inquiet et en quelque sorte maladif du devoir et de l’opinion d’autrui, il n’est pas possible qu’on ait en même temps l’instinct grossier de la cupidité », pour expliquer de manière manichéenne les excès du côté des hommes au pouvoir, même si lui aussi y était à certain moment.
Jean-Rénald Viélot