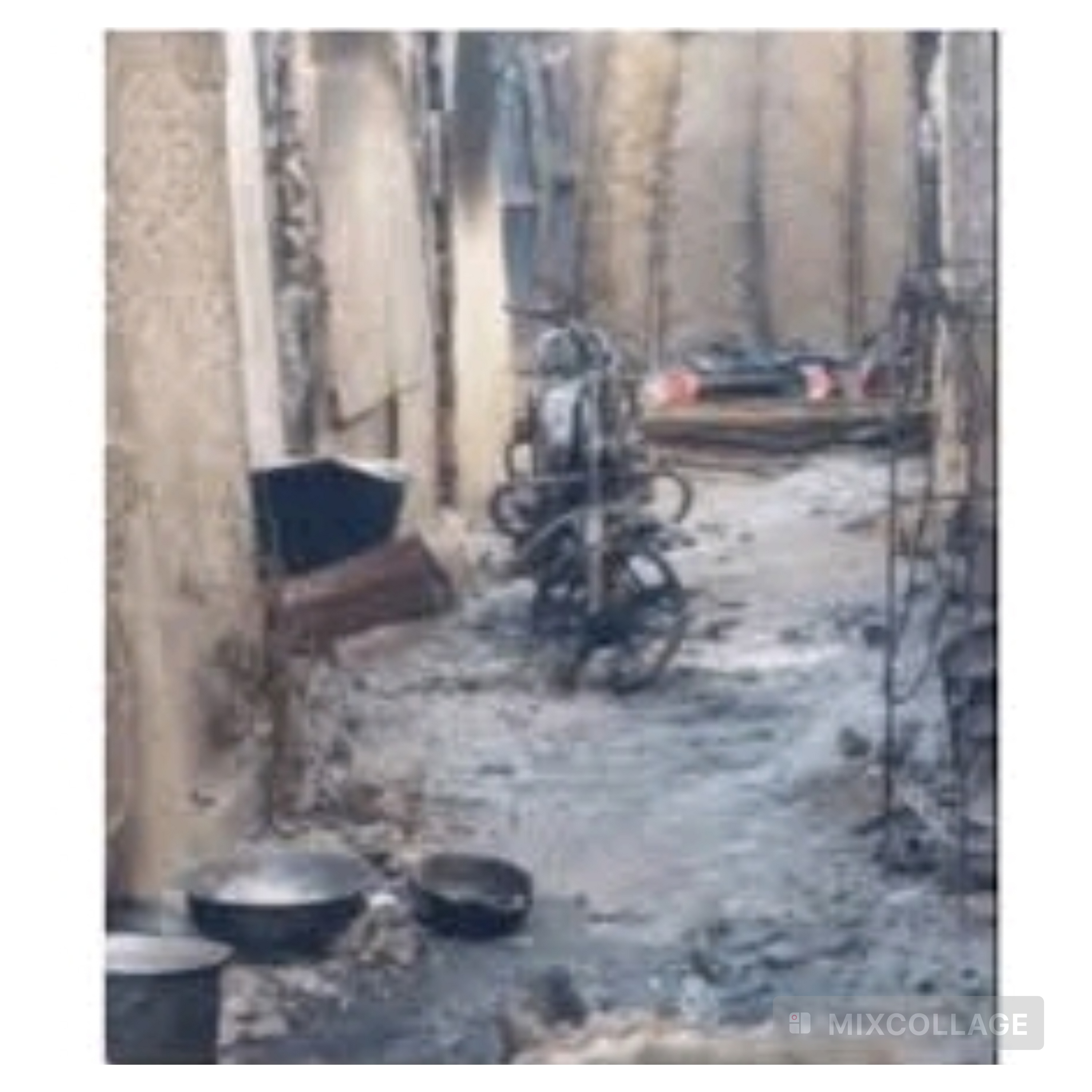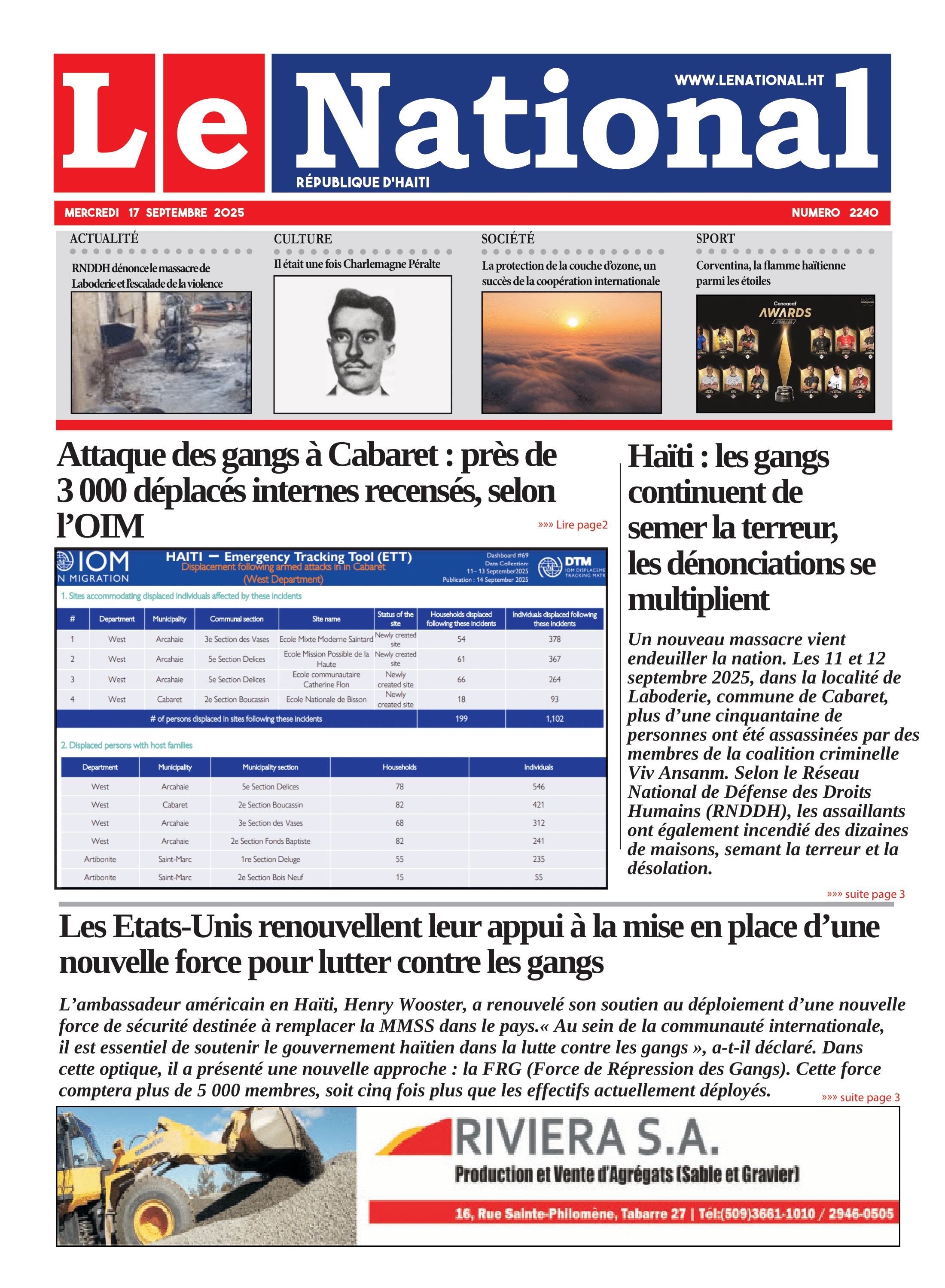Le constat qui constitue le point de départ de toute étude relative à la pauvreté en science juridique, aussi difficile à admettre serait-il, est que la pauvreté n'est pas définissable en droit.
Partie 1/2
Certes, les textes juridiques de différents États peuvent déterminer un « seuil de pauvreté » à partir duquel seraient développées des mesures spécifiques pour contribuer à la lutte contre les exclusions ou pour porter remède aux situations d'extrême pauvreté, mais la plupart du temps, les critères d'évaluation des cas à traiter reposent sur une définition économique, finan- cière et monétaire, plus que sociologique ou psychosociologique, de la pauvreté. La définition proposée par les économistes retient donc souvent l'attention des pouvoirs publics : « Est pauvre celui qui a un revenu insuffisant pour atteindre un niveau de vie minimum. » L'indétermination même des notions – qu'il s'agisse d'un « revenu insuffisant » ou d'un « niveau de vie minimum » – influence l'ensemble des politiques publiques qui seraient mises en œuvre dans le but de lutter contre la pauvreté. La définition de la pauvreté doit alors, à chaque fois, dans chaque État, être considérée comme contingente, incluse dans un flou permanent – concernant pourtant des positions individuelles, familiales, collectives –, comprise dans un cheminement allant de la difficulté d'assurer sa survie, particulièrement liée à un « droit à la vie » toujours à repenser, jusqu'à la difficulté de vivre des privations temporaires ou d'assumer des frustrations.
3Lorsque la démarche économique, accompagnée de sa logique monétaire, est retenue puis transposée dans les discours de droit, elle conduit à la création de catégories juridiques de personnes qui pourraient, suivant les régimes juridiques en vigueur dans les différents États, bénéficier de mesures d'assistance ou d'aides, de formes de soutiens ou d'allocations, ou, sur un plan moral, de considération.
4Dans les États « avancés », ces catégories de personnes ne relèvent pas des « sans » (sans ressources, sans biens, sans abri et sans moyens de subsistance : cf. Fournel et Zancarini, 2000, p. 213). Le langage du droit se refuse à les appréhender directement, choisissant les désigner de manière fragmentaire par la précision des objets à la source des carences, man-ques, privations, pénuries. Les personnes sans abri sont sans domicile fixe, les personnes sans ressources sont des personnes économiquement faibles, les personnes sans activité professionnelle sont des demandeurs d'emploi, etc. Cependant, si la fragmentation permet un certain ciblage des prestations sociales, des mesures d'aide ou d'assistance, une formule générale permet de réunir ces catégories de personnes dans un concept qui prend de l'ampleur : ce sont des « personnes défavorisées ». Dans les sociétés démocratiques contemporaines, profondément libérales, ce qualificatif, qui masque les sources de la défaveur, vise à empêcher de penser les échelles de la pauvreté à l'extrême pauvreté.
5Les déterminations de la pauvreté se réalisent alors en rapport avec une notion de « besoin » qui, pourtant éloignée de l'approche économique, est saisie suivant une grille d'analyse fondée sur une notion de « dignité » particulièrement subjective – elle a permis de faire de la mendicité, d'ailleurs, un délit et de l'assistance une procédure ; car l'appropriation par le droit du concept philosophique de la dignité de la personne humaine n'apparaît pas ici opératoire. Les besoins recensés sont situés suivant une graduation allant du besoin « vital » jusqu'au besoin « indispensable », en passant par le « besoin essentiel » sans qu'une référence de base ait pu être définie – à part, au niveau mondial essentiellement, celle de « l'alimentation », encore que, sous la pression du marché, les produits de base qui faisaient l'objet d'une réglementation par leur prix (pain, lait, riz) sont désormais livrés à la concurrence.
6Cette démarche invite à associer deux temps d'analyse spécifiques qui, pourtant, ne peuvent logiquement être placés dans un même registre : les politiques mises en œuvre relevant de la lutte contre l'exclusion et les mesures destinées à combattre l'extrême pauvreté. Les superlatifs acquièrent une valeur essentielle qui suscite une interrogation particulière sur la façon dont les discours juridiques abordent le phénomène de la pauvreté. En effet, de par le monde, ces discours ne s'attachent qu'aux effets les plus ostensibles de la pauvreté, ils ne prennent en considération que l'extrême pauvreté, et dans les sociétés industrialisées qui se targuent d'un produit intérieur brut conséquent, les objets du droit (non les sujets de droit !) sont les plus démunis, les plus pauvres. La prise en considération de la pauvreté est ainsi composée différemment selon les angles de vue et selon les lieux d'analyse. Toutefois, n'évoquer que l'extrême pauvreté est un moyen d'entériner l'existence de la pauvreté, de considérer la pauvreté comme un phénomène endémique dont il ne s'agirait de traiter que les aspects les plus saillants, les plus visibles. La pauvreté, qui exige de penser qu'existent des prestations matérielles indispensables, s'appréhende ainsi comme un phénomène économique et social contemporain lié aux conjonctures internationales, dans un monde globalisé, pour lequel l'effort peut demeurer mesuré tandis que la lutte contre l'extrême pauvreté relève d'un dispositif juridique plus pressant mais qui, limité à des actes déclamatoires et à des textes programmatiques, s'avère peu adapté. Deux types de droits, décalés de la logique de l'indivisibilité des droits de l'homme, sont exposés dans ce cadre : le droit à la subsistance (qui n'est pas clairement formulé en tant que tel), et le droit à l'insertion. On notera d'ailleurs qu'est écarté ici le premier des principes exposé dans les Pactes relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966, c'est-à-dire le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Les États choisissent alors d'évoquer les questions relatives aux premiers des besoins des individus : manger à sa faim, disposer de la santé physique, avoir accès aux ressources naturelles, avoir un toit et vivre en sécurité individuelle et collective. Si, au niveau international, c'est surtout la question d'un droit à l'alimentation qui retient l'attention, dans le cadre des États démocratiques contemporains européens et nord-américains, c'est la question de l'aide et de l'assistance sociale – et non de la protection sociale –, qui est le plus souvent soulevée. Ainsi, par exemple, en France, les dispositifs législatifs sont de plus en plus affinés et rétrécis, des lois relatives à l'habitat en passant par la loi de lutte contre les exclusions et la création de la couverture maladie universelle jusqu'à la remise en cause de la Sécurité sociale.
7Dans ces États, les mots du droit s'attachent surtout aux « insuffisances » ; de ce fait, face aux phénomènes d'exclusion, les lois ne font que les constater et les enregistrer, proposant quelques remèdes pour éviter leur aggravation, pour prévenir leur expansion. En quelque sorte, il semble qu'en dépit de la consécration des droits de l'homme, la pauvreté ayant de tous temps existé, elle ne peut être traitée que par un ensemble de mesures particulières qui, d'une part, consistent à mettre en exergue une notion d'insertion qui rendrait effective le concept d'égalité des chances, et d'autre part, appellent les pouvoirs publics à développer des mesures de protection et d'assistance pour ceux qui ne seraient pas aptes à saisir ces chances. Le langage du droit indique une infériorité, une soumission, voire une résignation au sort, c'est dire la « précarité », la fragilité, la vulnérabilité des personnes défavorisées, des plus démunis, des pauvres. Pour contourner la logique comptable initiale, c'est désormais à partir de ces critères que se constitue la catégorie générale des « personnes défavorisées ».
8La fonction sémantique du droit préfigure donc une certaine réticence à prendre en considération l'ampleur des écarts de richesse, de revenus, de ressources entre les individus et pérennise la notion de classes sociales – en dépit du rejet du vocabulaire marxiste. Pourtant, les divisions sociales dues à de fortes disparités de revenus sont toujours génératrices de phénomènes de paupérisation des classes moyennes et d'aggravation des conditions de vie des classes laborieuses – ces classes sombrant, de plus en plus, dans la précarité, l'instabilité puis l'inadaptation et, en fin de parcours, le dénuement, la pauvreté. Ces épreuves sont indéniablement génératrices de violence : lorsque le droit entérine l'existence de fortes disparités économiques et sociales, tôt ou tard émeutes de la faim, insurrections contre les nantis et brutalités des rapports entre personne, au sein des familles et entre groupes, etc., se font jour. Ces excès apparaissent comme la conséquence de la violation des droits de la personne humaine.
9En quelque sorte, la pauvreté est bien une violation des droits de l'homme mais elle est aussi la résultante de la logique des droits de l'homme.
10La décomposition de la problématique est donc préoccupante dans la mesure où, d'une part, il apparaît que la pauvreté s'inscrit dans la lecture libérale des droits de l'homme et, d'autre part, il semble que la pauvreté n'est plus une question à résoudre mais un fait « accepté ». S'il devait en être déduit qu'il s'agit principalement de lutter contre « l'extrême pauvreté », cela signifierait que la logique des droits de l'homme connaîtrait de substantielles remises en cause puisqu'il y aurait encore des plus pauvres que les pauvres.
De la pauvreté à l'extrême pauvreté : approche de la catégorie des « plus démunis »
11En droit, les discours ont effectué un passage équivoque du traitement de la pauvreté vers l'attention portée à l'extrême pauvreté. Or, l'extrême pauvreté n'a pas d'autres indicateurs que la pénurie, l'absence de biens, l'absence de ressources de quelque nature qu'elles soient. Dans cette perspective, la distanciation entre la notion d'absence (carence, pénurie) et la notion d'insuffisance (manque, privation) n'est guère analysée.
12L'approche étant recentrée sur les situations d'extrême pauvreté, c'est à un droit à la subsistance pour tous et chacun qu'il peut être fait référence ; cependant, de nos jours, ce droit, pensé essentiellement sur le plan mondial, est conçu suivant une optique minimaliste : subsister ne permet pas de vivre dans des conditions décentes.
13Les enjeux de la lutte contre la faim ont été transposés depuis les États sous-développés dans les États dits industrialisés alors même que ces derniers ne reconnaissent pas vraiment avoir à faire face à ce type de situations. Mourir de faim dans un pays où la surabondance de biens de consommation est la règle leur paraît anachronique. Cette translation a modifié les formes de la lutte contre la pauvreté. Faire du « droit à l'alimentation » le premier des droits de l'homme méritant protection et justifiant des mesures d'aide (alimentaire) revient à occulter plusieurs séries de questions qui, de toute évidence, obligeraient les États à s'inquiéter de l'influence grandissante des expertises économiques sur les formes de la production juridique et sur les modes de gestion sociale.
14Dans un rapport sur « la réalisation des droits économiques et sociaux », Asbjørn Eide (1999) avait eu à s'interroger sur « le droit à une alimentation suffisante et le droit d'être à l'abri de la faim [1][1]L'article 11 § 2 du Pacte international relatif aux droits... ». Cette étude était sous-tendue par le constat, alarmant au plan mondial, d'une lutte impuissante contre les phénomènes de la malnutrition et de la faim alors même que la Commission des droits de l'homme a affirmé à plusieurs reprises que « la faim est une honte et porte atteinte à la dignité humaine ». Elle signifiait qu'il s'agissait là d'une « des carences les plus graves de l'action à accomplir dans le domaine des droits de l'homme ». Néanmoins, l'idéal contenu dans l'affirmation d'un « droit à une alimentation suffisante » dépend, pour sa mise en œuvre, des politiques des États qui, plus que lutter contre la malnutrition, choisissent de survaloriser le droit d'être à l'abri de la faim et le droit de tous à l'alimentation pour ne pas se préoccuper des autres droits de l'homme. Être à l'abri de la faim est sans aucun doute un droit humain fondamental [2][2]Voir l'article 28 § 2(c) de la Convention sur les droits de... – et plus encore, demain, être à l'abri de la soif – mais l'effectivité de ce droit ne peut être traitée seule. Il ne peut être isolé parmi l'ensemble des droits fondamentaux ; s'il est indispensable d'affirmer que personne ne doit se trouver dans une situation conduisant à une totale insatisfaction de ses besoins nutritionnels élémentaires – ce qui l'engagerait dans une lutte non pour sa subsistance, mais pour sa survie –, il apparaît de plus en plus que la jouissance de tous les autres droits de l'homme, des droits civils et politiques comme des droits économiques, sociaux et culturels, dépend de cette subsistance. L'indivisibilité des droits de l'homme devrait être positivement rappelée afin de ne pas faire le jeu des despotes, tyrans et dictateurs, qui, au prétexte d'une impossible satisfaction des besoins primaires de la population, l'ont posée comme condition première de la transition démocratique.
15Replacées dans un univers marchand, où le paradigme du marché se conjugue avec la concurrence, ces conceptions amènent à affirmer que la dignité des hommes, des femmes et des enfants devrait passer avant « tout argument purement utilitaire » qui convoquerait la rentabilité économique et la performance industrielle. Mais comment faire en sorte que les entreprises multinationales, productrices de biens de consommation, soient un jour conduites à défendre les mêmes intérêts que les services publics dispensateurs de prestations essentielles ?
16L'adoption, au niveau national comme au niveau international, de politiques économiques, environnementales et sociales appropriées, visant à l'élimination de la pauvreté et à la réalisation de tous les droits de l'homme pour tous, est présentée comme « urgente ». Mais les moyens préconisés pour y parvenir semblent aller à l'encontre des dynamiques néolibérales à l'œuvre sur le plan mondial, notamment quand il s'agit de faire état de « droits » dont seraient titulaires – non pas bénéficiaires – les individus.
17Au-delà d'un droit à la subsistance, existerait tout un ensemble de droits économiques et sociaux qui donnerait au premier son sens et son effectivité sans soulever la question de l'aide ou de l'assistance. Ce sont des droits dits « créances », des « droits d'obtenir » et non des « droits de demander ». Ces droits, souvent de nature économique et sociale, sont des exigences, des sommations de faire ; ils ne sont pas formés de sollicitations, ils expriment des nécessités composant autant d'impératifs ; ils sont pour les gouvernants autant de dettes, de charges, d'engagements, de devoirs, d'obligations d'offrir ou de donner, en aucun cas de monnayer ou de vendre.
18Parmi ces droits, il est possible de citer le droit au travail [3][3]Article 23 de la Déclaration universelle des droits de l'homme,..., ce qui suppose le droit d'obtenir un travail et non de demander un emploi ; le droit d'obtenir du travail pour son épanouissement personnel et non exclusivement pour satisfaire à des besoins essentiels, alimentaires notamment. Mais encore, doit être relevé le droit à la sécurité sociale, puisque chacun est fondé à obtenir la satisfaction des droits indispensables à sa dignité (article 22 de la Déclaration universelle des droits de l'homme), d'où découlent le droit d'obtenir les ressources nécessaires pour satisfaire ses besoins (article 23 § 3 de la Déclaration universelle) ; le droit d'obtenir la sécurité alimentaire, c'est-à-dire autant le droit à une alimentation suffisante que le droit d'obtenir des denrées alimentaires saines, exemptes de risques pour la santé (organismes génétiquement modifiés, encéphalite spongiforme bovine) ; sans omettre la principale conséquence qui concerne le droit de jouir de tous les droits de l'homme, et notamment des droits économiques, sociaux et culturels.
19À ce stade de l'analyse, il est donc possible d'affirmer que la pauvreté constitue en elle-même une violation des droits de l'homme en ce qu'elle compromet l'exercice des droits économiques et sociaux et, par là, entrave la jouissance des autres droits de l'homme, des droits fondamentaux de la personne humaine. Elle maintient les pauvres dans un état de dépendance et accentue leur résignation devant leur sort.
20De fait, la mondialisation a élargi l'éventail des revenus et entravé le développement des politiques de redistribution dans certains États, même si les observateurs notent une réduction des inégalités économiques et sociales de par le monde (cf. Sachwald, 2002). La mondialisation a ainsi fait perdre de vue les exigences du respect des droits de l'homme tant les effets de la libéralisation du commerce ont fait des individus d'abord et avant tout des consommateurs. Or, ne peuvent valablement être « consommateurs » que ceux qui disposent de terres ou de ressources, donc parmi les non-propriétaires, ceux qui disposent d'un travail « correctement rémunéré ». Encore le langage de l'assistance sociale lui-même est-il désormais atteint par le virus du commerce, puisque, suivant la logique libérale de compression des déficits publics, les bénéficiaires de aides sociales sont de plus en plus considérés comme des « consommateurs » de prestations sociales. Ce déplacement sémantique induit certaines interrogations sur la qualité des rapports qui s'institueraient désormais entre les organismes de protection sociale et les personnes qui y font appel. Quoi qu'il en soit, l'insuffisance de l'offre de travail est également annonciatrice d'une mutation profonde des rapports sociaux qui situe la question de la pauvreté au cœur du débat.
21La dynamique du droit s'est placée dans l'orbite du discours économique et s'est ainsi soumise aux impératifs de la compétition entre économies capitalistes développées. L'idéologie dominante a dès lors défait la conception du travail – devenu désormais emploi –, alors qu'elle avait auparavant permis de penser le chômage comme étant le résultat d'une insuffisante solidarité entre les membres de la société civile. Comme l'abaissement du coût du travail pèse sur les salaires et non sur les investisseurs et producteurs, au prétexte des progrès techniques (dématérialisation des actes et des procédures), sous couvert de transferts diversifiés (délocalisation et défiscalisation), la logique du profit pour ces derniers engendre la montée du chômage et du sous-emploi, l'exclusion et la paupérisation qui ont autant de conséquences sur le mode de régulation des secteurs économiques que sur les formes de sociabilité. Le refus des États d'endiguer les vagues de licenciement des travailleurs aggrave en effet la tension sociale. Pour prendre l'exemple de la France, parmi d'autres États européens, la difficulté de soutenir le droit à l'instruction dans des actions éducatives est accompagnée d'une incitation à la constitution de cursus professionnalisés afin de ne faire entrer sur le marché du travail que des personnes dotées d'une formation spécialisée répondant à la demande des « bassins d'emplois » à la multiplication de « mesures en faveur de l'emploi des jeunes » (stages de formation, contrats d'insertion ou de solidarité, emplois-jeunes, incitation à la création de « petits boulots ») et à l'accroissement des emplois à temps partiel (qui concerne surtout les femmes) s'ajoutent la marginalisation croissante des plus faibles et la stigmatisation des étrangers.. Les quelques mesures qui ont pu être prises n'ont donc été qu'un moyen d'entériner les écarts de richesse au prétexte de la nécessaire défense, par l'État considéré, d'un rang à conserver ou à acquérir au niveau international. Plutôt que « moraliser » les sources de profits, ces mesures particulières ont été édictées non pour remédier à la pauvreté mais pour éviter l'extrême pauvreté : revenu minimum d'insertion (rmi), revenu minimum d'activité (rma), revenu minimum vieillesse (rmv), prestation d'autonomie ou allocation dépendance, remodelage des allocations familiales en priorité pour les plus démunis, couverture maladie universelle (cmu), etc. Et la vie civile se décline désormais en signes de désaffiliation sociale.
22En outre, le remaniement de la répartition entre salaires et profits a généré des phénomènes de paupérisation des populations laborieuses ; celles-ci sont dépourvues de place dans un monde qui fait de la productivité et de la rentabilité les principes fondamentaux des relations sociales ; elles se sont ainsi ajustées au phénomène de la pauvreté – et ces repositionnements se sont ajourés de sentiments de frustration et d'inutilité générateurs de violences et de révoltes. Alors qu'autrefois, le pauvre était celui qui ne disposait pas d'emploi, de nos jours même celui qui bénéficie d'un (contrat de) travail et d'un (bas) salaire peut être considéré comme pauvre.
23Si les classes laborieuses étaient des classes dangereuses, les populations fragilisées constituent les classes défavorisées, elles deviennent des classes marginalisées potentiellement dangereuses. C'est bien parce que le travail a perdu de son sens, parce que le salariat n'est plus pris en considération, que la pauvreté pose soudain problème et que les États se trouvent obligés d'entériner ce phénomène et de n'y porter remède qu'à la marge.
24Tous les droits de l'homme procèdent de l'existence de moyens de subsistance. L'article 11 § 1 du Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels du 19 décembre 1966 reconnaît « le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et pour sa famille, y compris une nourriture, un vêtement et un logement suffisant, ainsi qu'à une amélioration constante de ses conditions d'existence ». Il s'agit donc d'assurer à chacun des « moyens convenables d'existence ».
25Comme, pour la majeure partie de la population, la base en était le contrat de travail, les régimes de sécurité sociale en étant corollaires, le chômeur privé involontairement d'emploi – et qui doit le prouver en restant à la recherche active d'un emploi quelle que soit sa spécialisation, quel que soit son âge, quelle que soit sa situation personnelle – devient inévitablement pauvre quand les régimes d'indemnisation sont remis en cause. Une idée d'un « revenu minimum d'existence » a pu alors être émise mais elle avait pour conséquence d'obliger la collectivité à se préoccuper du sens à donner, en pratique, au droit à la subsistance et au droit au travail, sans avoir à solliciter de chacun la preuve de l'état de faiblesse et de précarité dans lequel il se trouve. Mais ce n'est pas par la compassion que la question de la pauvreté se trouvera résolue.
26Le premier indicateur de la pauvreté est l'absence de revenus stables, l'insuffisance de ressources. Or, les pouvoirs publics ont esquivé leur traitement et recherché principalement les moyens d'éradiquer l'extrême pauvreté au lieu de s'interroger sur les moyens de pallier absence de revenus stables et insuffisance de ressources par une revalorisation du droit au travail et par un renforcement des principes du droit du travail protecteurs des salariés. Parmi ces principes protecteurs : une rémunération équitable et suffisante, la sécurité et l'hygiène du travail, une durée raisonnable du travail et des congés payés (article 7 du Pacte international, relatif aux droits économiques, sociaux et culturels), mais aussi des contrats à durée indéterminée, l'interdiction des licenciements « boursiers », la réglementation des licenciements économiques, l'obligation de respect des principes d'égalité de traitement entre les hommes et les femmes (article 11 de la Convention du 1er mars 1980 sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes) et de non-discrimination, etc.
27La pauvreté est alors considérée désormais comme un fait incompressible ; l'objectif des États n'est plus d'y remédier mais de se saisir essentiellement des situations les plus manifestes qui en découlent. Cette démarche marque un degré supplémentaire dans la dégradation de la considération morale due à la personne humaine. Dans les discours juridiques, le pauvre est alors celui qui dispose de ressources ou de revenus « insuffisants » pour répondre à un certain niveau de vie ; mais, aussi réduits soient-ils, ces ressources ou revenus ne sont pas inexistants. Les « plus démunis » sont plus que pauvres puisqu'ils n'ont aucun revenu, aucune ressource, sinon celle qui leur serait allouée au titre d'une aide sociale pour leur assurer leur subsistance. La variation de l'une à l'autre de ces catégories se construit dans un souci de conciliation entre l'acceptable (la pauvreté) et le souhaitable (atténuer la souffrance des pauvres) et suivant un modèle progressif allant de l'impensable (lutte pour la survie) au compensable (aide pour la subsistance). Les superlatifs sont essentiels pour l'appréhension de ces situations par les pouvoirs publics : les politiques publiques s'occupent des plus démunis sans évoquer la question des droits de l'homme. L'objectif de ces politiques, en ne traitant que l'urgence, serait-il d'éradiquer l'extrême pauvreté pour mieux accepter la pauvreté ?
28Ce passage de la pauvreté à l'extrême pauvreté repose sur une logique comptable : plus bas est le seuil déterminé pour attribuer une aide, moins nombreux sont les bénéficiaires potentiels des politiques publiques engagées en la matière – et donc plus faibles sont les déficits publics. Toutefois, les questions financières ne sont guère mises au jour. La justification principale de cette réduction du nombre des bénéficiaires des mesures d'assistance trouve alors sa source dans le principe de dignité de la personne humaine puisque l'intégration des droits sociaux dans la sphère d'influence de ce principe demeure incertaine. Si la plupart des commentateurs s'accordent à dire que l'extrême pauvreté constitue une atteinte à la dignité humaine, penser la pauvreté comme une violation des droits de l'homme semblerait plus malaisée.
29Pourtant, certaines gradations pourraient être mises à jour afin de contrer cette tentative d'aveuglement démocratique. L'évolution du droit à la subsistance au droit de mener une vie décente paraît aller de soi mais il se trouve que, sous la pression d'une mansuétude enfermante, les plus démunis ne seraient pas en droit de revendiquer plus que la seule distribution du pain. Comment leur serait-il possible d'invoquer un droit à des moyens convenables d'existence alors qu'ils seraient tributaires de l'assistance charitable des pouvoirs publics ? Soumis aux nécessités de la subsistance, rattachés par des procédures et des formalités à des espaces (et des locaux) précis, considérés en infraction s'ils s'adonnaient à la mendicité ou s'ils se prêtaient au vagabondage, comment pourraient-ils revendiquer le respect d'un droit de circuler librement ? De quel droit au respect de la vie privée pourraient-ils se prévaloir dans la mesure où, privés de domicile fixe, ils s'évertuent à défendre leur espace intime, lové dans leur for intérieur ? Par quel biais seraient-ils en mesure de choisir librement les voies d'accès à la culture, à la connaissance, à l'éducation ?
30De fait, la jouissance des droits de l'homme n'est pas accessible aux plus démunis, mais l'exercice de ces droits n'est pas non plus garanti aux pauvres.
Geneviève Koubi