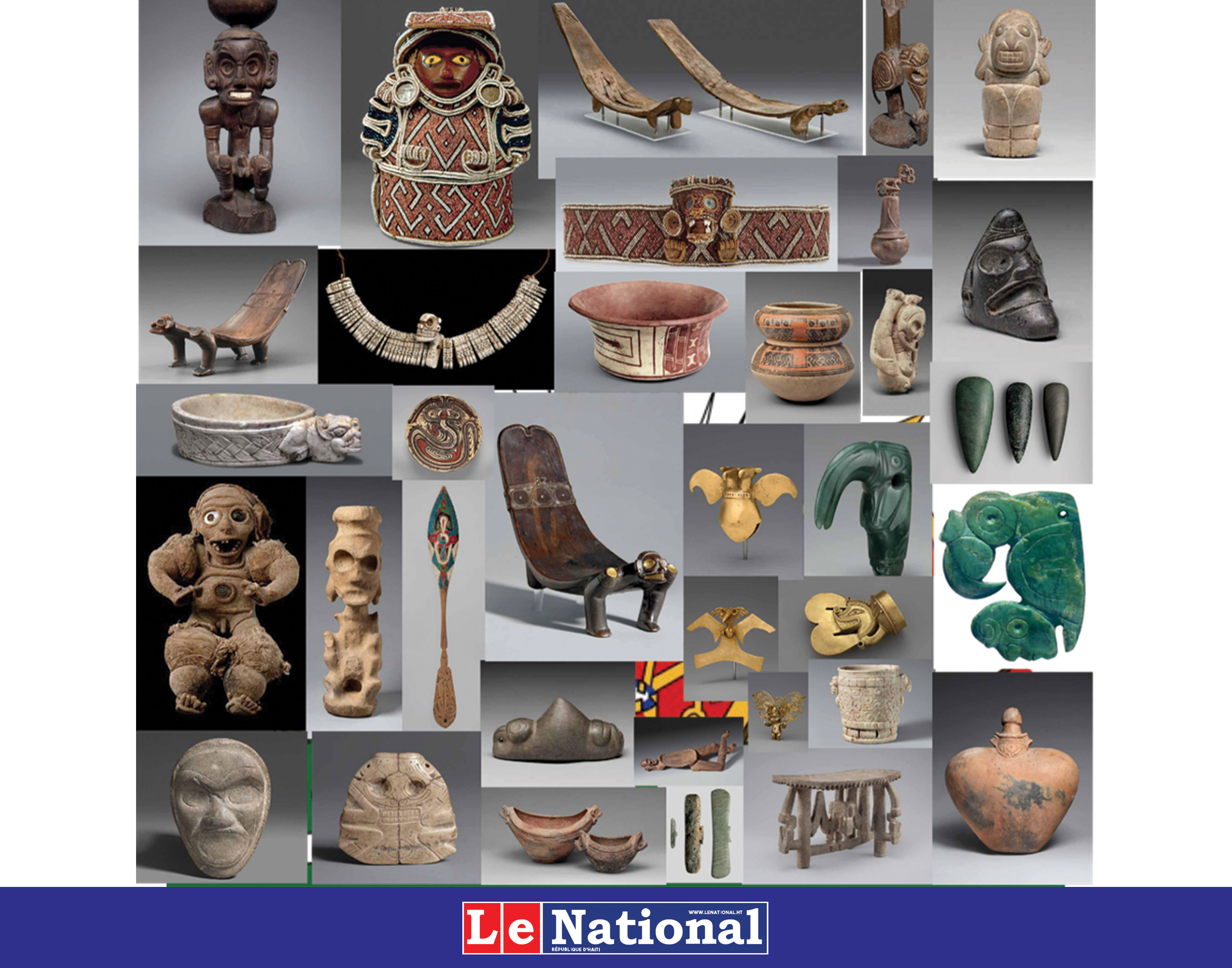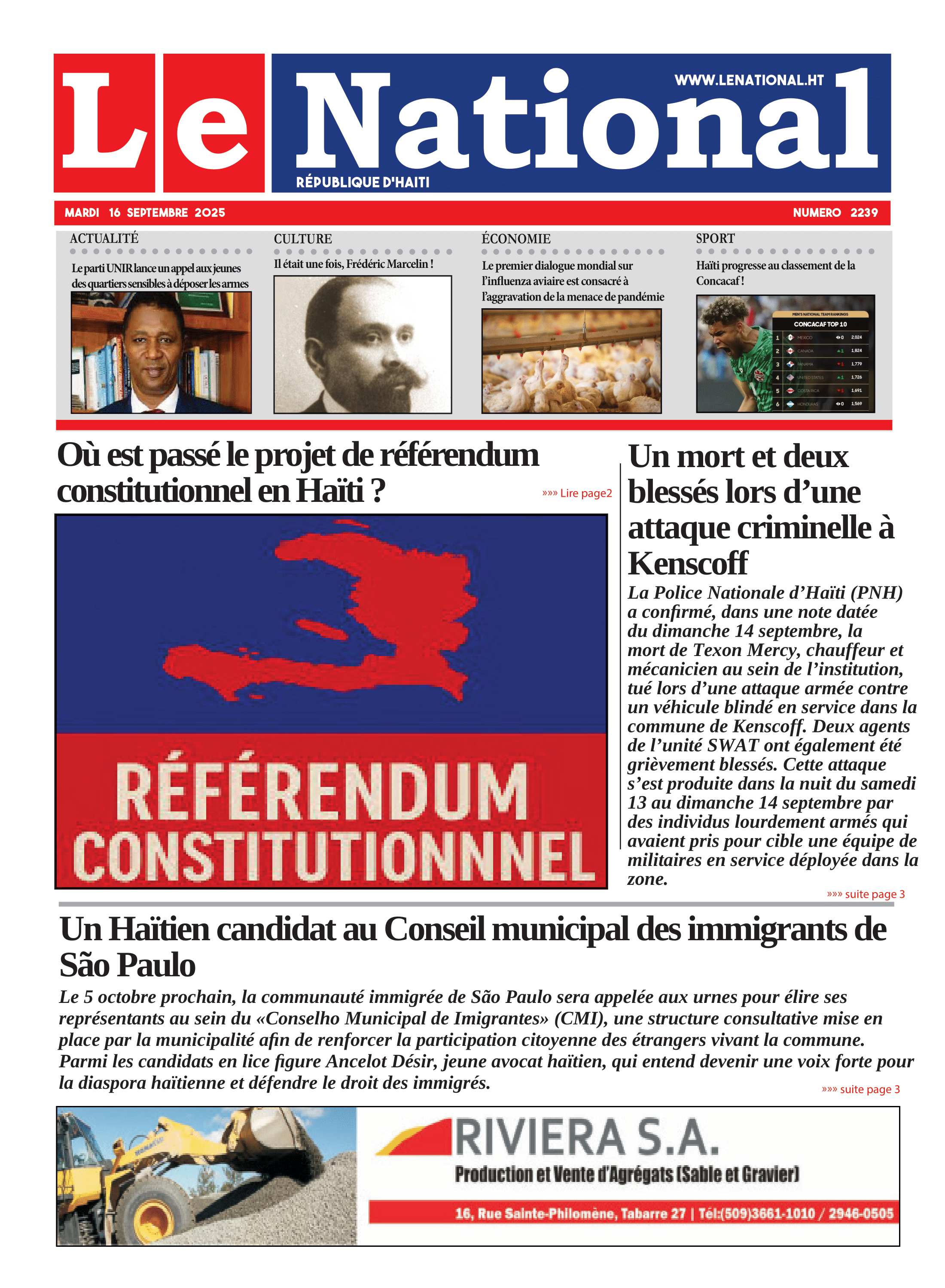À l’approche du 7 février 2026, date censée marquer l’entrée en fonction d’un président élu, et face à une situation jugée catastrophique, un forum d’anciens Premiers ministres appelle au dialogue, y compris avec le Conseil présidentiel de transition (CPT), pour tenter de trouver une issue à la crise politique.
Ces anciens chefs de gouvernement plaident pour des élections organisées dans les règles. Mais un scrutin dans quatre mois relève de l’impossible. Même dans un contexte stable et avec des progrès réels, il faut en moyenne 18 mois pour mettre en place un processus électoral crédible, sans compter les inévitables retards administratifs. Or, à ce jour, rien n’est prêt : ni sur le plan sécuritaire, ni sur le plan technique, ni en termes de consensus politique.
Tout est au point mort, ce qui se comprend dans le contexte économique actuel. Les partis eux-mêmes hésitent, craignant que leurs véritables adversaires électoraux ne soient pas d’autres candidats, mais les « puissants gangs » qui dominent désormais le pays sur les plans politique, économique et « militaire ». Une telle situation remet gravement en cause l’égalité des chances. Car si les gangs continuent de supplanter un État affaibli, depuis longtemps privé de son monopole de la violence légitime, comment croire à des élections crédibles sans fraude ni manipulation ?
On ne doit pas répéter les erreurs du passé. Depuis 1987, les urnes ont trop souvent engendré violences et bains de sang, devenus le « vin rouge » qui accompagne les festins des loups-garous de la politique haïtienne.
Seulement deux élections plus ou moins correctes en 38 ans
Parmi plus d’une vingtaine d’expériences de cette « pédagogie démocratique », nos recherches sur le régime haïtien ne révèlent que deux exceptions notables à la règle des loups-garous et des malfaiteurs politiques : les élections du 16 décembre 1990, qui portèrent au pouvoir le Révérend Père Jean-Bertrand Aristide par un vote quasi plébiscitaire, bien que marquées par certaines irrégularités techniques et judiciaires ; et celles de 2015, le plus long processus électoral de la transition, remportées par Jovenel Moïse, également entachées d’irrégularités. Toutes les autres consultations, en revanche, ont été frappées de graves dérèglements et se révèlent par conséquent inacceptables.
Cependant, par des coups d’État et par l’assassinat, des acteurs invisibles ont cherché à ramener ces deux exceptions – Aristide et Moise - dans la règle générale.
À bien regarder, la démarche des anciens chefs de gouvernement est justifiée, tant sur la forme que sur le fond. Le Conseil présidentiel de transition (CPT) n’est pas un élément étranger tombé du ciel et de ce fait, il ne peut être exclu d’un dialogue indispensable à la recherche d’une solution, afin d’éviter le pire. Même si l’actuel Exécutif n’est pas légal au sens strict de la Constitution, il est en quelque sorte légitime puisqu’il résulte d’un compromis entre la classe politique, le secteur privé et des organisations de la société civile.
Quant au Conseil électoral provisoire (CEP), il est issu lui aussi des partis politiques et de la société civile, qu’il a parfois déçus en ne respectant pas certains engagements. Il devrait dépasser le discours convenu de « l’organisation d’élections libres, honnêtes, transparentes et démocratiques » et trouver plutôt les moyens concrets d’offrir au pays un scrutin simplement crédible et acceptable.
Il faut cependant admettre que cette institution n’a pas toujours eu les coudées franches pour mener à bien sa mission. Les anciens CEP ne sauraient être tenus pour seuls responsables des scrutins mal organisés. L’absence de dialogue, de consensus politique et d’éducation civique a considérablement compliqué leur tâche. À cela s’ajoute le manque de collaboration des ministères concernés – notamment la Justice et l’Intérieur – qui n’ont jamais coopéré pleinement avec l’institution électorale, en particulier sur les dossiers des candidats en conflit avec la justice. Faute de transparence judiciaire, le CEP se retrouve privé d’informations essentielles et reste paralysé.
Plus de provisoire ni de permanent
Dans ce contexte, il faut saluer la décision des derniers constituants de ne plus qualifier le futur Conseil électoral ni de « provisoire » ni de « permanent ». Depuis 38 ans, la classe politique n’a jamais réussi à s’entendre pour mettre en place le Conseil permanent de neuf membres prévu par la Constitution de 1987. La raison est simple : chaque parti a toujours cherché à y placer « ses poulains » — voire l’ensemble de ses représentants — afin d’influencer les scrutins à venir.
Ce désir de mainmise totale, combiné à une méfiance séculaire entre adversaires et à un déficit chronique de tolérance, a non seulement bloqué l’application de la Constitution, mais aussi brisé le rêve de voir un jour un organisme électoral indépendant des calculs partisans. Certes, il est « de bonne guerre » que chaque parti tente d’imposer sa domination au sein du CEP. Mais l’institution ne doit pas céder à ces pressions si elle veut préserver les acquis démocratiques déjà fragiles.
En supprimant toute qualification, les constituants ont, sans le savoir, résolu un problème que les politiciens, toutes tendances confondues, n’ont jamais voulu affronter avec patriotisme.
Cependant, soyons lucides : ce choix ne suffira pas à garantir des élections crédibles tant que perdureront l’absence de volonté politique, l’instrumentalisation des institutions, le déficit de confiance entre acteurs et l’insuffisance chronique d’éducation civique. Cette dernière devrait être intégrée au cursus scolaire, aux programmes des partis politiques et soutenue concrètement par l’État dans ses budgets, sans discrimination partisane. Mais aujourd’hui, les partis sont si nombreux qu’ils tendent à dépasser le nombre d’électeurs eux-mêmes.
Sans un véritable sursaut collectif, le Conseil électoral — quel que soit son nom — restera condamné à l’impuissance.
Emmanuel Charles
Avocat et spécialiste des élections