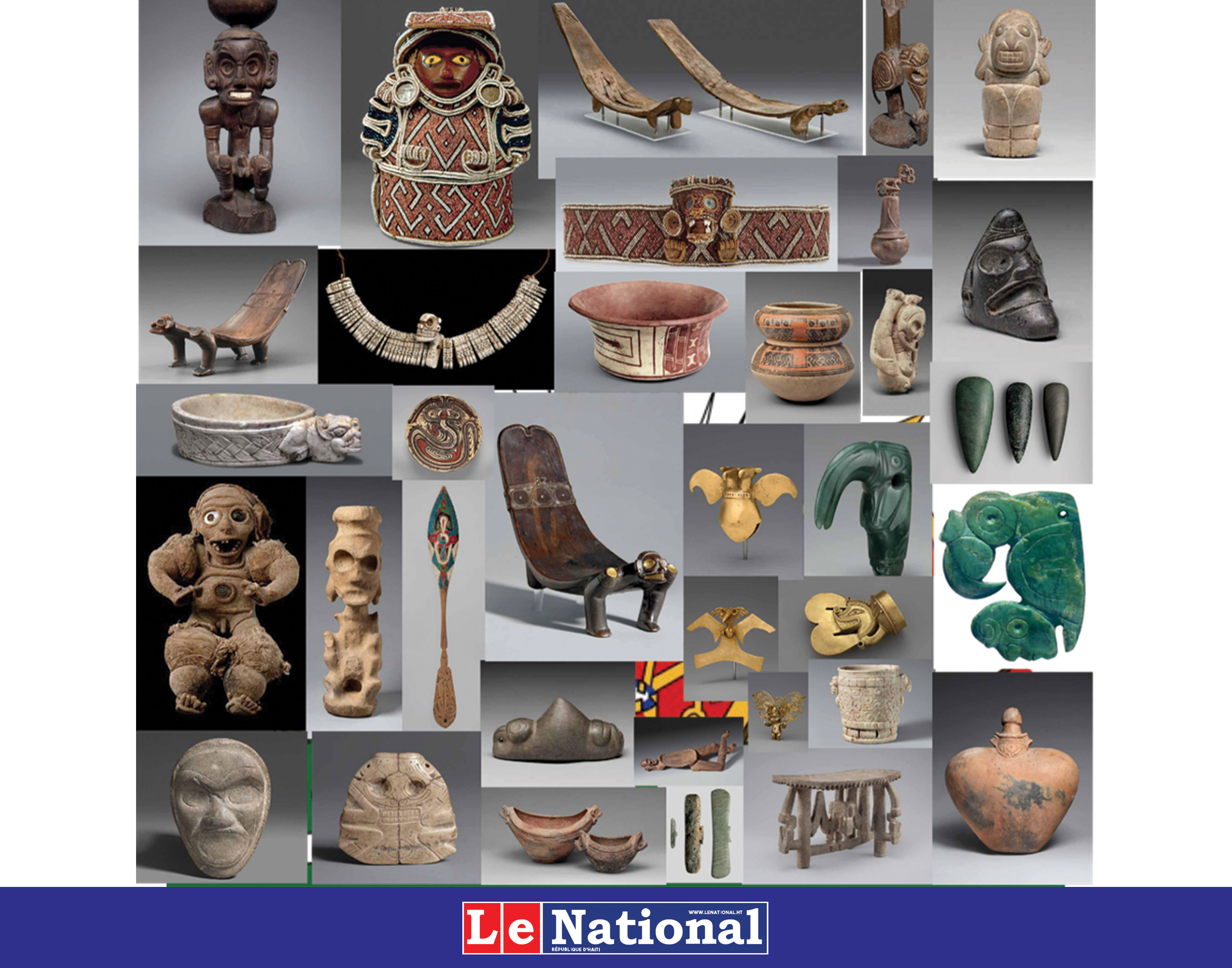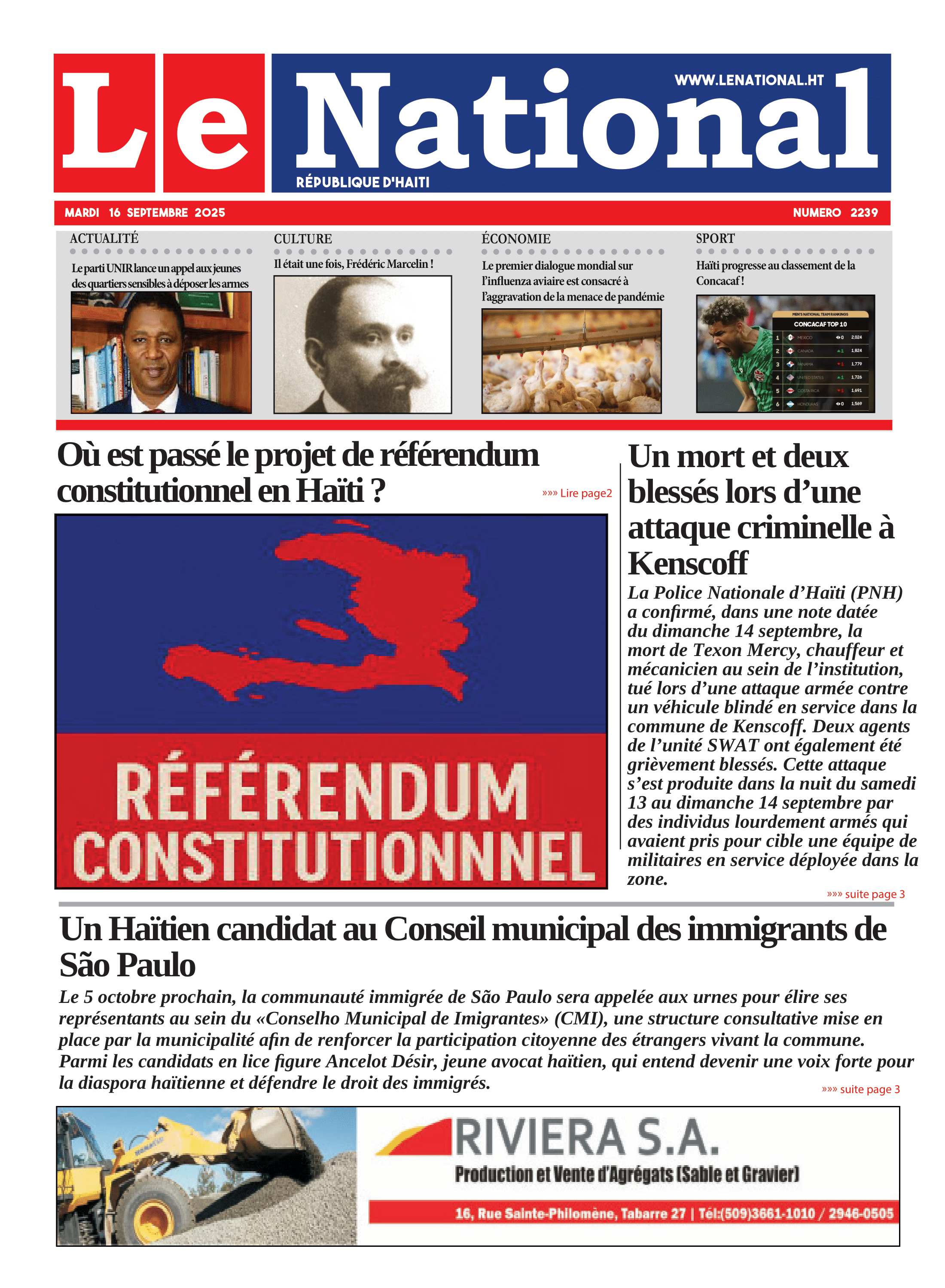Introduction
L’apprentissage de la langue écrite constitue un enjeu fondamental de la scolarité, conditionnant non seulement l’accès aux savoirs, mais aussi l’autonomie cognitive, la réussite éducative et la participation citoyenne, voire plus largement, l’émancipation. Or, malgré l’importance reconnue de cet apprentissage, de nombreux élèves peinent à établir un rapport solide et confiant à l’écrit. Une explication majeure réside dans la persistance d’un enseignement traditionnel centré principalement sur le décodage, la transcription et les règles grammaticales. Cette approche traite l’écrit comme un code abstrait, décontextualisé et normatif. Bien qu’elle puisse convenir aux élèves déjà familiers des codes scolaires, elle fragilise ceux dont les expériences langagières diffèrent, en particulier les élèves issus de milieux populaires, et génère des malentendus sociocognitifs (Bautier & Goigoux, 2004).
Le défi de l’entrée formelle dans la langue écrite est particulièrement manifeste dans des contextes bilingues comme en Haïti, où la majorité des élèves grandit en créole tout en devant apprendre à lire et à écrire en français, langue dominante de l’école (Govain et al., 2023). Ce décalage initial entre la langue orale et la langue écrite rend l’accès à l’écrit plus complexe, surtout pour les enfants issus de milieux défavorisés, et montre comment une approche techniciste, loin de compenser les inégalités, tend à les reproduire.
Dans cette perspective, la notion de littératie s’impose comme un changement de paradigme, offrant une vision élargie, intégrée et inclusive de l’apprentissage du lire-écrire. Cet article examine en quoi une entrée par la littératie peut constituer un levier structurant pour l’acquisition de la langue écrite, renforcer les parcours scolaires – en particulier ceux des élèves les plus vulnérables – et ouvrir des pistes de transformation pour les pratiques enseignantes et les politiques éducatives.
Les limites d’une approche techniciste de la langue écrite
L’enseignement traditionnel de la langue écrite repose sur une conception linéaire et normative : lire signifie déchiffrer correctement un texte, tandis qu’écrire consiste à produire des phrases grammaticalement correctes. Cette approche, largement répandue dans l’espace francophone, valorise la norme linguistique au détriment du sens et des usages réels du langage écrit (Carpentier, 2016). En traitant l’écrit comme un objet décontextualisé, elle invisibilise les intentions de communication et les situations sociales qui lui donnent sens (Goodman, 2014/1986 ; Van Kleeck, 2010). L’élève lit pour répondre à des consignes scolaires ou écrit pour satisfaire une exigence d’évaluation, sans lien avec son environnement ou ses expériences.
En Haïti, cette difficulté se double du fait du contexte linguistique : la majorité des enfants grandit dans un environnement créolophone, alors que le français domine l’écrit scolaire. La plupart entrent à l’école sans exposition préalable au français écrit, créant un décalage majeur entre leurs compétences langagières de départ et les attentes scolaires. Le poids accordé aux normes formelles du français – souvent déconnectées de leurs pratiques quotidiennes en créole – accentue le sentiment d’exclusion et fragilise leur rapport à l’écrit. Ce bilinguisme, loin d’être valorisé comme une ressource, se transforme fréquemment en obstacle.
De plus, la focalisation sur l’orthographe, la syntaxe et la ponctuation tend à transformer l’écrit en un espace de sanctions plutôt qu’en un moyen d’expression ou d’exploration. Cela entraîne démotivation, perte de confiance et rejet de l’apprentissage chez certains élèves (Delamotte, 2014). L’écrit devient alors associé à l’échec, plutôt qu’à l’émancipation.
Ces constats soulignent les limites d’une approche strictement techniciste. Face à ces défis, un changement de perspective s’impose : concevoir la langue écrite non seulement comme une compétence technique, mais comme une pratique sociale, culturelle et fonctionnelle (Lahire, 2021et Sirois et al., 2012).
La littératie : une approche intégrée et contextualisée
À rebours de la conception techniciste, la littératie propose une vision élargie et contextualisée du lire-écrire. Les compétences langagières ne se limitent pas à des mécanismes techniques ; elles s’inscrivent dans des pratiques sociales variées, dépendantes des contextes, des finalités et des interlocuteurs (Street, 2014, 1984 ; Barton & Hamilton, 1998).
Lire, c’est interpréter, comprendre, critiquer et situer un texte dans une culture, une époque et un réseau de significations. Écrire, c’est produire du sens pour un destinataire et un objectif spécifique. L’enseignement de l’écrit gagne donc à intégrer des situations authentiques : articles de presse, récits de vie, messages numériques, affiches, formulaires, blogues (Delamotte, 2014).
Dans un contexte bilingue comme celui d’Haïti, l’entrée par la littératie ouvre des perspectives fécondes : elle valorise les répertoires langagiers pluriels des élèves, en intégrant le créole comme ressource et non comme obstacle. Les récits oraux, contes populaires, échanges communautaires ou pratiques numériques peuvent devenir des appuis pour introduire et renforcer l’écrit en français, contribuant à la construction d’un rapport plus confiant et signifiant à l’écrit. Cette approche rejoint les travaux récents sur le translanguaging (Cenoz & Gorter, 2021 ; García & Wei, 2014), car la littératie valorise également la diversité culturelle et linguistique, rompant avec l’idée d’un écrit « légitime » unique. Elle permet de mobiliser les savoirs acquis dans les environnements familial, communautaire et numérique, et de les articuler aux exigences scolaires (Barré-De Miniac, 2003). Elle développe en outre des compétences critiques indispensables : questionner les sources, comprendre les intentions, détecter les manipulations et interpréter les données (Janks, 2010). Ces compétences transversales forment des élèves autonomes, capables de participer activement à la vie démocratique.
Sur le plan didactique, la littératie ouvre à des pratiques pédagogiques diversifiées : projets interdisciplinaires, coécriture, lecture collaborative, multimodalité. L’écrit se trouve replacé dans des situations concrètes, motivantes et culturellement pertinentes pour les élèves, en Haïti comme ailleurs. Dès les premiers apprentissages, la littérature de jeunesse et les activités d’écriture précoce peuvent être introduites dans des contextes de jeu. Le jeu favorise des apprentissages implicites, naturels et motivants, car il est perçu comme pertinent du point de vue de l’enfant – ce qui constitue un moteur essentiel selon Goodman (2014/1986).
Les bénéfices pour la réussite scolaire et l’inclusion
L’entrée par la littératie favorise la compréhension des tâches scolaires et l’implication active des élèves (Delamotte, 2014). Elle agit comme un facteur d’équité, en réduisant les écarts entre élèves porteurs de la culture scolaire implicite et ceux qui en sont éloignés (Bautier & Goigoux, 2004).
En reconnaissant la légitimité des pratiques langagières diverses (Nelson & Kessler Shaw, 2002) et en multipliant les occasions d’apprentissage à partir de textes réels, elle contribue à réduire les inégalités et à renforcer l’inclusion. Elle permet aussi de renforcer la construction identitaire et la reconnaissance sociale des élèves en valorisant leur langue première (Cummins, 2001). En ce sens, la littératie constitue un levier d’estime de soi et de persévérance scolaire.
Pour une nouvelle culture de l’écrit à l’école
Adopter une perspective de littératie suppose de transformer les pratiques d’enseignement. Il ne s’agit pas d’abandonner les règles linguistiques ou les compétences techniques, mais de les replacer dans un cadre signifiant et orienté vers la compréhension et l’usage. Cette évolution demande de former les enseignants à concevoir des dispositifs intégrés, basés sur des projets et sur des textes variés, et à mobiliser les savoirs issus de la sociolinguistique, de la didactique des langues et des sciences de l’éducation. Les approches de didactique plurilingue (Moore, 2022) offrent ici des repères concrets.
La promotion de la littératie suppose également une mobilisation collective : familles, bibliothèques, institutions culturelles et associations peuvent jouer un rôle clé dans la construction d’un environnement lettré stimulant, en particulier pour les élèves les plus éloignés de la culture scolaire.
Conclusion
En valorisant les langues premières, les répertoires culturels et les pratiques sociales de l’écrit, la littératie constitue un levier puissant d’équité et de réussite pour tous les élèves. Elle permet de dépasser une vision purement technique du lire-écrire pour en faire un outil d’émancipation, de participation citoyenne et de consolidation des parcours scolaires. Dans le contexte haïtien, où le bilinguisme et les inégalités sociales marquent fortement le rapport à l’écrit, la littératie offre des pistes concrètes pour réduire les écarts, renforcer la confiance des élèves et valoriser leurs compétences langagières et culturelles.
Au-delà des écoles, la promotion de la littératie implique une mobilisation collective : enseignants, familles, institutions éducatives et culturelles, ainsi que les autorités publiques, doivent s’engager pour créer un environnement lettré stimulant, inclusif et équitable. Il s’agit d’investir dans la formation des enseignants, de repenser les curricula et de soutenir des pratiques pédagogiques innovantes qui reconnaissent la diversité linguistique et culturelle comme une richesse.
Ainsi, pour Haïti comme pour d’autres contextes multilingues, la littératie ne se limite pas à l’acquisition de compétences techniques : elle ouvre la voie à une école véritablement inclusive, socialement pertinente et capable de préparer des citoyens critiques, autonomes et engagés. Les autorités éducatives sont appelées à prendre des mesures concrètes pour intégrer cette approche dans les politiques publiques, afin que chaque enfant puisse développer son potentiel et accéder pleinement aux bénéfices de l’éducation.
Francky-Love Cassamajor
Doctorant en psychopédagogie
Université Laval
Bibliographie
Barré-De Miniac, C. (2003). La littéracie: au-delà du mot, une notion qui ouvre un champ de recherches variées. Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften, 25(1), 111-123.
Barton, D., & Hamilton, M. (2005). Literacy practices. In Situated literacies (pp. 25-32). Routledge.
Bautier, É., & Goigoux, R. (2004). Difficultés d'apprentissage, processus de secondarisation et pratiques enseignantes: une hypothèse relationnelle. Revue française de pédagogie, 89-100.
Carpentier, G. (2016). Review of [Barré-De Miniac, C. (2015). Le rapport à l’écriture : Aspects théoriques et didactiques. Villeneuve-d’Ascq, France : Presses universitaires du Septentrion]. Revue des sciences de l’éducation, 42(3), 213–214. https://doi.org/10.7202/1040091ar
Cenoz, J., & Gorter, D. (2021). Pedagogical translanguaging. Cambridge University Press.
Cummins, J. (2001). Negotiating Identities: Education for Empowerment in a Diverse Society. Los Angeles, CA: California Association for Bilingual Education.
Delamotte, É., Liquète, V., & Frau-Meigs, D. (2014). La translittératie ou la convergence des cultures de l'information: supports, contextes et modalités. Spirale-Revue de recherches en éducation, (53), 145-156.
García, O., & Wei, L. (2014). Translanguaging: Language, bilingualism and education. Palgrave Macmillan.
Goodman, K. (2014/1986). What's whole in whole language in the 21th century. Garn Press.
Govain, R., M. Michel &F.-L. Cassamajor (2023). Littératie, Plurilinguisme et droits Linguistiques dans l’éducation de base en Haïti, (dir.), Les droits Linguistiques et la politique linguistique dans la région caraïbéenne, Kréolistika, n3, Scitep Éditions.
Janks, H. (2010). Language, power and pedagogies. Sociolinguistics and language education, 1(3), 40-61.
Lahire, B. (2021). Culture écrite et inégalités scolaires: sociologie de l’«échec scolaire» à l’école primaire. Presses universitaires de Lyon.
Nelson, K. et Kessler Shaw, L. (2002). «Developing a socially shared symbolic system», dans E. Amsel, P. James et J. Byrnes (dir.), Language, Literacy, and Cognitive Developement, Mahwah, Lawrence Erlbaum Associates, p. 27-58.
Moore, E. (2022). Didactique plurilingue et apprentissage des langues. Presses Universitaires de Paris.
Sirois, P., Boisclair, A., Darveau, M., & Hébert, É. (2010). Écriture et entrée dans l’écrit. La littératie au préscolaire: une fenêtre ouverte vers la scolarisation, 279-316.Street, B. V. (2014). Social literacies: Critical approaches to literacy in development, ethnography and education. Routledge.
Street, B. V. (1984). Literacy in theory and practice (Vol. 9). Cambridge University Press.
Van Kleeck, A. (2010). Les facteurs culturels et la promotion de la lecture interactive chez les familles d’enfants d’âge préscolaire. La littératie au préscolaire. Une fenêtre ouverte vers la scolarisation, 245-278.