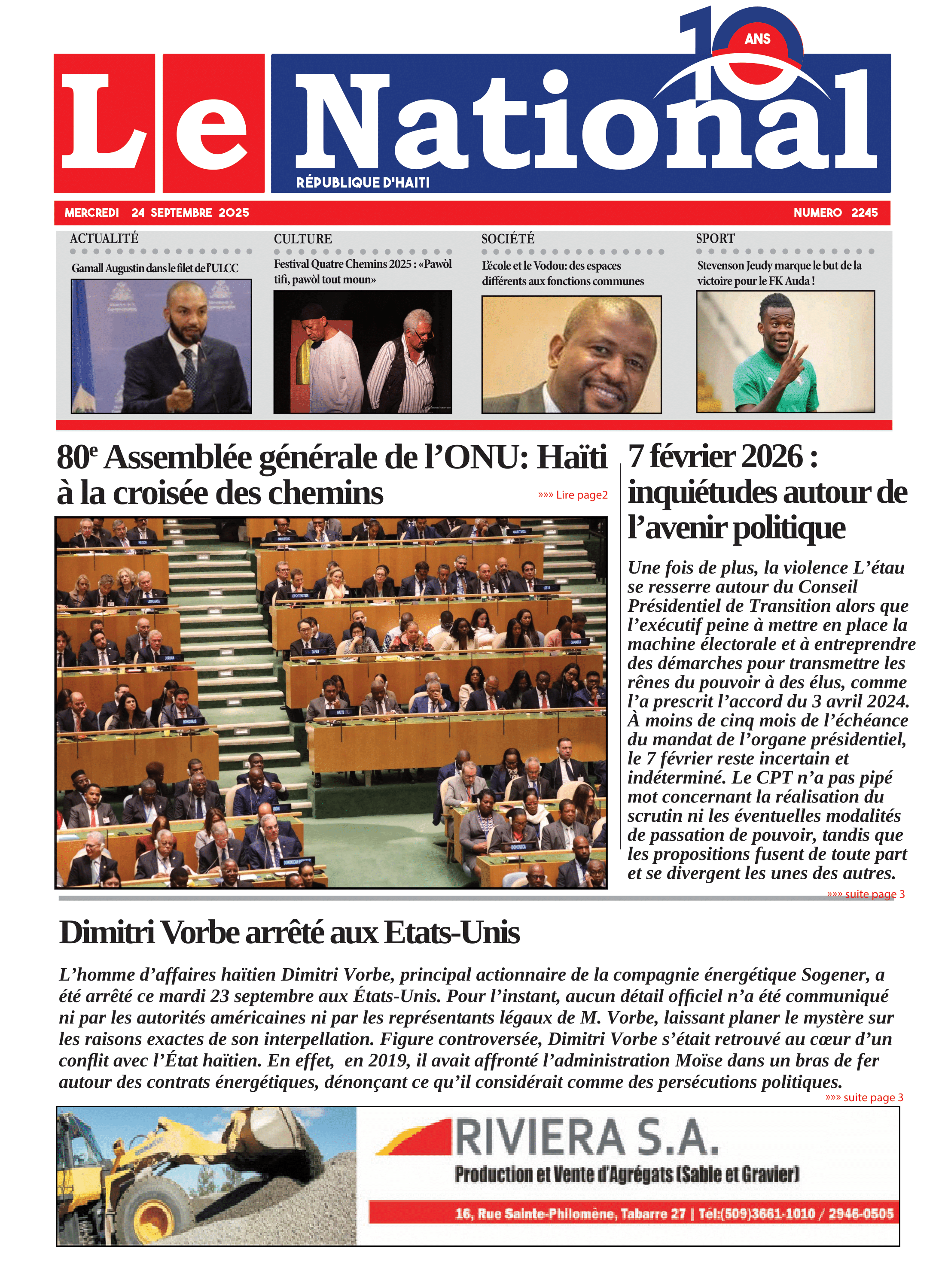Le constat est implacable : Hayti s’enlise dans la violence armée et l’instabilité politique, attendant, comme une fatalité, une nouvelle intervention étrangère. Mais après onze missions onusiennes avortées, faut-il croire à l’aube d’une libération ou à l’ombre d’une tutelle déguisée ? Sans un sursaut interne, sans une politique d’autosuffisance et de souveraineté, toute force venue d’ailleurs ne sera qu’un palliatif passager, un remède qui empoisonne. Car la paix ne se décrète pas par l’ONU ni par Washington ; elle se forge dans la volonté d’un peuple, dans la dignité retrouvée de ses institutions. Alors, la vraie question demeure pertinente en ce sens que Hayti peut-elle être sécurisée de l’extérieur, ou se libérer de l’intérieur ? De l’ailleurs, eu égard à cette discussion, les enjeux stratégiques sont multiples, car avant même de partir à la quête de sécurité immédiate, de restauration de l’État par les élections, il fallait accepter de redéfinir les rapports avec les puissances occidentales et les politiques diplomatiques internationales avec notamment Washington, pour le sauvegarde de la dignité nationale. En ouverture à cela, la sécurité est loin d'être une quête universelle émanant de l'ONU à Ayiti; en ce sens que comment construire une paix durable issue de la volonté de la population haytienne, et non d’un diktat extérieur après 11 tentatives de réhabilitation de paix déchues ?
Un projet aux allures de dernier recours
Ayiti, éternel phénix blessé au cou, se voit une fois encore convoquée au tribunal de grandes puissances mondiales. Dans l’arène du Conseil de sécurité de l’ONU, les États-Unis et le Panama brandissent une nouvelle résolution : déployer une force de 5 500 hommes pour mettre fin à la tyrannie des hommes armés en Ayiti. Mais la mémoire de l'histoire longue, tenace, rappelle que onze missions se sont déjà succédé, sans délivrance ni rédemption. Alors faut-il saluer cette proposition comme une aurore fragile ou la dénoncer comme l’ombre d’un nouveau protectorat étranger ? Entre communication politique de la souveraineté et mémoire historique d'une population en mode martyr, cette résolution cristallise encore la grande table des rapports diplomatiques internationaux d'Ayiti avec l'hémisphère Nord de l'ONU de la question séculaire : comment pacifier Ayiti une douzième fois sans la trahir ?
Le projet américano-panaméen se veut l'anti-dote d’un mal chronique structuré pour tenir Ayiti sous le protectorat d’interventions militaires en la réduisant à l'aide humanitaire. Il s’agit, selon le texte en circulation, d’instituer une force de 5 500 hommes, mandatée pour neutraliser, arrêter et détenir les fauteurs de violence sur la terre de liberté détachée de l'Afrique qui avait pour la première fois donné un véritable sens à la liberté et à l'essence des droits de tous les hommes et de toutes les femmes. En d’autres termes, donner corps à une puissance coercitive que l’État ayitien, démembré et exsangue, après 11 tentatives de mission déchues et (de)responsabilisées de l'ONU, n’est plus en mesure d’incarner la paix en Ayiti.
La CARICOM, dans une rare convergence, salue l’initiative et manifeste une impatience éloquente. Car chacun sait que l’insécurité en Ayiti est une contagion où les hommes armés exportent la peur au-delà de l’île, transformant la Caraïbe en poudrière et de pailles de blé aux yeux de l'ONU. De ce point de vue, la résolution n’est pas qu’un acte de charité internationale, une mèche allumée à ses deux extrémités; elle est aussi une assurance-vie cicatrisée pour les voisins réduits à mille menaces répétés.
Eu égard à cette approche, une objection se profile dans le canevas de l'histoire longue d'Ayiti et dans le calendrier des missions à la sécurité de l'ONU en Haïti : n’est-ce pas la répétition d’un vieux refrain changeant de ton à mille résonances qui se répète à chaque instant dans les tympans de la République d'Ayiti? Pourquoi depuis trois décennies, chaque mission onusienne a été saluée comme « l’ultime rempart » de la stabilité en Ayiti ? Alors que le chaos demeure et tatoué l'avenir d'Ayiti comme des varices sur la peau. L’histoire d’Haïti est jonchée de ces promesses avortées, ou manipulées ou le moins bullshétisées, où les saveurs d’hier se sont mutées en geôliers d'aujourd'hui, d'une façon ou d'une autre, ainsi de suite, l'histoire se répète.
Les poids du passé, la peur d’un éternel recommencement
Onze missions. Onze espoirs déçus. Onze démonstrations de force vouées à l’impuissance. Haïti (dans l'ONU), au fil du temps, est devenue le laboratoire de bonnes intentions et le cimetière des traces d’illusions. Peut-on, dès lors, accueillir une douzième mission sans l’ombre d’un scepticisme récurrent?
Les obstacles sont connus : absence de consensus au Conseil de sécurité, avec une Russie et une Chine promptes à brandir le Véto, (l'ONU : ce que veut dire le droit de véto), pour dénoncer l’hégémonie occidentale. Mais plus encore, l’écueil financier : contrairement aux missions financées par le budget onusien, la MMSS repose sur des contributions volontaires, tributaires du bon vouloir des États. Qu’adviendra-t-il si la générosité s’essouffle face à un conseil de perte de temps (CPT) ?
Ce doute n’est pas anodin. Car l’expérience a montré que les promesses creuses valent moins que l’absence d’intervention militaire. Une mission incomplète, mal financée, mal coordonnée, peut s’avérer pire que le statu quo. Car elle nourrit la désillusion et accroît la défiance envers l’« international communautaire » et perpétue le communautarisme de l'impérialisme occidental. Alors, que peut-on espérer sinon l’éternel recommencement d’un cycle où l’Haïtien demeure spectateur de sa propre stabilité ?
L’autonomie militaire, une épée à double tranchant
Le projet prévoit que la force déploie des opérations indépendantes, sans consultation préalable du gouvernement haïtien. Une telle disposition, conçue pour contourner la bureaucratie et la fragilité institutionnelle, suscite autant d’enthousiasme que de frayeur.
D’un côté, l’efficacité est la promesse. Face à des hommes armés qui se déplacent comme des nuées insaisissables, seule une force agile et affranchie des lenteurs diplomatiques peut frapper vite et fort. Mais d'où vient-elle : de l'ONU, ou de l'État ayitien ? Le Premier ministre Fils-Aimé l’a dit sans ambages, malgré lui : « Il faut neutraliser les groupes armés, et sans délai. ». L’heure n’est plus aux débats oiseux, mais à l’action résolue. Message délivré. Mais jusque-là bien codé.
De l’autre côté, n’est-ce pas là une dépossession ultime ? Que reste-t-il de la souveraineté d’un pays lorsque ses décisions vitales en matière de sécurité sont prises par des étrangers qui s'érigent en maître du monde et qui aident les dominés sans répit ? Peut-on se dire maître chez soi lorsque l’épée qui doit défendre la maison appartient à d’autres mains insensibles ? En tout cas, la dialectique est implacable : efficacité immédiate décidée à l'ONU contre dignité différée en millettes morceaux en Ayiti.
Les ingérences comme matrice de dépendance
Depuis trois décennies, la grammaire internationale appliquée à Ayiti est toujours la même : stabiliser sans (re)construire, intervenir sans comprendre véritablement le terrain ayitien, imposer sans réformer, missionner sans commissions valables. Qui osent dire que ces missions successives ont transformé le pays en un théâtre de manœuvres où les puissances jouent leur partition géostratégique à l'Île?
Derrière le germi-sida carottiste humanitaire se profile sans cesse répétée l’ombre des intérêts inavoués : routes maritimes sécurisées, flux migratoires contrôlés, main-d’œuvre à bas coût exploitée, bottes et hommes armés sur le sol à travers les institutions. Haïti, au lieu de recouvrer sa souveraineté, s’est manipulée par les poids du capitalisme ethnocidaire et malheureusement trouvée enchâssée dans le commerce international du crime, des armes et des trafics illicites. Le prix de cette mise sous tutelle a été lourd : une nation fragilisée, un État désinstitutionnalisé, une population réduite à l’état de spectateur dans les camps d'une Port-au-Prince sans culotte.
Ce constat résonne comme une malédiction colonialiste : une partie de l’Île qui fut jadis le berceau du premier empire noir libre se retrouve encore et toujours sous l’ombre portée d’une nouvelle servitude exigé par l'aide humanitaire.
Legs amer des onze missions onusiennes
De la MICIVIH en 1993 à la MMAS en 2024, la liste est éloquente. Droits humains, police civile, justice, stabilisation, intégration politique : chaque mission avait son mandat, son budget, son horizon et sa mission calculée. Pourtant, toutes ont laissé derrière elles un vide béant de similitudes criantes.
La MINUSTAH, la plus longue et la plus coûteuse (7,2 milliards de dollars), reste gravée comme une plaie : scandales, épidémie de choléra, exactions. Le BINUH, censé être une mission politique allégée, n’a pas inversé la trajectoire du mal des puissances extérieures de l'ONU. Quant à la MMAS, elle s’est avérée trop faible pour affronter des hommes armés qui, prétendant désormais mieux équipés que la PNH.
Le constat est implacable sinon partante : la succession de ces missions a semé plus de doutes que d’espérance à la stabilité. Chaque échec a creusé un peu plus la méfiance, chaque fiasco a nourri la conviction que l’international communautaire de l'ONU ne vient pas pour sauver, mais pour gérer un désordre utile à ses propres desseins non déclarés.
La MMAS, de l’espérance à la désillusion
En 2023, la MMAS avait suscité une ferveur rare. Enfin, une force prête à appuyer Haïti dans sa lutte existentielle contre les hommes armés. Mais l’enthousiasme s’est vite mué en désenchantement. Effectifs dérisoires, financement incertain, coordination bancale, l’espoir s’est effrité sous le poids des réalités ayitiennes.
Le Premier ministre a insisté à gorge déployée : « Il ne s’agit pas de substituer l’international à l’État, mais de donner à Haïti les moyens de sa stabilisation. » Une formule noble, mais qui sonne comme une supplique de roue colonialiste sur la tête des esclavagisés des noirs. Car dans les faits, la MMAS a surtout révélé l’impuissance : attendre l’aide extérieure, constater l’inaction, subir la progression des hommes armés comme des agents d'un autre territoire.
Chaque jour d’attente, répète Monsieur Fils-Aimé, est un jour gagné par les criminalisés. La MMAS, au lieu d’être le glaive, s’est muée en symbole d’un surplace tragique, notamment à Kenscoff et à Port-au-Prince. Un pays malgré leur présence à stabiliser le gouvernement est voué à l'implosion.
La sécurité d’Ayiti, un enjeu régional et universel
Laisser prospérer les réseaux de criminalité en Ayiti, c’est accepter la propagation d’un incendie régional. Les armes, les drogues, l’argent sale circulent, franchissent les frontières et nourrissent un crime transnational sous l'aile inavouée de l'OEA et de l'ONU. C'est pour dire que la question ayitienne dépasse donc ses frontières : elle devient une bombe à retardement pour la Caraïbe et pour le monde, croit-on.
Mais cette prise de conscience méticuleuse n’efface pas les doutes. Car en quoi une mission internationale peut-elle comprendre la complexité linguistique, culturelle et territoriale d’Ayiti ? Ou du moins peut-elle agir sans froisser l’orgueil d’une population qui a bâti son identité sur la lutte pour la liberté et l'égalité des genres ?
A côté de ce point de vue, la PNH reçoit de nouveaux blindés, signe que l’effort national tente encore de subsister. Mais la disproportion reste criante pourtant. Des policiers mal équipés contre des hommes dits surarmés. La mission onusienne, comme toujours existée en Ayiti comme soutien ; mais passe toujours à côté de l'attention des Ayitiens. Ainsi Ayiti perd-t-elle toujours jusqu’à son dernier attribut de sa souveraineté.
L’énigme ayitienne face au dilemme universaliste diplomatique
Ainsi se dessine le paradoxe ayitien : un pays qui ne peut survivre sans aide, mais qui se renie s’il accepte l’aide comme tutelle. Une nation qui a jadis éclairé le monde en brisant les chaînes du mal du monde, et qui, aujourd'hui, se débat face à un ordre mondial capitaliste dans des fers invisibles au bénéfice de trafiquants et de l'hégémonie occidentale, trébuche face à l'insécurité grandissante.
La douzième mission onusienne, si elle voit le jour, ne pourra se montrer le petit doigt à l’échec qu’à une condition : qu’elle tente comme aux années précédentes rompt le cercle vicieux des interventions palliatives pour s’ancrer dans une logique de (re)construction endogène pour gouverner à la place des autorités ayitiennes, prétextant leur redonner les moyens de se gouverner eux-mêmes.
Attend-t-on donc à la répétition de l’histoire : une nouvelle mission, une nouvelle désillusion, et une population une fois de plus trahie, meurtrie, mâchée ses hanches dans la misère. Plus d'un le savent que Ayiti ne demande pas d’être assistée, contrôlée par l'international communautaire de l'ONU; mais elle exige d’être respectée, de lui laisser la voix de choisir son revêtement idéologique pour se porter vers la politique de l'autosuffisance gouvernementale en développant des rapports diplomatiques internationaux gagnant-gagnants avec les Etats qui lui conviennent comme bon lui semble. Et c'est là que réside toute la différence entre une tutelle de plus et une véritable fraternité des nations.
Ayiti se tient, une fois de plus, à la croisée des chemins d'une occupation militaire. Plus d'un s’en soufflent. La résolution votée à New York promet sécurité et stabilité, mais l’Histoire nous a appris que les promesses des puissants se muent souvent en illusions ou en make-up désinfectant la liberté, l'autosuffisance gouvernementale et s'attaquent directement à l'intégrité et la souveraineté nationale. Onze fois déjà, la communauté internationale s’est déployée sur ce sol meurtri, et onze fois la plaie s’est refermée sans cicatriser. Alors, faut-il croire à ce douzième élan, ou se préparer à une nouvelle désillusion ou à une opération de césarienne pour une chirurgie en mal makak? Jusqu'à quand ce masque tombera du visage de l'ONU dans les affaires des Ayitiens ?
En tout cas, la vérité est crue jusque-là : aucune armée étrangère ne sauvera Ayiti sans les Ayitiens, après onze tentatives de plus de trente ans. La force militaire peut réduire un foyer d’incendie, le sait-on, mais elle ne rallumera pas les flammes de la confiance, de la justice et de la dignité nationale. C’est à la nation elle-même, dans ses institutions, dans sa jeunesse, dans sa mémoire historique, qu’il revient de reprendre la main.
L’intervention annoncée peut être une paire de béquilles provisoires, mais elle ne saurait être un destin de longue date. Car si Ayiti doit renaître, ce n’est ni sous les bottes des agents de l'ONU ni de l'OEA, ni non plus, sous la tutelle de l'International communautaire occidentaliste, mais dans la clairvoyance d’une population qui refuse l’asservissement et choisit enfin la voie de l’émancipation, suivant les traces de son passé historique via une politique de l'autosuffisance. Voilà l’urgence qui craque : que l’aide étrangère soit un souffle par intermittence, non une chaîne d'histoire qui devient de plus en plus naturelle avec quoi l'État haitien s’habitue; et que l’avenir de ce grand pays s’écrive par et pour les Ayitiens.
joseph.elmano_endara@student.ueh.edu.ht
Formation : Masterant en Fondements philosophiques et sociologiques de l’Éducation/CESUN Universidad, California, Mexico; Juriste- Sciences Juridiques/FDSE, Communication sociale/Faculté des Sciences Humaines (FASCH/UEH)