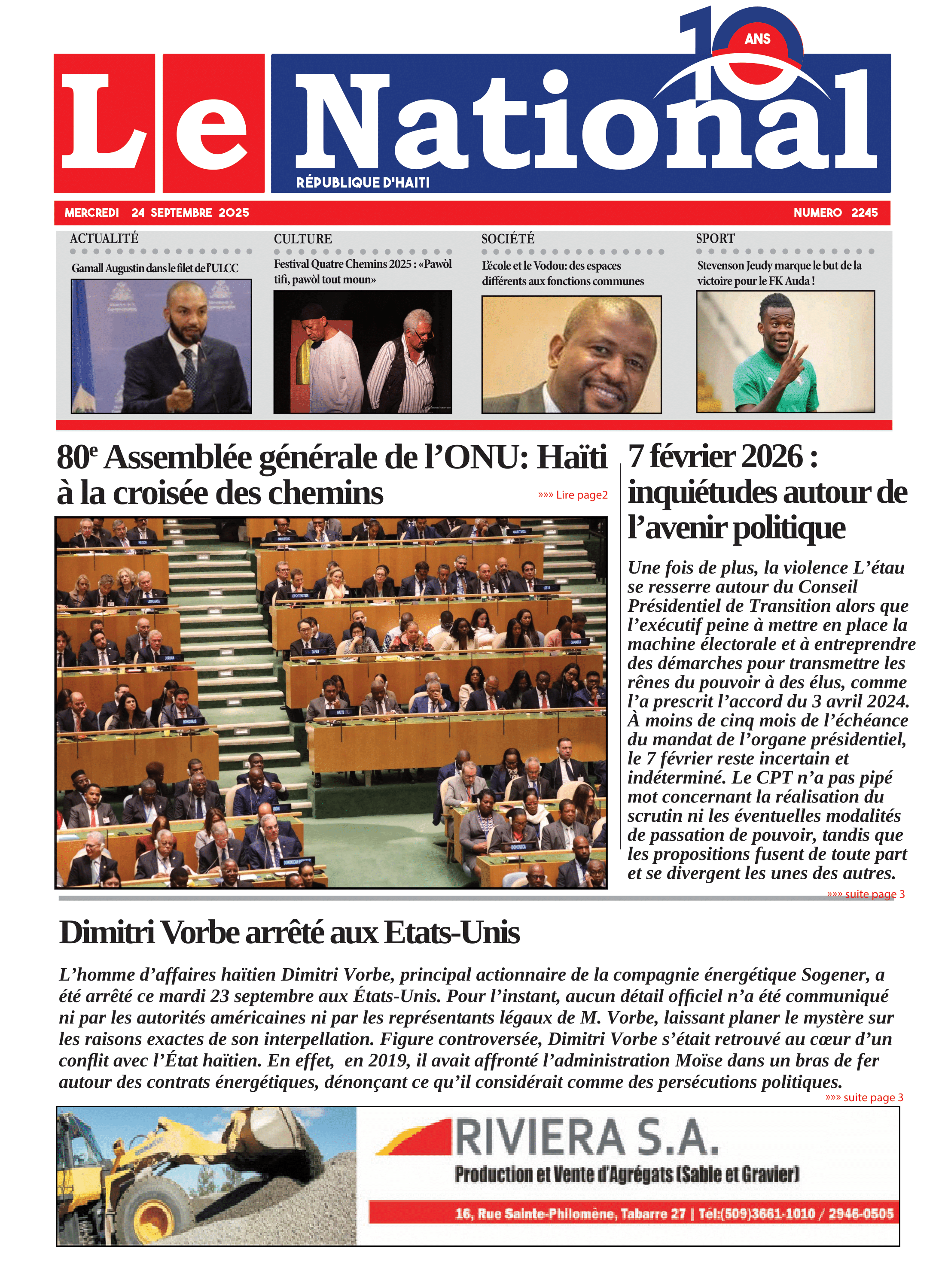Partie II
Par Savannah Savary
L’effondrement de l’État et la prise du pouvoir pas les gangs.
Le point de rupture : la désagrégation du pouvoir judiciaire. Le point de rupture fut ce coup de grâce asséné par Jovenel Moïse à l’architecture institutionnelle du pays, la révocation illégale d’un acteur central scella l’effondrement du pouvoir judiciaire. En 2019, Jules Cantave, président de la Cour de cassation, fut évincé de manière illicite, au mépris de la séparation des pouvoirs et garanties prévues par la Constitution de 1987. La Cour de cassation, plus haute juridiction haïtienne en matière civile, commerciale et pénale, est garante de l’interprétation du droit et de la séparation des pouvoirs. Ses juges sont nommés par le président mais seulement après avis du Sénat, ce qui assure un équilibre institutionnel. L’éviction de Jules Cantave fut perçue comme une manœuvre politique de Jovenel Moïse, visant à neutraliser une institution capable de freiner son autorité, notamment dans le dossier PetroCaribe. Elle a déstabilisé le mécanisme de succession constitutionnelle et ouvert la voie à l’arbitraire. Ce geste du président ne relevait pas seulement d’un excès de pouvoir, il marquait une rupture symbolique avec le principe fondamental de l’indépendance de la magistrature, socle de tout état de droit. À la suite de cette destitution, le vide laissé à la tête de la Cour plongea la justice haïtienne dans une fragilité inédite. L’absence de stabilité et de légitimité au sein de la plus haute juridiction du pays accentua le sentiment d’un État livré aux improvisations d’un exécutif tentaculaire. Ce n’est qu’en novembre 2022 que Jean Joseph Lebrun fut nommé à ce poste, dans un contexte déjà délégitimé, où le rétablissement de la confiance citoyenne apparaissait hors de portée.
L’ébranlement des organes de contrôle. Le séisme institutionnel ne s’arrêta pas là. Peu après, la tension monta autour de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif (CSCCA), pierre angulaire de la reddition des comptes et de la transparence publique. Déjà affaiblie par des nominations contestées, la CSCCA se retrouva en première ligne lors de la publication, en 2019, d’un rapport d’audit sur le programme Petrocaribe. Ce rapport, résultat d’un travail minutieux, mit en lumière des dysfonctionnements massifs. Détournements de fonds atteignant plusieurs milliards de dollars américains, initialement destinés à des projets d’infrastructures et de développement social. Attribution de contrats opaques et irréguliers, souvent sans appels d’offres, à des entreprises liées à des proches du pouvoir. Non-exécution de projets, malgré les décaissements effectués, révélant un système où la corruption devenait une norme plutôt qu’une exception. Ces révélations firent éclater le scandale Petrocaribe et déclenchèrent une vague de contestations sociales sans précédent depuis 1986, marquée par le slogan devenu cri de ralliement : « Kot Kòb Petrocaribe a ? ». Face à cette pression populaire, l’Exécutif tenta d’affaiblir, voire de neutraliser, les prérogatives de la CSCCA. Des voix proches du pouvoir cherchèrent à remettre en cause son autorité, certains allant jusqu’à évoquer sa transformation en simple organe consultatif.
L’érosion programmée des contre-pouvoirs. La révocation contestée de Jules Cantave à la tête de la Cour de cassation, puis les tentatives de neutralisation de la Cour supérieure des comptes (CSCCA) après la publication du rapport Petrocaribe, marquent deux étapes décisives. Dans les deux cas, le pouvoir exécutif a porté atteinte aux piliers censés garantir la séparation des pouvoirs et la reddition des comptes. Or, quand le judiciaire et l’organe de contrôle budgétaire perdent leur indépendance, l’État cesse d’exercer sa fonction de régulation et s’affaiblit dans ses fondements.
Le vide créé par l’effondrement de l’État de droit. Privé de justice crédible et de mécanismes de contrôle financier, l’appareil d’État s’est vidé de sa substance. Les citoyens, ne trouvant plus recours auprès des tribunaux, se sont tournés vers des solutions locales, souvent imposées par la force. L’impunité généralisée a renforcé l’idée que le crime paie, encourageant l’essor de structures armées capables d’offrir une protection, une vengeance ou un arbitrage rapide, là où la justice officielle échouait.
La conquête des fonctions régaliennes par les gangs. Dans ce vide, les gangs ont commencé à occuper l’espace étatique, en imitant ses prérogatives. Monopole de la violence : contrôle de quartiers, de routes, de ports informels, établissement de check-points et taxation illégale. Fonctions judiciaires : règlements de conflits locaux, justice expéditive, imposition de sanctions. Fonctions sociales : distribution d’eau, redistribution de ressources, organisation d’événements ou de funérailles, instruments de clientélisme qui cimentent leur légitimité. Peu à peu, la population a dû reconnaître leur autorité non par adhésion, mais par nécessité de survie.
La normalisation d’un pouvoir parallèle. L’absence d’un État protecteur et impartial a fait des chefs de gangs des acteurs incontournables. Ils sont passés du statut de simples criminels à celui de « gestionnaires de territoire », interlocuteurs obligés pour les habitants mais aussi, parfois, pour des représentants politiques ou économiques. Cette transformation n’aurait pas eu lieu si les contre-pouvoirs institutionnels, la Cour de cassation, le CSCCA, le Parlement avaient pu jouer leur rôle. Leur neutralisation a été le terreau sur lequel s’est enracinée cette nouvelle forme de souveraineté armée.
Une substitution silencieuse mais totale. Ainsi, l’enchaînement d’attaques contre les institutions n’a pas seulement affaibli l’État, il a préparé la scène pour son remplacement. Dans de larges portions du territoire, la République n’existe plus qu’en théorie. Les gangs ont récupéré les attributs régaliens, imposant une forme de gouvernance parallèle où la loi se confond avec la volonté de ceux qui détiennent les armes.
Les institutions à l’abandon : une transition sous contrôle externe. Après l’assassinat de Jovenel Moïse en juillet 2021, aucun président n’a été élu, ouvrant une vacance de pouvoir d’une gravité inédite dans l’histoire contemporaine du pays. Le gouvernement est resté discoordonné, marqué par la nomination contestée d’Ariel Henry, choisi dans l’ombre des négociations diplomatiques, perçu comme imposé par le « Core Group », groupe d’ambassades influentes, États-Unis, France, Canada, Union européenne, les Nations unies et l’Organisation des États américains, se réclamant amis d’Haïti. Sous couvert d’amitié et de « stabilité », cette démarche a été interprétée par de larges segments de la société haïtienne comme l’acte fondateur d’une tutelle internationale déguisée. Au lieu d’un mandat issu de la volonté populaire, le pouvoir exécutif s’est trouvé adossé à une légitimité empruntée, dépendante de soutiens extérieurs, sans enracinement démocratique interne. Selon les tenants du concept, cette transition reflète davantage une tutelle que la souveraineté haïtienne. Les tenants du pouvoir, affaiblis, peinent à imposer leur légitimité, alors que la population, désabusée, est laissée à elle-même.
Depuis, la République s’apparente à un État fantôme. Le Parlement est absent, dissous par le temps et l’inertie politique. Le pouvoir exécutif, réduit à un Premier ministre aux ordres de puissances étrangères, peine à s’imposer comme autorité respectée. Quant au pouvoir judiciaire, déjà ébranlé par la révocation de Jules Cantave et les attaques contre la Cour supérieure des comptes, il s’est retrouvé incapable de jouer son rôle d’arbitre. La société civile, longtemps foyer de résistance et d’innovation, s’est trouvée désarmée, marginalisée par des rapports de force où les armes parlent plus fort que les urnes. Ce vide institutionnel a nourri un sentiment collectif d’abandon : une population désabusée, condamnée à survivre dans l’anomie, sans médiation ni protection de l’État. Cette transition, censée rétablir un semblant d’ordre, a au contraire approfondi la dépendance. En plaçant les clés de la stabilité entre des mains étrangères, le Core Group a conforté l’idée que l’État haïtien ne pouvait plus se sauver par lui-même. Ce glissement a eu des effets politiques et psychologiques dévastateurs, sapant la confiance nationale, affaiblissant encore davantage les élites locales et ouvrant la voie à la montée irrésistible des pouvoirs parallèles.
L’État captif des gangs : une puissance parallèle. En 2025, les chiffres sont édifiants, plus de 1 600 morts en seulement trois mois, plus d’un million de déplacés, et 85 % de la capitale entre les mains des groupes armés. Le portrait d’un pays en naufrage. Le terme insécurité combien utilisé pour décrire la situation gangrenée du pays, devient plutôt une délinquance institutionnalisée, règle de fonctionnement d’un territoire livré aux armes. Là où l’État devrait garantir l’ordre, ce sont désormais des coalitions de gangs qui imposent leurs couvre-feux, taxes, sanctions, et administrent des fragments entiers de la cité. Le pouvoir des caïds ne se limite plus à la violence, il s’étend à l’économie informelle, au contrôle des routes, au commerce et jusqu’aux négociations avec des acteurs extérieurs. Une oligarchie armée a émergé, fruit monstrueux de l’abandon institutionnel et du vide politique. Ses chefs, souvent jeunes mais dotés de ressources colossales, dictent leurs conditions non seulement à la population, mais aussi au gouvernement démissionnaire réduit à l’impuissance et condamné à la passivité.
Le contraste est saisissant. Un pouvoir officiel qui prétend incarner l’État tout en étant incapable d’assurer la sécurité la plus élémentaire. Des seigneurs de guerre urbains qui gouvernent par la terreur et l’arbitraire. L’État haïtien, déjà affaibli par des décennies d’attaques contre ses institutions, se trouve aujourd’hui oblitéré par la voracité des gangs, au point de n’être plus qu’une façade fragile derrière laquelle prospère un pouvoir parallèle. Ce basculement marque une rupture historique. Pour la première fois depuis l’indépendance, le monopole de la violence légitime a été intégralement transféré à des acteurs privés armés, érigés en maîtres du territoire. La nation pionnière de la liberté se retrouve aujourd’hui prisonnière de ses propres failles institutionnelles, prisonnière d’un État devenu captif. La République, vidée de ses attributs régaliens, se retrouve littéralement prise en otage par des forces criminelles qui dictent leur loi.
Les protagonistes de cette dérive : oligarchie, CPT, Alix Fils-Aimé. Le pouvoir parallèle exerce sa mainmise au gré de l’apathie étatique, un ordre informel mais terriblement contraignant. Si les gangs apparaissent comme les nouveaux maîtres visibles du territoire, leur ascension ne s’explique pas seulement par la force des armes. Elle est aussi le produit d’une complicité structurelle, d’alliances tacites et de l’inertie calculée de ceux qui tirent les ficelles dans l’ombre. Derrière l’effacement de l’État se profile une oligarchie économique et politique, vieille de plusieurs décennies, qui a appris à prospérer sur le chaos. Constituée de familles, d’entreprises et de clans solidement ancrés dans les rouages financiers du pays, l’oligarchie haïtienne n’a jamais cherché à construire un État fort. Au contraire, cette classe d’hommes et de femmes méprisable et méprisante a toujours œuvré à affaiblir l’État, pour mieux préserver ses privilèges. Ses membres, souvent reliés à des réseaux internationaux, s’accommodent de l’insécurité tant qu’elle n’entrave pas leurs affaires ; certains y voient même une opportunité de renforcer leur emprise sur des secteurs clés tels importations, télécommunications, infrastructures, finance parallèle.
À cette matrice s’ajoute le Conseil présidentiel de transition (CPT), dont la légitimité est plus que contestée. Présenté comme une solution de sortie de crise, il est perçu par beaucoup comme une usurpation de souveraineté, un pouvoir occulte qui se déploie sans contrôle démocratique ni contre-pouvoir effectif. Le CPT, en occupant les interstices laissés par la décomposition institutionnelle, impose un ordre informel mais terriblement contraignant. Ses décisions, prises loin du regard du peuple, renforcent le sentiment d’un État confisqué. Au centre de ce dispositif, le Premier ministre Didier Alix Fils-Aimé incarne, pour une large frange de l’opinion, cette captation du pouvoir par une minorité. Loin d’apparaître comme un chef de gouvernement capable d’incarner l’autorité nationale, il est décrit dans de nombreuses analyses comme le serviteur d’une oligarchie corrompue, prisonnier de réseaux de connivence et d’intérêts privés. Sa gouvernance ressemble à une machine rouillée, qui s’active pour maintenir en place le statu quo au service de quelques-uns, plutôt que de porter une vision de bien commun et de redressement collectif.
Ainsi se dessine un triangle pervers. Les gangs qui règnent par la violence, l’oligarchie qui préserve ses privilèges, et le CPT qui orchestre dans l’ombre une transition sans légitimité, le tout sur fond d’un gouvernement impuissant et discrédité. C’est cette configuration hybride, un mélange de force brute, de manipulation politique et d’abandon institutionnel qui a plongé Haïti dans une situation de quasi-non-État ou, pour reprendre l’expression consacrée, d’entité ingouvernable.
Savannah Savary
Contact de l’auteure : savannahsavary@yahoo.com | +509 36 49 57 37