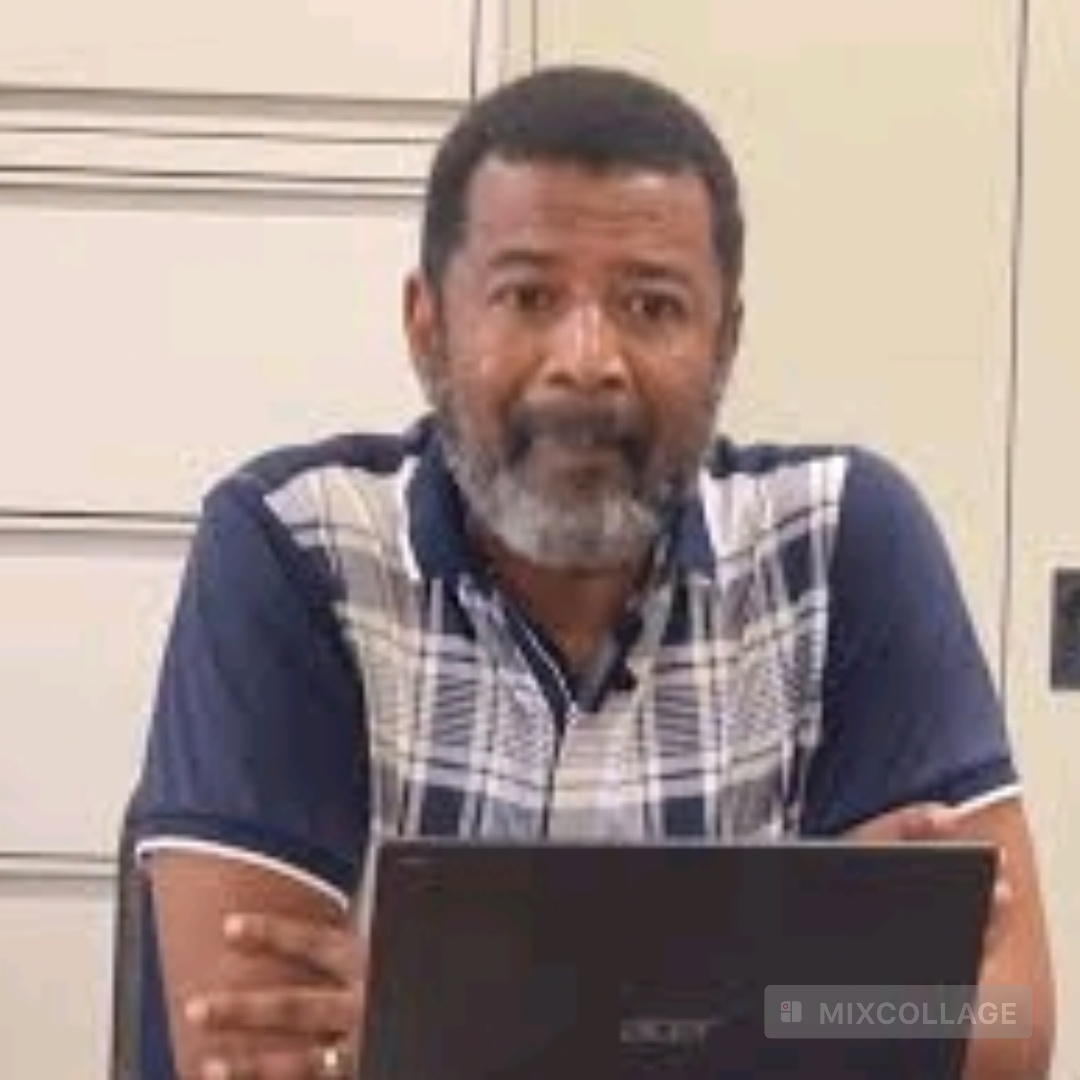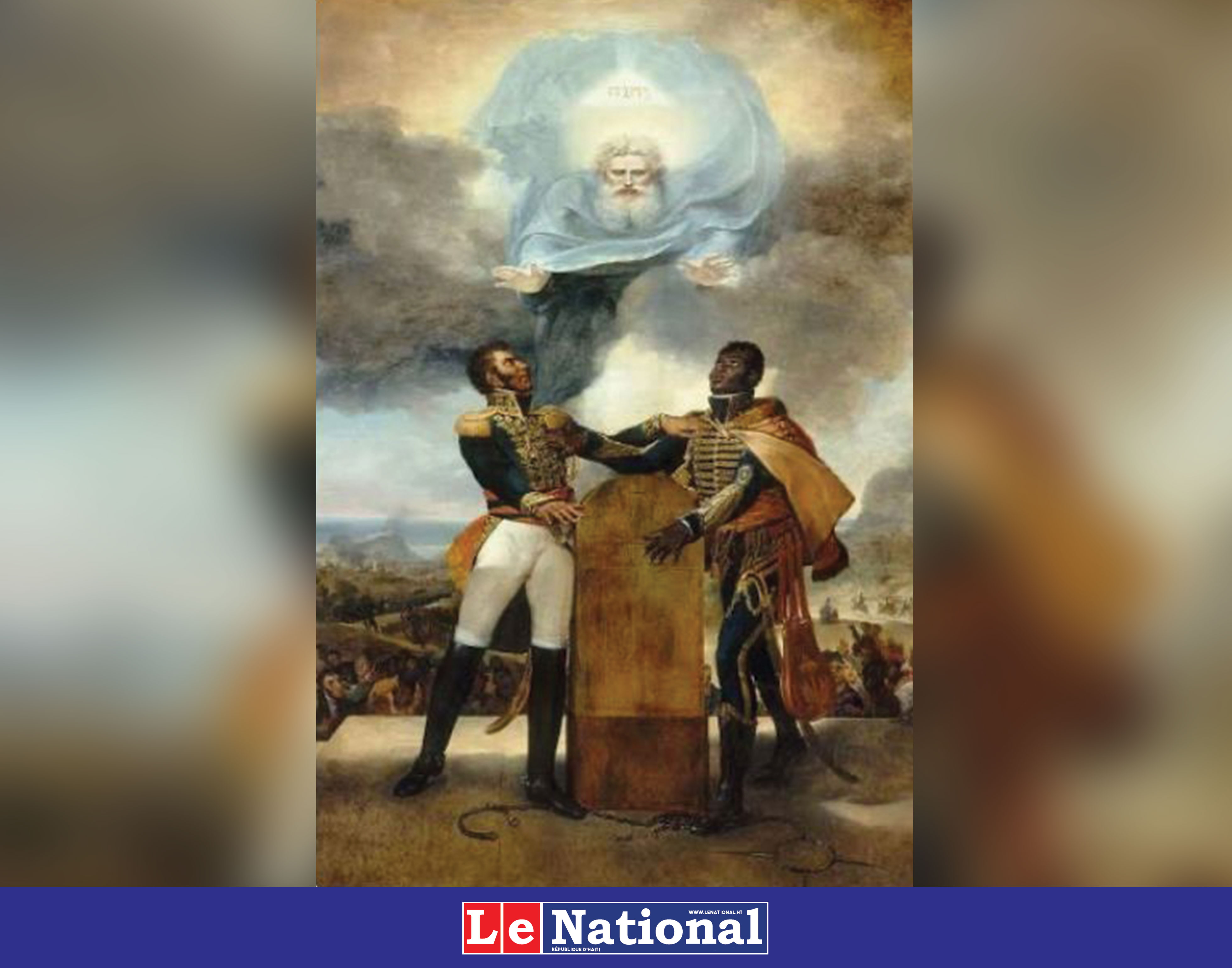Par Dr Jean Gardy Marius
En 2025, plus de 12 millions d’Haïtiens vivent dans un pays où l’accès aux soins de santé relève du miracle. Pendant que des milliers de familles cherchent en vain un médecin, un lit d’hôpital ou un simple médicament, l’État reste muet, laissant la crise sanitaire s’aggraver sans réponse efficace. Ce dysfonctionnement n’est plus un simple défaut organisationnel : il s’apparente à un abandon collectif, nourri par l’incompétence et la corruption qui gangrènent les institutions publiques.
Un système de santé à bout de souffle
Les données sont sans appel. Haïti compte environ 25 médecins pour 100 000 habitants, soit 0,25 médecin pour 1 000 personnes. Ce chiffre est dramatiquement bas, loin en deçà du seuil minimal de 4,45 médecins pour 1 000 habitants recommandé par l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Dans un pays où moins de 16 000 professionnels de santé sont recensés, la majorité d’entre eux est concentrée dans les zones urbaines, laissant les régions rurales quasiment dépourvues de soins.
La comparaison avec nos voisins illustre crûment cette fracture : Cuba dispose de plus de 84 médecins pour 10 000 habitants, la République dominicaine entre 20 et 22, alors qu’Haïti peine à en compter deux. Ce déséquilibre témoigne de choix politiques qui orientent les ressources vers d’autres secteurs, ou pire, vers des poches privées, au détriment de la santé publique.
Un investissement dérisoire qui révèle des priorités
Alors que le monde entier reconnaît que la santé est un moteur essentiel du développement humain et économique, Haïti consacre à peine 0,43 % de son produit intérieur brut (PIB) à ce secteur. En comparaison, la République dominicaine investit près de 5 %, et Cuba plus de 11 %. Cette disparité manifeste traduit une négligence délibérée, un désintérêt politique qui, loin d’être un hasard, est symptomatique d’un État aux priorités déséquilibrées.
L’argent existe, mais il est détourné, dilapidé ou englouti dans des réseaux de corruption, alimentant un système opaque où les fonds publics ne parviennent pas à leur destination. Pendant ce temps, les hôpitaux s’effondrent, les maternités manquent de matériel, et les patients se retrouvent livrés à eux-mêmes dans des établissements à bout de souffle.
Insécurité et corruption : un cocktail mortel pour la santé publique
L’insécurité chronique qui ravage le pays aggrave encore davantage ce tableau déjà sombre. La fuite des professionnels de santé, l’arrêt de certains services hospitaliers sous la menace des gangs, le non-paiement des salaires des infirmières et ambulanciers : autant de facteurs qui minent le système.
La politisation des établissements hospitaliers, le détournement des fonds internationaux et l’impunité généralisée des gestionnaires publics ont transformé la santé en un terrain de prédation. Seuls les plus riches ou ceux disposant de relations peuvent espérer bénéficier de soins adaptés, accentuant les inégalités et creusant la fracture sociale.
Ce que certains appellent un « génocide médical silencieux » se déroule au grand jour, sans que la communauté internationale ou la classe politique locale ne parviennent à renverser la tendance. Chaque jour, des vies sont perdues faute d’un accès adéquat aux soins, tandis que le pays s’enfonce un peu plus dans la crise.
Un appel à la mobilisation citoyenne
Il ne s’agit plus d’envisager des réformes cosmétiques, mais d’adresser une question de survie pour toute la nation. La dégradation du système de santé est une blessure profonde, une honte que le peuple haïtien ne peut plus accepter.
Il est impératif de réclamer des comptes, d’exiger transparence et responsabilité dans la gestion des fonds publics. L’heure est venue d’unir les forces vives du pays autour d’un projet clair : construire un système de santé accessible, équitable, efficace et respectueux de la dignité humaine.
Le droit à la santé doit cesser d’être un privilège réservé à une élite. C’est un droit fondamental, indispensable à la reconstruction d’Haïti. Ce combat passe par une prise de conscience collective, un engagement citoyen fort, et une pression constante sur les autorités, nationales et internationales.
Haïti est un pays de résilience. La santé ne peut rester à la marge de cette résilience. Pour que demain, aucun Haïtien ne meure plus en silence, il faut agir aujourd’hui.
Dr Jean Gardy Marius
Spécialiste en santé globale
Ancien consul général d’Haïti à Santiago, République dominicaine