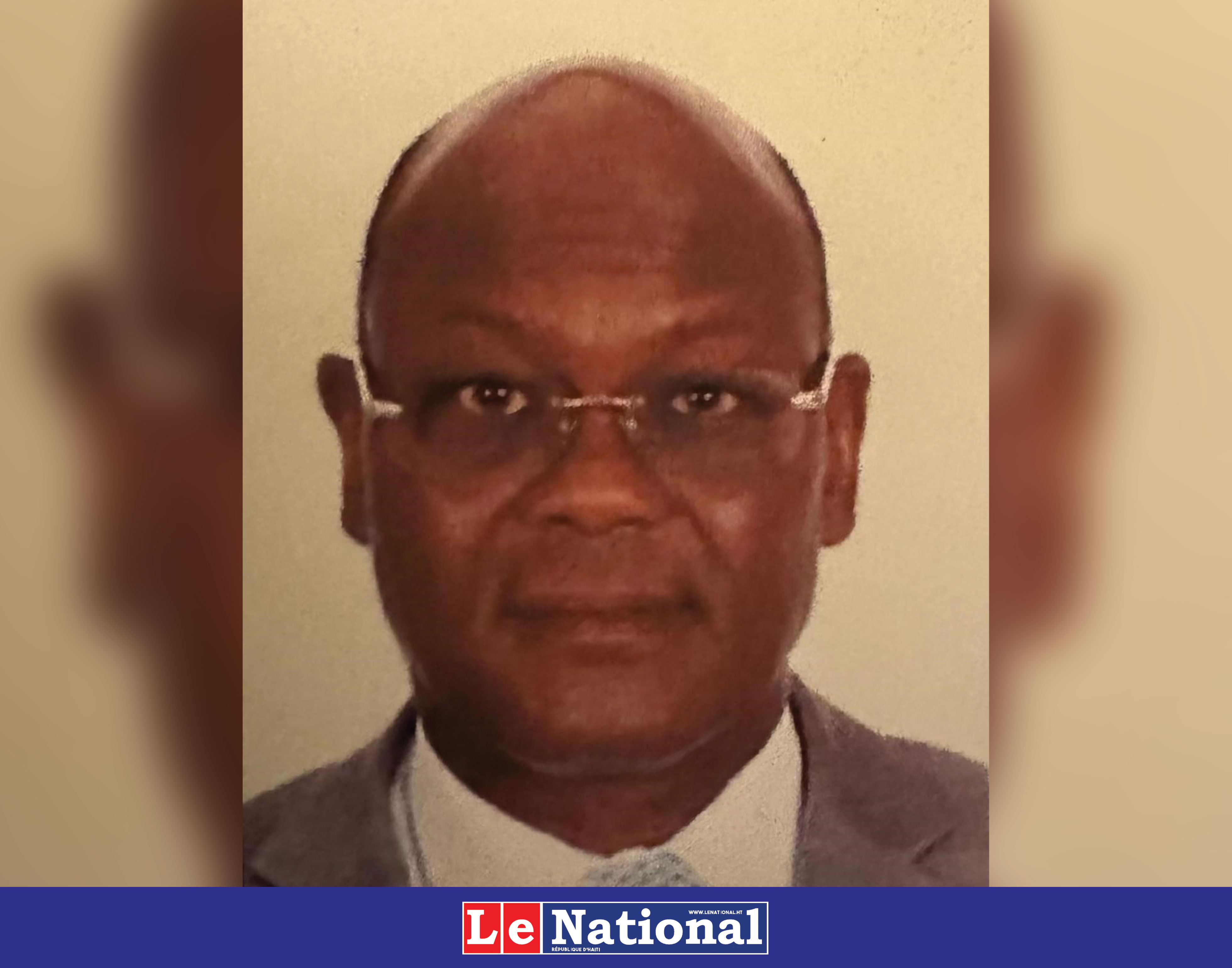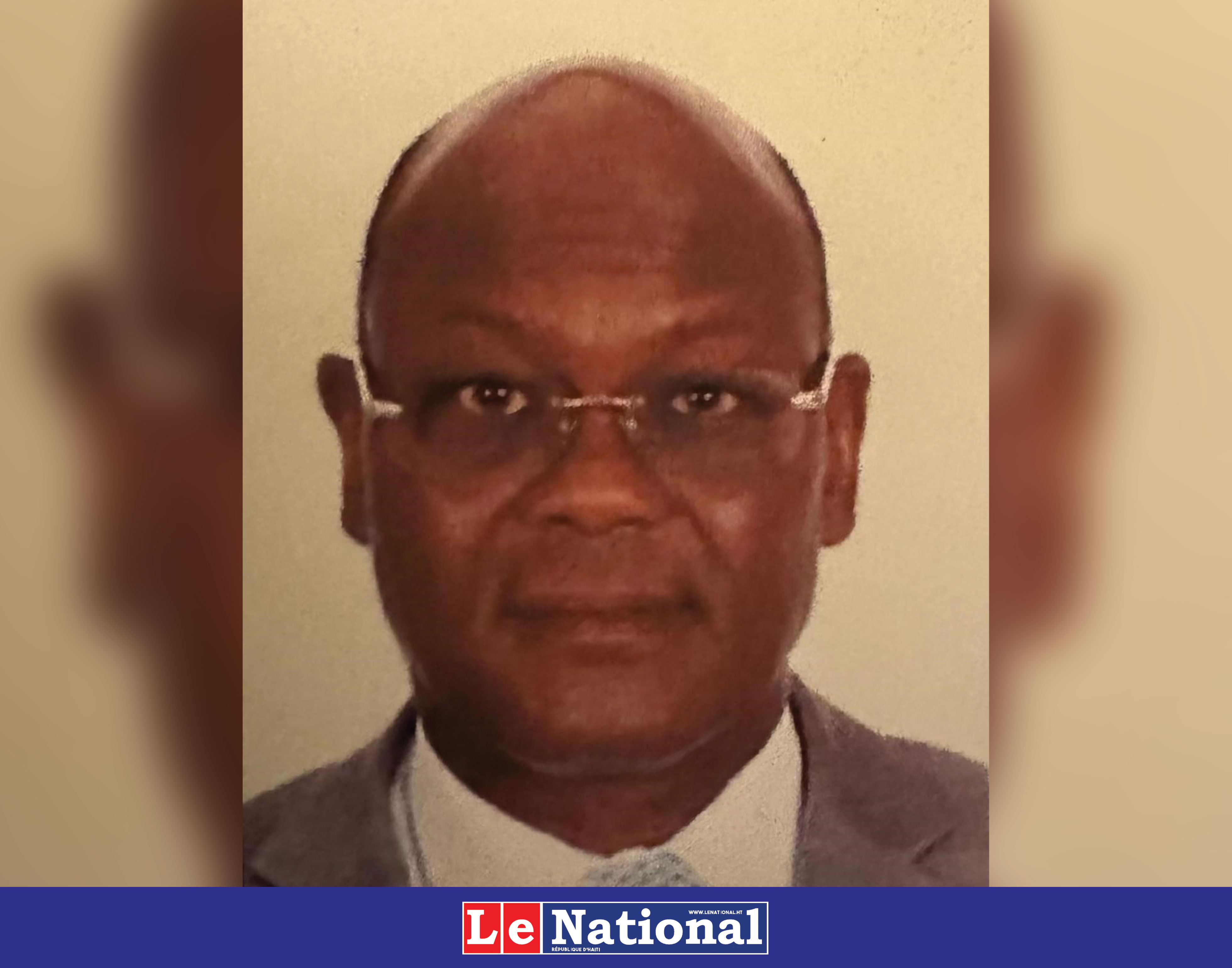Pour se porter candidat aux élections, il faut être propriétaire ; mais en Haïti, prouver sa propriété relève du parcours du combattant, faute de cadastre fiable. Une situation qui s’est, aujourd’hui, aggravée avec les déplacements forcés liés à l’insécurité. À la veille des élections annoncées, c’est le moment d’évoquer ce problème majeur, d’en connaître l’origine et ce qu’il faut faire pour s’y attaquer.
Jusqu’ici, les titres de propriété habituellement présentés au Conseil électoral ont toujours été acceptés sans vérification. Or, si cette question est souvent traitée à la légère, tout ce qui touche à la nationalité, au domicile et à la résidence du candidat fait, en revanche, l’objet d’un examen minutieux lors des élections — au point de déboucher régulièrement sur des contentieux.
Il est vrai qu’il n’appartient pas au CEP de vérifier si les documents de propriété sont corrects. Il faut une instance chargée de s’en occuper, et pas uniquement lors des consultations électorales. N’en déplaise à l’État, qui inscrit dans tous les documents officiels des citoyens le titre de propriétaire, même lorsqu’ils ne le sont pas. Juste après le nom, la date, le lieu de naissance, vient cette formule sacramentelle : « propriétaire, demeurant et domicilié à ». Quelle absurdité !
Nous savons que la résolution de ce problème majeur n’est pas aisée. La question foncière est profondément enracinée dans la société. Alors que l’on dit souvent qu’un problème bien défini est à moitié résolu, l’insécurité foncière en Haïti semble échapper à cette logique : malgré son ancienneté et sa visibilité, elle reste irrésolue et s’est aggravée au fil du temps, au point de constituer aujourd’hui une véritable crise nationale.
Cela remonte à l’Indépendance
Les conflits liés à la terre remontent à l’Indépendance et traversent l’histoire haïtienne. Vieux comme le monde, le problème foncier en Haïti remonte à la distribution initiale des terres après l’indépendance et aux politiques mal encadrées des premiers dirigeants, comme Alexandre Pétion. Historiquement, les tensions foncières opposaient surtout paysans et citadins, mais elles ont évolué avec les crises politiques, les catastrophes naturelles (séisme de 2010) et plus récemment l’essor des gangs armés. Au lieu de simples litiges civils, elles sont devenues des contentieux complexes, souvent violents.
Le tremblement de terre a conduit à la destruction de repères cadastraux, de documents officiels et d’archives, provoquant une insécurité foncière massive. L’État, dépassé, a pris des mesures improvisées, notamment en installant des sinistrés sur des terrains privés et publics sans cadre légal. Cette gestion hasardeuse a multiplié les invasions de terrains et créé une nouvelle catégorie de « faux propriétaires ».
L’essor des gangs a commencé à partir de 2018. Au fur et à mesure, des milliers de familles ont été violemment dépossédées de leurs maisons et terres. Les bandits s’approprient non seulement les biens immobiliers mais aussi mobiliers, détruisant les preuves de propriété. On estime aujourd’hui à des milliers d’hectares de terres cultivables et des centaines de maisons bâties sont aux mains de groupes armés.
Cette dépossession systématique, assimilable à un « châtiment collectif », a plongé le pays dans une crise foncière d’une brutalité inédite.
L’évolution de l’insécurité foncière
Autrefois, l’insécurité foncière reposait surtout sur des conflits dits « traditionnels » : querelles d’héritage, contestations de limites, fraudes notariales. Si ces litiges étaient fréquents, ils restaient dans une logique civile.
Mais depuis 2010, et surtout avec l’irruption des gangs, la situation a pris une tournure dramatique. La dépossession violente, les expulsions armées et l’effacement des preuves légales de propriété ont transformé la crise en un véritable désastre national. Selon les données diffusées par la presse locale, plus d’un millier de biens immobiliers bâtis sont aujourd’hui au centre de nouveaux litiges, et le phénomène touche toutes les classes sociales.
L’insécurité foncière affecte profondément la société haïtienne. Elle fragilise les familles modestes, détruit la confiance dans l’État et nourrit un climat d’anarchie où la loi du plus fort prévaut. Devenue une crise nationale, elle menace la cohésion sociale, la stabilité politique et la survie économique du pays. Par exemple, la perte des terres cultivables compromet la sécurité alimentaire et accentue la pauvreté. La dépossession de maisons en zone urbaine accroît aussi les problèmes de logement, d’exode interne et de vulnérabilité sociale. Les paysans, en particulier, sont les principales victimes : souvent analphabètes et dépourvus de ressources, ils ne peuvent défendre leurs droits devant des tribunaux. C’est principalement dans les tribunaux de paix qu’on trouve le plus de malversations : des juges peuvent dresser des constats avec deux personnes, l’une propriétaire et l’autre non (celle-ci s’étant procuré un faux titre). Il arrive aussi qu’aucun des deux ne soit propriétaire. On apprend même qu’un juge de paix peut dresser plusieurs constats pour une seule propriété, au profit de « propriétaires » munis de faux titres. D’ailleurs, ce sont eux qui fixent le prix du constat, l’État étant absent. Cette pratique alimente la corruption et l’anarchie foncière.
Droit coutumier et droit positif
Les problèmes liés aux titres de propriété ont aussi à voir avec la coexistence entre droit coutumier et droit écrit, et la corruption du système judiciaire. Les tribunaux, calqués sur des modèles occidentaux, ne disposent pas des bases juridiques claires pour trancher efficacement, et leur fonctionnement est largement discrédité. De plus, l’article 36 de la Constitution de 1987, qui reconnaît explicitement le droit à la propriété, reste largement inappliqué. L’absence de lois d’application et l’instrumentalisation politique des conflits fonciers ont aggravé la méfiance des citoyens envers les institutions.
Ce qui fait que les transactions foncières – achats, ventes, héritages – sont souvent entachées de fraudes : faux papiers, complicité de notaires, juges ou fonctionnaires, ou encore manœuvres de mauvaise foi. Ces pratiques touchent toutes les couches mais en particulier les populations modestes et analphabètes, qui manquent de moyens pour défendre leurs droits.
L’État haïtien, censé être garant de la sécurité foncière et détenteur du monopole de la violence légitime, a progressivement perdu sa crédibilité. Sa faiblesse structurelle, les pratiques de corruption et son incapacité à faire respecter la loi ont ouvert la voie à des acteurs non étatiques qui imposent leur propre logique, souvent par la force.
L’insécurité foncière en Haïti illustre la faillite d’un État incapable de protéger ses citoyens et leurs biens. Sa responsabilité est centrale. En ne protégeant pas les droits fonciers, en tolérant la corruption judiciaire, en échouant à appliquer la Constitution et en gérant mal les catastrophes, il est devenu lui-même producteur d’insécurité. Son inaction laisse le champ libre aux gangs, aux spoliateurs et aux « faux propriétaires ».
Loi insuffisante
Le rôle de garant de la justice et de la sécurité foncière n’a pas été assumé. La société haïtienne se retrouve ainsi privée de tout mécanisme fiable de protection de la propriété privée.
Ce problème a transformé le droit de propriété en une source permanente de conflits et d’injustices.
La Constitution de 1987 avait introduit des mécanismes de réparation, notamment des clauses, visant à permettre aux victimes de spoliations politiques (surtout sous Duvalier) de récupérer leurs biens. L’article 293, par exemple, annulait les décrets d’expropriation dont l’objectif n’avait pas été réalisé dans les dix ans. La disposition suivante (art. 293-1). L’article 293-1 offrait une procédure accélérée aux victimes de confiscations d’ordre politique pour récupérer leurs biens.
Mais ces dispositions, adoptées dans la précipitation, ont manqué de rigueur juridique. Elles ont ouvert la voie à de nouveaux conflits : entre anciens propriétaires réclamant leurs biens et nouveaux acquéreurs qui les avaient pourtant achetés légalement à l’État.
Faute de lois d’application claires, les tribunaux ont navigué à vue, exacerbant les injustices. Ces articles, transitoires par essence, sont devenus une « boîte de Pandore » perpétuant les litiges sur plusieurs générations.
Des solutions existent
La persistance de ces litiges, l’absence de lois d’application claires et la faiblesse institutionnelle de l’État perpétuent un cycle où chaque génération hérite de la crise des précédentes.
Pourtant, des solutions existent. Elles passent par des réformes législatives, la mise en place d’un cadastre fiable, la pénalisation effective des spoliations, la restauration de la confiance dans la justice et le renforcement de l’autorité publique.
Pour enrayer cette spirale, plusieurs pistes se dégagent. D’abord, adopter des lois claires et réellement applicables, afin de combler le vide juridique laissé par les dispositions transitoires de 1987. Ensuite, refonder la confiance dans la justice grâce à une réforme en profondeur du système judiciaire et à une lutte résolue contre la corruption, notamment chez certains notaires, magistrats et agents de l’administration. Il est également indispensable de qualifier la dépossession illégale comme une infraction majeure et de sanctionner fermement les spoliateurs.
Le rétablissement de l’autorité de l’État constitue un autre volet central : il suppose de réaffirmer le monopole de la violence légitime et de sécuriser concrètement les biens fonciers des citoyens. La modernisation du cadastre, enfin, apparaît incontournable pour limiter les fraudes documentaires et mieux protéger les propriétaires. Toute politique de relogement ou de réforme foncière devra, en outre, intégrer la menace des gangs, afin d’éviter que de nouvelles injustices ne viennent prolonger la crise.
En Haïti, la question foncière est au cœur du pacte social. Lui apporter une réponse durable est une urgence nationale : sans sécurité foncière, il ne peut y avoir ni paix sociale, ni développement économique, ni stabilité politique, tant que les titres de propriété restent fragiles, contestables ou inapplicables.
Dr. Emmanuel Charles
Avocat, sociologue et spécialiste des élections