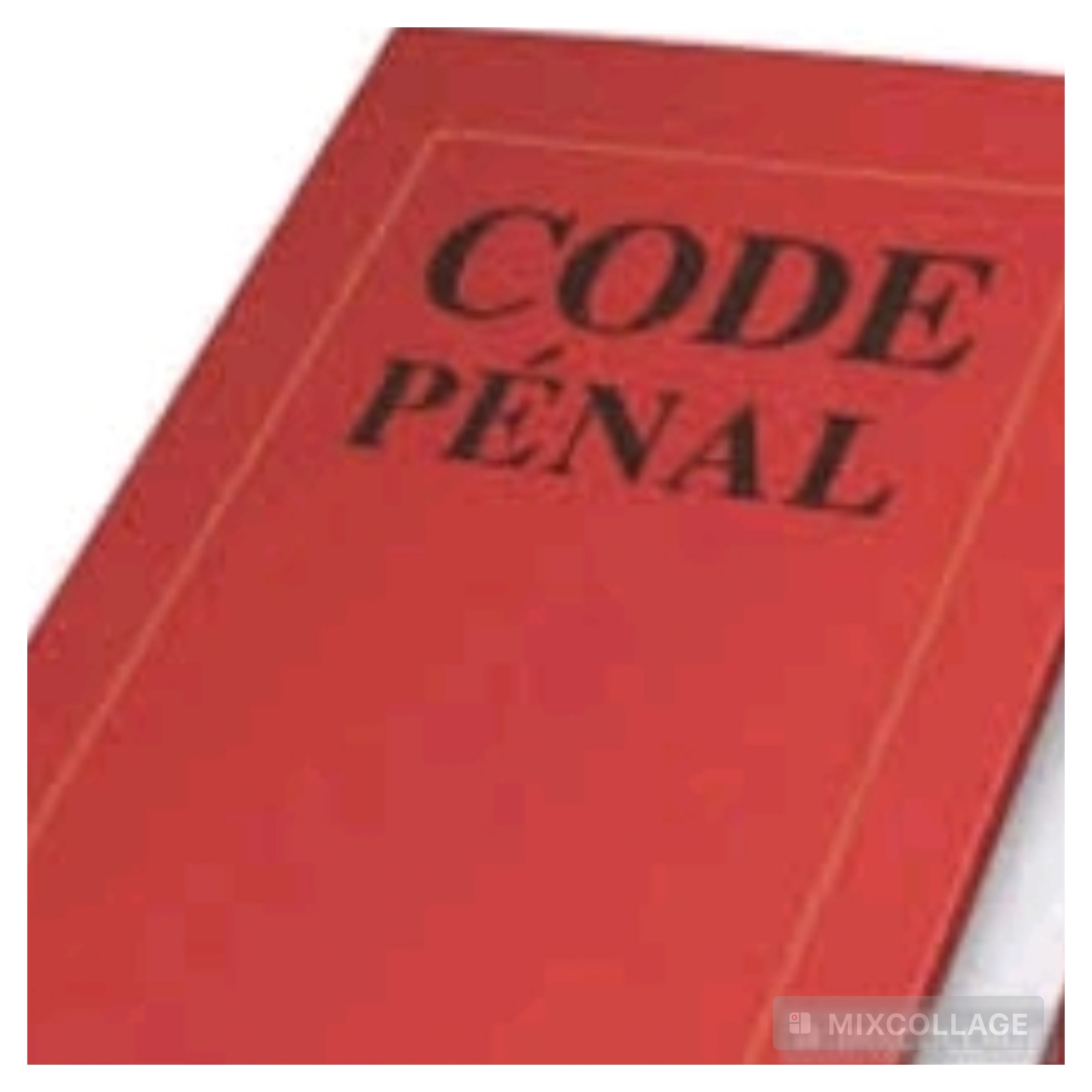La Révolution haïtienne est un procès d’institution du corps-propre de l’esclave par le travail pour soi. Ce procès passe par un mode d’appropriation du corps par la propriété qui, étant devenue ce que l’on possède en propre, a partie liée avec le corps libéré de l’emprise du maître-colon, et donc du mors qui servait à l’embrigader, le bestialiser, mais surtout à le massifier, et ainsi le décorporéiser, autrement dit le désincarner. En effet, ce que l’on possède en propre, avant de posséder tous les biens, c’est son corps. Évidemment, il s’agit du corps vivant, du corps qui est déjà moulé dans l’éthicité de la vie et notamment celle du bien-vivre. D’abord, poser la conservation de la vie et de la vie bonne comme condition du corps é-mancipé, capable dès lors d’être joyeux. La Révolution haïtienne est une promesse de joie – un hymne à la joie au sens plein du terme –, mais les interprétations habituelles l’enferment dans des symbolisations trop simplistes. La lecture que je propose dans cette réflexion méritera sans doute d’être corrigée du fait de son caractère incomplet et de ses enjeux dépolitisants.
- Travailler pour soi : une étape de la révolution. Du travail pour soi à la nécessité de la liberté
Si la Révolution haïtienne aurait quelque chose de révolu, quelque chose qui aurait marqué une césure dans la temporalité économique et politique de la colonie, il serait la grande préoccupation des anciens esclaves de travailler pour soi, et de fonder la liberté sur ce cette base. Il s’agirait, malgré cette avancée qui reprend le travail comme enjeu central de la société haïtienne, d’un pas franchi qui ne traduit pas entièrement la rupture avec le système colonial. Je tiens ici à montrer que le travail-pour-soi ne manque pas de piéger le capitalisme en lui livrant un contre-offensif souterrain et diffus. Le travail pour soi entrave une certaine emprise de l’État haïtien sur le corps du paysan et permet à ce dernier de s’approprier son corps et se mettre en route pour instituer le corps-propre, c’est-à-dire le corps comme son propre corps délivré de la mainmise du maître. Tout au long de ma réflexion, je croyais trouver dans le travail pour soi la voie par laquelle la révolution s’est imposée comme manière de rendre révolue la colonialité. Pourtant, il n’en est rien, puisque le travail pour soi n’a fait que repousser plus loin le problème en me mettant en face de la question de l’institution du monde commun haïtien. Car travailler pour soi en plus de supposer une compréhension de la liberté qui se réfère à l’intériorité, capacité à décider de soi-même en partant de la propriété de son corps, donc de lier liberté et propriété, il entrave l’expérience de la liberté comme pensée et participation à la pluralité ou à l’institution de la politique comme constitution conflictuelle du commun. Le crédit que j’avais accordé au travail pour soi a bien sûr le mérite de préparer la réflexion sur les conditions de la politique, qui n’ont pas été formulées par les historiens, les sociologues et les politologues. La saisie intellectuelle, scientifique et philosophique des enjeux de la révolution est indispensable pour en dégager l’« esprit », et se dresser en véritable héritier. Gustinvil avait bien compris l’important de l’héritier dans la conceptualisation de l’héritage qu’il ne pense plus ou plus seulement du côté du passé ou des ascendants. Il propose d’appréhender l’héritage du côté de la réception. Cela cesse de figer l’héritage dans le simple don fait par ceux qui ont précédé ceux qui sont à peine arrivés. Il rend l’héritage dynamique.
Je fais de cette position théorique une posture méthodologique. Elle concerne la manière de recevoir l’esprit de la révolution.
Entre les mailles discursives, les revendications, les proclamations et les décisions politiques et administratives, j’ai compris que le sens fondamental de la révolution part de la nécessité d’instaurer un régime de travail pour soi comme première modalité d’instaurer un corps vivant, faisant expérience de sa capabilité dans son travail pour soi comportant une intentionnalité qui lui est propre et non extérieure et appartenant aux maîtres. L’enjeu important de cette instauration nécessaire à l’expérience politique est de savoir comme faire advenir la politique comme institution du commun depuis la « culture du soi ». Telle est la question qu’impose à ce stade de l’herméneutique de la révolution.
- Les impasses du travail pour soi
L’esclavage est le dispositif qui pose que le corps de l’esclave ne lui appartient pas puisqu’il est au maître qui en dispose et peut en disposer de diverses manières : l’exploiter, le violenter, le violer ou en jouir. Le corps, réduit à la simple machine biophysique, est mêlé à la machine productive coloniale. Posé juridiquement comme « bien meuble » à la disposition du maître, l’esclave est apprécié uniquement pour son apport mécanique et biologique. Son corps, réduit au rang de propriété du maître, est évidé de sa dimension spirituelle ou affective qui lui donne sa texture particulière, celle d’être soi, d’être propre à soi-même. Il est considéré comme un objet parmi les autres objets du rouage de la machinerie coloniale.
Il est devenu corps exploitable et a été exploité du matin au soir, dans les champs de canne à sucre, de café, de coton ou de tabac. Il en constitue donc à la fois un rouage de la machinerie coloniale et le nœud gordien de l’économie de plantation. Sa temporalité expresse est la fatigue ou l’épuisement. Mal nourri, ce corps dépense plus d’énergie qu’il n’en reçoit. Ce déséquilibre l’épuise et le fait mourir à petit feu.
En même temps que le corps de l’esclave est saisi par la rudesse du travail servile et la violence physique du commandeur, le symbolique le construit comme corps déchu, siège du diable et inférieur. Il est catégorisé, installé dans un ordre hiérarchique qui le méprise, le sous-estime. Fort de ce complexe pratico-discursif, le maître profite à fond du travail de l’esclave, à qui il ne reconnaît aucun droit de propriété, même sur son corps.
Le travail servile est littéralement expropriation, l’esclave étant un bien meuble. Toutefois, si le maître, par son artifice discursif, a construit l’esclave comme simple corporéité, cet artifice n’a pas enrayé la réalité fondamentalement humaine de l’esclave qui existe, qui mobilise des passions et donne du sens à ce qu’il fait. Ce sens confisqué par le maître le plonge dans l’aliénation et la dépossession. Pour cette raison, la possession de la terre, le mode d’appropriation colonial devient son exemple. Son désir d’avoir sa portion de terre et de ne pas travailler pour les autres devient la modalité de la liberté et d’être avec autrui. Travailler pour les autres se révèle avilissant. Il entend travailler pour soi et profiter des fruits de son travail.
Ce désir de travailler pour soi n’a pas un simple sens sociologique de contestation de l’ordre colonial, une volonté de mettre fin à l’ordre colonial. Il renferme un sens plus existentiel et fondamental qui vise la restauration du « propre » qui a été confisqué dans le dispositif de dépossession esclavagiste. Il s’agit de faire pour soi l’expérience du corps en travaillant pour soi. Le travail pour soi libère l’affectivité emprisonnée dans les caprices du maître et la dispose à l’expérience de l’importance de sa force de travail, de son propre effort d’être.
Les historiens sont rares à souligner que le sens fondamental de l’irruption définitive des esclaves sur la scène politique coloniale est dans l’octroi du roi de trois jours de repos, auxquels ils pouvaient se consacrer à la culture de leurs lopins de terre. Ce fut vital. Ils avaient enfin l’occasion de s’approprier leur corps en jouissant des produits de leur travail et faire l’expérience du corps-propre, du sens de leur travail. Par ce renversement du régime de travail, l’esclave est en marche vers la dynamique de fabrication d’un nouveau corps capable de s’éprouver pour lui-même et inaugurer un régime de liberté qui n’est plus le fait d’être propriétaire de son corps, de la terre et du corps de l’esclave attaché à cette terre. La liberté devient préalablement préoccupation à sortir du dispositif de la liberté-travail pour autrui ou liberté-servitude, vers la liberté-travail-pour-soi et corps-propre, même lorsque la propriété ou la propreté du corps passe par la possession de la terre, par où se met en marche une nouvelle temporalité, celle d’être pour soi et avec soi et les autres.
On peut remarquer toute la force phénoménologique de cet effort appelé par la nouvelle dynamique du travail pour soi. Elle est intérieure ou subjective, elle est méditation et soupçon des altérités prédatrices et se fait marronne contre les velléités à reconduire le dispositif liberté-expropriation – servitude-jouissance de l’autre. La liberté-travail pour soi se fait subsistance, une jouissance modérée qui ne dépasse pas le seuil de la famille ou de la communauté familiale, le lakou, compris comme un système de liens affectifs et émotionnels et d’intérêts fondé sur les liens de sang ou la parenté.
On aurait tort de penser que ce système de travail ne concerne que le paysan. Du point de vue de la sociologie du travail dans la société haïtienne qui est à élaborer et dont j’esquisse intuitivement l’ossature, le travail occupe une fonction de tremplin vers une gestion de soi indépendamment de la dépendance à l’autre comme patron. Du système de sous-traitance, souvent mis en place par le capitalisme international dans les pays dits sous-développés constitués souvent d’anciennes colonies, il s’agit de ne pas miser gros afin de n’être pas la proie du système prédateur et puissant. On comprend donc facilement la raison pour laquelle la « bourgeoisie » haïtienne se mêle du jeu de la subsistance en se convertissant en rentier et prédateur de l’État au lieu de prendre le risque de travailler ou faire travailler dans le système commercial international. Inversement, une foule de gens, appelée masse populaire, se refusent de travailler pour cette bourgeoisie ; du moins, s’ils consentent à se mettre au travail « bourgeois », c’est dans le simple but de gagner un maigre capital qui pourrait nourrir leur propre entreprise, leur propre activité qui leur garantit le sentiment d’être libres, de ne dépendre de personne. Il y a certainement dans ce rapport au travail quelque chose de révolutionnaire, mais qui est loin d’être révolu. Puisque le travail, quoiqu’anticapitaliste, ne permet pas de répondre à la promesse véritable de la révolution : établir un ordre politique d’égalité, de liberté (non liberté-propriété-travail, mais de capacité à faire valoir sa position sur l’espace public du commun, en ce sens que le commun implique la pluralité des points de vue et la nécessité de la constitution du commun).
- Sortir du système de travail en repensant l’ordre capitaliste et colonial de la politique. La promesse de la révolution et son héritage véritable
Dégager le sens radical de la révolution ne consiste pas à prendre au pied de la lettre les revendications souvent factuelles des « coloniaux ». C’est la position souvent adoptée par l’historiographie haïtienne qui s’inspire, peut-être sans le savoir puisque cela n’a jamais été mis à jour, d’un style d’analyse de discours où le « sous-entendu » est confondu au « présupposé ». En d’autres termes, elle a su mettre en avant comme sens de la révolution les sous-entendus du racisme, du capitalisme et de l’esclavagisme. Alors qu’en réalité, le présupposé de l’esclavage comme dispositif de confiscation de corps-propres, est la pluralité, le commun ou le monde commun, la politique comme dispositif de la pluralité, du conflit comme condition du commun et non de son annulation, enfin de l’expérience du jugement, comme capacité de la raison à penser davantage en situation d’impasse, à commencer. En ce dernier sens, la révolution comme moment de la mise en acte du jugement renferme en elle-même son sens fondamental : la politique est l’acte d’inventer constamment le monde commun quand il se révèle impropre et inadéquat.
De la thèse d’Hannah Arendt sur le travail, je tire deux importantes considérations sur le travail dans sa relation à la politique. D’une part, il convient de montrer que la philosophie marxienne du travail, qui est la référence dans la tradition de la pensée occidentale, étant prise dans le spectre subjectiviste et utilitariste de la modernité, se révèle incapable de penser l’impasse théorique à laquelle conduit cette conception du travail. D’autre part, en liant le travail à la nécessité de la vie, Arendt montre très bien combien tout cet épistémè théorico-politique et économique fait un pari sur la vie ou sur la nécessité biologique comme condition de la politique, du moins, en le disant d’une autre manière, fait dépendre la politique de la nécessite de la vie que les Anciens attribuaient à la vie domestique et laissaient aux compétences des maîtres. Il s’agit de deux considérations majeures d’Arendt pour comprendre les raisons pour lesquelles la politique moderne s’est vue enfermer dans cette rationalité économiciste, mais n’a pas su protéger les citoyens de la domination, de la perte de l’humanité. Ce constat qui concerne la modernité ne concerne pas moins la société haïtienne qui, étant fille de la modernité, a su reprendre en les surdéterminant les facteurs esclavagistes de cette modernité. C’est d’abord cette reprise du travail, de manière plus complexe, par l’État et la société. Tous les deux se battent pour un modèle de travail. Souvent les historiens ou les sociologues, haïtiens ou étrangers, voient dans cette tension la lutte entre deux visions sociales, l’une faisant la promotion de la grande propriété fondant ainsi le dispositif d’exploitation ; l’autre privilégiant la petite propriété qui promeut la « liberté » individuelle ou de groupe plus ou moins élargi. Cependant, tous ces théoriciens sont passés à côté de cette remarque que le travail en lui-même constitue une entrave fondamentale à l’institution de la liberté et de l’expérience de la « pluralité » comme conditions de la politique. Et c’est sur point que je juge qu’il est important de discuter tout en cherchant en arrière-fond le véritable programme de la révolution, formulé dans son eidétique propre. Pour ce faire, il est indispensable de reprendre dans ses grandes lignes la thèse d’Arendt sur le travail ainsi que sa critique de Marx. Ensuite, je reviendrai sur l’idée selon laquelle le travail pour soi représente l’aspect le plus avancé de la révolution, mais n’y assure en rien la radicalité. Ce que j’ai considéré en un premier temps comme une avancée importante qui ferait conserver, un tant soit peu, l’idée « anticapitaliste » de la Révolution haïtienne doit être revue et dépassée. En dernier lieu, il s’agira de remarquer que même cet anticapitalisme apparent garde quelque chose de la modernité – relation de la liberté et de la propriété, la prégnance d’une conception de la politique comme « biopolitique », comme politique de la vie, en conséquence la politique comme technique de domination sur les corps.
Or je rencontre tous ces aspects de la modernité dans la société haïtienne, même s’il faut reconnaitre que cela n’enlève en rien la pertinence de la révolution dans son « geste », dans ce vers quoi elle a fait et fait signe. C’est justement, ce « signe » (Derrida) que je tiens à suivre. En le suivant, je perçois que l’idéalité de la révolution qui la rendrait anticapitaliste, antiesclavagiste et antiraciste est dans ce que la révolution a renfermé comme « présupposition » et non comme « sous-entendus ». Ce dernier moment dans mon argumentaire conduit d’abord à distinguer le présupposé du sous-entendu. Un nouveau cadre théorique qui apporte un ton différent et nouveau à la pensée socio-historique et politique haïtienne. Ce cadre se révèle indispensable, d’une part, pour attirer l’attention sur la réflexivité dans les sciences sociales haïtiennes. Il porte une attention particulière à la langue, celle de la révolution ou de l’intelligibilité sociale, politique et culturelle. D’autre part, ce nouveau geste théorique permet de ne pas saisir la révolution en termes d’intention. En tout cas, je veux bien montrer, par le recours à la pragmatique linguistique que le sens de la révolution est dans ce qui l’a présupposée et non ce qu’elle a en sous-entendu. Ma thèse ainsi formulée, je me pose la question : qu’est-ce qui présuppose la révolution de Saint-Domingue, la lutte contre le système de liberté-propriété ? Ma réponse va à l’encontre de la doxa traditionnelle. Ce qui présuppose la révolution ne sont pas ses « antismes », déclinés en « anticapitalisme », « antiracisme », « antiesclavagisme » qui sont tous des sous-entendus, c’est la capacité à commencer de dehors des bornes de la colonialité. Le sens véritable de la Révolution haïtienne est dans la position de la possible destruction d’un ordre de servitude qui fait signe vers un ordre de liberté, entendue comme faculté à commencer. Vu que l’esclavage a été un ordre de mise à profit de la vie et du corps, une véritable biopolitique, ce que renferme sa contestation, c’est le refus global de la gestion de la vie comme vie jetable ou exténuée. La révolution s’annule dans les pratiques qui reconduisent les expropriations, les formes diverses de travail et de la gestion de la vie politique sur le modèle de la vie domestique. Le nom de la Révolution haïtienne est l’institution d’un ordre de liberté politique comme seule condition d’institution d’un ordre humain, d’un ordre qui a pour tâche de sortir les anciens colonisés de la servitude, des pratiques bestialisantes de la gestion de la biopolitique, qui prend la forme de la politique de la survie[i], et qui se manifeste par des formes de bestialisation. En lieu et place de la « nécropolitique », j’ai recours à la zoopolitique pour rendre lisible cette perspective de la politique de la survie ou de la mourance, qui ne vise pas à donner la mort, mais à laisser mourir, puisque la décrépitude de la vie asservie, épuisée participe au confort psychologique et existentiel[ii] du « dominant » bourgeois ou paysan (c’est bien ce qui se raconte dans la paysannerie concernant le « zombi »).
- Du travail et de la nécessité de la vie : la politique moderne est une zoopolitique
Arendt se demande : « Quelles furent les expériences inhérentes à l’activité du travail qui s’avèrent d’une si haute importance pour l’époque moderne ? » Cette question vient après que l’auteur des Conditions de l’homme moderne a passé en revue le sens que le travail a eu pour les Grecs, comment, avec le renversement moderne, il a connu une valorisation qui porte toute la tradition, Locke, Smith, particulièrement Marx, qui a défini l’homme comme animal laborans. Aussi Arendt s’est-elle occupée, dans le même élan, à s’étonner de la confusion qui est faite dans cette même tradition entre travail et œuvre. Chez Locke, Smith aussi bien que Marx, la distinction de l’œuvre et du travail, peu présente et explicite chez les Grecs, prend la formulation de différence entre « travail productif » et « travail improductif ». Distinction qui ne manque d’attribuer une position fondamentale au travail, mais qui témoigne aussi d’une « ascension soudaine, spectaculaire du travail, passant du dernier rang, de la situation la plus méprisée, à la place d’honneur et devenant la mieux considérée des activités humaines. »[iii] Telle est situation intellectuelle du travail qui le porte, selon Arendt, à cette promotion du travail qui est passé de l’antiquité gréco-latine pour être une activité dégradante n’ayant rien à avoir à la condition de l’homme – puisque « l’animal laborans n’est, en effet, qu’une espèce, la plus haute si l’on veut, parmi les espèces animales qui peuplent la terre »[iv] –, au temps moderne où il est célébré comme la plus haute activité de l’homme.
Selon Arendt, il y a chez Marx une identification du « travail » et de la « procréation » qui serait capitale ; cette identification serait due à la subsomption de ces deux réalités au « même processus de fertilité vitale ». En d’autres termes, « le travail était la reproduction de la vie », assurant la conservation de l’individu, et la procréation était la reproduction « de la vie d’autrui » assurant la perpétuation de l’espèce ». Une telle idée constitue le fond de la théorie marxienne du travail, en dépit des ajouts conceptuels, tels la « plus-value ». Le sens du travail comme modalité de l’activité humaine dont la finalité est l’entretien de la vie n’a pas changé.
Michel Henry, phénoménologue de la vie, ne s’est pas trompé dans sa lecture de Marx. Selon lui, le travail chez Marx a quelque chose de vivant. Une force affective compose le travail et se trouve entravée dans l’aliénation. L’idée que le travail aurait quelque chose à voir avec la vie affective ou biologique a particulièrement pour conséquence la difficulté qu’un régime politique puisse se mettre en place dans la logique du travail. Car le travail enferme les individus dans la spécificité de la vie singulière et rend difficile l’avènement du monde commun. Tel est l’enjeu des thèses qui considèrent la Révolution haïtienne comme une révolution anticapitaliste. Une thèse qui supposerait que la Révolution haïtienne fût une déconstruction du système de travail pour autrui. Pourtant, cette thèse reste peu attentive à la reconduction du système de travail pour soi, qui reprend l’ordre de gestion de la vie singulière au détriment de la vie politique, qui promeut la singularité ou la particularité des préoccupations vitales des individus contre l’idéal politique de la communauté.
On peut comprendre en conséquence la raison pour laquelle le système de combite n’apporte rien dans l’institution de la vie politique. Certains anthropologues ont montré la force communautariste du combitisme. Ils se montrent pourtant incapables de penser la faible vertu politique du combitisme qui répond à une exigence sociale et non politique de la vie en communauté. Le combitisme répond aux besoins de reproduire la vie et enferme les citoyens dans des sphères sociales de la nécessité politique. Ces sphères constituent autant de modalités de la maisonnée. Il est davantage une modalité de la vie sociale où les individus se placent l’un à côté de l’autre sans être ensemble, sans être en commun, sans en constituer du commun. Le combitisme serait davantage l’expression d’une expérience davantage sociale que politique.
La catégorie du travail pour soi en appelant une logique sociale et répond aux nécessités biologiques est loin de mettre à mal le capitalisme. Au contraire, elle s’impose comme une catégorie qui est à la fois en rupture et en continuité avec le capitalisme. En rupture, puisqu’elle se manifeste dans une dynamique précapitaliste de non-accumulation. Elle continue le capitalisme par la logique même de la nécessité biologique et consumériste qui la fonde. Elle le continue particulièrement par l’économie politique de la vampirisation et de la bestialisation, qui consiste à se nourrir des autres, à les consumer au profit de sa propre vie. Les expériences de zombification et de bestialisation, racontées dans les légendes populaires et les récits anthropologiques, expriment l’analogie entre le travail servile du capitalisme et le travail paysan de « subsistance » effectué par les « zombis ». Pour découvrir la véritable portée politique de la Révolution haïtienne, il est plus pertinent de la comprendre par ce qu’elle présuppose que par ce qu’elle sous-tend.
- Sous-entendu et présupposition de la révolution
Les études de sciences sociales sur la Révolution haïtienne n’ont pas su procéder au préalable à la distinction entre « sous-entendu » et « présupposition », encore qu’elles fussent bien inconscientes de ces deux enjeux conceptuels. Elles ont toutes eu recours sans l’avoir postulé consciemment aux sous-entendus de la révolution et ont lié les sous-entendus de la révolution à son présupposé. Il est important d’expliciter conceptuellement la présupposition et le sous-entendu pour mieux mettre en relief cette erreur dans le raisonnement et dans les représentations qui ont été faites de la révolution. En retour, j’exposerai la pertinence de l’analyse que je retiens, celle qui sera fondée sur le choix de la présupposition de la révolution comme l’angle pertinent de son intelligibilité.
Le présupposé et le sous-entendu sont « deux types particuliers d’effets de sens » dans la langue, l’un « rend compte » du sens dès le « niveau du composant linguistique », l’autre « exige du composant rhétorique ».[v] La langue constitue un complexe de significations. Certaines significations sont liées à la langue elle-même indépendamment des circonstances extérieures et d’autres sont attachées à des circonstances sociales, culturelles. Le composant linguistique concerne les significations liées à la langue, le composant rhétorique aux circonstances extérieures au système de la langue. Dans le cas de ma réflexion, je dois procéder à un déplacement de la langue à l’action, du texte à l’action, Paul Ricœur a montré l’identité du texte et de l’action, tous les deux constitués de la mise en intrigue et de la refiguration du monde. Cette identification de la sémantique du texte et de l’action me permet d’affirmer que l’action comme texte est composée de deux composants, linguistique (praxique) et rhétorique. Le composant linguistique ou praxique consiste à surprendre ce qui constitue en propre le système d’action révolutionnaire et les circonstances qui permettent de la caractériser. En d’autres termes, le présupposé est une proposition ou une réalité qui fonde la pertinence d’un jugement ou d’une action indépendamment de ces conditions politiques, économiques, sociales et culturelles de manifestation. Il se constitue en maxime fondamentale qui donne sens aux autres propositions. On ne saurait exposer tout le traitement complexe qu’ont apporté à cette réalité linguistique les théories du présupposé ou de la présupposition. On retient ici qu’il offre un avantage théorique indispensable pour penser l’action. Agir, c’est postuler des convictions, des maximes générales qui doivent fonder l’action et lui apporter justification.
Hannah Arendt, encore une fois, reconnaît que le propre de toute révolution moderne qui trouve ses manifestations différenciées, mais identiques dans le présupposé, dans les révolutions française et américaine, est la liberté. Les révolutions modernes, par différence à celles qui ont lieu avant la modernité politique et s’intéressaient au changement de régime, procèdent fondamentalement à l’institution d’un ordre politique de liberté.[vi] Le sous-entendu de l’action révolutionnaire est donc l’ensemble des attributs circonstanciels qu’on accorde à la révolution. Ainsi, on s’est empressé, sans avoir explicité ce point de la sémantique de la révolution, de subsumer le présupposé de la Révolution haïtienne à ses sous-entendus.
Dans le cas de la Révolution haïtienne, le présupposé n’est pas l’opposition à l’esclavage, au racisme et au capitalisme qui ne sont que des modalités, des circonstances que revêt le système colonial esclavagiste de la négation de liberté. Ces modalités ne sont que des sous-entendus de la révolution ; des entraves qu’elle a rencontrées sur son parcours, qui ne sont pas susceptibles de lui fournir son véritable sens. Ce qui procure à la révolution servile son sens fondamental est ce qui la présuppose : la liberté.
La Révolution haïtienne pose un postulat implicite dans sa forme même de contestation : l’humanité dans sa dignité est essentiellement liberté. En conséquence, tout ce qui contrevient contre la liberté humaine doit être combattu et détruit. Tel est le syllogisme de la révolution. L’esclavage est une négation. Elle nie la liberté et toute lutte contre l’esclavage est une position de la liberté comme commencement et comme fin de la vie politique, de la vie à plusieurs.
Le problème donc qui est laissé aux héritiers de la révolution est celui de l’institution politique de la liberté. Il est à ce moment facile de deviner que la liberté dont il s’agit est loin d’être le procès pour accéder à des portions de terre, ou de s’adonner à une économie de la pluriculture et de la subsistance. Tous ces attributs, la propriété, l’agriculture, le travail pour soi, ne font que reconduire le système de dénégation de la liberté, qui ne peut se déployer que dans l’asservissement, donc dans le raturage de l’idéal de la révolution. Ils témoignent aussi d’une scission du concept de liberté en propriété et circulation : dans la colonie de Saint-Domingue, le maître qui représente la figure de l’homme libre, était propriétaire et avait seul la latitude à se déplacer. Ce à quoi les historiens, les sociologues devraient se livrer consistait à dégager le contenu conceptuel de cette postulation de la liberté sentie par les esclaves, pris dans les surdéterminations herméneutiques de la culture coloniale qui a confondu liberté-propriété à la liberté-capacité-à-commencer-à-plusieurs, à-construire-un-monde-commun, mais incapables à lui restituer un concept précis du fait de leur manque de culture intellectuelle. Ce qu’il faut mettre à jour au regard de la présupposition de la liberté dans la révolution servile haïtienne concerne le sens de la liberté et ses exigences d’institution d’un monde commun, d’une vie politique véritable.
Chez Hannah Arendt, la liberté peut recevoir, dans la tradition de la philosophie occidentale, deux acceptations. Elle constate que la tradition a deux concepts de liberté, l’un intérieur, un extérieur. La liberté intérieure est dérivée de la liberté extérieure et est définie comme la capacité de maîtrise intérieure de l’homme. Elle est pensée par Épictète à partir de l’expérience politique qui a fixé des attributs à la liberté extérieure, laquelle est comprise par des attributs de propriété, de domination et de pouvoir : « D’après la pensée antique, l’homme ne pouvait se libérer de la nécessité qu’en exerçant un pouvoir sur d’autres hommes, et il ne pouvait être que s’il possédait un lieu, un foyer dans le monde. »[vii]
Cette citation demande quelques précisions afin de mieux comprendre le rets conceptuel et la confusion à laquelle se trouvent tombée les interprétations sur la révolution. Dans la colonie, la liberté était liée à la propriété (de la terre et du corps de l’esclave), à la domination et au pouvoir. Le monde colonial étant composé d’un monde et de son « désert », la liberté se trouve appréhendée différemment selon le point de vue du monde du colon ou du désert de l’esclave. Dans le monde colonial, la liberté-propriété-circulation constitue l’attribut du colon, tandis que l’esclave réclame la simple liberté-propriété en se laissant enfermé dans les fermes. À première vue, la liberté coloniale s’apparente à la liberté extérieure antique. Comme elle, elle procède à la constitution d’un commun colonial où les esclaves sont exclus. La perversion de la liberté au cours de la révolution est à comprendre comme difficulté à penser la liberté comme servitude. Arendt a bien compris cette perversion, qui serait au cœur de la distinction qu’elle établit entre « révolution américaine et française ». Elle avance que la Révolution américaine a réussi parce qu’elle a profité de la présence de la main-d’œuvre des noirs. Cette main-d’œuvre a favorisé le maintien d’une classe de lettrés qui se disposent de temps libre pour s’adonner à la culture. Dans le sens contraire, la Révolution française qui a vu le « peuple » se mettre à la rue, a donné naissance à une politique sociale qui vise à enrayer la « misère » avant d’en venir à l’institution d’une classe de lettrés capables de délibérer.[viii] Selon cette analyse, la liberté est fondamentalement politique. Elle est caractérisée par le fait de disposer du temps libre pour prendre part aux délibérations sur le commun. Elle comprend donc la capacité à discuter, à délibérer, laquelle capacité présuppose la culture (intellectuelle). Cette remarque m’invite à penser que la relation absence d’un système éducatif et persistance d’une économie politique de l’insécurité est la conséquence directe de la mésinterprétation de la révolution qui la comprend dans la perspective du travail et non de la liberté, de la vie (zoê) et non de la vie politique (bios) .
La Révolution haïtienne semble avoir connu une perversion de la liberté tronquée de son attribut de délibération au profit de la simple capacité à dominer, à se disposer des autres. L’échec apparent de la Révolution haïtienne est dans la séparation entre liberté et pouvoir de délibération et constitution-de-monde-commun au profit de la liberté comme disposition de soi à soi-même qui s’est révélée un choix antipolitique. Cet échec doit être saisi comme non-écoute au présupposé de la révolution et un surinvestissement de ses sous-entendus. Étant non-écoute, elle se déploie autour d’une pseudo-politique de la production de miséreux. S’inscrivant dans la ligne droite du racialisme colonial, elle conforte une démarcation par des attributs biologiques entre les individus. Contrairement à la Révolution française qui s’est arrêtée en chemin pour répondre aux besoins vitaux du « peuple » français, la politique postrévolutionnaire haïtienne enfonce le « peuple » haïtien dans la misère et perdure l’exploitation. Contrairement à la Révolution américaine, elle se révèle incapable d’instituer une expérience crédible et fructueuse de la délibération, qui se transmue en guerres civiles armées, qui ne cessent de scander l’histoire politique de la société haïtienne, devenue plus une meute qu’un ordre social. En somme, la révolution propose un mélange de guerre civile sous-fonds d’appauvrissement et d’abrutissement des héritiers des esclaves. Ce qui a été comme le lieu d’une tension se présente ici comme un choix délibéré des élites d’enfermer le grand nombre dans l’obscurantisme (le système éducatif rabougri), l’abrutissement (pratique généralisée de la corruption et de la violence). Il s’agit bien d’une forme de gouvernementalité dans le contexte précis du post-esclavagisme qui fait le choix non de la liberté, de la pensée mais de l’exploitation et du travail abrutissant.
Cette situation dans laquelle se trouve la Révolution haïtienne n’est pas un échec. Il y a échec quand la réalisation de l’idéalité s’avère impossible ou coincée par des obstacles majeurs ou irréductibles. Il est plus acceptable de considérer que les acteurs n’étant, pas à l’écoute au présupposé de la révolution, ont détourné le sens de la révolution soit par intérêt soit par manque de compréhension du sens de la liberté révolutionnaire.
Le travail primordial de la Révolution a été celui de la délibération. Il s’agirait de penser le sens de la révolution. Ce qu’aurait voulu présupposer le fait de contester l’ordre colonial. Ce travail de délibération, travail de la pensée, étant un travail de création de monde autre, de monde nouveau, celui de la liberté qu’Arendt définit comme la faculté de commencer, devrait accompagner la révolution.
Vraisemblablement, la révolution qui a présupposé la liberté s’est méprise dans sa formulation du sens véritable de la liberté. Prise entre la liberté-propriété-pensée-monde-commun et liberté-propriété-asservissement, elle a laissé par sédimentation anthropologique l’imaginaire colonial lui fournir sa grammaire au lieu de procéder à l’invention de la grammaire qui l’a présupposée. C’est un signe de manque d’imagination et de création (deux caractéristiques essentielles de la pensée) qui continue à la fois dans les pratiques politiques et économiques des hommes d’affaires et politiciens et dans les gestes théoriques des chercheurs en sciences sociales.
Montrer que la Révolution haïtienne, dans son présupposé, n’a rien d’une révolution anticapitaliste, antiraciste et antiesclavagiste, c’est se livrer à une gageure. C’est s’attirer des répliques qui seront réactives, puisqu’une telle thèse met à mal une doxa qui a la vie longue, mais qui s’est montrée incapable à se dépasser pour libérer l’imaginaire politique de la société haïtienne. La formulation dérangera inévitablement. Pourtant, reconnaître le caractère anticapitaliste, antiraciste et antiesclavagiste de la Révolution haïtienne, c’est se tromper du point de vue de la sémantique de l’action qui, posant que l’action est structurée comme un texte, renferme des présuppositions qui la rendent évidente dans sa déclaration. La révolution servile n’est pas parce qu’elle conteste le capitalisme, le système de travail ou d’exploitation, le racisme et l’esclavage. C’est confondre son présupposé à ses sous-entendus, ses éléments de signification accessoires à son sens intrinsèque et fondamental.
Une fois le malentendu linguistique esquivé, et qu’on s’entend sur l’idée, devenue maxime générale de la révolution, que la liberté est le fondement de la liberté, le pas supplémentaire à faire consiste à procéder à un deuxième moment dans le travail d’explicitation. La liberté dont il est question dans le présupposé de la révolution n’est pas celle qui se lie à la propriété, à la servitude, à la circulation. La liberté révolutionnaire consiste à penser la possibilité-du-monde-commun, laquelle faculté de penser fait appel à la pluralité et à la délibération.
À la fin, on comprend sans difficulté qu’une telle compréhension de la liberté doit articuler la politique sociale de la réduction de la misère du « peuple », composé essentiellement des héritiers des esclaves, mettre en œuvre un véritable système éducatif qui instruit les citoyens haïtiens aux compétences de la délibération ou de sa participation à l’avènement-du-monde-commun. Ce préalable appelle par un enchaînement déductif toutes les autres conditions d’une expérience politique décente.
Dr Edelyn DORISMOND
Professeur de philosophie au Campus Henry Christophe de Limonade -UEH
Directeur du comité scientifique de CAEC
Responsable de l'axe 2 du laboratoire LADIREP.
[i] J’ai défini ailleurs dans mon livre et plusieurs articles ce concept que j’oppose à la « nécropolitique », telle qu’Achille Mbembe l’entend. Je renvoie le lecteur à mon livre, Le problème haïtien. Essai sur la colonialité de l’État haïtien, Port-au-Prince, Éditions Polaire, 2020, et à ces deux articles, entre autres, « Qu’est-ce qu’une vie humaine den Haïti ? De la zoopolitique haïtienne » ; « Réalisme » politique haïtien. Imagination et politique de l’é-mancipation ». Programmatique d’un poétique de la politique ». Tous ces deux articles se trouvent sur mon blog, déjà cité.
[ii] Je rédige un article qui tente d’expliciter les conditions affectives et phénoménologiques de cet état d’esprit macabre.
[iii] Hannah Arendt, Condition de l’homme moderne, Calmann-Lévy, 2018, p. 169.
[iv] Hannah Arendt, Op. cit., p.142.
[v] Oswald Ducrot, « Présupposés et sous-entendus », in Langue française, n°4, 1969, p.33.
[vi] Voir Hannah Arendt, La liberté d’être libre, Paris, Payot et Rivages, 2019.
[vii] Hannah Arendt, Crise de la culture, Paris, Gallimard, p. 192.
[viii] Hannah Arendt, La liberté d’être libre, op. cit.