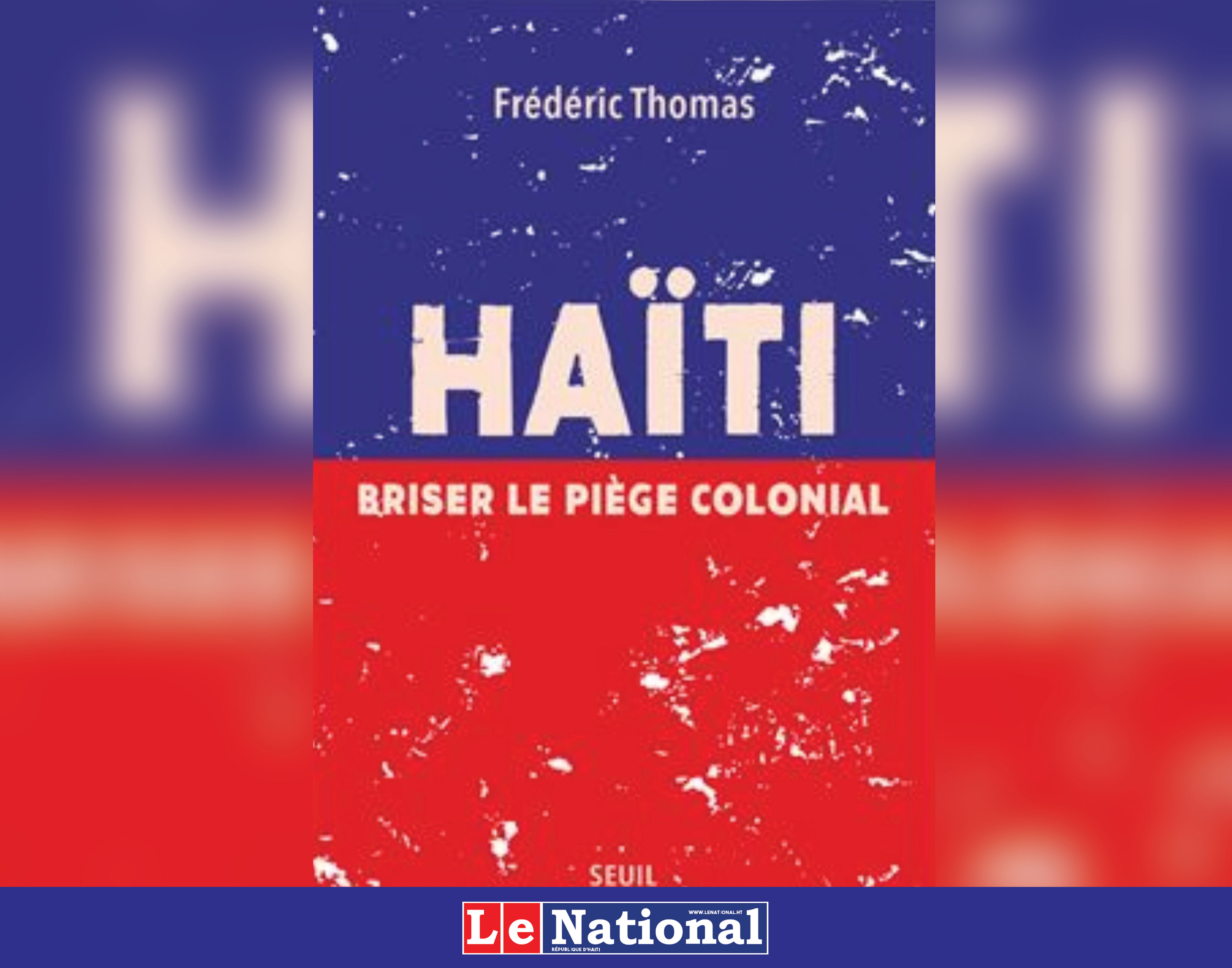« Tout manuscrit est un exilé. Toute bibliothèque est un lieu d’asile. Et celui qui veille, le dernier à lire à voix basse dans l’ombre des pages anciennes, est un survivant parmi les ruines. » — Ismaël Diadié Haidara. Il est né à Tombouctou, en 1957. Une ville que les cartographes nommaient "mystérieuse", que les poètes rêvaient d’atteindre comme on rêve d’une étoile noire, et que les conquérants convoitaient sans jamais la comprendre. Lui, il en venait. Dès l’enfance, il fut lecteur clandestin, scribe silencieux, fils des livres. Car il n’était pas seulement un enfant du désert : il était l’héritier d’un trésor. La bibliothèque Fondo Kati, dépositaire d’une mémoire arabo-andalouse, hébraïque, castillane et africaine, fondée au XVIe siècle par Mahmud Kati, fils d’un exilé de Tolède, Ali b. Ziyad al-Quti.
Dans ses manuscrits, ce n’était pas seulement l’encre qui parlait, mais le vent du Sahel, la suie des maisons, la sueur des lettrés. On y trouvait des traités de droit malikite, des vers soufis, des lettres entre Tombouctou et Fès, Djenné et Séville. Et parfois, le silence. Des noms effacés. Des doutes, des fragments d’hérésies. Un vertige de vérités oubliées.
Ismaël Diadié Haidara n’a cessé d’écrire — pour témoigner, pour préserver, pour résister. Il publia dans les années 1990 un ouvrage que nul n’osait signer : Les Juifs à Tombouctou. Ce fut un choc. Ce livre ressuscitait une présence juive millénaire, refoulée, persécutée, niée. On voulut le faire taire. On l’exila.
D’abord l’exil intérieur. Puis, en 2012, le vrai départ, lorsque Tombouctou fut livrée aux milices islamistes. Il quitta sa terre, emportant la mémoire — non pas dans des malles, mais dans sa chair, dans l’ordre secret des manuscrits dispersés, photographiés, protégés. Il passa par la Suisse, puis revint à Tolède, là même d’où ses ancêtres étaient partis. Un exil à rebours.
Dans cette traversée, il inventa une forme poétique nouvelle : les Tebrae, poèmes brefs de deux lignes, hérités des chants des femmes du Sahara. Loin des carcans occidentaux, il y retrouva l’oralité originelle. « La poésie n’a pas besoin de temple. Elle a besoin de souffle. » écrivait-il. Dans Tebrae pour ma mère, Territoire de la douleur ou Sahel, il taille ses mots dans l’os de la mémoire.
La poète espagnole Virginia Fernandez Collado l’affirme : « Si les tankas ont eu Takuboku, les quatrains Khayyam, les haïkus Bashô, alors les tebrae ont en Ismaël leur inventeur. » Philosophie de la joie lucide, ces poèmes disent : « L’exil n’est pas triste / Loin de chez moi, ici il y a l’amour, la neige, la mer. »
Sudeep Sen, poète indien et éditeur d’Ars Notoria, note leur profondeur : « Épigrammatiques, mélancoliques, mais jamais pleurnichards. Il rit de la mort. Il danse avec l’oubli. » Ainsi :
Un jour l’herbe poussera sur ma tombe, mais ne pleure pas, / Nuage flottant, j’ai ri de tout.
Chez Ismaël, l’exil devient sagesse. Face à l’absurde, Camus choisissait la révolte ; lui, il choisit le rire. Il n’érige aucune cité divine. Il marche, libre, vers la Cyrénaïque de l’épicurien Aristippe. Il ne fonde sa cause sur rien, sinon sur la beauté nue du présent.
Sa poésie n’est pas belle : elle est vraie. Elle ne cherche pas à séduire : elle tranche, elle brûle. Elle est cri, poussière, prière sans dieu. Dans ce désert où il vit encore, l’exilé écrit comme on veille un feu — fragile, mais tenace.
À plus de soixante-cinq ans, il demeure en exil. Mais il n’est pas seul. Chaque poème est un témoin. Chaque lecteur, un veilleur. Car il n’a jamais cessé d’être de Tombouctou. Non par lieu de naissance, mais par destin. Il en incarne la croisée : caravanière, mystique, hérétique, incandescente.
« Je suis devenu poète, philosophe, historien — non par choix, mais par devoir, dit-il. Mes livres sont des caravansérails de mémoire. Écrire, c’est reconstruire Tombouctou. »
Dans les archives de la bibliothèque Fondo Kati, certains feuillets datent du XIe siècle. Ils parlent d’étoiles, de commerce, d’amour et de justice. Ils nient le mythe d’une Afrique sans pensée. Mais qui les lit encore ? Qui les entend ?
Le silence autour d’eux est une violence. Son combat est contre l’oubli, contre l’arrogance des puissants. Fondo Kati n’est pas qu’un legs familial : c’est une balise pour les peuples déracinés. Un cri contre l’amnésie organisée.
Parfois, le soir, il rêve encore qu’il marche dans les rues sablonneuses de Sankoré. Le vent soulève la poussière des siècles. Les voix des anciens flottent. Elles ne parlent pas fort. Elles murmurent, comme on prie. Comme on écrit.
Il est peut-être leur dernier lecteur.
Godson Moulite