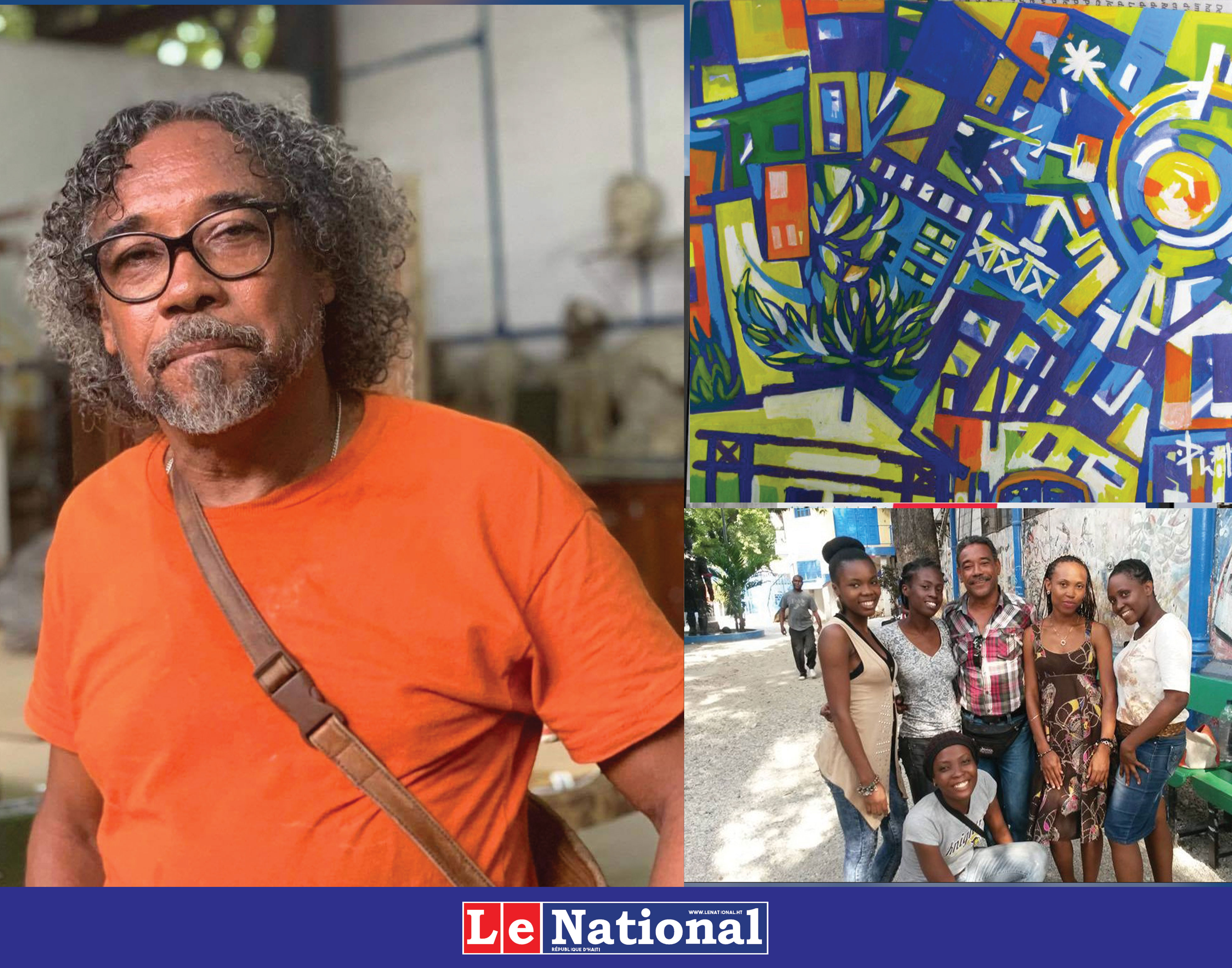Louis Étienne Félicité Lysius Salomon, dit Lysius Salomon Jeune, le diplomate devenu président à vie, est le créateur du salomonisme, cette doctrine politique et économique née en Haïti dans les années 1880. C’est l’époque où cet homme politique, revenu d’un long exil, devint non seulement le président de la République, mais aussi le symbole d’une ambition nationale : réconcilier Haïti avec la modernité. L’ancien exilé de Paris portait encore dans son esprit l’empreinte de l’Europe, de ses institutions, de son ordre et de son organisation.
Il croyait, sans doute sincèrement, que le salut d’Haïti passerait par la discipline et le progrès économique, tels qu’il les avait observés sur le Vieux Continent. Aussi, dès son accession au pouvoir, mena-t-il une politique que d’aucuns qualifièrent de francophile à outrance, au point que certains contemporains disaient, non sans ironie : « Tout pour la France, et sans retenue ». Mais derrière cette apparente dévotion se cachait une stratégie : utiliser la puissance française comme levier de modernisation, et non comme chaîne de dépendance.
Lysius Salomon Jeune ne fut pas diplomate par hasard ni président par ambition. Dès ses débuts, il fut façonné par l’esprit de l’État et la rigueur du devoir. Sa carrière politique s’ouvrit sous le signe de la diplomatie et de la finance deux arts où la précision, la patience et la prudence sont sœurs. Son premier poste ministériel, il l’obtient sous l’Empire de Faustin Soulouque, devenu Faustin Ier. Le 9 avril 1848, le jeune Salomon fut nommé Secrétaire d’État des Finances, du Commerce et des Relations extérieures, trois portefeuilles redoutables, exigeant à la fois l’œil du stratège, la main du comptable et la langue du diplomate.
Il exerça ces fonctions jusqu’au 26 avril de la même année : huit mois et dix-sept jours d’un ministère bref, mais marquant. Déjà, il apparaissait comme un jeune faucon dans un ciel politique d’orage : un homme d’ordre dans un empire livré aux passions. Sous Faustin Ier, il apprit trois leçons qu’il n’oublierait jamais : la discipline, la loyauté et la solitude du pouvoir.
Le diplomate en lui se forma dans ce creuset d’or et de feu. Son successeur, Louis Dufresne, allait détenir un record de longévité à la tête du ministère des Relations extérieures plus de dix ans, surpassant à peine René Chalmers, ministre sous François Duvalier.
Ces durées montrent que la diplomatie haïtienne a toujours été le miroir de la stabilité du pouvoir central. Quand l’État était fort, ses ministres duraient ; quand la tempête grondait, les portefeuilles chancelaient. Salomon, lui, fut de ceux qu’on ne déracine jamais vraiment.
« Gouverner n’est pas régner mais présider »
Exilé, il restait ministre dans l’âme ; banni, il continuait à défendre son pays. Dans la symphonie tumultueuse du XIXᵉ siècle haïtien, il fut un violoniste obstiné : il jouait juste, même quand l’orchestre se désaccordait.
Sous l’Empire, il apprit la grandeur ; dans l’exil, la mesure ; et à la présidence, il sut unir les deux pour incarner un chef d’État dont l’influence devait survivre à sa chute.
Car si Faustin Ier régna en empereur et tomba comme un mythe, Salomon régna en diplomate et survécut comme un symbole. Il savait que le pouvoir se conquiert par la force, mais se maintient par l’équilibre entre la parole et le silence, la fermeté et la persuasion, la nation et le monde. Son expérience diplomatique fut bien plus qu’un épisode de sa vie : elle fut l’école de son caractère et la forge de sa présidence.
Formé dans les chancelleries d’Europe, il apprit à écouter avant de parler, à observer avant d’agir, à peser chaque mot comme un acte.
Cette discipline intérieure, acquise loin du tumulte de Port-au-Prince, devint l’armature invisible de sa gouvernance. Lorsqu’il accéda à la magistrature suprême en 1879, Salomon apporta au Palais national la précision du rédacteur de traité et la patience du négociateur. Pour lui, gouverner, ce n’était pas régner : c’était présider comme on arbitre une conférence. Chaque décision, chaque dossier, chaque province méritait la même attention qu’un État étranger à ménager. Les longues années passées à Paris lui avaient donné un sens aigu de la modernité. Il avait vu la France se transformer, l’Europe s’industrialiser, la communication révolutionner le monde.
De cette expérience, il retira une conviction : Haïti devait entrer dans le concert des nations non par imitation servile, mais par la force de son propre génie. Devenu président, il appliqua une diplomatie intérieure rétablissant l’ordre, disciplinant les finances, réformant l’administration et une diplomatie extérieure redonnant à Haïti sa voix et sa dignité. Là où d’autres gouvernaient par impulsion, lui gouvernait comme on négocie un traité : avec méthode, prudence et hauteur de vue.
Il disait qu’un pays se dirige comme une ambassade : en représentant le peuple avec dignité, sans arrogance, en résistant aux pressions sans fermer la porte au dialogue. Ainsi, il transforma la présidence en une chancellerie nationale, où le chef de l’État devint médiateur, arbitre et gardien du prestige d’Haïti.
Les diplomates européens le respectaient pour sa modération, sa connaissance des affaires internationales, et son attachement à la souveraineté haïtienne. Ses contemporains le décrivaient comme un homme “posé, calculé, presque froid”, mais cette froideur n’était que la maîtrise d’un diplomate qui savait que l’émotion est l’ennemie de la raison d’État. Son expérience d’ambassadeur durant la crise de 1867-1869 lui servit de boussole.
Il avait vu ce qu’un pays déchiré peut perdre et comprit que la première diplomatie d’un président est celle de la paix intérieure. Lorsqu’il prit le pouvoir, il s’efforça de réconcilier les factions, de réorganiser l’administration d’imposer le respect par la stabilité. Sous sa direction, la diplomatie haïtienne devint le miroir de l’État lui-même : ordonnée, instruite, exigeante. Il exigeait de ses ambassadeurs non la soumission, mais la loyauté à la République et la maîtrise de l’art diplomatique. L’ancien plénipotentiaire de Paris fit de son expérience d’exil un véritable laboratoire d’État.
Le diplomate s’était mué en président, mais sans jamais cesser d’être diplomate : la plume du négociateur était devenue le sceptre du chef d’État. À ses côtés, un homme joua un rôle essentiel : François Saint-Surin Manigat, ministre fidèle, souvent qualifié de “premier ministre de fait”. Polyvalent et d’une énergie inépuisable, il passait d’un portefeuille à l’autre - Relations extérieures, Finances, Commerce - avec la souplesse d’un esprit formé à toutes les disciplines. Entre les deux hommes existait une relation quasi filiale : Salomon le mentor, Saint-Surin l’élève dévoué. Ils s’étaient rencontrés à Paris, lorsque le jeune Saint-Surin, boursier haïtien, tomba malade loin de sa famille. Salomon, alors ambassadeur, l’avait recueilli et soigné. De cette rencontre naquit une amitié indéfectible, nourrie par la gratitude et la confiance. Devenu président, Salomon fit de ce jeune protégé son plus proche collaborateur, son bras droit et le gardien de sa pensée. Leur tandem, à la fois intellectuel et politique, forma le cœur battant du régime salomonien.
Malgré plus de vingt ans d’exil, Salomon n’avait rien oublié de ce qu’un État devait être : une machine instruite et organisée. Sous son impulsion, Haïti entra dans l’ère moderne : il fit adhérer le pays à l’Union postale universelle, symbole d’une nation connectée au monde.
Moderniser sans aliéner, s’ouvrir sans se soumettre
Avec lui, l’argent retrouva son sens premier : l’investissement. Il fonda la Banque Nationale d’Haïti, première grande institution financière du pays. Mais cette réussite portait aussi les germes d’une dépendance. L’ancien ministre et économiste Frédéric Marcelin révéla plus tard comment les banquiers français s’étaient emparés de la Banque Nationale, tirant de substantiels profits au détriment du trésor haïtien. Salomon, croyant fortifier la souveraineté économique du pays, avait ouvert malgré lui une brèche.
Pour comprendre cette ambivalence, il faut se rappeler que, dans les années 1880, l’Europe et surtout la France dominait la diplomatie mondiale. Salomon, francophile convaincu mais patriote intransigeant, tentait l’impossible équilibre : moderniser sans aliéner, s’ouvrir sans se soumettre. Ainsi s’esquisse le portrait d’un homme d’État complet : diplomate avant d’être président, président sans cesser d’être diplomate, Salomon fit de la politique un art du dialogue et de la mesure.
Sous son regard calme et son écriture précise, Haïti chercha à conjuguer ordre et progrès, dignité et ouverture, fierté nationale et exigence moderne. En lui, la République trouva son visage d’équilibre : la raison d’État habillée du manteau de la diplomatie.
Maguet Delva
Paris, France