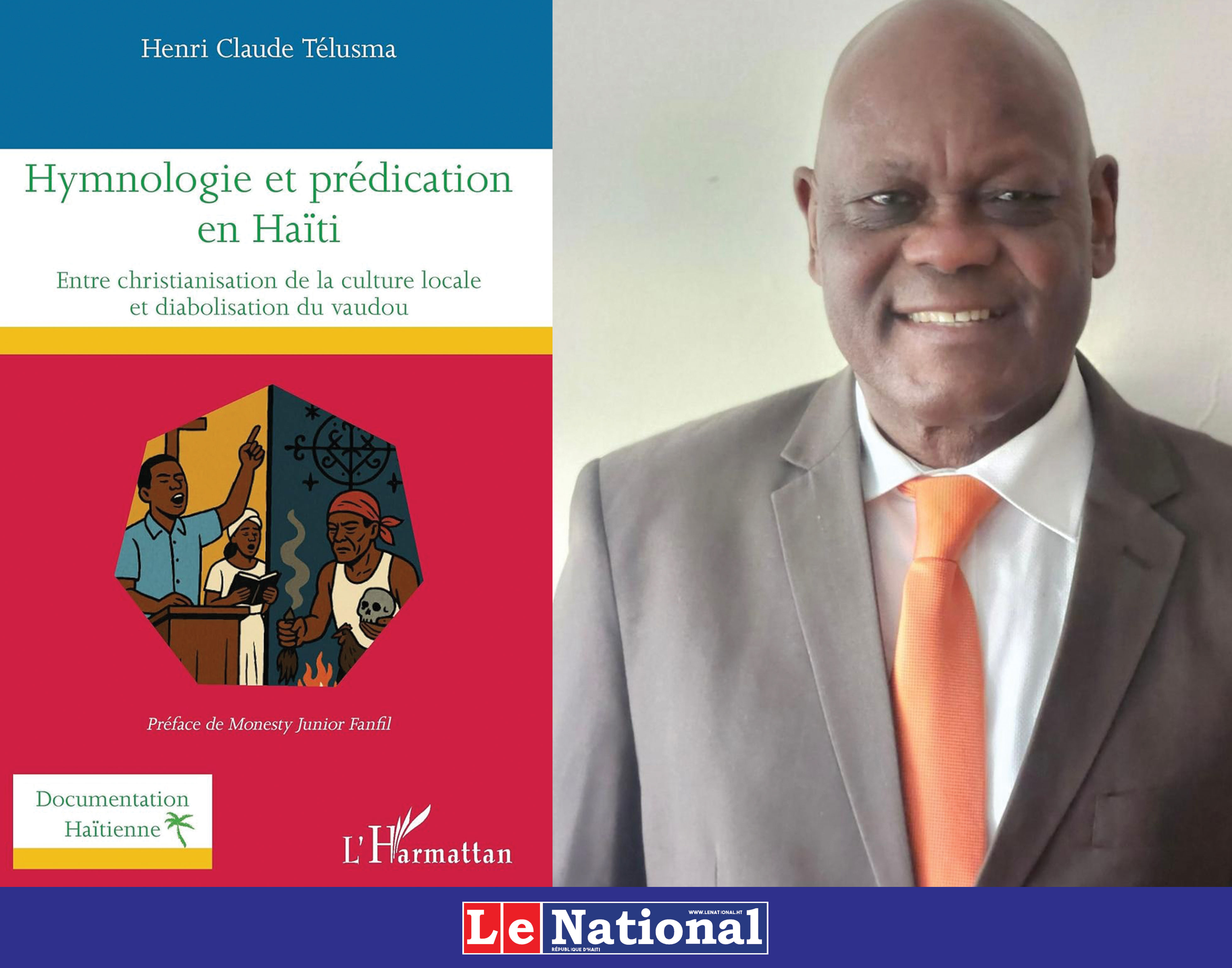Soucaneau Gabriel est poète, nouvelliste, journaliste et chroniqueur culturel. Son dernier livre Port-au-Prince, de soufre et de sang (Legs édition, novembre 2025) est un recueil de nouvelles taillé dans la pierre vive du réel. Avec une forme dense comme une nuit sans étoiles, le livre laisse jaillir des personnages qui avancent dans la capitale tels des corps en sursis, lestés de calamités, d’angoisses et de douleurs ordinaires. Chacun occupe sa place comme on occupe une blessure ouverte. L’écrivain n’a pas à forcer l’imaginaire : la matière brûle sous ses pieds. Il écoute la ville comme on colle l’oreille contre une poitrine malade, attentif au souffle court, aux silences qui hurlent.
Comment dire Port-au-Prince, ville martyre, ville fracassée, dont les reins ploient sous les dalles de fractures accumulées, semblable à un corps sans repos traîné de ruine en ruine ? Sa langue, lourde de cendres, n’est plus capable de lécher l’espérance : elle recrache la puanteur des jours, goutte après goutte, comme une plaie mal refermée. Port-au-Prince est ici une bête blessée qui tourne sur elle-même, saignant à ciel ouvert, condamnée à survivre dans l’asphyxie.
Dans cette nuit urbaine, Soucaneau Gabriel fait surgir une ville qui meurt presque à chaque minute, comme un cœur qui s’obstine à battre malgré l’hémorragie. Son imaginaire, loin de masquer le réel, l’éclaire d’une lumière crue. Il nous attrape, nous immobilise, et nous entraîne dans ses nouvelles comme dans une descente aux entrailles de la ville. Les actualités qu’il convoque tombent sur le lecteur telles des pluies acides : elles brûlent la peau, glacent le sang, mais révèlent, dans leur violence même, la nécessité d’une écriture qui regarde la catastrophe droit dans les yeux.
Quatre-vingt-sept pages pour raconter une ville et ses meurtres quasi quotidiens. Dès les premières lignes, l’un des personnages, Charlotte, donne le ton d’un quotidien ravagé, celui d’une cité où la beauté, autrefois debout comme une promesse, s’est effritée sous le poids du sang et de la peur. Port-au-Prince y apparaît comme un corps épuisé, condamné à compter ses morts à la cadence des jours, tandis que les vivants avancent à pas comptés, le regard chargé d’ombres. En peu de pages, l’écrivain parvient à dire l’essentiel : une ville qui survit, non par espoir, mais par habitude de la douleur.
Se tenir face à la mort
Parfois, il ne suffit plus de nommer la douleur. Il faut la traverser, la dépasser, pour se tenir face à la mort elle-même, dans ce qu’elle a de plus cru, de plus barbaresque. Une mort qui n’explose pas, qui ne saigne pas toujours, mais qui s’impose dans son calme obscène, comme une évidence installée au milieu de la ville. Elle ne hurle pas : elle attend. Elle s’offre au regard, figée, presque décorative, tandis que la vie, autour, reprend son souffle mécanique.
Aller au-delà de la douleur, c’est accepter ce face-à-face sans détour, regarder la mort non comme une fin spectaculaire, mais comme une présence quotidienne, ordinaire, et d’autant plus terrifiante qu’elle ne choque plus. « Le corps reposait sous l'imposante statue du Marron inconnu. Un drap de soie recouvrait partiellement ses cuisses laissant apparaître le triangle de son sexe. Ses seins, à l'air libre, étaient laissés à l'appréciation des passants. Ses cheveux étaient soigneusement rangés en un chignon, les yeux fermés comme si on l'avait jeté dans un sommeil profond. Il n'y avait pas de sang qui dégoulinait, pas d'impact de balle. Seulement une immobilité parfaite, presque mise en scène. Il était six heures du matin, les premiers rayons jaunâtres du soleil commençaient à poindre au loin. Les vendeurs du Champs-de-Mars ouvraient leurs échoppes. Les effluves de café sortaient des restaurants de fortune. Dans leurs uniformes bleus, les travailleurs. »
Cette scène s’ouvre comme un tableau funèbre soigneusement composé, où la mort n’est pas chaos mais ordonnance. Le corps, « reposant » sous l’imposante statue du Marron inconnu, n’est pas simplement abandonné : il est déposé, presque offert. La statue, symbole historique de résistance et de liberté, devient un socle paradoxal pour un corps féminin réduit au silence. La liberté célébrée par le monument contraste violemment avec l’immobilité définitive de la victime, comme si l’Histoire, figée dans le bronze, regardait sans pouvoir intervenir.
La banalisation de la violence
Le drap de soie agit comme une fausse pudeur, une tentative dérisoire de masquer l’exhibition du corps. La nudité partielle cuisses couvertes, sexe suggéré, seins exposés transforme la victime en objet de regard, livrée « à l’appréciation des passants ». Le corps devient vitrine, rappel cruel de la banalisation de la violence, où même la mort peut être mise en scène. La comparaison implicite avec une statue vivante se renforce : immobilité parfaite, absence de sang, aucune trace visible de violence. Tout semble propre, presque esthétique, comme si la mort avait été polie pour être regardable.
Les cheveux soigneusement rangés et les yeux fermés « comme si on l’avait jetée dans un sommeil profond » convoquent la métaphore du sommeil, figure classique de la mort apaisée. Mais ce sommeil est mensonger : il ne protège pas, il dissimule l’horreur. L’absence de sang et d’impact de balle renforce une inquiétante étrangeté la mort n’a pas laissé de signature visible, elle est devenue silencieuse, insaisissable, à l’image d’une violence quotidienne qui n’étonne plus.
Le lever du jour agit comme un contrepoint cruel. Tandis que le soleil « jaunâtre » pointe, la ville reprend son souffle mécanique. Les vendeurs du Champs-de-Mars ouvrent leurs échoppes, le café exhale ses odeurs familières, les travailleurs en uniforme bleu entrent en scène. La vie continue, indifférente, presque obscène dans sa normalité. La comparaison est implicite mais puissante : la mort est immobile, la ville est en mouvement, et c’est ce décalage qui glace.
L’auteur ne décrit pas seulement un cadavre ; elle met en scène une ville habituée à la mort, où le crime devient décor, où le quotidien absorbe l’exceptionnel. Le corps féminin, exposé sous un monument national, devient une métaphore tragique de Port-au-Prince elle-même : offerte au regard, meurtrie sans traces visibles, et pourtant contrainte de continuer à vivre sous le soleil du matin.
Car toute entreprise sincère d’écriture de nouvelles finit toujours par être saillante dans les faits qu’elle met en exergue. À force de précision et de regard, le texte atteint juste. Ainsi, ce livre de Soucaneau Gabriel s’impose comme une petite perle de sociologie du crime ordinaire, où les violences ne se cachent plus mais se pavanent dans les rues de Port-au-Prince, à visage découvert. L’écrivain ne les grossit pas, ne les dramatise pas inutilement : il les montre telles qu’elles sont, intégrées au paysage urbain, devenues langage quotidien. Et c’est précisément dans cette sobriété implacable que le livre frappe, révélant une ville où le crime n’est plus l’exception, mais une manière tragique d’exister. Ne raconte-t-il pas qu’à Port-au-Prince, « la mort est un plat bon marché qui s’offre à votre table, sans que vous l’ayez commandé. Un habitant de Port-Prince a tellement vu et vécu durant son existence qu’il est étranger à toute forme d’horreur. »
Au terme de ces pages, le livre de Soucaneau Gabriel expose, comme on expose une plaie à l’air libre. En peu de pages, l’écrivain parvient à dire l’essentiel une ville qui meurt à bas bruit, une humanité qui vacille, mais aussi une écriture qui refuse l’aveuglement. Ses nouvelles ne proposent ni consolation ni rédemption mais témoignage, âpre et nécessaire. Ce faisant, Soucaneau inscrit son livre dans la mémoire collective, afin que la ville, malgré le sang et la nuit, ne disparaisse pas sans avoir été dite.
Maguet Delva