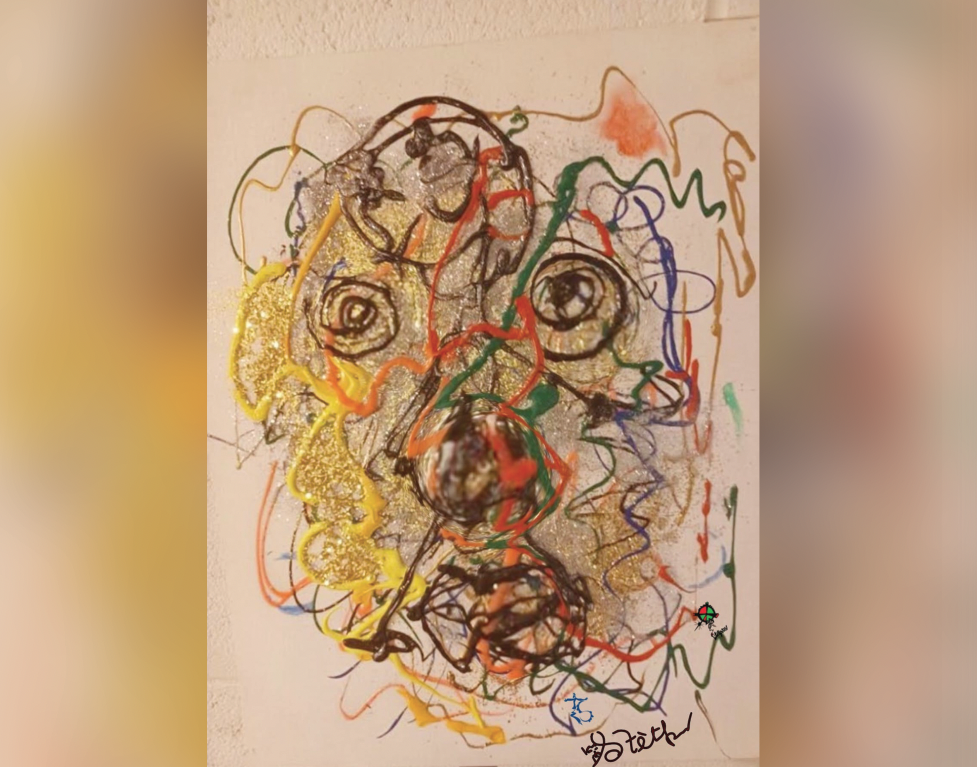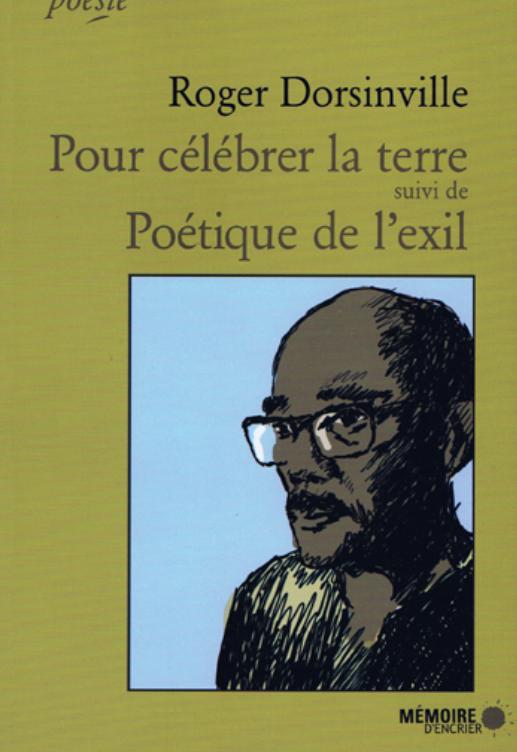Désormais reconnu comme un classique, le long-métrage d'Akira Kurosawa a joué un rôle décisif pour ouvrir à la reconnaissance internationale les cinémas ne venant ni d'Europe ni d'Amérique du Nord.
Le 10 août sort dans les salles françaises la version restaurée et numérisée en très haute résolution d'un film qui a joué un rôle exceptionnel dans l'histoire du cinéma. Beau film assez étrange, qui se regarde aujourd'hui comme une curiosité plutôt que comme un des chefs-d'œuvre de son auteur, Akira Kurosawa, Rashōmon marque en effet un tournant lors de son apparition hors du Japon en 1951.
En septembre de cette année-là, il remporte le Lion d'or au Festival de Venise, récompense alors encore plus prestigieuse qu'aujourd'hui. Cette consécration est confirmée au début de l'année suivante par l'Oscar du meilleur film.
Ce double coup de projecteur signe rien moins que la première reconnaissance sur la scène internationale d'un cinéma non «occidental» (si on inclut dans l'Occident le monde soviétique), ou du moins d'un cinéma du monde non blanc.
Le cinéma a alors un peu plus d'un demi-siècle d'existence. Pour ce qui définit sa reconnaissance artistique et culturelle, il se fabrique exclusivement entre Moscou et Los Angeles, via Berlin, Paris et Rome –avec une féconde mais éphémère parenthèse scandinave au début du siècle, vite absorbée par Hollywood.
Un demi-siècle de géographie amputée
Dès les premières décennies du XXe siècle, on a assurément tourné des films dans de nombreux autres pays du monde, de la Chine à l'Argentine. Mais aucun d'entre eux n'a conquis une visibilité hors de son pays, ni laissé de marque alors entérinée dans les histoires du cinéma.
Dès sa première édition, en 1946, le Festival de Cannes accueillait bien La Ville basse de l'Indien Chetand Anand et Dunia de l'Égyptien Muhammad Karim. Le moins qu'on puisse dire est que ces exotiques seconds couteaux n'ont pas marqué les esprits. Cela ne s'est d'ailleurs pas tellement arrangé depuis: ne cherchez pas les synopsis de ces films sur Wikipédia, ils sont introuvables.
Soit dit en passant, l'origine de ces deux films, issus de cinématographies qui s'affirmeront comme parmi les plus prolifiques et les plus conquérantes, viennent de pays qui sont alors directement (l'Inde) ou indirectement (l'Égypte) sous tutelle britannique. Ce n'est pas de l'Empire français qu'on risquait de voir venir des films à présenter dans le grand festival de la patrie du cinéma: dans ses colonies, l'accès aux caméras était tout simplement interdit aux indigènes.
Que ce soit du Japon qu'arrive, en 1951, le premier film conquérant une réelle visibilité, n'est pas étonnant, le pays étant depuis l'ère Meiji à bien des égards plus proche de l'Occident industrialisé que du reste de l'Asie.
En 1950, le cinéma japonais est d'ailleurs un art et une industrie riches d'une longue et riche histoire. Pour ne citer que quelques artistes majeurs, Kenji Mizoguchi tourne depuis 1922, Daisuke Itō depuis 1924, Heinosuke Gosho depuis 1925, Yasujirō Ozu depuis 1927, Mikio Naruse depuis 1930. Il existe des genres nationaux vivaces et féconds, des studios puissants, un vaste réseau de salles...
Mais, aussi moderne soit le Japon, les profondes différences culturelles avec l'Occident ont maintenu un fossé qui mettra du temps à être franchi. C'est bien ce à quoi s'est attelé Akira Kurosawa.
Stratégies et intermédiaires
Il ne s'y est pas attelé seul. Si Rashōmon est assurément un projet artistique du réalisateur, projet auquel il travaille depuis plusieurs années, c'est aussi un projet économique de son producteur, Masaichi Nagata.
Celui-ci dirige alors le studio Daiei, une société qui n'a pas un bon accès aux salles japonaises, contrôlées par les studios les plus puissants. Il décide alors de conquérir des positions sur les marchés étrangers, mais les États-Unis, quelques années après la fin de la guerre où le Japon a été son ennemi principal, sont inaccessibles.
«On procéda alors à une étude très soignée des marchés internationaux et il s'avéra que le point faible était constitué par les pays européens et plus encore par les pays latins. Il fut alors décidé que l'on se lancerait dans des films à costumes –historiques– exotiques et culturels pour affronter les festivals européens: Venise et Cannes surtout», racontera Nagata à Marcel Giugliaris et à son épouse japonaise Shinobu.
Ce monsieur Giugliaris, premier représentant à Tokyo de l'organisme d'exportation du cinéma français, Unifrance Films, jouera un rôle important dans la découverte du cinéma japonais en Europe comme du cinéma français au Japon. Il est arrivé dans ce pays l'année même de la découverte du film de Kurosawa, en 1951.
La déclaration de Masaichi Nagata est extraite du premier ouvrage dédié à cette cinématographie, livre pionnier écrit quelques années après par Shinobu et Marcel Giuglaris, Le Cinéma japonais (1896-1955)[1].
Quant à la stratégie revendiquée par monsieur Nagata, elle sera à l'évidence couronnée de succès, avec la présence de deux films japonais à Cannes en 1952, de trois en 1953 (pas forcément produits par lui), et l'année suivante le triomphe de La Porte de l'enfer de Teinosuke Kinugasa, Grand Prix à Cannes et Oscar du meilleur film étranger.
Et cela même si la clairvoyance du patron de la Daiei doit être relativisée: venant juste de prendre Kurosawa sous contrat, il avait détesté le scénario de Rashōmon, s'était résolu à contrecœur à le produire. Lorsqu'il découvrit le film, il quitta la projection en plein milieu, furieux, le déclarant incompréhensible. À sa sortie au Japon, il obtient d'ailleurs de médiocres critiques et fut un échec commercial.
Si le film qui allait ouvrir les yeux du «monde» –c'est à dire de l'Occident– sur l'excellence du cinéma japonais se retrouva à Venise, ce n'est nullement grâce à son producteur.
Kurosawa, qui comme il l'a raconté dans son autobiographie, ignorait que son film était présenté à la Mostra au moment où il apprit avoir gagné le Lion d'or, doit l'arrivée du film à Venise à l'activisme d'une dénommée Giuliana Stramigioli.
Cette Italienne japonisante et cinéphile, installée au Japon à la fin de la guerre du fait de sa trop grande proximité avec le fascisme mussolinien, y importa les premiers grands films du néoréalisme italien. Ayant apprécié Rashōmon, elle manœuvra avec assez d'habileté pour que l'histoire du bandit violeur, du samouraï lâche, de l'épouse très loin des canons de la féminité soumise et du bûcheron voyeur arrive au Lido en septembre 1951.
Le début d'un âge d'or
Éclatante, la consécration de Rashōmon sera loin de ne profiter qu'à ce film ou à son seul auteur. C'est aussi à partir de ce moment que la Daiei produit régulièrement celui qui, à l'époque, sera considéré par beaucoup comme le plus grand artiste du cinéma japonais, Kenji Mizoguchi, dont Nagata avait naguère produit deux des chefs-d'œuvre précoces, La Cigogne de papier (1934) et Les Sœurs de Gion (1936).
Mizoguchi s'impose alors par une série de films sublimes, la plupart produits par Nagata: Miss Oyu (1951), Les Contes de la lune vague après la pluie (1953), L'Intendant Sansho (1954), Les Amants crucifiés (1954), L'Impératrice Yang Kue-fei (1955), Le Héros sacrilège (1955), La Rue de la honte (1956).
En Occident, la reconnaissance de l'importance de son œuvre est puissamment relayée par Henri Langlois, le patron de la Cinémathèque française, les Cahiers du cinéma, qui en feront une figure essentielle de la cinéphilie, mais aussi le Festival de Venise, qui récompensera trois de ses films en quatre ans (1953, 1954, 1956).
Immense cinéaste au langage universel, Mizoguchi impose son style alors qu'un autre génie reste encore pour longtemps à l'écart de la reconnaissance internationale. Il faudra à Yasujiro Ozu, considéré comme «trop japonais», vingt ans de plus pour occuper, à titre posthume, la place qui lui revient au panthéon des grands cinéastes du monde.
Trop et pas assez japonais
Pour Kurosawa, c'est d'une certaine manière l'inverse. Il conquiert en Occident une place qui lui vaut une réticence massive de ses compatriotes, qui le trouvent, quant à lui, trop occidentalisé.
Kurosawa eut presque toute sa vie à affronter ce genre d'obstacle, où le sort de son troisième film, Les Hommes qui marchèrent sur la queue du tigre, fait figure de symbole de l'absurdité des obstacles qui se dressent sur le chemin d'un grand artiste.
Tourné durant les derniers mois de la dictature militaire japonaise, le film était prêt à être présenté aux autorités lorsque survint la capitulation.
Comme le raconte le grand historien du cinéma japonais Donald Ritchie, «les censeurs [japonais] affûtaient leurs ciseaux, mais comme l'achèvement du film coïncida à peu près avec celui de la guerre, ils ne purent pas faire grand-chose. Néanmoins, en le retirant de la liste des films soumis au nouveau bureau de censure de l'occupant allié, ils s'assurèrent que le film ne sortirait pas. Plus tard, lorsque les censeurs américains examinèrent ce film dont l'esprit avait été jugé trop démocratique et trop américain par leurs confrères nippons, ils le trouvèrent, au contraire, trop féodal, et trop japonais.»[2]
Celui qui finira, en grande partie grâce au soutien des amateurs de cinéma du monde entier –au premier rang desquels se porteront un jour Martin Scorsese et Francis Coppola–, par occuper un des tout premiers rangs dans l'admiration mondiale, s'inspirera en effet de grandes références occidentales (L'Idiot d'après Dostoïevski, Le Château de l'araignée et Ran en partie d'après Shakespeare, Les Bas-Fonds d'après Gorki) et empruntera autant qu'il le jugera souhaitable aux codes du cinéma de genre américain.
Aussi bien certains de ses films donneront lieu à des remakes américains (Les Sept Samouraïs devenu Les Sept Mercenaires de John Sturges, et Rashōmon devenu L'Outrage de Martin Ritt) ou italo-américain (Le Garde du corps, copié sans vergogne par Sergio Leone avec Pour une poignée de dollars).
Kurosawa n'a jamais fait mystère de sa passion pour les grands films américains et européens. Mais il aura aussi raconté avec ses films, de manière précise et sensible, des vastes pans de l'histoire et de la culture japonaise à différentes époques et dans de multiples contextes, y compris les arts martiaux et leur philosophie.
C'est au carrefour de ces apports que s'inscrit Rashōmon, inspiré d'une nouvelle de l'écrivain Ryūnosuke Akutagawa parue en 1922, «Dans le fourré». Des commentateurs occidentaux pourront voir dans ce récit d'un viol et d'un meurtre, raconté successivement et très différemment par quatre protagonistes l'influence de Luigi Pirandello, l'auteur de À chacun sa vérité et de Six personnages en quête d'auteur.
Cette approche éclatée, qui remet en jeu l'idée même de vérité unique et valorise les questions de point de vue (question de cinéma aussi, bien évidemment), était bien présente chez l'écrivain japonais, qui ne devait rien à son collègue italien. On pourrait tout aussi bien évoquer Citizen Kane d'Orson Welles, film novateur lui aussi construit en flashbacks successifs construisant un récit fragmentaire, sans rien enlever à l'originalité de Kurosawa.
Construction, force visuelle et grimaces
D'une impressionnante puissance visuelle, Rashōmon est en effet composé, d'une manière très inhabituelle, avec un flashback (le récit du procès par les trois hommes obligés par une pluie diluvienne de se réfugier sous la porte qui donne son titre au film) dans lequel s'enchâssent plusieurs autres, constitués par les quatre témoignages.
Le film détonne tout autant par la définition des personnages, qui ne répondent en rien aux critères du film de genre, y compris lors d'un combat au sabre qui ridiculise ouvertement la supposée maîtrise des armes par ses deux principaux personnages masculins, le brigand exultant de vitalité sauvage et le samouraï.
Film d'époque semblant relever d'un genre très codifié, Rashōmon emprunte à des styles de jeu inhabituels, venus du théâtre traditionnel japonais, notamment de certains styles correspondant à l'époque à laquelle est située l'action (aux alentours de l'an 1000) comme le Sarugaku. Celui-ci se caractérise par des outrances dans l'interprétation, qui mobilise volontiers hurlements et visages grimaçants.
Parmi les interprètes se détache, à demi nu et en pleine effervescence physique et expressive, l'acteur fétiche de Kurosawa, Toshirō Mifune, avec qui il a déjà tourné quatre films majeurs, L'Ange ivre, Le Duel silencieux, Chien enragé et Scandale. Ils tourneront seize films ensemble, jusqu'au sommet inégalé qu'est Barberousse en 1965.
Rashōmon occupe donc une place historique majeure quant aux effets qu'il a produits (place analysée en détail dans l'ouvrage Rashomon Effects, Kurosawa, Rashomon and their legacies). Ce n'est pas pour autant un des meilleurs films du futur auteur de Vivre, de Dersou Ouzala ou de Rhapsodie en août. Mais c'est un bon témoin de l'art d'un cinéaste qui emprunte aussi bien au puissant héritage culturel de son pays qu'à de multiples autres sources.
La force du noir et blanc et la composition des cadres évoquent ainsi les splendeurs du cinéma muet allemand ou soviétique. Difficile à supporter est en revanche la présence insistante, durant la première moitié du film, d'une musique symphonique envahissante, parodie du Boléro de Ravel, la moins recommandable des influences occidentales présentes dans le film.
Vu aujourd'hui, en pleine connaissance de l'œuvre immense de Kurosawa, le film surprend par ses aspects grotesques, ses outrances –procédés excessifs que le cinéaste retravaillera, de manière différente, dans de grands films plus tardifs, du personnage de Mifune dans Les Sept Samouraïs à Dodeskaden.
Il est vraisemblable que c'est son côté hybride, ses exagérations, en même temps qu'une énergie sauvage des corps et de la réalisation, qui ont permis à Rashōmon de faire sauter le verrou qui jusqu'alors excluait tous les films non blancs de la considération qu'ils méritaient.
Un long chemin inachevé
À partir de 1951, le cinéma japonais a désormais conquis droit de cité. Il faudra attendre quatre ans de plus pour qu'un autre grand cinéaste non européen, mais pas japonais, conquière à son tour une visibilité de première importance: ce sera l'Indien, ou plutôt le Bengali Satyajit Ray, grâce au prix obtenu à Cannes pour son premier film, La Complainte du sentier en 1956, suivi un an après du Lion d'or à Venise pour le deuxième volet de sa «Trilogie d'Apu», L'Invaincu.
Les pas décisifs accomplis par Kurosawa et Ray, auxquels succéderont au début des années 1960 les auteurs du «Cinema Novo» brésilien, s'inscrivent dans une trajectoire qui est loin d'être accomplie. Lorsqu'en 1998 Jean-Luc Godard donne sa forme définitive à cette œuvre monumentale qu'est Histoire(s) du cinéma, immense montage qui retraverse un siècle de créations pour le grand écran en écho aux mouvements de l'histoire du siècle, il cite des centaines de réalisateurs. Parmi eux, un seul, Kenji Mizoguchi, n'est ni européen ni américain.
Malgré d'incontestable avancées, il reste encore beaucoup à faire au XXIe siècle pour que la planète cinéma ressemble à la réalité des richesses en manières de raconter et en manières de montrer que recèle la planète Terre.
1 — Éditions du Cerf, 1956, p.25. Cité par Mounir Allaoui dans sa thèse «Nouvelles Vagues et subjectivité en France et au Japon: dialogues interculturels entre la critique et les institutions cinématographique en France et dans le “cinéma d'auteur” japonais» (université Montpellier 3 – Paul Valéry, 2021). Retourner à l'article
2 — Le Cinéma japonais, Monaco, Éditions du Rocher, 2005 (pour la traduction française), p.130. Retourner à l'article
Source : slate.fr