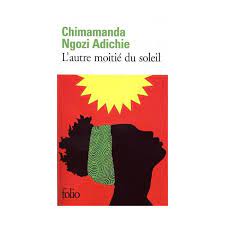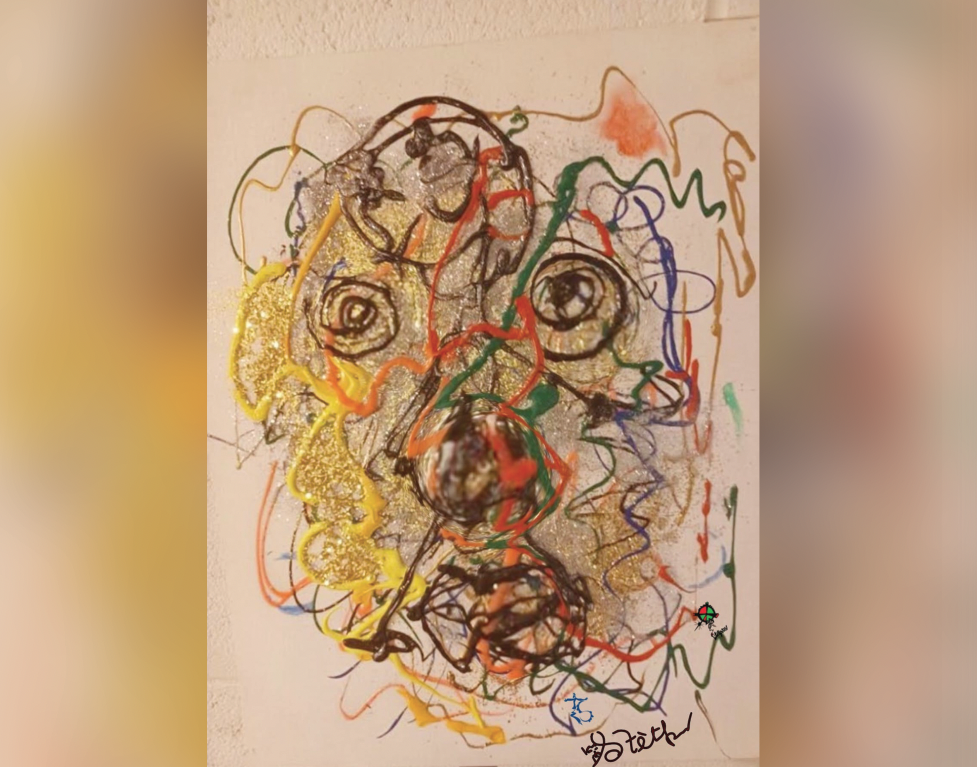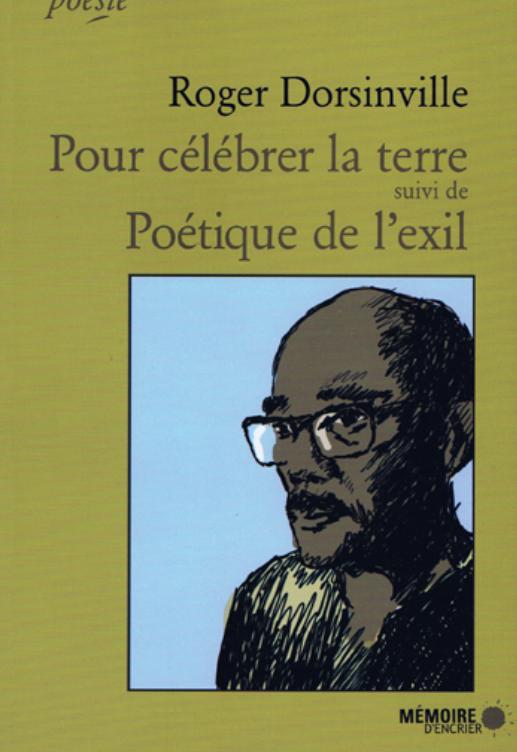J’emprunte le titre de cet article à une phrase que l’auteur de L’Autre moitié du soleil prête à son père qui terminait ainsi les histoires qu’il racontait autour du conflit Nigéria-Biafra. Ce conflit oublié de la fin des années 60 est le cadre du roman de Chimamanda Ngozi Adichie.
De tout temps, les longs romans présentant une trame historique font partie de mes lectures favorites. J’ai été comblée avec ce superbe récit d’Adichie où elle veut nous convaincre, si besoin est, que la guerre est déshumanisante. Bien que se plaçant du point de vue du Biafra – sa famille est originaire de la région, ses deux grands-pères ont péri lors du conflit – Adichie ne verse guère dans le manichéisme, idéalisant son camp et diabolisant l’autre. Elle fait dire par Olanna, sa principale figure féminine :
Mais nous sommes tous capables de nous infliger mutuellement les mêmes choses, en fait.
Le casus belli ? Des massacres commis contre les membres de l’ethnie ibo, majoritaire dans le sud-est du Nigéria. Ils décident de faire sécession et de proclamer la République du Biafra. Pourquoi le Nigéria et ses soldats massacreurs ne se contentent-ils pas de dire « bon débarras » ?
C’est le pétrole, dit-elle. Ils ne peuvent pas nous lâcher facilement avec tout ce pétrole en jeu.
On est parti pour trois ans d’une guerre civile atroce que Chimamanda Adichie nous met sous les yeux avec beaucoup de talent : la société nigériane au lendemain de l’indépendance, les vrais enjeux du conflit, les victimes innocentes, le cynisme de la communauté internationale face à la grave crise humanitaire.
Atrocités, bassesses, corruption sont également réparties dans les deux camps. Les massacres perpétrés par les haoussas et les yorubas contre les ibos m’ont frappée par la similarité avec ce qui s’est passé trente ans plus tard au Rwanda avec le génocide des Tutsis par les Hutus. Cette même haine, ces mêmes armes blanches, ces mêmes cadavres de femmes, d’hommes et d’enfants mutilés. Adichie a pour but de dénoncer la guerre en soi, non de s’apitoyer sur le sort des vaincus. J’ai aimé ce parti pris.
La ferveur populaire et le nationalisme farouche des Biafrais voisinent avec les sarcasmes à l’encontre de leur seigneur de guerre, Ojukwu, dont on raille la mise toujours soignée, l’accent d’Oxford, la concupiscence :
Les seuls traitres que nous ayons sont ceux qu’Ojukwu a inventés pour pouvoir mettre en prison ses adversaires et les hommes dont il veut les femmes.
De l’autre côté, des soldats nigérians me font penser à cette boutade (réelle ou inventée ?) des dirigeants nazis : « Quand j’entends le mot culture, je sors mon révolver » :
Odenigbo démarra. Il retira ses lunettes et les enveloppa dans un bout de tissu. Les soldats nigérians, avaient-ils entendu dire, n’aimaient pas les gens qui avaient l’air d’intellectuels.
Plus loin, encore des soldats nigérians fouillent la maison d’Odenigbo et d’Olanna, peu après la fin du conflit, perdu par le Biafra comme nous savons :
« Nous sommes à la recherche de tous matériaux susceptibles de menacer l’unité du Nigéria », puis il alla à la cuisine et en revint avec deux assiettes pleines de riz jollof fait par Ugwu. Après avoir mangé, après avoir bu de l’eau et roté bruyamment, ils montèrent dans leur break.
Ceux-là sont de la race des Tonton Makout qui, sous Duvalier, sont venus fouiller la bibliothèque de René Dépestre, accusé de communisme, et qui sont repartis emportant fièrement comme ouvrage très subversif, Le Petit Chaperon rouge.
Mais deux passages, qui d’ailleurs se suivent de près dans le livre, illustrent parfaitement le message à tirer de ce roman : la guerre, loin d’opposer des camps ennemis, ne fait que les réunir dans une même bêtise.
Le premier est une conversation entre deux jeunes soldats biafrais.
Le dernier camp que j’ai infiltré, quand j’étais dans le bataillon de Nteje, leurs femmes cuisinaient la sauce avec des morceaux de viande gros-gros. Ils en ont même donné à nos hommes quand ils ont arrêté les combats pendant une semaine pour fêter Pâques.
- Ils ont arrêté les combats pour fêter Pâques ? » demanda Ugwu.
High-Tech parut content d’avoir enfin capté son attention.
« Oui. Ils jouaient même aux cartes ensemble et buvaient du whisky. Quelquefois, ils décident ensemble de ne pas se battre pour que tout le monde se repose. »
Ainsi donc, entre combattants ennemis, on prend une pause. La boucherie héroïque est reportée au prochain jour ouvrable.
L’autre passage relate un viol collectif commis par un groupe de soldats, dont les deux interlocuteurs qui précèdent, sur une jeune serveuse de restaurant en territoire du Biafra. Une fille de leur camp.
Fraterniser entre belligérants et se charcuter dans son propre camp, voici l’art de la guerre.
Un des violeurs, Ugwu, est le personnage principal du roman. Comme les co-auteurs de cet acte odieux (puis-je les appeler criminels de guerre ?), il a été recru de force. Et, eux tous venaient de boire et de fumer tout leur saoul. Ugwu exprimera quelque regret par la suite. Plus loin dans le roman, Anulika, sa propre sœur subira l’horreur d’un viol collectif, cette fois par des soldats ennemis. Était-ce le prix de la rédemption du jeune Ugwu ? Une expiation par procuration ?
Le roman nous offre aussi, deux histoires d’amour palpitantes, entre Olanna et Odenigbo d’une part, Kainene et Richard d’autre part. Avec un douloureux télescopage entre les deux couples. D’autant plus douloureux que Kainene et Olanna sont des jumelles. Une grande place est faite à l’amour physique. Le désir l’emportant souvent sur le reste, selon moi. L’infidélité, chez la femme, ressemble à une manière de s’affirmer, de se libérer. Adichie, figure de proue du féminisme contemporain, crée certains personnages féminins en vue d’illustrer ses idées en la matière.
Avec environ 650 pages, ce roman est parfois étourdissant. On n’est pas loin de se noyer dans une multitude de personnages. Ici ou là, dans l’histoire du couple Olanna et Odenigbo surtout, on tombe dans un mélodrame – les épisodes impliquant Amala ou Alice par exemple - à la limite du rocambolesque.
Un autre point fort du roman L’Autre moitié du soleil est la structure de valse à quatre temps.de la narration qui est en mode aller-retour, le début des années soixante, la fin des années soixante. Et l’analepse est reprise. C’est un procédé déjà à l’œuvre dans le premier roman d’Adichie, L’Hibiscus pourpre. Ce principe crée des anticipations chez le lecteur qui doit patiemment poursuivre sa lecture pour avoir certaines réponses. Je pense à la naissance de Baby, entre autres.
Je voudrais, pour terminer, revenir à Ugwu. À bien des égards, ce jeune garçon, venu de la brousse à treize ans pour servir de boy à Odenigbo et dont l’épanouissement social et intellectuel se déroule sous nos yeux, a tout d’un héros attachant. Une subtile mise en abîme qui se dévoile vers la fin du roman nous révèle que c’est lui qui l’écrit en fait. Pourquoi en avoir fait un criminel de guerre ? (J’assume le qualificatif).
C’est cela la force de la guerre très laide. Tuer le héros en nous.
Nathalie LEMAINE
Port-au-Prince – 18 octobre 2022