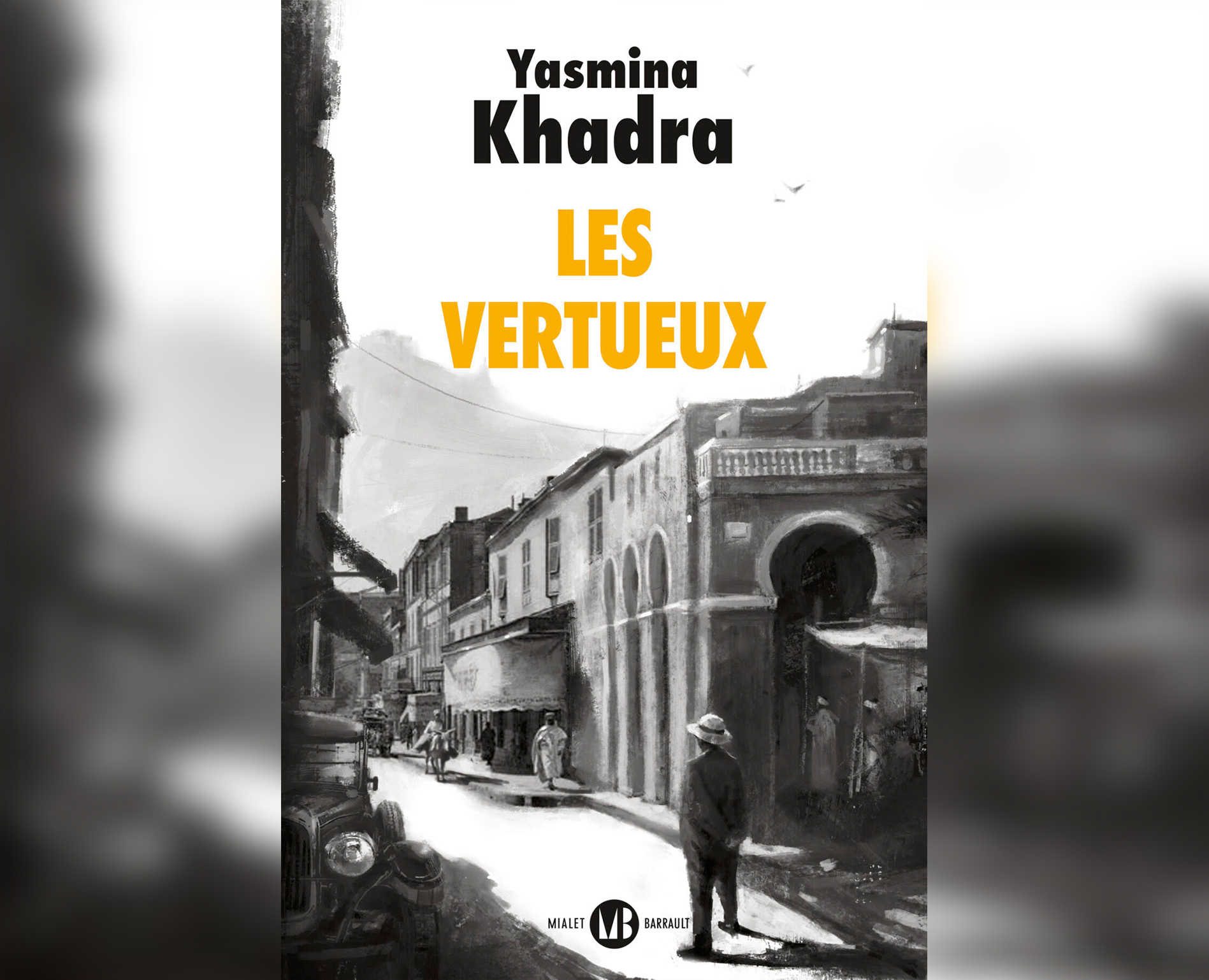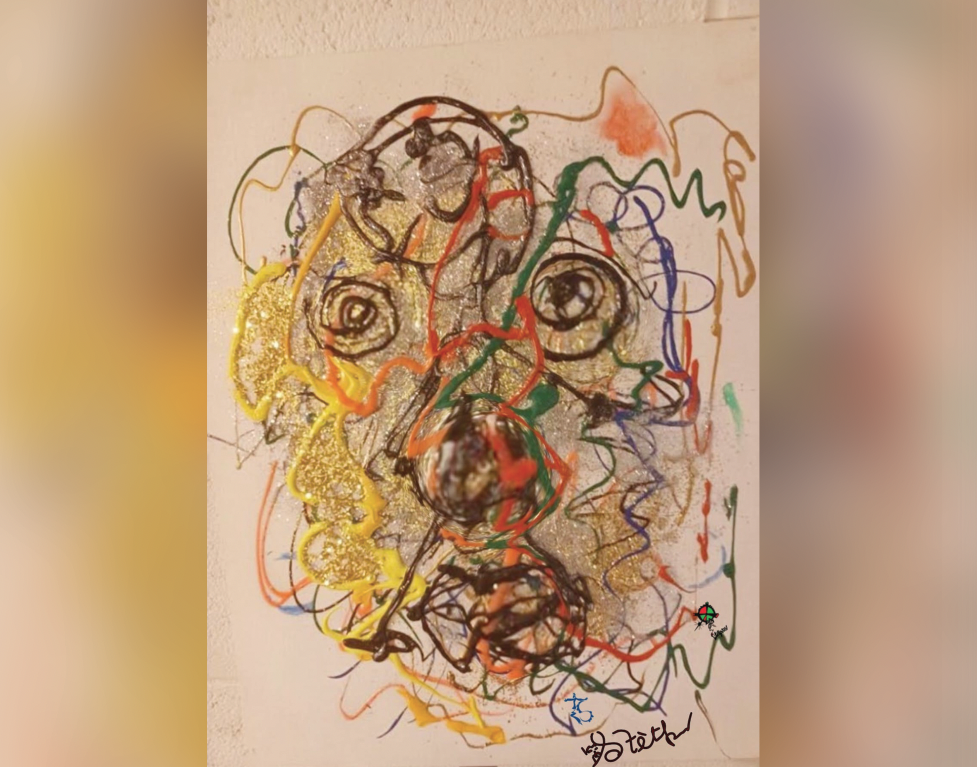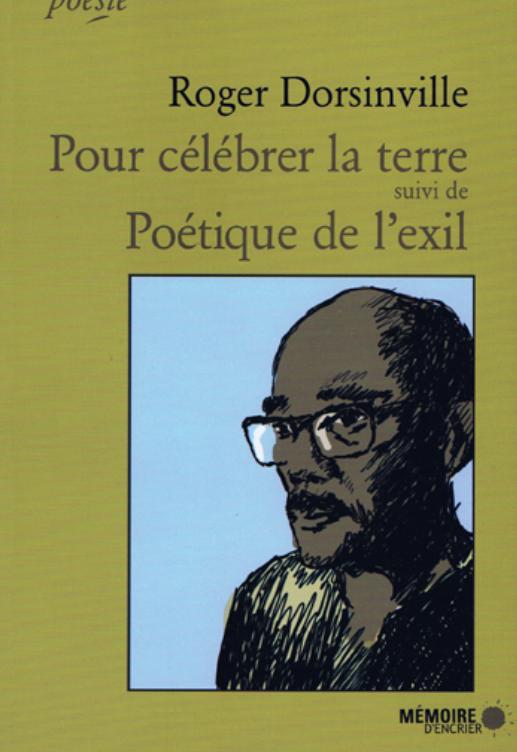C’est un texte majeur que présente l’écrivain qui depuis longtemps a choisi de ne pas se séparer de son pseudonyme, parce que ce dernier participe intégralement de son identité, voire de son intimité secrète, et qu’il en fait don à ses lecteurs. C’est d’abord un très bon et très juste roman.
De la vertu en général. Les Anciens et les penseurs du sacré ont fait de la vertu le point de repère, voire l’amer dans nos pérégrinations intérieures, sauf que la vertu elle-même demeure rétive à se laisser circonscrire. D’ordinaire, ce sont plutôt ses attributs qui sont nommés. La vertu est démultipliée en vertus cardinales (prudence, tempérance, force d’âme, justice), théologales, dans la pensée catholique, et plus largement dans les pactes monothéistes (foi, espérance, charité). D’autres qualités sont fréquemment adjointes : franchise, dévouement et même parfois, pureté. On pourrait presque y retrouver la simplicité, celle du peu de conscience sociale du « chaste fol ». Ainsi, avec la vertu, l’être est acculé à une pensée dynamique, qui oscille entre connaissance et inconnaissance du bien, du vrai et sans doute également du beau.
De l’action. Dans le genre du roman, la vertu se manifeste dans l’action.
Et c’est bien par là que le roman d’YK, Les Vertueux, développe une fiction particulièrement âpre, puisqu’il ne s’agit pas de qualifier l’objet de la vertu elle-même, mais de mettre en jeu ce qui s’en estime redevable. L’auteur fait ainsi le pari de la fiction et de ses débordements, contre la neutralisation par l’abstraction et l’expression stéréotypée des bons sentiments : le mal sanctionné, la bonté d’âme récompensée. Le point de départ en est un prétendu accommodement particulièrement insupportable, celle d’un jeune homme, Yacine Cheraga, un quasi chaste fol, justement, à qui le caïd local, Gaïd Brahim, homme puissant et dont pouvoir, richesse, et territoire constituent la frontière mentale de Yacine, enjoint de prendre la place de son fils lors de la conscription de 1914. L’homme puissant lui assure que sa famille, pauvre entre les pauvres, sera récompensée pour ce sacrifice. Yacine Cheraga devient Hamza Boussaïd et part mener une guerre qui lui est incompréhensible, mais par laquelle peu à peu il va acquérir un savoir sur les autres, sur la guerre, sur la géographie, et sur lui-même. Voici le constat qu’il prononce une fois que c’est terminé : « Quatre années de tranchées, de replis meurtriers, d’assauts suicidaires, de cauchemars éveillés, de gaz moutarde, de fièvre jaune et de dysenterie ». YK a connu la guerre, et on ne saurait lui faire le reproche énoncé par le vieil Erasme : « Dulce bellum imperitis ». Ses camarades et lui porteront en eux la conviction d’être des survivants.
Pour l’instant, Yacine est immobilisé par l’exigence de soumission, imposée par des menaces et leur corollaire, le respect, qui est bien cette attitude qu’exige des autres un puissant qui les méprise, comme Yacine le constatera amèrement par la suite. En cela, Les Vertueux fait remonter à la conscience du lecteur des figures plus anciennes, qui interrogent l’exigence sociale et politique de la vertu. Plus tard, quand un temps de dureté aura passé, et que momentanément Yacine trouvera un semblant d’assurance, un de ses compagnons le lui dira sans détour, réancrant le texte dans la fiction romanesque et la dénonçant tout à la fois, en indiquant au lecteur une matrice de lecture : « Tu es sincère, entier, pur, et ça, c’est pas prudent ».
Lumière, face opaque. Depuis le siècle des Lumières, et les quelques tentatives de romans édifiants à l’usage de la bourgeoisie qui prend peu à peu le pouvoir, les écrivains ont mis à mal l’apologie de la vertu comme principe de vie. La vertu, c’est un des ressorts du romanesque, pendant longtemps. Pamela, ou la vertu récompensée (1740) de Richardson révèle les intrigues sociales à l’œuvre pour faciliter le changement de classe de l’héroïne, mais ce faisant satisfait pleinement un public à la recherche du contentement social. Sur l’autre balancier, Justine, ou les malheurs de la vertu (1791) de Sade, prend le contrepied systématique de l’attitude bonne, en confrontant la jeune héroïne à une théorie de monstres et de pervers, quand ce n’est pas le ciel lui-même qui la foudroie, alors qu’elle pense avoir trouvé le repos. On n’oubliera pas le succès européen du texte que Sade récrira durant de nombreuses années. Et en même temps, le succès entier de La Nouvelle Héloïse (1761) de Rousseau, autre texte qui se joue de l’édification : une esthétique du renoncement qui s’avérait une véritable mécanique de l’écriture. YK inscrit sa propre écriture dans un registre critique, dès l’origine du thème et la mise en évidence de l’aporie sur laquelle le sens commun la fait reposer : si elle est récompensée, la vertu perd son attribut de souverain bien, car elle n’est plus qu’un instrument au service du salut, de la rédemption ou d’un médiocre et souvent risible contentement : « J’ai été étonné du plaisir qu’on éprouve en faisant le bien ; et je serais tenté de croire que ce que nous appelons les gens vertueux, n'ont pas tant de mérite qu'on se plaît à nous le dire » écrit Valmont à Madame de Merteuil dans Les Liaisons dangereuses (1782), de Laclos. Le traitement littéraire de la vertu en acte est dangereusement paradoxal. YK le sait bien.
Guerre. La confrontation à la brutalisation générale est alors la seconde étape de cette existence, présentée depuis la conscience du personnage central de Yacine, désormais Hamza. La guerre au jour le jour constitue ainsi une part importante du roman. Hamza prend conscience brutalement à chaque étape de l’étendue du monde et de la diversité des êtres : train, bateau, marches, paysages de plus en plus déchirés, corps en charpie suspendus aux barbelés, cette conscience est aussi peu à peu celle de la loque qu’il devient quand le feu tombe sur la troupe. Il partage l’héroïsme quotidien des combattants et celui de l’existence dans les tranchées, dont l’horreur est appuyée, depuis le premier mort réellement regardé, et qui devient le repère même de la déchéance morale qui le ronge, presque à son insu, et qui resurgira, à l’automne de sa vie : « …Ich bin verletz » lui hurle le jeune soldat allemand qu’il transperce de sa baïonnette. « Jamais je n’oublierai ce regard », affirme le narrateur. La tristesse est entière, et elle devient le symptôme même de la folie généralisée. C’est un moment de tous les extrêmes, et dans la narration, un de ceux qui impriment une datation de l’histoire, comme si le masque d’Hamza ne comptait plus et que Yacine se manifestait dans la lumière anamnésique de l’histoire racontée : « Des décennies ont passé. Je n’ai pas réussi à oublier ce jour-là ». Sans tirer sur les limites de l’interprétation, on considérera ce moment du texte, et d’autres de la même forme, comme des mises en scène de l’écriture. Par le truchement du personnage narrateur de cette histoire, l’écriture se manifeste comme signal d’un procédé. L’histoire, ce ne sont pas seulement les faits racontés, mais leur mise en mémoire et l’efficacité de leur agencement narratif.
De la modernité. Et il poursuit : « Ce ne fut pas seulement mon baptême de sang, ce fut ma vraie naissance au monde moderne - le monde vrai, cruel, fauve et impitoyable où la barbarie disposait de sa propre industrie de la mort et de la souffrance ». Il faut avoir bien considérer l’omniprésence du développement de techniques et d’instruments de souffrance et de mort au sein même des sociétés qui déclarent l’amour de la paix et de la mesure, pour parvenir à appréhender l’hébétude des soldats, et les peurs viscérales qui les amène à perdre le sens, et rapidement à mettre en œuvre une prudence adossée à l’urgence de vivre. Une scène du roman montre cette ambivalence et le retrait en soi de ces soldats extraits violemment de leur univers algérien, quand, au hasard d’une patrouille, ils observent sans intervenir l’apparition d’un groupe de jeunes femmes se baignant nues dans une rivière. Apparition furtive, évanouie et qui ne reviendra plus sauf dans l’imaginaire des jeunes hommes, comme l’équivalent d’un repère pour la sensualité perdue.
C’est aussi une école sinon de fraternité, du moins de camaraderies, et qui dans la narration va préparer la suite du roman. Lorsque la guerre est finie, malgré la persistance des attitudes racistes, la joie du retour est tempérée par la séparation définitive : depuis le bastingage, celui qui est encore un temps Hamza entrevoit ses camarades « au loin, alignés sur les quais par milliers, en train de nous faire des signes d’adieu », comme des spectres abandonnés. L’histoire de Hamza est celle de la survie de Yacine, d’abord, et des quelques rescapés du grand massacre : Sid, Zorg, Mabrouk, Horr, Issa, Raho, mais aussi l’officier Gildas, Algérois qui a rompu avec sa famille riche et qui se rapproche du monde de l’autre, le colonisé. C’est bien la situation coloniale qui au retour de la guerre constitue le premier plan du panorama.
Algériens dans la guerre. Le roman, au début tout au moins, neutralise la description coloniale de la société. À peine transpire t-elle dans les parlures des militaires et des sous-officiers. Et même l’enrôlement et l’embrigadement des « indigènes », qui dans notre actualité sont progressivement devenus la marque du scandale colonial, sont au début du roman à peine plus que des promesses de vaillance. Ou bien d’une façon d’acclimater et de se persuader de la possibilité de se défaire de modes vie considérés comme archaïques, et de gagner la modernité.
Les tirailleurs algériens, en tant qu’unités de l’armée française existent depuis 1842. Dans La Force noire, le futur général Mangin, qui promeut une armée formée de troupes coloniales, comme force aux interventions qui furent décisives décisives pendant les campagnes militaires de la seconde moitié du XIXème s., écrit : « Ce n’est pas seulement par cette indomptable ténacité et par cette irrésistible furie sur le champ de bataille que se signalèrent nos troupes indigènes, c’est par leur confiance imperturbable en leurs chefs, par leur ténacité dans la lutte, qu’elles n’abandonnent que quand le commandement a bien perdu tout espoir, par leur stoïcisme dans les revers, par leur profond sentiment de la discipline, qui restait vivace alors que les autres troupes l’avaient perdu… ». Le roman de YK intègre cette réalité de l’ardeur des troupes coloniales, dans l’histoire elle-même, mais aussi dans l’exigence sociale du personnage de Gaïd Brahim, qui est pourtant l’emblème de la neutralisation et donc du dévoiement de cette exigence de prestige. Ce qu’il advient ensuite des survivants est aussi à l’image, en partie, de la désaffection désormais identifiée de l’État colonial pour ses soldats. Cet aspect constitue l’arrière-plan de la narration, dès lors que Yasmine Cheragua est rendu à la vie civile. C’est aussi à ces moments que la vie militaire se rappelle à lui.
Le retour. Commence alors une autre histoire, celle par laquelle Yacine va devoir se battre pour reconstruite une identité mise à mal : par la supercherie du caïd, par le surgissement extrêmement violent de cette modernité qui se manifeste d’abord par la guerre, par les conflits latents qui vont devenir si manifestes. Celui qui se poursuit entre Sid et Zorg, par exemple, reprend la coupure entre ruraux et urbains, en Algérie. Selon Zorg, Sid est méprisable car il habite le monde urbain des colons. En filigrane, le texte insiste sur la séparation, qui va tracer une ligne de démarcation radicale entre des personnages dont la guerre a fracassé les consciences.
Pour Yacine, c’est aussi par là que va commencer et s’accomplir une traversée de la société, et par laquelle il va élaborer son existence, au fur et à mesure de ses pérégrinations mouvementées. Les épisodes s’enchaînent à partir du moment où Yacine comprend qu’il a été trompé, qu’il n’existe plus en tant qu’être, que sa famille a été maltraitée au point qu’elle a disparu. Après avoir rencontré une dernière fois l’adjudant-chef Gildas, perdu dans les souvenirs d’une passion malheureuse, et la trahison de sa compagne (avec le propre père de Gildas ?), Yacine est attiré dans un traquenard dont il échappe en tuant son agresseur. Commence alors une vie d’errances, à la recherche de sa famille, perdue. Il est aidé dans cette quête par plusieurs intercesseurs qui finissent par le décourager. Au cours des déplacements, et des événements, les rencontres accomplies sont autant de moments propice à des récits.
Un roman picaresque. Il s’agit bien d’un roman picaresque : le personnage raconte son existence à la première personne, et ses déboires. Cependant, à la différence du picaro des origines, la ruse, la bassesse et la tromperie ne sont pas les moteurs de l’amélioration de sa condition. En revanche, dès que le sort de Yacine est susceptible d’être amélioré, la catastrophe survient. Ainsi, lorsqu’il accède au métier de vendeur de tissus et devient l’amant de la propriétaire du magasin. Une machination de la famille de celle-ci l’oblige à fuir au loin, et à tenter de se retrouver, ainsi que les siens, dans l’errance. De nombreux quiproquos amplifient la narration, et, partant, la figuration d’une Algérie coloniale âpre à ceux que l’on ne nomme plus que comme « Indigènes ». La violence sociale a succédé aux tranchées, et la misère redevient le lot commun. Le picaro traverse la société, et son regard, ses questionnements sont aussi des mises en cause de l’État social : « Dans mon douar natal, (…) nous étions trop pauvres pour prétendre nourrir le voisin, mais nous étions solidaires et unis dans la pauvreté et la maladie ». La modernité, c’est d’abord la bidonvillisation et son lot de dénuement et de détresse : « À Jenane Jato, foutoir sauvage et impitoyable, c’était chacun pour soi et il n’y avait pas grand chose pour le cupide ni pour le vertueux ». Ce lieu de déchéance sociale revient dans plusieurs des romans de YK, comme lieu de l’avilissement achevé, et de la désolation sans répit. Là où même ce qui ne parvient pas à se faire société se dilue et s’éteint.
Ou en tous les cas, c’est ce qui advient à la conscience du personnage, et qu’un des intercesseurs de sa quête, Wari, lui fait remarquer, lors de leurs recherches dans le bidonville : « Quand tu marches parmi les nôtres, on dirait que tu as peur de choper un microbe… Que les roumis nous snobent, il y a sans doute une raison. Mais qu’un Algérien méprise les siens, c’est qu’il est le plus à plaindre d’entre eux ». Certes. Mais le verbe « snober » introduit une dimension quelque peu ironique, voire dégradée au propos. La posture coloniale ramenée à une marque de distinction sociale de salon est neutralisée comme idéologie de la hiérarchie sociale. D’une certaine façon, Wari renvoie Yacine à sa condition de picaro, à l’exigence imposée par celle-ci : demeurer assuré de sa propre identité, persévérer dans son être, quelles que soient les situations rencontrées. Un éleveur de dromadaire qui lui sauve la vie alors qu’il est perdition dans le désert et dans son esprit lui apprend que « le courage d’être soi en toutes circonstances » est une des marches qui le mèneront à la sagesse.
La révolte. Un épisode important du roman concerne les retrouvailles avec Zorg, dont la haine contre la ville européanisée s’est métamorphosée en guerrilla anti-coloniale. Le roman rappelle cet axiome important : s’il y a bien une histoire de la conquête coloniale et de la colonisation, il est tout aussi certain qu’il y a une contre-histoire à celle-ci.
La rencontre est aussi le moment de la première récapitulation : comme Ulysse échoué chez les Phéaciens, Yacine est sommé de raconter l’histoire de ses errances depuis le retour de la guerre, récit qui suscite incompréhension au pire et sarcasmes au mieux. Le récit n’est pas indifférent à la situation qui lui est propice ni à ses destinataires. Pour Zorg, qui a intégré jusqu’à la caricature les formes du commandement et de l’armée, cette histoire ne dit que le mépris de soi qu’aurait cultivé Yacine en acceptant de passer pour un autre. L’insurgé est un intransigeant, dont le combat n’a que faire de la morale : « …Je vais tout changer dans ce pays. Je foutrai à la mer les roumis jusqu’au dernier… » promet Zorg. Il est secondé dans cette lutte par sa cousine Abla, guerrière passionnée, cousine de celui-là et dont le frère était un spectre sur le quai, mais dont même le corps n’a pas été retrouvé.
La guerrilla n’est pas ainsi ramenée à une simple incidence dans l’existence du picaro. Elle est au cœur même du roman, comme perspective d’avenir, et comme geste commencée bien avant le début de l’histoire racontée. Un des anciens compagnons des tranchées le rappelle à Yacine, dont l’attentisme est critiqué : « Ça n’a jamais arrêté, caporal, depuis presque un siècle. Et ça ne s’arrêtera que lorsque nous aurons récupéré nos terres jusqu’au dernier empan ». L’histoire en est développée, les épisodes qui la constituent se succèdent à un rythme soutenu. Cette accélération de l’histoire voit ainsi les jeux d’alliance et les trahisons s’enchevêtrer, Zorg échouer à éliminer Gaïd Brahim, à qui il veut faire payer les trahisons, le groupe des révoltés décimé par les attaques. Pour Yacine c’est une nouvelle étape : il est marié par Zorg tout puissant à une jeune femme, Mariem, d’une tribu qui a recueilli les rescapés.
L’oasis. C’est à Kenadsa que l’histoire connaît une station, prélude aux dernières catastrophes qui s’abattent sur Yacine. « Et elle était là, offrande au bout de la route, Kenadsa, la sultane des oasis … ». Yacine y trouve un temps le bonheur. Comme la règle picaresque s’applique encore, alors qu’il se croit parvenu au bout de sa quête en rejoignant un lieu décrit comme quasiment matriciel, alors que son épouse donne naissance à un garçon, Yacine connaît le désastre majeur. Il assiste d’abord avec ses derniers compagnons de révolte à la fin misérable de Zorg et d’Abla, victimes de trahisons, et des sbires de Gaïd Brahim. Il retrouve alors Sid Tami, à Sidi Bel Abbes, qui lui offre de retrouver les amis des temps difficiles et l’entraîne dans des affaires louches, avant de disparaître brusquement.
Tout aussi brusquement, l’ordre colonial s’impose à Yacine : il est arrêté un matin, accusé de crimes qu’il n’a pas commis, par Gaïd Brahmi. Il est condamné au bagne et aux travaux forcés. Dans sa quête de lui-même, il se libère de sa violence contenue toute son existence, contre un détenu qui cherche à le déshumaniser : « J’ai cogné, cogné, cogné, pour faire mal, pour détruire, pour tuer. Les peurs que j’avais engrangées faute de les surmonter, les colères que je ruminais depuis des années, les peines, les humiliations, le chagrin, la déveine, tout le magma de haine et de dégoût qui sourdait en moi érupta si violemment que j’ai cru entendre mes ancêtres me supplier d’arrêter ». Il reste au bagne durant ce qui reste de l’entre-deux guerres. Et le volcan s’endort.
Nouvel arrêt du destin : il y est reconnu par un ancien compagnon d’armes qui est désormais livreur. Ce dernier parvient à retrouver l’adjudant-chef Gildas, qui vient retrouver le réprouvé. Ce dernier lui raconte alors son histoire véritable. Il la raconte aussi au nouveau directeur de la prison, ancien colonel, et qui réactive chez Yacine les moments d’héroïsme et d’abnégation, à Verdun notamment. Il est désormais mieux traité, mais demeure en prison pendant encore une année, pendant laquelle il s’interroge sur l’origine du mal qui le torture depuis si longtemps.
Et il finit par le voir, dans la figure du premier homme qu’il a tué, « ce Boche si jeune et beau, presque adolescent (…) et je sus que le Seigneur était juste ».
Histoires de vie. Mais il se pourrait aussi que le roman Les Vertueux raconte d’autres histoires que celles que le picaro raconte à ses lecteurs. Divers moments éveillent l’attention, et qui semblent dénoncer le romanesque tout en appuyant sur les effets littéraires de ces parcours du personnage, de ces anecdotes multiples, ces très nombreux attachements à des détails de la vie quotidienne : préparation du thé, par exemple, ou bien pratiques culturelles. Ce serait comme si le romancier parfois levait discrètement le masque, et observait son lecteur. Le personnage de Yacine met en mots cette situation, et il faut sans doute considérer ce passage comme le nœud de plusieurs significations : « J’ai le sentiment d’être retranché derrière un miroir sans tain ». Par là le personnage fait retour sur les circonstances de son existence, certes, mais aussi il est tourné vers ceux à qui il raconte. C’est une autre fiction, assurément qui se déroule alors à l’insu du lecteur. La récurrence par exemple dans les romans de YK du bidonville de Jenane Jeto, et la présence dans certains textes d’une esthétique de la décharge, comme dans L’Olympe des infortunes (2010) pourrait renvoyer à une perception de la misère profondément ancrée dans la sensibilité de l’écrivain, plutôt discret quand il s’agit de sa vie intime.
Autre indice, la belle Kenadsa est bien oasis matricielle pour l’écrivain, le lieu de sa naissance. L’oasis participe de l’ancrage dans un récit pluriséculaire et qui transforme le moment colonial en épisode presque secondaire, au regard de la construction à la fois architecturale, culturelle et lieu d’épanouissement de la vie quotidienne, et qui tient « tête aux tempêtes et au sirocco », totalement à l’opposé justement des espaces de relégation : la ville européenne, le bidonville, la hamada, le bagne dans le désert, le douar de l’exploitation elle aussi pluri séculaire par tous les Gaïd Brahim. Kenadsa neutralise ces lieux de contraintes, et l’oasis est à la fois point de départ et lieu de la dernière renaissance. Enfin, le picaro croit laisser derrière lui ces histoires sans fin et ces espaces chaotiques.
Des intercesseurs, de la vertu. Le roman de YK nous arrive ainsi comme une fresque sociale qui raconte une histoire souvent méconnue, dans la littérature, renvoyée au silence, et qui contrevient à la plupart des clichés activés dès lors qu’il est question de l’Algérie coloniale, qui fut, on l’oublie trop souvent, un espace de pauvreté et de misère sans répit[1]. C’est aussi un texte dans lequel un ancien militaire raconte de façon discrète une histoire intime et qui concerne une actualité encore insupportable, comme avec ses propres déconvenues. Ce n’est pas un texte moralisateur, qui prônerait directement un mode de considération devant l’existence. Le personnage central est à la fois héros et naïf, personnage complexe avant tout et qui n’est pas figé dès le début, mais qui raconte la construction et la déconstruction de son identité, puis sa nouvelle élaboration, par les autres, tous ces intercesseurs qu’il retrouve à la fin de son chemin. Il est confronté à ces abominations dont les proverbes nous dressent la liste immémoriale (Pr, 6, 16-19) : le mépris des autres, le mensonge, les projets coupables, l’empressement au mal, le faux témoignage, l’exercice de la zizanie, le meurtre. En regard à ce que subit Yacine, il y a l’enseignement qu’il reçoit de l’éleveur de dromadaires dans la hamada et qui lui sauve la vie. La voie du discernement est étroite et il faut monter sept marches pour espérer accéder à la sagesse : « l’amour ; la compassion ; le partage ; la gratitude ; la patience et le courage d’être soi en toutes circonstances (…) La septième est au bout de ton chemin ». L’art du raconteur d’histoires est ainsi donner sens et vie à ces abstractions, par le truchement d’un récit fondé par une esthétique de la réitération et la transformation progressive des situations, comme de nombreux pas de côté et par la récurrence des personnages au long de situations déclinées selon une grammaire qui progresse à la fois comme si le personnage était le jouet du hasard, alors que l’écriture suit de près la loi d’airain de la composition de la narration.
« On ne peut pas être trop près du bon Dieu sans se mettre à la merci du diable », lui fait remarquer Wari, celui qui le guide dans la recherche de ses parents et qui lui enjoint de ne pas déconsidérer les miséreux. C’est sans doute l’expression la plus resserrée de cette quête intime, et de son oscillation dans la réalité du monde. Celles et ceux qui parviennent à se délester de la charge de misère qu’on leur assigne à la naissance, le reconnaissent, et peut-être que c’est ce savoir diffus qui peut les rendre vertueux. Cela n’a plus rien à voir avec la figure stéréotypée du héros. Car le héros n’existe pas tout seul.
Et parmi les êtres qui rendent possibles cette accession à l’existence adulte, les femmes occupent des places essentielles. Lalla, la patronne de Yacine lorsqu’il vend des tissus, lui fait toucher le désir, et la recherche érotique du plaisir comme don essentiel et existentiel tout à la fois, et dans la toute-puissance. « Le scandale n’effraie que ceux qui ont une piètre opinion d’eux-mêmes », affirme Lalla, énonçant ainsi cette exigence d’identité nécessaire dans la voie de la sagesse. Mais ce n’est pas d’amour dont il est éventuellement question : « Elle cédait volontiers à la passion des sens, et se gardait de celle de l’émotion (…) ’Tu es ma renaissance à moi-même, pas ma vie’, m’avait-elle avoué sur l’oreiller ». Elle revendique désormais son identité de femme désirante et sa liberté, pivôt de son existence, lâchant Yacine dès lors que sa présence est encombrante. Cette figure lumineuse va s’éteindre, comme dans les ténèbres au fond des impasses.
C’est avec Mariem, la jeune épouse qui lui a été dévolue, que l’amour va se manifester comme réalité absolue. C’est une dernière figure médiatrice, et c’est bien par elle, avec elle, et pour elle que Yacine accède à la septième marche. Elle est sans doute une des plus lumineuses figures féminines de l’œuvre de YK, juste parce qu’elle cultive l’exigence en elle d’être là. Juste d’être là. Ce qui entraîne le lecteur alors à reprendre le roman, et à tenter d’interpréter le geste autoritaire de Zorg, devenu vertueux, lui aussi, malgré lui.
[1] Voir le récent ouvrage de Jean-Michel Wavelet, Albert Camus. La voix de la pauvreté, Paris, L’Harmattan, coll. Approches littéraires, Paris, 2023