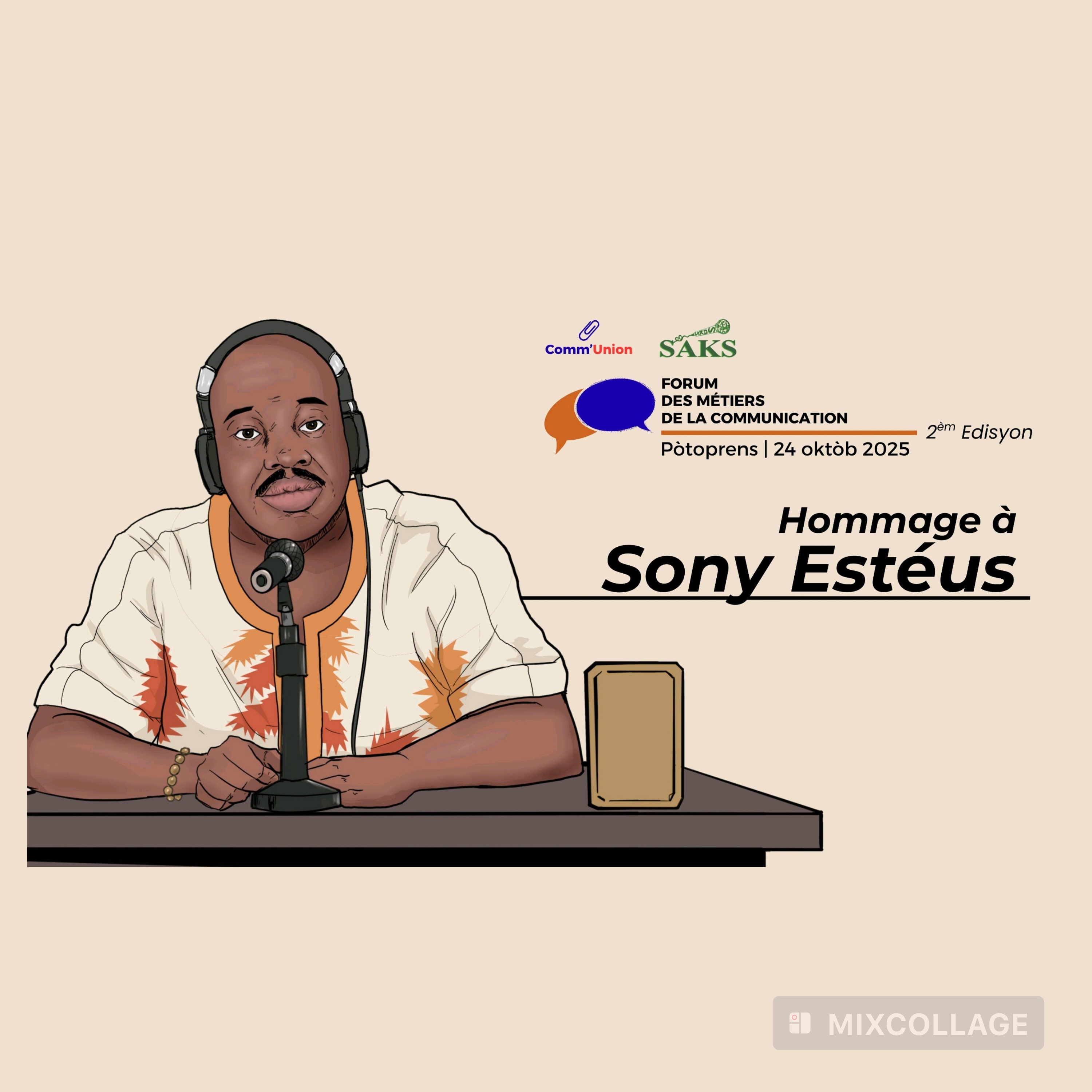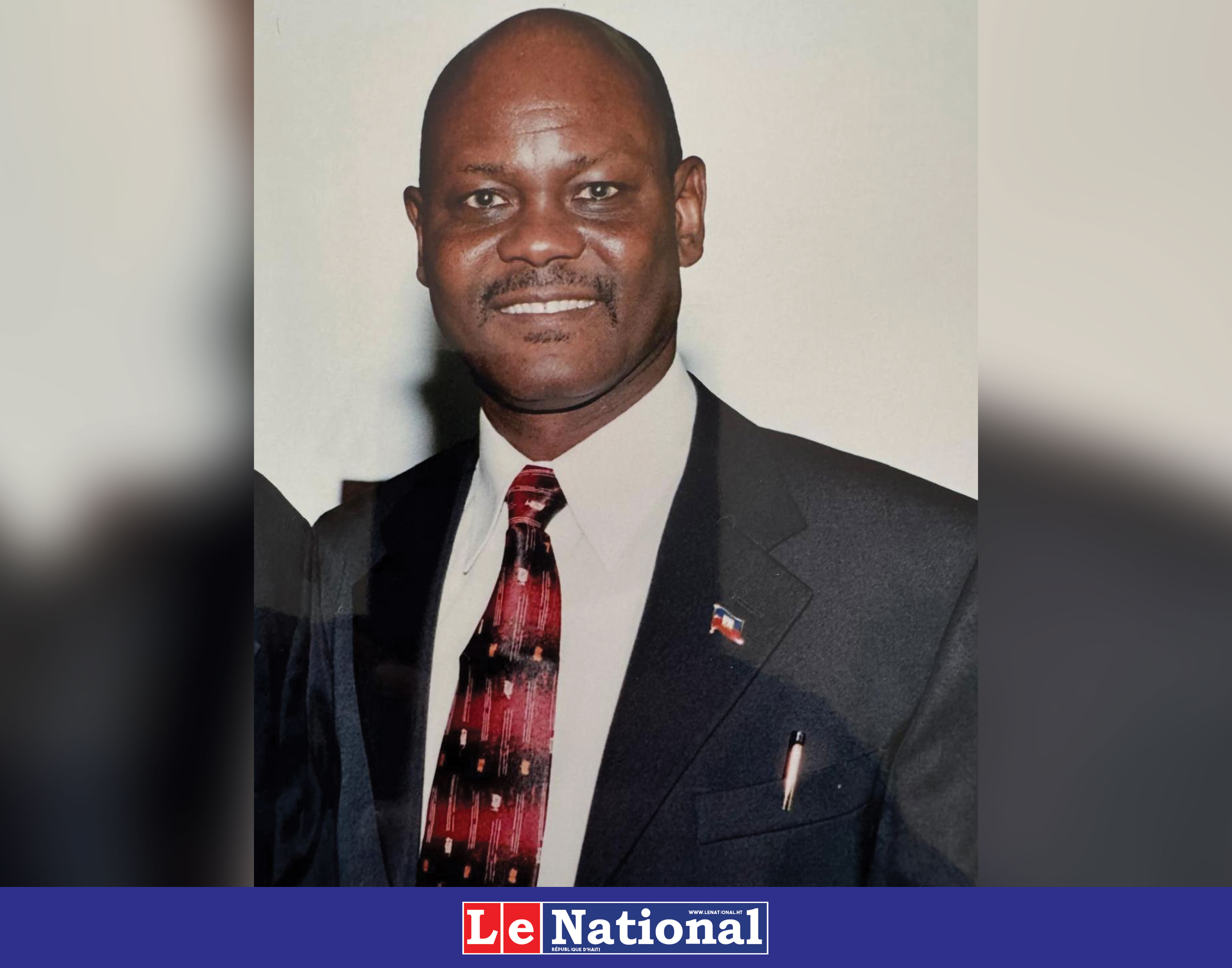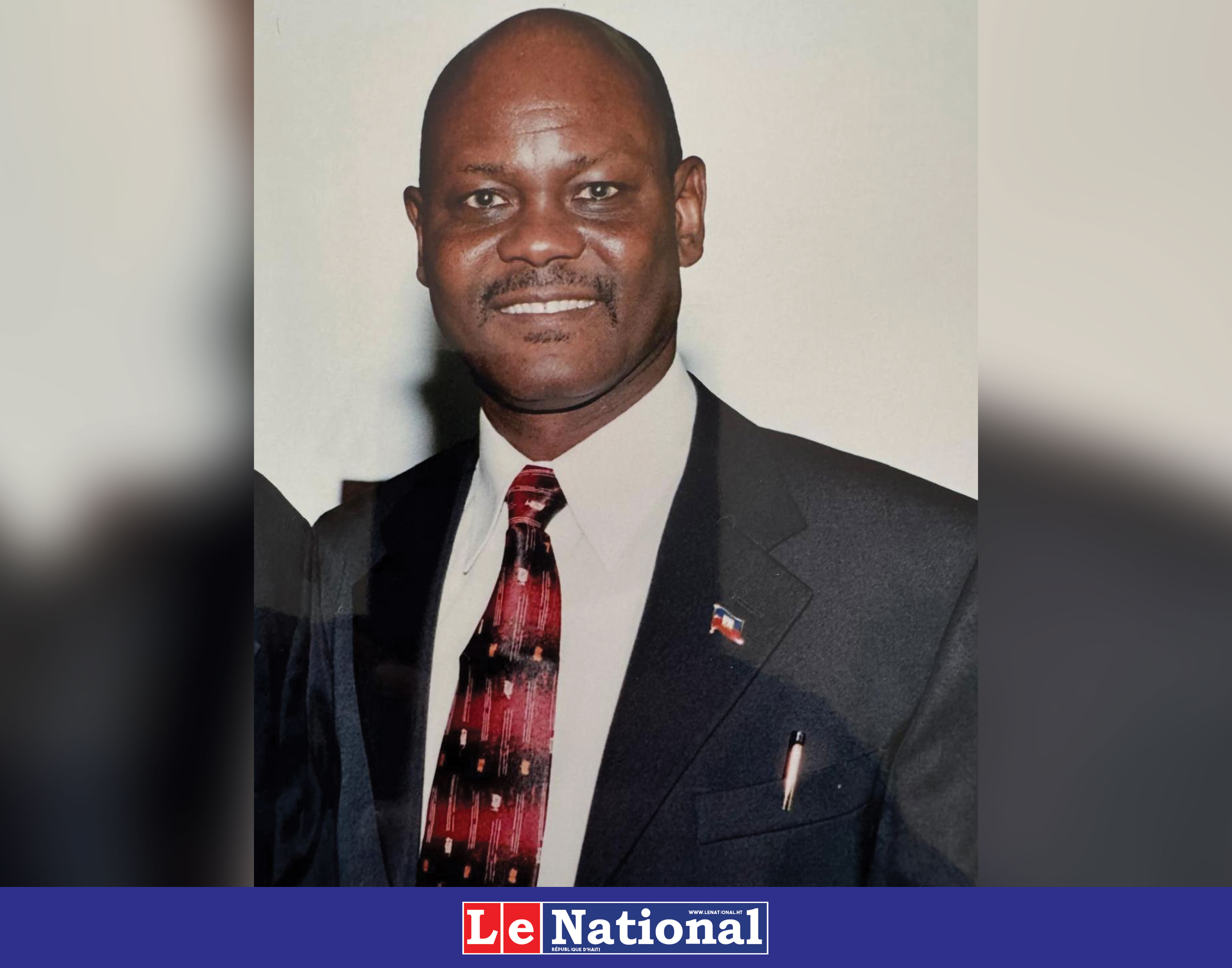Le mot consensus refait surface. Espérons que, cette fois, il en résultera quelque chose de concret. Peut-être faudrait-il instaurer un serment adapté à notre culture, assorti d’une clause de respect de la parole donnée, afin que les futurs signataires tiennent leurs engagements.
Une dizaine de figures de la scène politique haïtienne — parmi lesquelles un ancien président, trois anciens premiers ministres, trois anciens candidats à la présidence et un ancien ministre — reprennent aujourd’hui leur bâton de pèlerin pour tenter de ranimer le souffle et la flamme du consensus, plongé dans un coma d’épuisement à force d’abus et de surutilisation. Une démarche noble, à vrai dire, car la situation du pays ne saurait perdurer dans son état actuel.
Ces leaders souhaitent renouer avec le dialogue afin d’éviter, une fois de plus, de fâcheux imprévus à l’approche du 7 février 2026. Comme souvent, l’inquiétude renaît à l’approche des fins de mandat, alors que la mission première de tout gouvernement devrait être d’organiser des élections pour prévenir tout vide institutionnel et toute illégalité. Un tel défi n’a été relevé qu’à deux reprises : sous le gouvernement Latortue–Alexandre, puis sous la présidence provisoire du sénateur Jocelerme Privert.
À chaque crise, deux mots quasi mystiques refont surface dans le discours politique : la date du « 7 février », inscrite dans la Constitution de 1987, et le terme « consensus », convoqué chaque fois qu’un accord non respecté engendre le besoin d’un nouveau.
Depuis 1987, le mot consensus s’est installé dans le vocabulaire politique haïtien. On est passé d’une définition classique — fondée sur la recherche d’un accord sincère — à des interprétations biaisées, empreintes d’une mentalité rétrograde. Le consensus est alors devenu l’outil d’une entreprise visant à sacrifier, sur l’autel d’une légitimité douteuse, le fonctionnement régulier des institutions démocratiques. Cette dérive a faussé les résultats électoraux et porté préjudice à des élus compétents et légitimes.
On récite désormais le mot consensus comme une prière politique, l’érigeant au cœur même de nos crises. Pourtant, ce compromis ne saurait être invoqué à tout propos : l’intérêt général ne peut se réduire à un mariage contre nature, porteur de sa propre destruction. Trop souvent, le consensus sert à contourner la loi et à mettre en veille la Constitution — sans même le courage du général-président Prosper Avril qui, lui, avait au moins assumé de citer et d’écarter les articles gênants pour sa présidence. Qu’on approuve ou non cet acte anticonstitutionnel, il avait au moins la lucidité de reconnaître sa transgression.
La dernière chance a sonné
Même si l’abîme semble sans fond, il existe toujours une dernière chance. Les précédentes crises ont été contenues grâce à des solutions provisoires, qui ont permis — tant bien que mal — de limiter les violences, le consensus étant privilégié comme principal mode de résolution. Mais cette fois, la crise a atteint sa vitesse de croisière depuis l’assassinat du président Jovenel Moïse, survenu dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021 — une crise dans la crise.
C’est pourquoi le consensus dont le pays a aujourd’hui besoin, avant le 7 février 2026, doit être l’œuvre collective du Conseil présidentiel de transition, de l’ensemble des partis politiques, ainsi que de toutes les organisations et plateformes de la société civile, sans exclusion.
Cependant, une question demeure : sommes-nous encore dans les délais pour parvenir à un véritable consensus ? Le temps nous fait la guerre, et les carottes sont presque cuites — il ne manque plus que l’appétit pour agir.
Il se fait tard, et nous sommes engagés dans une course contre la montre pour sauver ce qui peut encore l’être et offrir au monde l’image d’une nation digne et prestigieuse, comme autrefois. Car, à mesure que s’approche le 7 février 2026, le baril de poudre n’attend plus qu’une minuscule étincelle pour exploser.
Il n’est jamais trop tard pour bien faire, surtout lorsqu’il s’agit de défendre la patrie que nous ont léguée nos ancêtres. Le dialogue en vue d’un consensus véritable, plus solide que tous ceux qui l’ont précédé, doit reposer sur l’apaisement des esprits, et non sur l’apparence d’une entente creuse ou sur un faux silence dissimulant rancunes et méfiances mutuelles.
Serge Gilles et le président Leslie F. Manigat doivent sans doute se retourner dans leur tombe, témoins désolés de l’échec, du manque de sérieux et de l’absence d’engagement patriotique qui caractérisent aujourd’hui nos leaders lorsqu’ils s’adonnent au consensus. Car, de jour en jour, l’adjectif “suffisant” accolé au mot consensus devient tristement insuffisant, tant la nature et la qualité de ses représentants se révèlent trop faibles pour tenir la barre, ballottés entre ambitions politiques personnelles, inavouées et inavouables.
Manigat a toujours enseigné que les leaders doivent agir avec sérieux, quelles que soient les décisions ou les ententes politiques engageant la nation.
Face à nos crises à répétition, nous n’avons cessé de rechercher des consensus — certains sérieux, d’autres beaucoup moins — mais presque toujours sans la participation du peuple. Il est temps de corriger, dès la prestation de serment, ce manque d’engagement patriotique de nos mandataires.
Autrement dit, le serment prêté avant l’entrée en fonction, en vertu d’un ultime consensus entre les acteurs, devrait être contraignant, surtout dans un contexte où les dieux tutélaires de la Nation semblent avoir déserté la scène.
Nécessité d’un serment
La formule de serment prévue à l’article 194-2 de la Constitution relève d’un certain mimétisme culturel. Ce rite d’engagement, dans sa forme actuelle, ne produit aucun effet réel sur les obligations des parties prenantes ni sur le respect de leurs promesses solennelles. Cette déclaration solennelle devrait être plus rigoureuse et plus contraignante, afin que ceux qui la prononcent se sentent patriotiquement liés à quelque chose de sacré — et non comme s’ils récitaient un simple poème.
Être lié par un engagement n’est pas répéter des formules convenues selon les circonstances. C’est prendre conscience d’avoir juré avec dignité, indépendance, courage, impartialité, patriotisme — et surtout avec cette crainte respectueuse qui impose la droiture.
L’Haïtien, en général, se sent effectivement lié et engagé par un serment porteur d’une force morale, enracinée dans la mythologie et les valeurs locales, capable de manifester sa puissance à tout moment.
Je proposerais qu’on adopte la formule de serment suivante, afin de garantir le respect du dernier consensus : « Que je ne me réveille point, en ma qualité de signataire de l’accord consensuel, sans avoir respecté fidèlement les engagements que j’y ai souscrits ». Quant aux promesses électorales restées sans suite, la sanction de l’inéligibilité devrait être appliquée sans hésitation.
Le consensus politique peut, dans certains contextes de crise, se révéler utile pour aider le pays à sortir de situations explosives. Mais il ne peut ni ne doit durablement se substituer à la loi. C’est plutôt le rôle de la Charte fondamentale — la Constitution — de combler ces zones d’ombre et de prévenir de nouveaux contentieux, en apportant des réponses claires sur les sujets sensibles tels que la réforme constitutionnelle ou la passation du pouvoir à un président élu en toute légitimité.
Emmanuel Charles
Avocat et constitutionnaliste