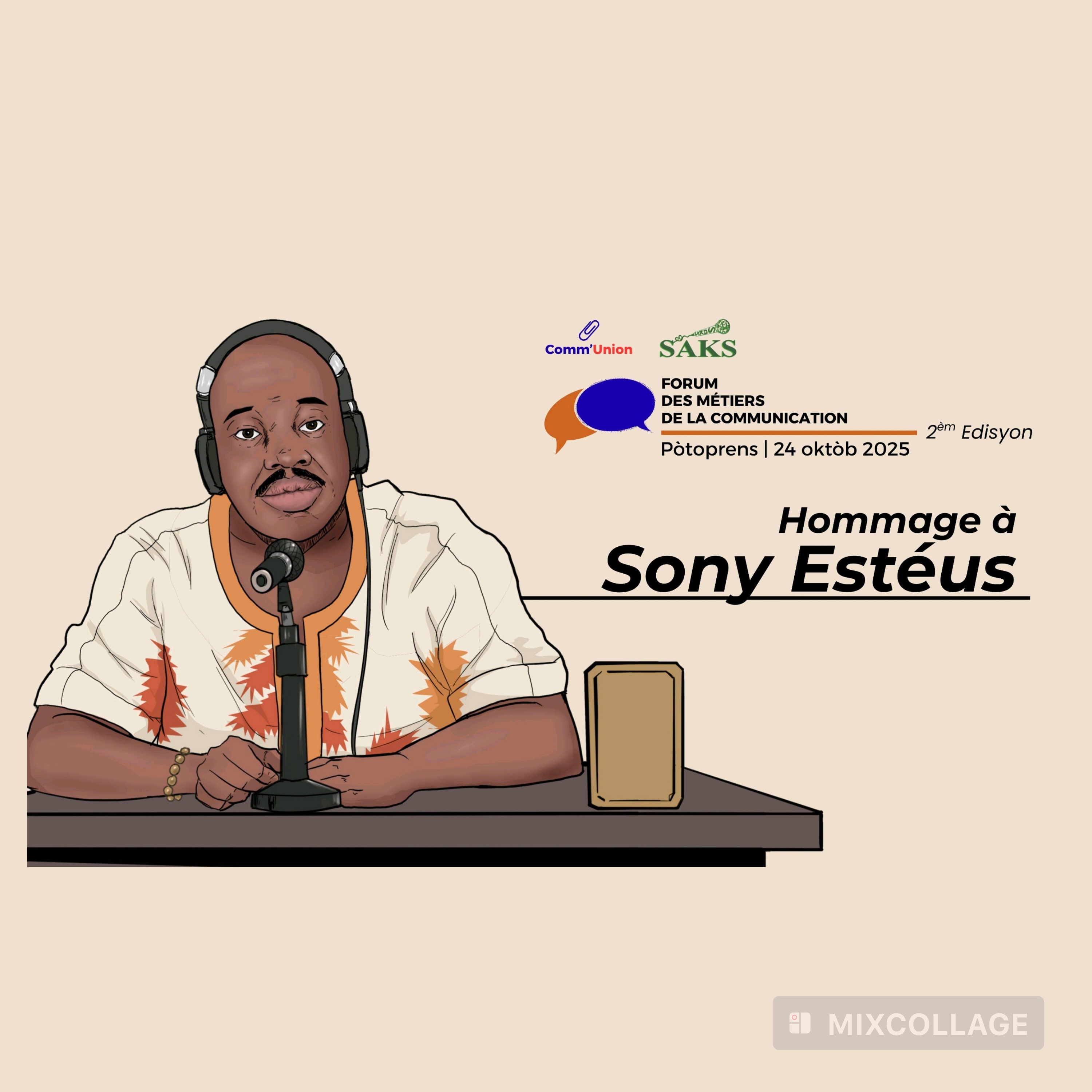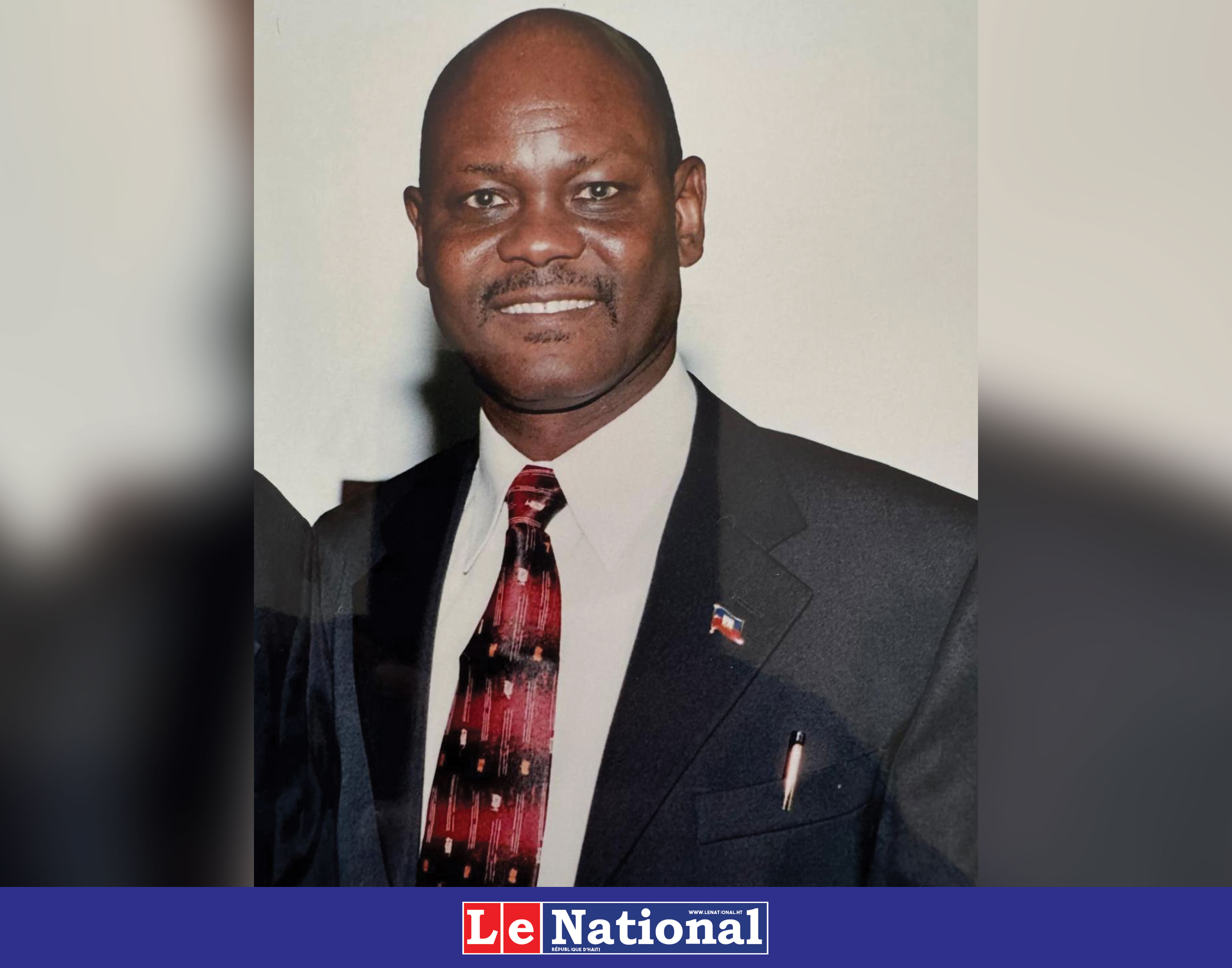Par Evens Emmanuel et David Noncent
Depuis le 28 juillet 2025, plusieurs institutions et entités haïtiennes comme l’ERC2-UniQ/LMI-CARIBACT, HELVETAS, InfosNation, Le National, Radio Nationale d’Haïti, Le Nouvelliste, Haïti Climat, et Haïti Sciences et Société (HaSci-So) ont mobilisé la médiation scientifique pour redonner force et vigueur à la Déclaration de Turgeau, dans laquelle le 1er septembre est adopté comme la Journée nationale haïtienne d’éducation aux Changements Climatiques (JNHECC). Placée en pleine saison cyclonique, la JNHECC semble se convertir en 2025 en une date où se diffuse dans les médias et les réseaux sociaux de la connaissance sur les changements climatiques. En s’alignant à cette nouvelle forme de célébration, on se propose dans cet article de présenter le fonctionnement, les mécanismes et les impacts locaux en Haïti de l’Oscillation Décennale du Pacifique (ODP), ou Pacific Decadal Oscillation (PDO) en anglais, qui est, un géant influençant le climat. L’ODP est un phénomène climatique majeur qui affecte les températures de l’océan Pacifique et, par extension, le climat mondial, y compris celui d’Haïti. Ce cycle à long terme joue un rôle dans les variations des précipitations et des conditions climatiques dans les Caraïbes.
Qu’est-ce que l’ODP ?
L’ODP, ou Pacific Decadal Oscillation (PDO) en anglais, est une variation à long terme des températures de surface de l’océan Pacifique, principalement dans le Pacifique Nord (au nord de 20°N). Elle oscille entre des périodes chaudes et froides sur des cycles de 20 à 30 ans. Contrairement à l’Oscillation Australe El Niño (ENSO), qui dure seulement quelques années (2 à 7 ans), l’ODP est un phénomène à long terme, influençant le climat sur des décennies. Découverte dans les années 1990 par des chercheurs étudiant les variations de la pêche au saumon dans le Pacifique Nord, l’ODP est mesurée par un indice basé sur les anomalies de température de surface de la mer (SST, Sea Surface Temperature) dans le Pacifique Nord. Une phase positive de l’ODP correspond à des eaux plus chaudes à l’est du Pacifique (près des Amériques) et plus froides -au centre et à l’ouest. En phase négative l'eau est plus froide à l'est et plus chaude au centre et à l'ouest.
Comment fonctionne l’ODP ?
L’ODP résulte de l’interaction entre l’océan Pacifique et l’atmosphère, influençant les régimes climatiques à l’échelle mondiale. Les mécanismes-clés sont : (1) la variation des températures océaniques; (2) l’interaction avec l’atmosphère ; (3) La durée et les cycles ; et (4) les causes de l’ODP.
La variation des températures océaniques
Durant la phase positive, les eaux du Pacifique Nord-Est (près des côtes de l’Alaska et de l’Amérique du Nord) sont plus chaudes que la moyenne, tandis que le centre et l’ouest du Pacifique (près du Japon) sont plus froids. Cela crée un contraste thermique qui modifie les courants atmosphériques.
Durant la phase négative, les eaux du Pacifique Nord-Est deviennent plus froides, tandis que le centre et l’ouest se réchauffent. Ce schéma inverse les effets climatiques.
L’interaction avec l’atmosphère
Les variations de température dans le Pacifique influencent les vents et les pressions atmosphériques, notamment le courant-jet (Jet Stream et les zones de haute et basse pression. En phase positive, le Jet Stream peut se déplacer, affectant les régimes de précipitations dans les Amériques et les Caraïbes. En bougeant, ces systèmes atmosphériques influencent la Zone de Convergence Intertropicale (ZCIT), une bande de nuages et de pluies tropicales. L’ODP la déplace, ce qui a un impact direct sue la quantité de pluie dans les Caraïbes. En effet, en phase positive, la ZCIT peut se déplacer, influençant les pluies dans les Caraïbes, tandis qu’en phase négative, elle peut réduire les précipitations dans des régions comme Haïti.
La durée et les cycles
Chaque phase de l’ODP (chaude ou froide) dure environ 20 à 30 ans. Par exemple, des phases positives ont été observées de 1925 à 1946 et de 1977 à 1998, tandis que des phases négatives ont dominé de 1947 à 1976 et de 1999 à 2014.
Ces cycles sont détectés grâce à des mesures directes des températures marines, et à des archives paléoclimatiques, données indirectes. Les travaux comme ceux menés par Noncent sur les sédiments du lac Azuei enregistrent les variations des précipitations et des conditions environnementales sur le dernier millénaire, permettant de lier les changements locaux en Haïti aux oscillations globales, telles que l'ODP.
Les causes de l’ODP
L’ODP est principalement un phénomène naturel, lié aux variations des courants océaniques et des vents dans le Pacifique. Cependant, des facteurs comme les éruptions volcaniques, les changements dans l’irradiance solaire ou le réchauffement climatique peuvent moduler son intensité.
Dans la thèse de Noncent, l’ODP est identifiée comme un facteur influençant les tendances climatiques en Haïti, en interaction avec l’ENSO et l’OMA.
Les impacts de l’ODP en Haïti
Les recherches menées en Haïti, comme celle de David Noncent montrent que l’ODP, en modifiant les températures du Pacifique, a une influence sur le climat haïtien pendant le dernier millénaire, modifiant les précipitations et les conditions environnementales enregistrées dans les sédiments du lac Azuei. Les impacts sont : 1). les précipitations et la sécheresse ; 2). l’activité cyclonique ; 3). I’impact sur l’agriculture ; 4) I’impact sur les ressources en eau ; 5). I’impact sur les écosystèmes ; 6). l’impact socio-économique.
1. Précipitations et sécheresse
Les eaux chaudes dans l’est du Pacifique, durant la phase positive, renforcent les conditions humides dans certaines régions des Amériques, mais dans les Caraïbes, elles peuvent réduire les précipitations en déplaçant la ZCIT plus au sud. Cela entraîne des périodes plus sèches en Haïti. Ces conditions se reflètent dans les archives sédimentaires. Les analyses des sédiments du lac Azuei, par exemple, montrent une diminution des apports sédimentaires (traduisant moins de lessivage des sols par la pluie) durant des périodes historiques de sécheresse, comme celle observée au début de l'Anomalie Climatique Médiévale (MCA1, 1000-1050 CE)
En revanche, durant la phase négative, les eaux plus froides dans l’est du Pacifique favorisent un déplacement de la ZCIT vers le nord, augmentant les précipitations en Haïti. La thèse identifie des périodes humides, comme l'Anomalie Climatique Médiévale (MCA2 1050-1100 CE), avec des apports sédimentaires accrus dans le lac Azuei, probablement liés à des conditions similaires à une phase négative de l’ODP.
2. L’activité cyclonique
Une phase positive de l’ODP peut réduire l’activité cyclonique dans l’Atlantique en modifiant les conditions atmosphériques, comme le cisaillement vertical du vent, qui inhibe la formation d’ouragans. Cela entraîne moins de cyclones en Haïti, mais augmente le risque de sécheresse.
Une phase négative favorise des conditions propices aux cyclones dans l’Atlantique, car les eaux plus chaudes de l’Atlantique (souvent liées à l’OMA) et un cisaillement réduit augmentent l’énergie disponible pour les tempêtes. Noncent observe des dépôts sédimentaires élevés dans le lac Azuei lors de périodes humides, suggérant des événements pluvieux extrêmes, comme des cyclones.
3. L’impact sur l’agriculture
Les sécheresses associées à une phase positive réduisent l’eau disponible pour l’irrigation, stressant les cultures comme le maïs, le riz et les bananes. Cela menace la sécurité alimentaire, particulièrement dans les zones rurales haïtiennes.
Les pluies abondantes de la phase négative peuvent bénéficier à l’agriculture en rechargeant les sols, mais des précipitations excessives ou des cyclones peuvent inonder les champs et détruire les récoltes. Dans les travaux de l’ERC-UniQ, les chercheurs notent un apport accru de matière organique dans le lac Azuei durant les périodes humides, reflétant une végétation abondante mais aussi des inondations destructrices.
4. L’impact sur les ressources en eau
La diminution des pluies durant la phase positive réduit les réserves d’eau dans les étangs et les lacs (comme Azuei), les rivières et les nappes phréatiques, aggravant le stress hydrique qui est, un problème majeur en Haïti.
Les fortes pluies de la phase négative rechargent les ressources en eau, mais peuvent provoquer des inondations et contaminer les sources d’eau avec des polluants ou des pathogènes, augmentant le risque de maladies hydriques comme le choléra.
5. I’impact sur les écosystèmes
En phase négative, les fortes pluies et les cyclones augmentent l’érosion des sols, surtout dans les zones déboisées comme le bassin versant du lac Azuei. Noncent observe des apports sédimentaires plus importants durant les périodes humides, reflétant cet effet.
Les apports massifs de sédiments et de nutriments pendant les phases négatives peuvent provoquer une eutrophisation dans les lacs, réduisant l’oxygène et affectant la faune aquatique. En phase positive, les niveaux d’eau plus bas, comme observé dans les périodes sèches de la thèse, modifient la chimie des lacs.
Les cyclones en phase négative endommagent les mangroves et récifs coralliens, essentiels pour protéger les côtes haïtiennes contre l’érosion.
6. L’impact socio-économique
Les sécheresses de la phase positive réduisent les rendements agricoles et l’accès à l’eau potable, affectant l’économie locale et augmentant les tensions sociales dans un pays déjà vulnérable.
Les inondations et cyclones durant la phase négative causent des destructions majeures (maisons, routes, écoles), entraînant des coûts de reconstruction élevés et des déplacements de population. Les agriculteurs perdent leurs récoltes, accentuant la pauvreté et l’insécurité alimentaire.
Pourquoi l’ODP est-elle importante pour Haïti ?
L’ODP, avec ses cycles de 20 à 30 ans, aide à comprendre les tendances climatiques à long terme en Haïti, ce qui est crucial pour anticiper les défis futurs dans un contexte de changement climatique.
En Haïti, l’ODP impose le devoir de la prévision à long terme. En surveillant les phases de l’ODP, Haïti peut anticiper des périodes de sécheresse ou de fortes pluies sur plusieurs décennies, permettant une meilleure planification agricole et hydrique.
L’ODP invite à l’adaptation climatique. Les phases négatives, avec plus de cyclones, nécessitent des infrastructures résistantes et des systèmes d’alerte précoce. Les phases positives, plus sèches, exigent une gestion durable de l’eau et des sols.
L’ODP recommande la protection des écosystèmes. Le reboisement et la protection des bassins versants, comme celui du lac Azuei, peuvent réduire l’érosion lors des phases humides et préserver les ressources en eau lors des phases sèches.
L’ODP retient les objectifs de la Journée nationale haïtienne d’éducation aux changements climatiques. Les recherches de l’ERC2-UniQ montrent que l’ODP a façonné le climat passé d’Haïti. Éduquer et sensibiliser la population à ces cycles peut encourager des pratiques durables et une meilleure préparation aux extrêmes climatiques.
Conclusion
L’Oscillation Décennale du Pacifique est un phénomène climatique clé qui influence le climat haïtien à travers des cycles de plusieurs décennies, alternant périodes sèches (phases positives) et humides (phases négatives). Ses impacts sur les précipitations, les cyclones, l’agriculture, les ressources en eau et les écosystèmes sont significatifs, selon les résultats des travaux de recherche de l’ERC2-UniQ sur des sédiments. Comprendre l’ODP permet à Haïti de mieux se préparer aux variations climatiques à long terme, en renforçant les infrastructures, en protégeant l’environnement et en sensibilisant les communautés aux défis climatiques. Dans un pays vulnérable comme Haïti, ces connaissances sont essentielles pour bâtir un avenir plus résilient.
Evens Emmanuel
ERC2-UniQ/LMI-CARIBACT
Pôle Haïti-Antilles, Haïti Sciences et Société (HaSci-So)
Équipe des Partenaires Scientifiques pour la Communication de la Recherche (E-PSi-CoRe)
evens.emmanuel@uniq.edu
David Noncent
ERC2-UniQ/LMI-CARIBACT
École Normale Supérieure - UEH
Pôle Haïti-Antilles, Haïti Sciences et Société (HaSci-So)
ndavid02@yahoo.fr