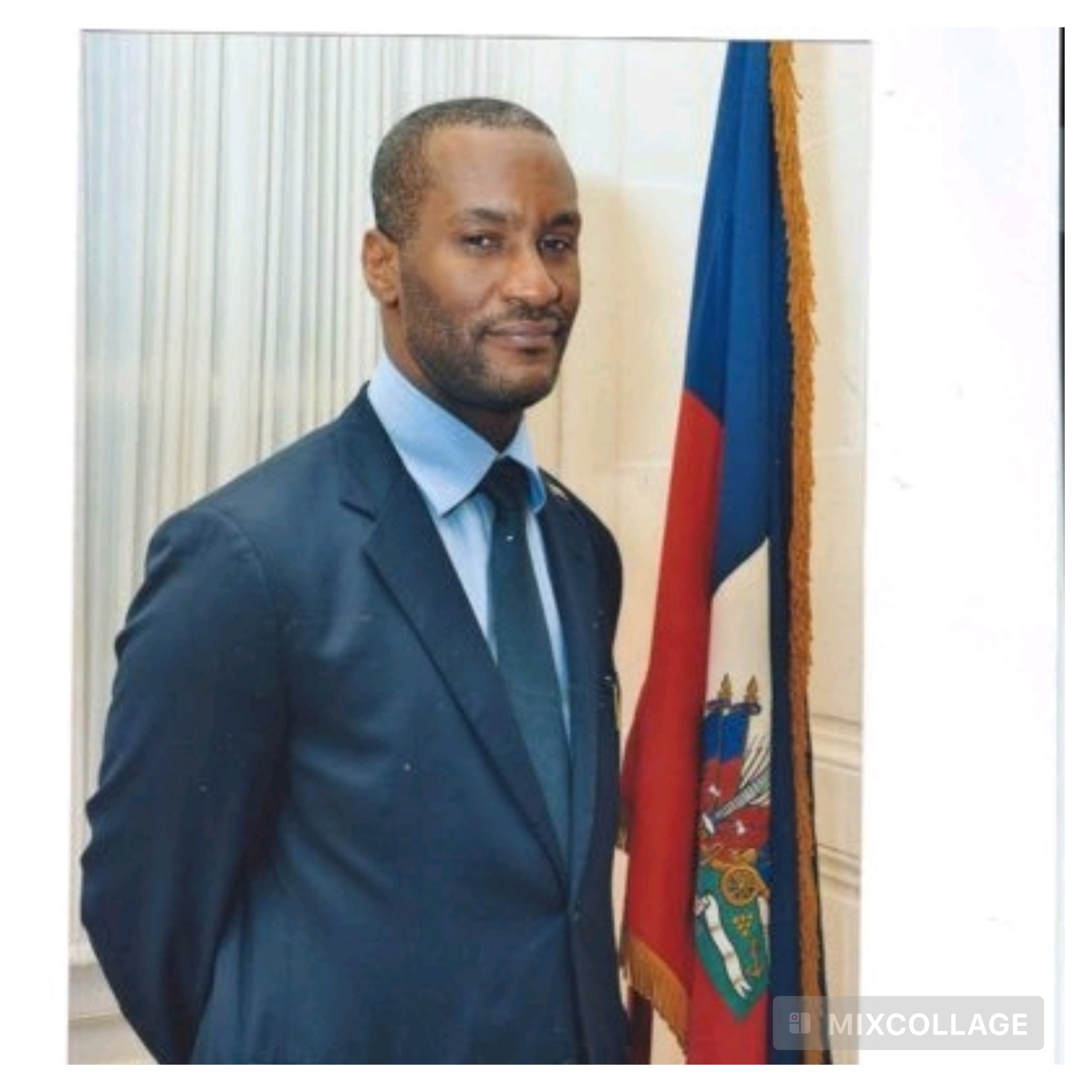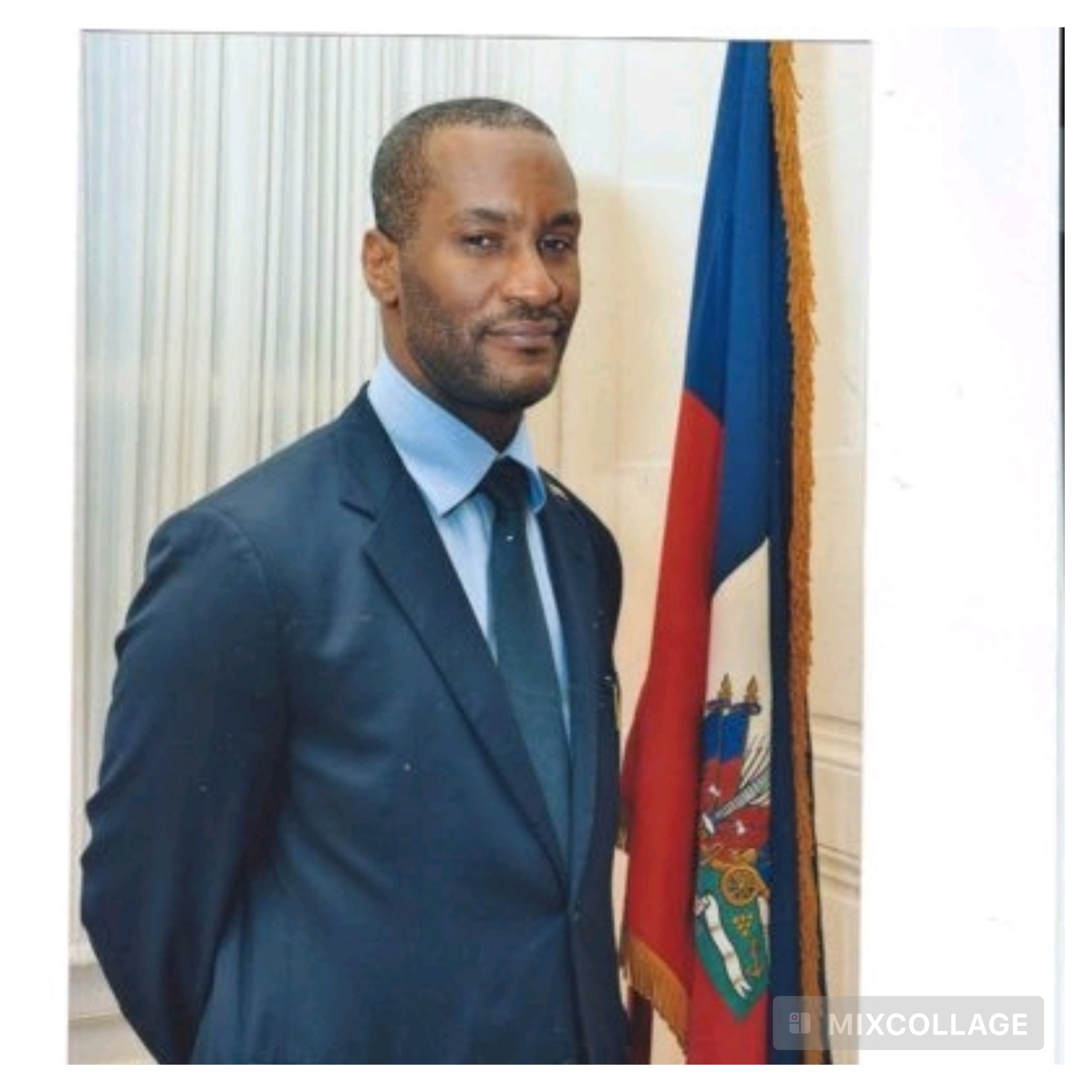Les relations franco-haïtiennes ne sont plus ce qu’elles étaient. Elles ressemblent aujourd’hui à une vieille tapisserie que l’on dépoussière après l’avoir longtemps roulée au fond d’un grenier de l’histoire. La recommandation du général Pamphile de La Croix, selon laquelle la France devait tout faire pour oublier la Révolution haïtienne, fut plus qu’un simple conseil : ce fut un mot d’ordre, une consigne transmise d’une main politique à une autre et amplifiée par tout l’appareil intellectuel.
Cette politique du silence fonctionna comme un brouillard épais, noyant la mémoire et estompant les contours du passé. Seul un pays doté d’une machine culturelle aussi puissante que la France pouvait orchestrer une telle amnésie collective. Les élites françaises, toutes tendances confondues, adoptèrent ce réflexe d’effacement avec un zèle remarquable. Ouvrage après ouvrage, conférence après conférence, la part haïtienne de l’histoire fut omise, diluée ou tout simplement ignorée. L’exemple le plus frappant demeure le livre de Lionel Jospin, Le Mal Napoléon.
Ce réquisitoire contre le stratège corse dissèque les failles de l’empereur avec la précision d’un scalpel, mais sans jamais évoquer la Révolution haïtienne ni l’homme qui l’a vaincu, Dessalines. C’est une omission si spectaculaire qu’elle frôle le révisionnisme, une ignorance académique qui interroge. Et ce qui rend ce silence encore plus troublant, presque dérangeant, c’est la trajectoire même de Lionel Jospin.
Pendant des années, il côtoya plusieurs acteurs de la scène politique haïtienne, notamment des milieux de la gauche tels que le PANPRA, qui compta parmi les organisations les plus influentes de la diaspora et des réseaux progressistes haïtiens d’alors. Une telle proximité aurait pu laisser espérer une plus grande sensibilité à l’histoire haïtienne, à ses blessures, à ses grandeurs, à ses silences. Or, c’est précisément l’inverse qui se produit : un effacement massif, presque méthodique, comme si l’un des chapitres fondateurs de l’histoire universelle n’avait jamais existé.
Ce black-out n’est donc pas un simple oubli ou une distraction d’auteur. Il révèle, au contraire, la profondeur d’un mécanisme mémoriel où l’individu même averti, même cultivé se retrouve emporté par le courant d’un récit national qui peine encore à intégrer l’existence d’une révolution noire victorieuse. Car l’amnésie n’a jamais été une improvisation lorsqu’elle émane d’un pays doté d’une tradition historique aussi structurée que la France. Elle fonctionne comme une véritable ingénierie du silence, minutieuse, patiente, intériorisée. Un pays qui maîtrise à ce point l’art de célébrer sa mémoire sait aussi organiser l’oubli avec une efficacité redoutable. À cet égard, l’absence d’Haïti dans le livre de Jospin n’apparaît plus comme une anomalie personnelle mais comme un symptôme : celui d’un récit français encore incapable d’assumer pleinement ce que l’histoire d’Haïti révèle de son propre passé.
Fissure de l’amnésie française
Pourtant, cette politique de l’amnésie commence à se fissurer. Les murs jadis hermétiques se craquellent comme des digues fatiguées par le poids du temps. Plusieurs facteurs expliquent ce renversement. Le tissu associatif haïtien en France, malgré son travail souvent dispersé, a mené une œuvre mémorielle considérable.
Entre 2008 et 2016, les représentations diplomatiques d’Haïti ont organisé plus d’une vingtaine de commémorations, de débats et de soirées mémorielles, parfois même dans des institutions françaises prestigieuses. Elles ont éclairé une opinion publique qui ignorait presque tout du passé commun franco-haïtien. La visite de Michel Martelly au Fort-de-Joux, lieu où mourut Toussaint Louverture, fut un jalon symbolique de ce retour du récit ; elle s’inscrivait dans une chaîne d’événements initiée dès le rapatriement symbolique des cendres du héros en 1983.
Cette réactivation mémorielle a également bénéficié d’autres relais essentiels. Les élus d’origine haïtienne, notamment en Île-de-France, ont porté ce travail dans les conseils municipaux, introduisant Haïti dans des débats locaux où elle n’était jamais apparue. Des associations dynamiques comme la PAHFA, Pour Haïti, Haïti Futur, et bien d’autres encore, ont mené une œuvre remarquable : conférences, programmes éducatifs, actions culturelles, partenariats publics et initiatives citoyennes.
Ces acteurs ont allumé, chacun à leur manière, des petites flammes dans la conscience française, jusqu’à ce que leur somme devienne un foyer de lumière. Il convient de leur rendre hommage : sans leur persévérance opiniâtre, nombre de portes seraient restées closes et la mémoire haïtienne n’aurait peut-être jamais retrouvé sa place dans le débat français.
S’y ajoutent enfin deux coopérations décentralisées importantes : celles engagées entre Haïti et les villes de Suresnes et de Strasbourg. Par des échanges culturels, des projets éducatifs, des partenariats institutionnels et des gestes de solidarité, ces collectivités ont contribué à rapprocher les deux peuples.
Vers une nouvelle relation franco-haitienne
Ces actions, modestes en apparence, ont fonctionné comme des ponts jetés au-dessus d’un gouffre historique : elles ont donné un corps, un lieu et un visage à la relation franco-haïtienne, longtemps abstraite et invisible dans la mémoire collective.
Dans cette dynamique générale, le message dénonçant l’injustice historique commise par la France envers Haïti a commencé à trouver un écho de plus en plus tangible. La montée de courants politiques favorables à une relecture du passé colonial, notamment La France insoumise, a amplifié cette prise de conscience. Une revendication longtemps marginalisée a fini par accéder au statut de question légitime dans l’espace public. Ainsi se redessinent, lentement mais inexorablement, les contours d’une nouvelle relation franco-haïtienne.
Ce qui relevait jadis de l’oubli volontaire devient un chantier de reconnaissance. Le passé, longtemps enfoui derrière un rideau dense, réapparaît peu à peu comme une fresque dont on restaure les couleurs. L’amnésie organisée n’a plus la force d’antan. Les fissures sont nombreuses, profondes, irréversibles. Et à travers ces brèches, la vérité s’infiltre, patiente, lumineuse, indéracinable, comme la mémoire d’un peuple qui n’a jamais cessé de se dresser face à l’oubli.
Maguet Delva, Paris