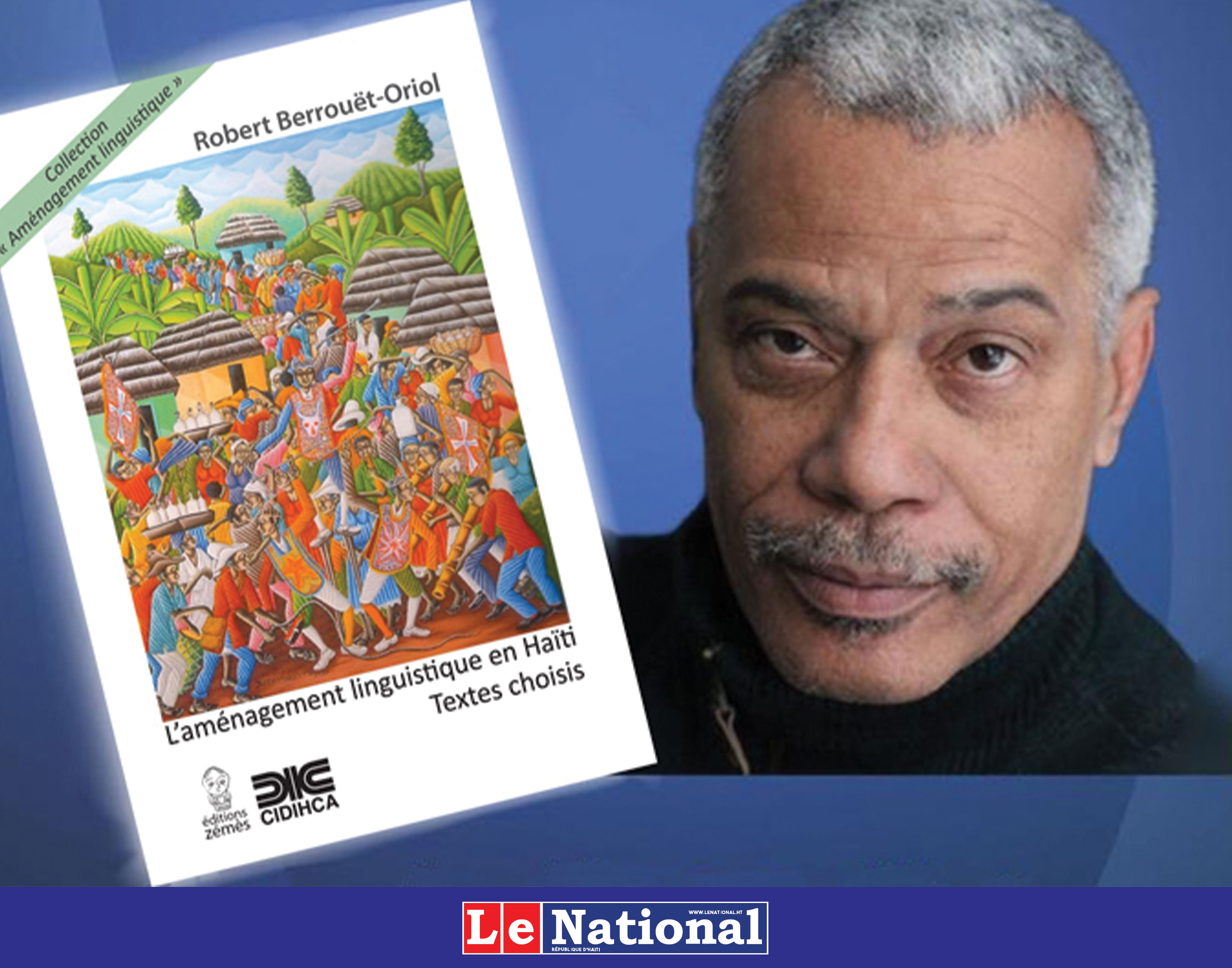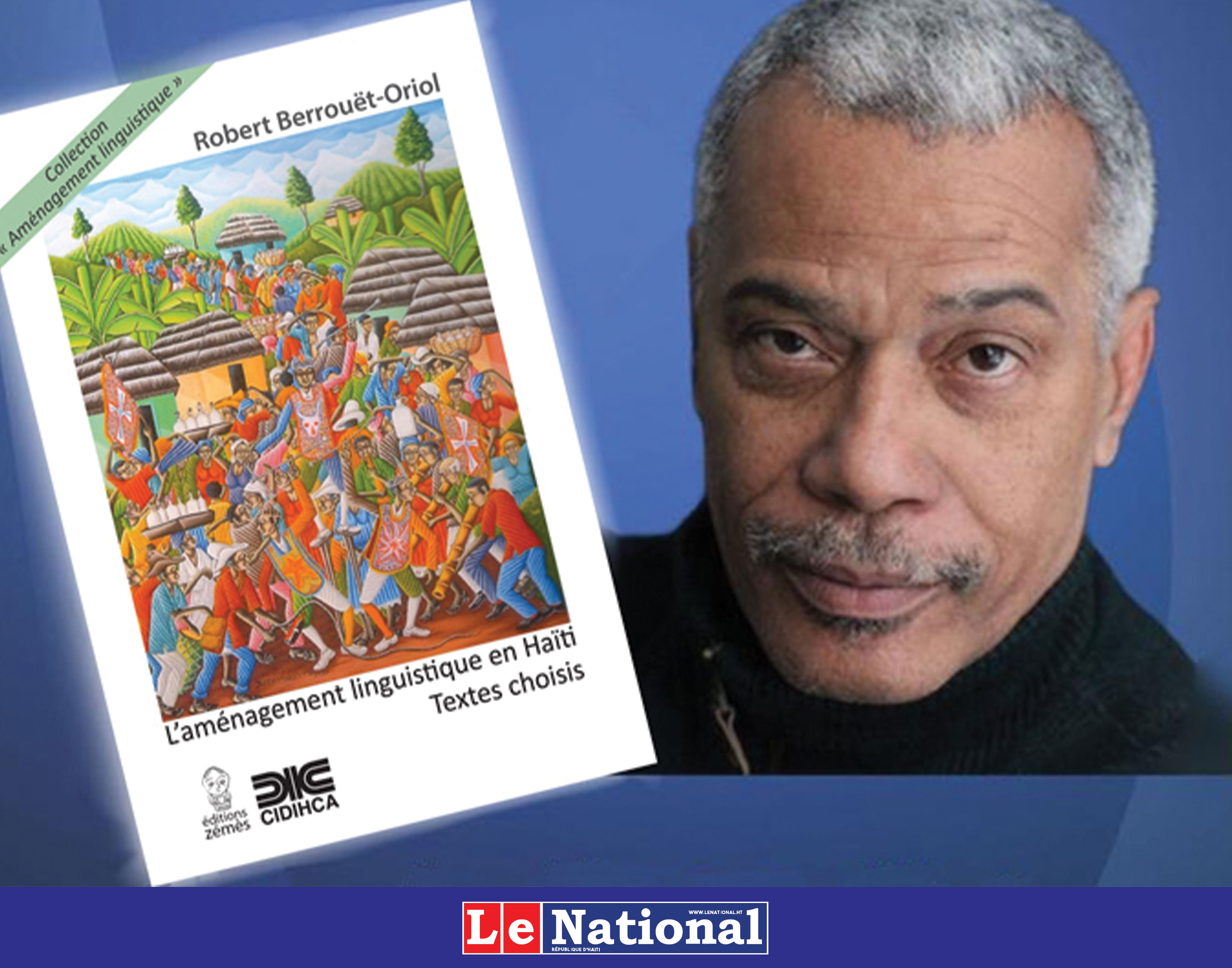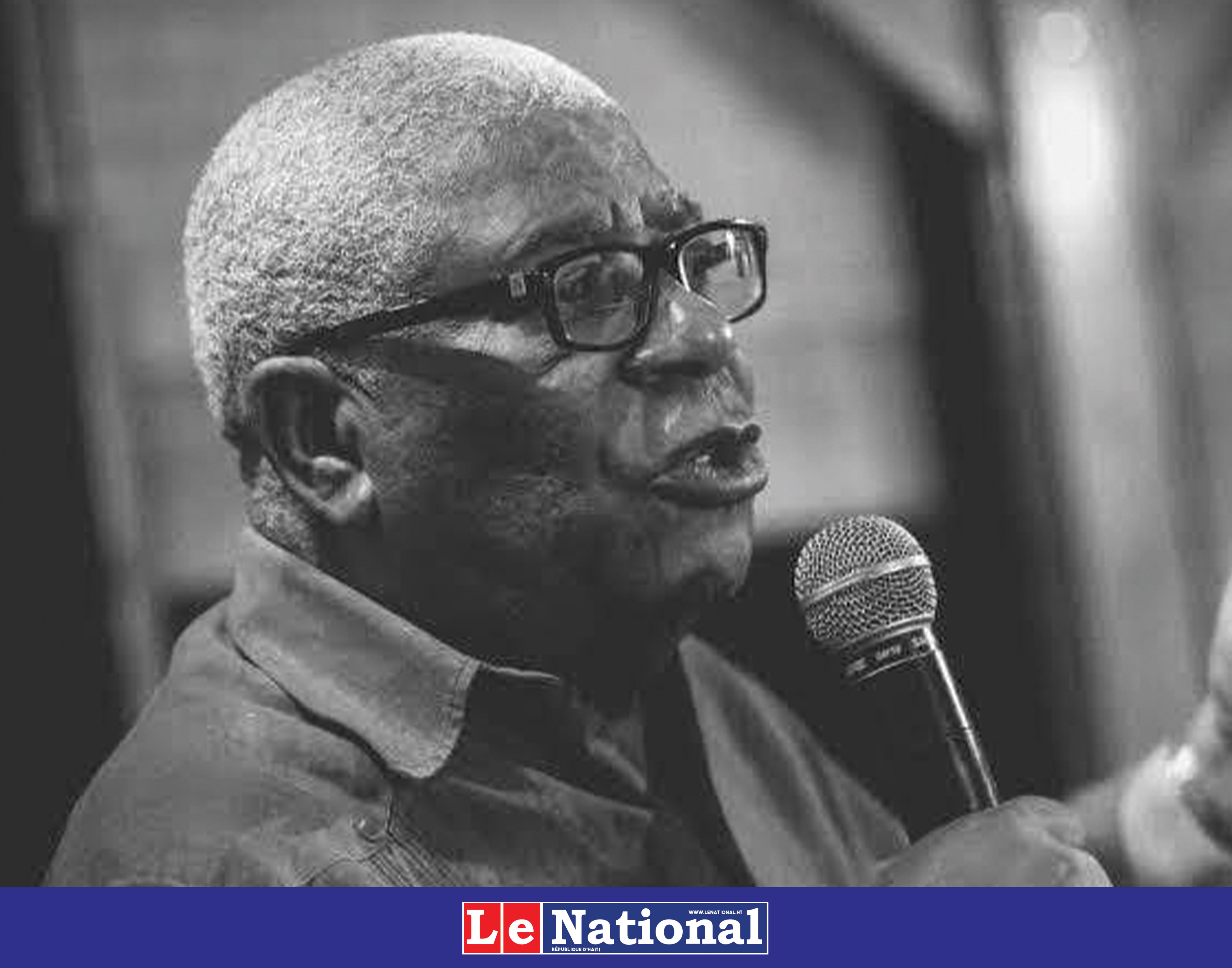(Langue, pouvoir et justice cognitive dans un contexte postcolonial)
Par Paultre Pierre Desrosiers
Résumé
Cet article propose une analyse anthropologique de l’aménagement du kreyòl et du français en Ayiti, abordant la question linguistique comme un fait social total au sens maussien[1], c’est‑à‑dire comme un champ où s’articulent les dimensions symboliques, politiques, cognitives et historiques de la société Ayisyenne. Loin de se réduire à une planification technique, l’aménagement linguistique révèle la persistance d’une diglossie structurelle issue du passé colonial : le kreyòl, langue commune et maternelle de la majorité, reste relégué aux marges du savoir et de l’institution, tandis que le français conserve une autorité symbolique et juridique profondément dissociée des pratiques sociales réelles. Cette asymétrie, analysée ici comme un régime de violence épistémique, produit une injustice cognitive durable : elle affecte la subjectivation des locuteurs, fragilise l’apprentissage scolaire et mine la légitimité symbolique de l’État. À partir d’une approche croisant anthropologie linguistique et épistémologie critique, l’article soutient qu’un aménagement équitable doit reposer sur la reconnaissance du kreyòl comme langue de fondation cognitive et symbolique — médium premier de la pensée, de l’enseignement et de la production du savoir — et sur la redéfinition du français comme langue seconde de spécialisation et d’ouverture. Cette refondation linguistique, fondée sur la justice linguistique et épistémique, vise la construction d’un espace public bilingue inclusif où la parole du plus grand nombre retrouve sa valeur de vérité et où la souveraineté cognitive devient le moteur d’une modernité Ayisyenne décoloniale.
Mots-clés : Ayiti ; kreyòl ; français ; aménagement linguistique ; diglossie ; anthropologie linguistique ; justice cognitive.
Introduction
La question de l’aménagement linguistique en Ayiti constitue depuis plusieurs décennies un enjeu central au croisement des débats éducatifs, politiques et culturels. Toutefois, elle est souvent réduite à une problématique technico-administrative, envisagée sous l’angle restreint de la normalisation grammaticale, du choix de la langue d’enseignement ou de la production de matériel pédagogique. Une telle réduction occulte la portée anthropologique et politique du problème : elle méconnaît le fait que les langues ne sont pas de simples instruments de communication, mais des matrices de subjectivation, des lieux de pouvoir et des dispositifs de production du savoir.
Dans le contexte ayisyen, la coexistence du kreyól et du français excède de loin les cadres ordinaires du bilinguisme. Elle s’inscrit dans une configuration diglossique profondément structurée par l’histoire coloniale, où les langues sont hiérarchisées selon des logiques de domination symbolique. Le kreyól, langue familière et langue commune de la nation entière, reste majoritairement assigné aux sphères de l’oralité, des interactions informelles et de la création culturelle. Le français, langue du prestige et de l’autorité institutionnelle, continue d’incarner la parole légitime de l’État, de l’école et du savoir savant, alors même qu’il n’est maîtrisé que par une minorité sociale.
Cette dissymétrie linguistique ne traduit pas seulement une inégalité d’accès aux ressources éducatives ; elle met en jeu des rapports de pouvoir plus profonds, inscrits dans les structures de production du sens et dans les formes de reconnaissance sociale. Penser l’aménagement linguistique en Ayiti revient dès lors à interroger les fondements symboliques de la citoyenneté et du savoir. Cet article propose de considérer ce champ comme un espace de luttes pour la reconnaissance, où se reconfigurent les rapports entre langue, pouvoir et connaissance. Il s’agira d’examiner, dans une perspective anthropologique, les effets de cette diglossie sur la formation de la subjectivité, sur les pratiques éducatives et sur la cohésion sociale, afin d’esquisser les principes d’un aménagement linguistique fondé sur la justice cognitive et la valorisation de l’épistémè kreyòl.
I. La diglossie ayisyenne comme fait anthropologique
La diglossie ayisyenne dépasse le cadre strict d’une coexistence fonctionnelle entre deux langues ; elle constitue un régime symbolique de hiérarchisation du sens et du savoir.[2] Ce n’est donc pas seulement la distribution des usages — domestiques pour le kreyòl, institutionnels pour le français — qui importe, mais la manière dont cette distribution encode une économie du pouvoir et de la reconnaissance. Le kreyòl s’inscrit du côté de la proximité, de la vie vécue, de l’oralité, du corps et du lien communautaire. Le français, à l’inverse, se situe du côté de l’abstraction, de l’administration, du droit et du savoir institué. Ce clivage n’est pas seulement sociolinguistique ; il opère comme anthropologie implicite du vrai, où chaque langue correspond à un régime de légitimité distinct. Parler en kreyòl, c’est témoigner, raconter, vivre ; parler en français, c’est prouver, décider, juger.
L’anthropologie du langage révèle ici le mécanisme d’une violence symbolique[3] : les sujets sont contraints de s’exprimer dans la langue de l’autorité pour être entendus, tout en intériorisant la dépréciation de leur idiome propre. Cette asymétrie cognitive fragilise le rapport à la pensée elle-même : elle crée un « doute linguistique » où s’effritent la confiance en sa parole et la légitimité de son propre mode de raisonnement. À l’école, cette hiérarchie s’institue en norme. Les enfants Ayitiens deviennent bilingues sous contrainte : ils apprennent prématurément à traduire leur expérience dans une langue autre, à filtrer leur pensée à travers un idiome de pouvoir. Le kreyòl est toléré comme langue d’explication ou de remédiation, jamais comme langue de conceptualisation. Le français demeure la langue de l’examen, du verdict et du succès.
Cette configuration engendre une dissociation durable entre cognition vécue et savoir reconnu. Le sujet collectif en vient à douter de sa capacité à produire du sens sans médiation étrangère : parler kreyòl, c’est vivre ; penser en français, c’est valoir. Ainsi, la diglossie ayisyenne se révèle moins comme un simple fait linguistique que comme un fait anthropologique total, où se condensent les héritages coloniaux, les hiérarchies sociales et les modes différenciés d’accès au symbolique.[4]
Rompre cet ordre suppose une refonte des médiations cognitives : reconnaître dans le kreyòl non l’idiome de compensation, mais la langue première du penser collectif, capable de réarticuler affect, raison et pouvoir au sein d’une même écologie du sens.
II. Langue, subjectivation et pouvoir : vers une anthropologie linguistique de la souveraineté
Toute politique linguistique engage, avant toute chose, une politique du sujet. L’aménagement des langues ne relève jamais d’une simple régulation technique des usages ; il constitue un dispositif de pouvoir qui institue des régimes de légitimité, de visibilité et de reconnaissance, à partir desquels se forment les subjectivités sociales. Une langue reconnue par l’État et les institutions ne fonctionne pas uniquement comme un outil de communication : elle agit comme un opérateur symbolique de reconnaissance. Parler une langue légitime, c’est être autorisé à exister pleinement dans l’espace public ; parler une langue disqualifiée, c’est intérioriser une position de minorisation ontologique.
Ainsi, la linguistique du pouvoir rejoint l’anthropologie de la personne : ce n’est pas seulement un corps parlant qui s’exprime à travers la langue, mais une place sociale, politique et symbolique qui s’y trouve autorisée ou interdite. La langue ne dit pas seulement le monde ; elle détermine qui peut en dire quelque chose, et à partir de quel lieu.
En Ayiti, le kreyòl constitue la langue première du rapport au réel. Il est la langue du sentir, du comprendre et du raconter ; celle dans laquelle s’élaborent les affects fondamentaux liés à la vie quotidienne, au travail, à la souffrance, à la mort, à la dette morale, à la relation au divin et à la communauté. Le kreyòl institue une ontologie relationnelle, fondée sur la voix, la mémoire partagée et la réciprocité : l’existence s’y dit toujours dans un réseau de relations, jamais dans l’abstraction d’un sujet désincarné.
Reléguer cette langue hors des sphères du savoir, du droit, de l’administration et de la gouvernance revient à produire une dissociation radicale entre le sujet parlant et sa propre condition d’existence. C’est instaurer une fracture structurelle entre le monde vécu et la légalité du discours, entre l’expérience sociale et la parole de l’État. L’institution parle une langue qui n’est pas celle dans laquelle le sujet s’est constitué ; elle exige ainsi une traduction permanente de l’expérience pour accéder à la reconnaissance.
La dissociation entraîne une aliénation psycho-symbolique profonde. Dès son plus jeune âge, le sujet prend conscience que son accent, son rythme cognitif, sa manière de raisonner, son idiome ne peuvent pas être considérés comme porteurs du vrai, du rationnel. Il prend conscience que sa parole spontanée n'est pas appropriée pour la connaissance, et que la recherche de la vérité demande une langue étrangère à son être-au-monde. La conséquence dépasse largement l'échec scolaire : elle engendre une auto-dévalorisation cognitive durable et une méfiance structurelle envers l'institution et sa parole, perçue comme étrangère, voire hostile. Le citoyen ayisyen se trouve ainsi placé dans une dette permanente de légitimité linguistique. Il doit traduire son vécu pour être entendu, reformuler son expérience pour être jugé sérieux, et souvent se taire pour être crédible. Le silence devient une stratégie de survie symbolique.
À l’inverse, le français fonctionne comme une langue d’autorité largement désincarnée de tout corps social majoritaire. Il distribue le pouvoir symbolique entre ses initiés et fonde les distinctions scolaires, administratives et politiques. Langue d’élite, il opère comme un filtre social : il ne sélectionne pas seulement des compétences, mais des appartenances. Il transforme la maîtrise linguistique en condition d’accès à la rationalité reconnue, à la citoyenneté effective et à la capacité de gouverner. Dans cette configuration, l’aménagement linguistique existant ne corrige pas les inégalités ; il les sacralise. Il naturalise l’exclusion en faisant passer une hiérarchie linguistique historiquement construite pour un critère neutre de compétence. La langue devient ainsi un instrument de différenciation politique, masqué sous les apparences de la rationalité et du mérite.
Réhabiliter le kreyòl comme langue de subjectivation autonome ne peut donc être réduit à une réforme linguistique ou pédagogique. Il s’agit d’un projet anthropologique et politique majeur : une anthropologie de la souveraineté. Refaire coïncider la langue du vécu et la langue du pouvoir, c’est permettre au sujet ayisyen de penser, de juger et de gouverner à partir du lieu même de son dire. C’est restituer à la parole ordinaire sa capacité à produire du savoir, du droit et du sens collectif. Autrement dit, la souveraineté linguistique n’est pas une revendication identitaire : elle est la condition même de l’émergence d’un sujet politique pleinement institué. Tant que la langue dans laquelle un peuple se constitue comme sujet restera exclue des lieux où se décide le vrai, le juste et le gouvernable, l’État demeurera symboliquement étranger à ceux qu’il prétend représenter.
III. Co-officialité constitutionnelle et asymétrie des usages
La Constitution Ayisyenne de 1987 marque une rupture historique : pour la première fois, elle reconnaît explicitement le kreyòl et le français comme langues officielles de la République, affirmant même le kreyòl comme « langue commune à tous les Ayitiens ». Sur le plan symbolique, cette disposition représente un acte de réparation : elle consacre juridiquement la langue du peuple comme fondement de l’unité nationale.
Mais cette co‑officialité, en apparence égalitaire, reste largement performative et inopérante. Dans la réalité institutionnelle, l’État Ayitien continue de fonctionner presque exclusivement en français : textes de lois, décisions administratives, discours officiels, publications universitaires et procédures judiciaires demeurent inscrits dans le monolinguisme historique des élites. Le kreyòl, pourtant langue de la majorité, n’accède à la sphère du pouvoir qu’en périphérie : traductions tardives, initiatives ponctuelles, communication électorale. Cette dissociation entre reconnaissance juridique et usage effectif traduit la persistance d’une hétéronomie linguistique : le droit proclame l’égalité symbolique des langues, mais les institutions continuent d’opérer selon la logique de la domination coloniale. La co‑officialité devient alors une fiction juridique, masquant la continuation d’une asymétrie fonctionnelle.
Du point de vue de l’anthropologie politique, cette tension linguistique affecte directement les conditions de légitimité de l’État. En maintenant la langue de la majorité en marge des espaces de délibération, de normativité et de décision publique, l’État se constitue comme une instance partiellement étrangère à la société qu’il prétend représenter. Le citoyen kreyólophone se trouve alors relégué à la position de simple destinataire passif d’un discours institutionnel formulé dans un registre linguistique et symbolique qu’il ne peut pleinement s’approprier. Cette dissociation entre langue du pouvoir et langue du vécu engendre une méfiance symbolique durable à l’égard des institutions centrales, affaiblit les mécanismes d’identification politique et réduit la participation démocratique à des formes formelles, souvent désincarnées. L’exclusion linguistique ne relève dès lors pas d’un simple déficit communicationnel, mais d’un processus structurel de désymbolisation de l’autorité étatique.
Du point de vue psychanalytique, l’exclusion de la langue kreyòl des espaces de reconnaissance institutionnelle produit des effets profonds de clivage identitaire. Le sujet est contraint de traduire son expérience intime, affective et imaginaire dans une langue qui n’a pas participé à sa structuration psychique première. Cette opération de traduction n’est pas neutre : elle introduit une dissociation entre le vécu et son énonciation, entre le sujet de l’expérience et le sujet parlant reconnu. Il s’agit là d’un mécanisme de dépossession symbolique, par lequel l’individu ne peut accéder à la reconnaissance sociale qu’au prix d’un déplacement de soi.
Dans ce cadre, le citoyen est sommé d’adopter l’idiome du « maître » pour être entendu, intériorisant progressivement la norme d’une Autre linguistique et symbolique qui devient l’instance de validation de sa parole et de sa valeur subjective. La langue cesse alors d’être un médium d’expression pour devenir un filtre normatif du dicible, assignant le sujet à une position d’hétéronomie symbolique. Cette dynamique rejoint de manière frappante l’analyse proposée par Frantz Fanon dans Peau noire, masques blancs (1952), où la langue du colonisateur apparaît non seulement comme instrument de communication, mais comme masque identitaire imposé par le désir de reconnaissance et la quête d’humanisation aux yeux de l’Autre. Il en résulte une méfiance symbolique à double facette : méfiance à l’égard de l’État, perçu comme porteur d’une parole étrangère et non incorporable, et méfiance envers soi-même, le sujet intériorisant l’idée que sa langue première — et avec elle son expérience — serait insuffisante pour fonder une parole légitime. Cette double aliénation fragilise durablement la constitution du sujet politique et participe à la désagrégation du lien symbolique entre l’individu, la langue et l’État.
Le sujet perçoit sa parole comme insuffisante, son langage comme inadéquat, sa pensée comme toujours déjà illégitime.[5] Ce n'est pas simplement un manque de confiance politique ; c'est un déséquilibre du narcissisme collectif, une diminution du sentiment d'être à l'origine de la Loi. En utilisant une langue étrangère pour la majorité, l'État réactive inconsciemment la figure du Père distant : celui qui donne des ordres sans comprendre, punit sans écouter, promet sans répondre. Rétablir le kreyòl dans le champ du pouvoir revient à réparer un dommage psychique. En donnant au sujet collectif la capacité d'entendre la Loi dans sa propre langue, de reconnaître le pouvoir en quelque chose qui lui parle au lieu de quelque chose qui le parle. Dans cette optique, la refondation linguistique a un effet thérapeutique et symbolique : elle cherche à réconcilier la parole et la loi, entre le corps social et son discours institutionnel. Ainsi, la co‑officialité linguistique n’aura de portée véritable que si elle s’accompagne d’une réorganisation structurelle des usages : formation juridique et administrative en kreyòl, traduction systématique des textes normatifs, enseignement supérieur bilingue, et reconnaissance du kreyòl comme langue de législation et d’argumentation publique. Sans cette transformation du rapport entre langue et pouvoir, l’État continuerait de parler au nom du peuple, mais non avec lui.
IV. Pour un aménagement linguistique fondé sur la justice cognitive
Repenser l’aménagement linguistique à partir de la justice cognitive consiste à reconnaître que toute langue est à la fois un instrument de communication et une matrice de raison. L’enjeu n’est donc pas seulement de distribuer des fonctions entre idiomes, mais de restaurer les conditions symboliques de la pensée partagée. Une politique linguistique juste est celle qui garantit à chaque citoyen la possibilité de savoir, comprendre et juger dans la langue même où il vit, sent et rêve. Dans cette perspective, le kreyòl ne peut demeurer une simple langue nationale d’usage domestique. Il doit être reconnu comme langue de fondation cognitive et symbolique : lieu premier de la conceptualisation, de l’enseignement et de la validation du savoir, notamment aux cycles préscolaires, fondamental et secondaire. Enraciné dans l’expérience vécue, il permet la continuité entre la cognition ordinaire et la connaissance instituée, tout en réduisant les inégalités linguistiques à l’origine de l’échec scolaire massif.
Le français, pour sa part, conserve une fonction importante : langue d’ouverture, de spécialisation et de circulation internationale des savoirs. Mais il ne saurait être l’unique voie d’accès à la rationalité. Enseigné de manière progressive, contextualisée et non discriminante, il vient compléter – non supplanter – l’espace cognitif structuré par le kreyòl. Le rapport entre les deux langues doit se concevoir selon une logique de complémentarité fonctionnelle, et non de hiérarchie symbolique. Un tel aménagement linguistique n’est viable qu’à une condition : la reconnaissance institutionnelle de l’épistémè kreyòl. Cela implique de valoriser les formes de raisonnement, de narration et de jugement qui s’expriment dans la langue créole : modes d’argumentation oraux, logique relationnelle, pragmatique du témoignage, rythmes de la parole. L’État, les universités et le système éducatif doivent investir dans la production de contenus scientifiques, juridiques et pédagogiques an kreyòl, et dans la formation d’enseignants et de cadres capables d’exercer pleinement dans cette langue.
Ce projet dépasse la simple réforme linguistique : il engage une politique de souveraineté cognitive. Restituer au kreyòl sa dignité épistémique revient à réparer la fracture entre langue et pouvoir, entre école et société, entre parole et pensée. C’est donner à Ayiti la possibilité de se penser elle‑même, non plus dans la traduction d’autrui, mais dans la plénitude de son propre dire.
Conclusion
L’aménagement du kreyòl et du français en Ayiti ne saurait être compris comme une simple question technique de bilinguisme. Il engage la structure anthropologique de la subjectivation collective et, par-là, la possibilité même d’un projet national cohérent. La langue n’est pas seulement un instrument de communication : elle est le médium par lequel une société se pense, se juge et se légitime. Tant que la langue dans laquelle le peuple Ayitien rêve, rit, prie et souffre restera reléguée hors des lieux du pouvoir et du savoir, la nation demeurera prise dans une fracture entre le vécu et l’institution, entre l’expérience et la loi. Ce désajustement linguistique constitue le noyau invisible de la fragilité de l’État. Il ne s’agit pas uniquement d’un déficit de traduction, mais d’une disjonction du symbolique, où la majorité demeure linguistiquement absente du champ décisionnel. L’autorité publique, exprimée dans une langue étrangère à la grande masse, apparaît comme extérieure au corps social. Ainsi, le peuple parle sans être entendu, et l’État, parlant sans être compris, se reproduit comme pouvoir sans représentation symbolique réelle.
À l’inverse, un aménagement fondé sur la justice cognitive permettrait de renverser cette logique d’exclusion. Reconnaître le kreyòl comme langue de savoir revient à ouvrir un espace où le citoyen retrouve le droit de penser à partir de lui‑même. Ce n’est pas un repli identitaire, mais une universalité située : celle qui admet que toute vérité procède d’un lieu, d’un corps et d’une histoire, et que l’universel ne se construit qu’à partir de pluralités reconnues comme égales. Un tel aménagement suppose une transformation en profondeur du rapport entre langue et pouvoir : former les enseignants, traduire les textes juridiques, produire la recherche et la science an kreyòl, jusqu’à ce que l’État devienne réellement bilingue, non plus par proclamation constitutionnelle, mais par opération cognitive. C’est par ce travail de chevillage entre langue, savoir et souveraineté que se jouera la refondation d’Ayiti : non pas comme mythe héroïque du passé, mais comme laboratoire contemporain d’une démocratie linguistique et épistémique.
En dernière instance, promouvoir le kreyòl comme langue de savoir, ce n’est pas seulement réparer une injustice historique : c’est affirmer la possibilité d’une pensée universelle issue du Sud, enracinée dans l’expérience des peuples subalternes et ouverte à la co‑production du vrai. En ce sens, la justice cognitive n’est pas le supplément éthique d’une politique linguistique ; elle en est le principe constituant, l’acte même par lequel un peuple redevient source du sens et auteur de son monde.
Paultre Pierre Desrosiers
Médecin anthropologue, psychanalyste, linguiste
19 janvier 2026
Bibliographie
Berrouët-Oriol, R. (2011). L’aménagement linguistique en Ayiti : enjeux, défis et propositions. Éditions de l’Université d’État d’Ayiti ; CIDIHCA.
Berrouët-Oriol, R. (2018). La didactisation du créole au cœur de l’aménagement linguistique en Ayiti. Revue internationale d’éducation de Sèvres, 79, 63–74.
Bourdieu, P. (1982). Ce que parler veut dire : L’économie des échanges linguistiques. Fayard.
Calvet, L.-J. (1999). Pour une écologie des langues du monde. Plon.
DeGraff, M. (2015). Linguists’ most dangerous myth: The fallacy of Creole Exceptionalism. Language, 91(3), 491–526.
Ferguson, C. A. (1959). Diglossia. Word, 15(2), 325–340.
Govain, R. (2014). Aménagement linguistique et éducation en Ayiti : Enjeux sociopolitiques. L’Harmattan.
Govain, R. (2018). Le créole Ayitien : Description et analyse. L’Harmattan.
Hymes, D. (1972). On communicative competence. In J. B. Pride & J. Holmes (Eds.), Sociolinguistics (pp. 269–293). Penguin.
Louis-Jean, J. (2009). Langue, école et pouvoir en Ayiti : Le créole face à l’institution scolaire. Études créoles, 32(1), 45–62.
Phillipson, R. (1992). Linguistic imperialism. Oxford University Press.
UNESCO. (2016). If you don’t understand, how can you learn? Global education monitoring report. UNESCO Publishing.
Valdman, A. (1988). Le créole Ayitien : Structure, variation, statut et origine. Klincksieck.
Zéphyr, L. (2008). Pwoblèm pawòl klè nan lang kreyòl. Éditions de l’Université d’État d’Ayiti.
[1] Mauss, M. (1925). Essai sur le don. Paris: PUF.
→ Référence indirecte mais structurante : notion de fait social total, transposable à la diglossie.
[2] La diglossie ayisyenne dépasse le cadre strict d’une coexistence fonctionnelle entre deux langues ; elle constitue un régime symbolique de hiérarchisation du sens et du savoir.
[3] Bourdieu, Pierre. Langage et pouvoir symbolique. Paris: Seuil, 2001 [trad. anglaise: Language and Symbolic Power, Harvard University Press, 1991]. Ouvrage de synthèse sur le rapport entre langage, domination et légitimité.
[4] Ferguson, C. A. (1959). Diglossia. Word, 15(2), 325–340.
→ Texte fondateur ; utile comme point de départ, mais à dépasser, car strictement linguistique.
[5] « Neo-Colonial Elites' Linguistic Violence and Monolingual Haitian Creole Speakers' Exclusion » (USF, 2020) montre que la domination du français en Haïti engendre faible estime de soi, auto‑dévalorisation et sentiment de marginalisation chez les locuteurs monolingues kreyòl.