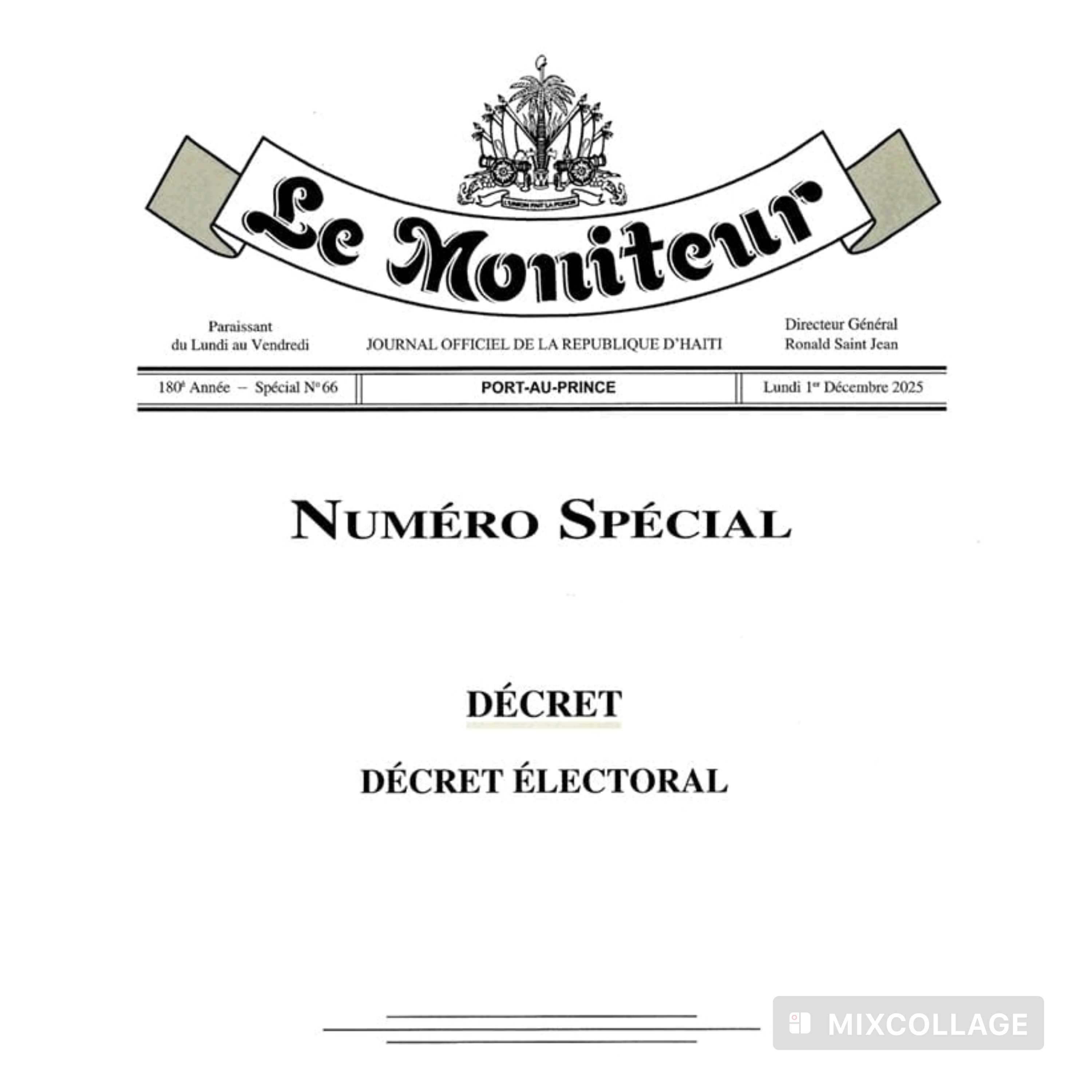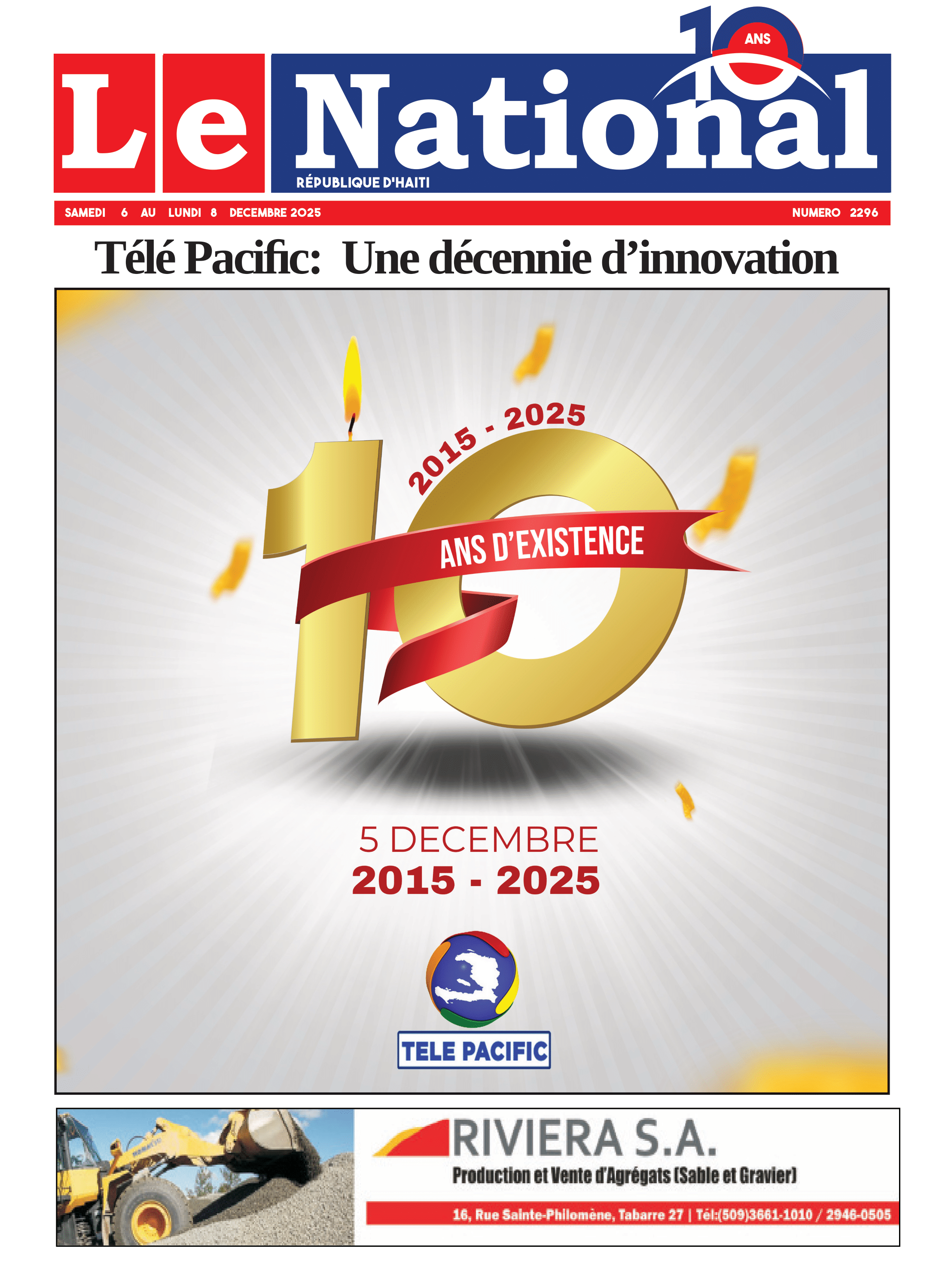Des dizaines ou des centaines de talents artistiques, des créateurs et d’autres amateurs et des professionnels qui pratiquent les métiers créatifs, issus des différentes filières des industries culturelles en Haïti, sont contraints entre l’exil, la reconversion et d’autres activités pas toujours valorisantes sociales, jusqu'à parfois s’autodétruire entre la drogue et l’alcool, entre autres. Ainsi on assiste à l’assassinat des revers des milliers de jeunes dans le pays. Qui a dit qu'un problème identifié est à moitié résolu ?
Demain sera peut-être trop tard, si on ne prend pas le temps de se poser les vraies questions, d’aborder les différents problèmes de la jeunesse haïtienne dans une approche logique et pratique. Ce qui n’empêche pas pour trouver des solutions à ces problèmes, d’explorer les leçons et formules inscrites dans le manuel d’arithmétique de l’économie de la culture en Haïti. En vous épargnant les grands discours et théories sur le sujet, je me contenterai une fois de plus d’inscrire mes mots dans un plaidoyer continu dans l’espoir de provoquer des débats sur l’économie de la culture en Haïti ?
De plus en plus considérée comme un simple ornement identitaire, la culture haïtienne est pourtant une véritable mine de richesses économiques encore sous-exploitée. Et je suis loin d’être le premier à le rappeler aux élites et à nos dirigeants qui voyagent un peu partout dans le monde et profitent largement des atouts des industries culturelles.
Dans toutes les filières, notamment dans l’art, le patrimoine, la musique, la danse, les arts visuels, l’artisanal, et les arts sacrés entre autres, qui célèbrent toute la vitalité de la spiritualité, plus d’un reconnaissent en Haïti comme dans sa diaspora, que le pays regorge de ressources qui pourraient devenir les piliers d’une économie culturelle dynamique et rentable.
Dommage pour la majorité silencieuse du peuple de 1804, qui se trouve en pleine guerre voilée et réelle contre l’Etat, l’indépendance et la nation haïtienne, pourtant ne réalise pas que c’est l’Être Haïtien, à travers sa culture nationale qui est avant tout ciblées dans toutes ses dimensions et ses composantes physiques, philosophiques, artistiques, mystiques, spirituelles, matérielles et symboliques.
Dans un contexte où les priorités nationales se concentrent souvent sur l’urgence sociale, la culture reste perçue comme un luxe. A travers cette publication de plus, et non de trop, je viens vous rappeler et éventuellement vous démontrer, avec ou sans les chiffres actualisés qui manquent malheureusement dans la planification actuelle des projets de développement national, de nombreux exemples à l’appui pourraient bien prouver que la mobilisation des investissements dans la culture en Haïti, notamment à travers des institutions stratégiques comme les salles de spectacles, les centres de formation techniques et les ateliers de production et de création multimédia, autant que les institutions de la mémoire comme les musées, figurent parmi les actions qui pourraient servir de le levier de développement économique structurant, durable et rentable pour Haïti.
Des calculs simples et pratiques, à expliquer aux autorités politiques, aux responsables de la finance et de l’économie, en passant par les responsables de la Direction générale des Impôts (DGI), les principaux responsables des administrations communales et d’autres financiers de la place, dans chaque commune du pays, prouveront combien la culture peut-être rentable en Haïti, si et seulement si, on prenant le temps d’investir dans ce secteur qui mobilisent le plus grand nombre d’attention, de consommation, et d’innovation.
Des défilés de Rara, en passant par les festivals, et sans oublier le Carnaval national dans le temps. La multiplication des divers produits et services liés à la consommation, a l’hébergement, au transport, à la communication, à l'animation, aux vêtements, et d’autres aspects peuvent suffire pour montrer le poids de la rentabilité de ce secteur.
Dans un musée par département, qui exposera en permanence et suivant des fréquences en accord avec la programmation du curriculum du ministère de l’éducation durant l’année académique, permettrait largement aux familles, aux parents, aux responsables de toutes les écoles classiques du pays, aux professeurs concernés par les sujets, de mobiliser tous les élèves autour de ces différentes expositions thématiques, historiques, artistiques, culturelles et scientifiques. A raison d’un sujet par trimestre destiné à prolonger les cours de la salle de classe dans des expositions multimédias, les élèves seraient plus que jamais heureux de découvrir d’autres le pays, les villes, la population dans sa diversité, la nature, les savoirs utiles.
Derrière chaque délégation et chaque exposition thématique, c’est toute l’économie nationale qui sera mobilisée dans chaque département géographique. L’arithmétique de la rentabilité est simple. La multiplication de la rentabilité de l’économie de la culture serait au centre des calculs: le prix unitaire pour la visite de l’exposition durant la tournée, à multiplier par nombre d’enfants par classe, à multiplier par le nombre de classe dans chaque école, à multiplier par le nombre d’école dans une ville, à multiplier par le nombre d’autobus pour le transport, le nombre de kits de nourriture, le nombre de kits éducatifs et de supports de l’exposition, le nombre de places d’hébergement, le nombre de maillots souvenirs imprimés, le nombre de chauffeurs d’autobus, de responsables d’accueils et de protocole, d’agents de sécurité, des membres du personnel médical, des guides pour accompagner ces enfants. Bref, toute une économie culturelle en marche !
Dans l’arithmétique de l’économie culturelle, la comptabilité sera au premier plan. Les économistes autant que les financiers et les banquiers, seront surtout invités à établir des théories, à évaluer et à calculer la rentabilité de chaque offre culturelle (qualitative et quantitative), à analyser des chiffres et d’autres modèles réussis dans d’autres pays, et d’autres villes qui ne disposent pas autant ou tous les atouts du pays en dehors, en Haïti.
Dans de nombreux pays, la culture est une industrie à part entière, générant des milliards en revenus, en emplois et en investissements. La république dominicaine, Cuba, Jamaïque, et d’autres pays de la Caraïbe le justifient en permanence. Pourquoi pas nous ? Est-ce les seuls problèmes de l’insécurité peuvent justifier un tel déclin en Haïti ? Selon l’UNESCO, les industries culturelles et créatives représentent plus de 3 % du PIB mondial et plus de 30 millions d’emplois.
Dans une seule et même activité culturelle de nos jours, il est possible de définir plusieurs options de rentabilité légale, et stratégique en parallèle, en maîtrisant les leviers et les engrenages de la typologie des recettes dans l'économie culturelle. On peut citer les recettes directes, qui sont réparties entre la billetterie de musées, les concerts, les festivals, les ventes d’œuvres d’art, les produits dérivés, la location d'espaces culturels, entre autres.
Des recettes indirectes sont parfois plus importantes et durables dans certaines activités culturelles, telles que les retombées touristiques, les emplois induits, la notoriété et l’image du pays, l’attractivité des territoires, qui permettent a court, moyen et long termes d’autres formes de circulation, de consommation, de production, de distribution, de création, d’animation et d’exploration à traduire en des chiffres, en des données et des recettes.
Des financements mixtes qui passeront également par les subventions publiques, le mécénat privé, les partenariats internationaux, le crowdfunding ne sont pas négligeables non plus, dans une démarche visant à rationnaliser la culture de la création de richesse, par la rentabilisation de l'économie de la culture dans les esprits des dirigeants et des élites haïtiennes, des familles et des jeunes qui souhaitent encore vivre dans leur pays.
De nombreux spécialistes qui maîtrisent les différents aspects des industries de la culture évoluent encore en Haïti. Ces hommes et ces femmes attendent juste un signal pour bouger, pour s’impliquer, pour travailler, et pour transformer le décor, ce sombre décor en une mine d’or.
Des nouvelles institutions qu’il faudra créer, des centaines d’entreprises culturelles spécialisées et innovantes à encourager et à accompagner, d’autres structures existantes ou moribondes à rendre fonctionnelles et efficientes, des professionnels à former dans tous les secteurs d’activités économiques, culturelles, administratives, juridiques, technologiques, informatiques, entre autres. En sachant que la rentabilité culturelle comme pour tout autre secteur, ne s’improvise pas, elle se repose avant tout sur une stratégie structurée et des outils adaptés, des objectifs bien définis et des équipes compétentes et motivées.
A suivre
Dominique Domercant