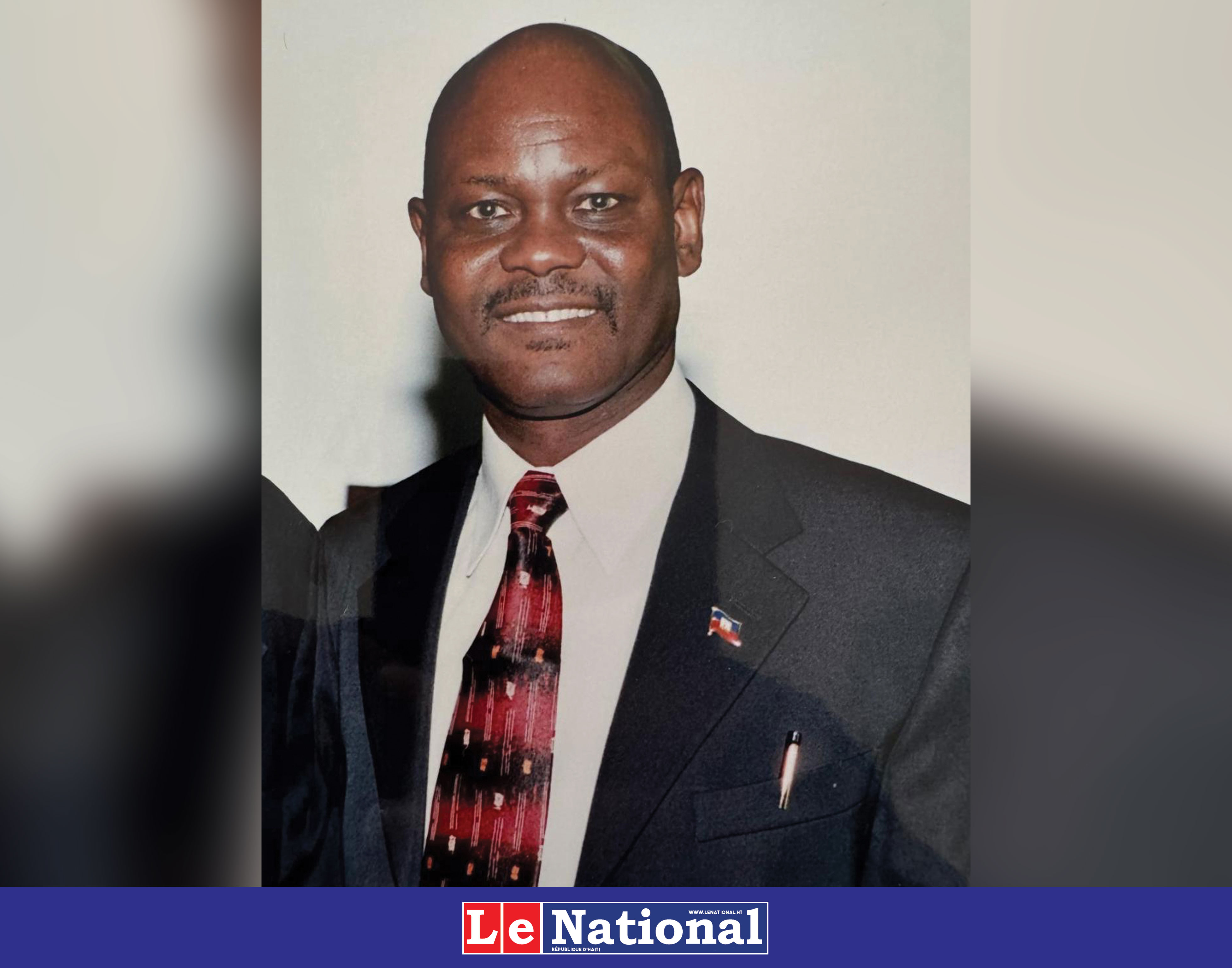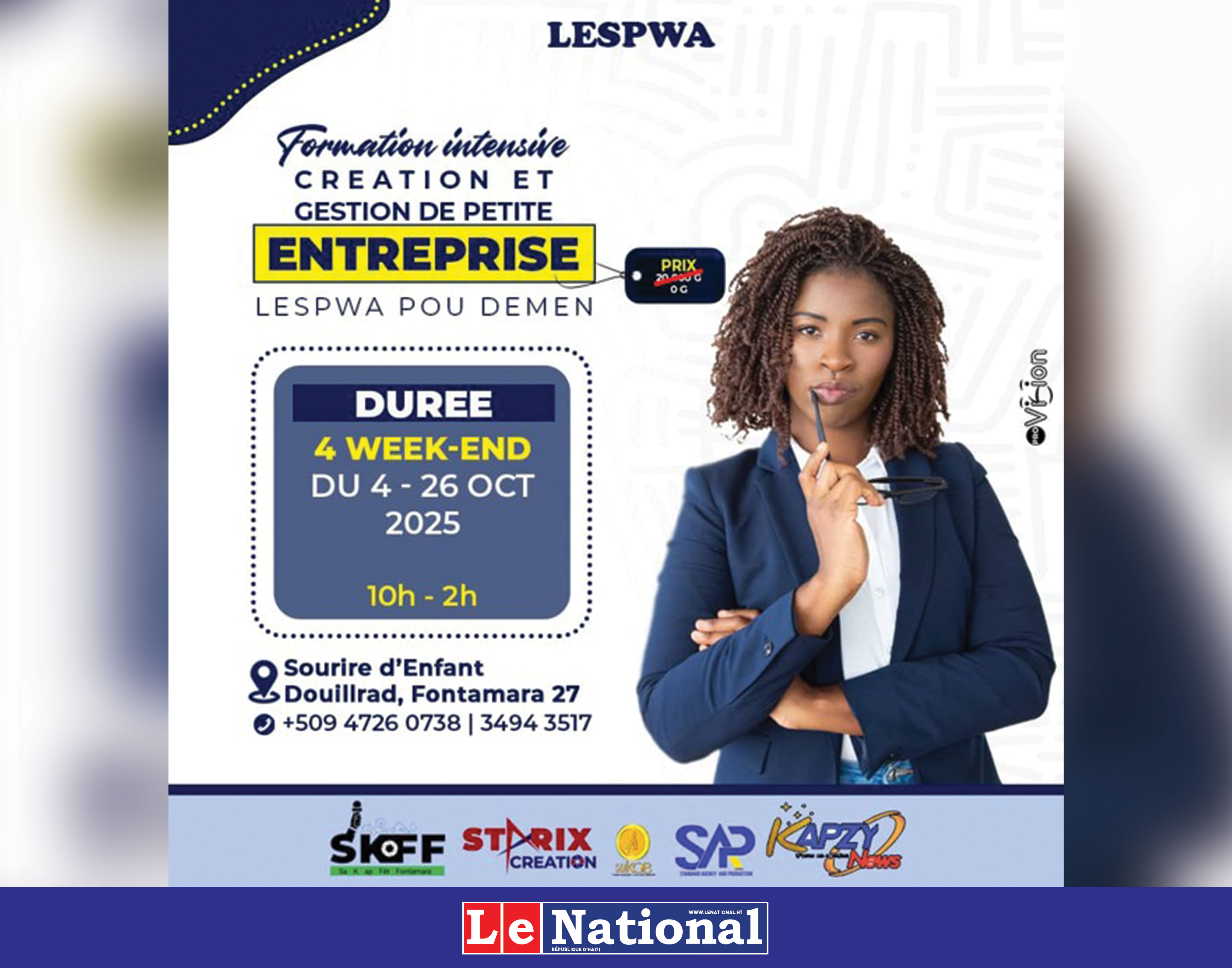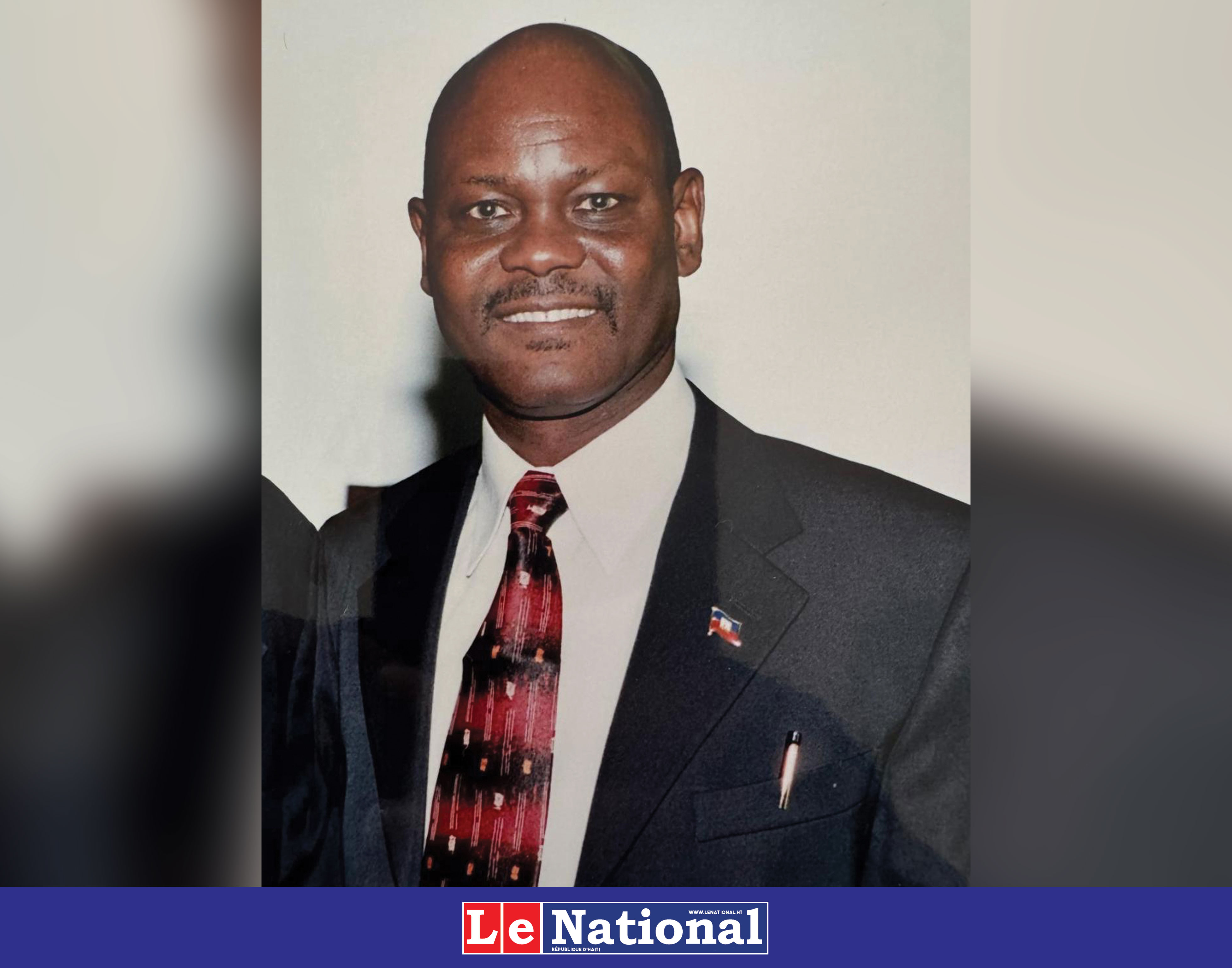L’avant-projet de Constitution, désormais au point mort, prévoyait un quota pour accroître la présence des femmes en politique. Mais dans une société où le machisme reste dominant, ce type de mesure favorise-t-il réellement l’égalité… ou ne fait-il que renforcer la discrimination qu’il prétend abolir ?
« Chassez le naturel, il revient au galop. » Cette maxime illustre bien la réalité haïtienne. L’État, lui-même, n’a pas échappé à cette tendance à l’exclusion, comme en témoigne l’article 30 de l’avant-projet de Constitution. Cette clause, prolongement de l’article 16 du même texte relatif à la participation des femmes, stipule que « L’État encourage la structuration et le développement des partis politiques. Il encourage les citoyens à adhérer aux partis politiques pour présenter leur candidature aux fonctions électives, le cas échéant. »
La formulation de cet article est révélatrice : il ne mentionne que les citoyens, occultant les citoyennes, alors même qu’il prétend promouvoir la participation des femmes. Une omission lourde de sens : en politique, le masculin continue de l’emporter sur le féminin.
Déjà, en 2018, une proposition visant à créer un « Office de la protection de la citoyenne et du citoyen » avait été rejetée au motif que l’adjectif « citoyenne » serait contraire à la Constitution (AlterPresse, 7 mars 2018). On sent ici tout le poids du machisme et du patriarcat.
Cette contradiction est encore plus flagrante lorsque l’article 30-1 stipule que « tout parti politique doit encourager la participation des femmes et des jeunes dans ses structures ». Comment les partis, déjà fragilisés financièrement depuis des années, pourraient-ils réellement promouvoir les femmes sans un soutien concret de l’État ?
L’incohérence s’accentue à l’article 30-1, qui exige que « tout parti politique encourage la participation des femmes et des jeunes ». Comment y parvenir sans appui concret de l’État, alors que les partis sont financièrement asphyxiés et que le pays est plongé dans une crise profonde depuis plusieurs années ?
À l’article 30-2, l’État promet de rembourser une partie des dépenses de campagne des partis, à condition qu’ils obtiennent au moins 10 % des sièges au Parlement ou des élus aux collectivités territoriales. Mais là encore, aucune mention spécifique n’est faite des femmes. Ce silence contraste avec l’intérêt affiché pour les collectivités locales et révèle une vision tronquée de la justice électorale.
En réalité, ces dispositions se contredisent et illustrent la fausse promotion de la femme en politique : le quota imposé n’est qu’une façade qui maintient l’exclusion au lieu de la combattre.
Une responsabilité politique et morale
Si l’État veut réellement promouvoir la participation des femmes, il doit aller au-delà des slogans et des déclarations symboliques. Cela suppose non seulement un engagement moral, mais aussi des moyens financiers concrets, à travers la création d’un fonds solide pour soutenir leurs candidatures. Il est également nécessaire de mettre en place de véritables mécanismes d’accompagnement et d’affirmer une volonté politique claire. La démocratie a un coût, mais elle ne peut être bâtie à crédit, et les femmes ne doivent plus se contenter de miettes déguisées en quotas mal définis.
Aujourd’hui encore, de nombreux législateurs agissent comme si les postes électifs appartenaient de droit aux hommes, n’accordant aux femmes qu’un quota de représentation par « pitié ». Pourtant, les campagnes électorales imposent en principe un partage équitable du temps d’antenne à la radio et à la télévision. Dans la pratique, les hommes gardent une nette avance technique et logistique, renforcée par des inégalités de moyens.
Réduire la participation des femmes à de simples quotas relève de l’imposture : les fonctions publiques et électives ne sont la propriété de personne, encore moins des hommes. Or, paradoxalement, au moment des campagnes, on se contente d’exiger un partage du temps d’antenne entre hommes et femmes, comme si ce geste symbolique suffisait à réparer des siècles d’exclusion.
Le poids de l’histoire et des modèles féminins
L’histoire d’Haïti regorge pourtant d’exemples de femmes ayant marqué la nation : Catherine Flon cousant le drapeau, Marie-Jeanne et Sanité Bélair aux côtés de Dessalines, Marie Déde Basile dite « Défilée la Folle » qui, seule, enterra l’Empereur abandonné de tous. De même, Marie de Magdala fut la première à annoncer la résurrection du Christ. Ces symboles rappellent que les femmes, même reléguées à l’ombre, ont toujours joué un rôle décisif.
Ces figures, longtemps considérées comme marginales, ont marqué notre destin collectif sans avoir besoin de quotas. Leur courage et leur vision rappellent que la place des femmes en politique est une exigence de justice, pas une faveur.
La Déclaration de Beijing (1995) le réaffirme sans ambiguïté : « Les femmes ont le droit à l’égalité d’accès aux fonctions publiques de leur pays et à participer aux affaires publiques, y compris la prise de décision. »
Or, au lieu de mettre en œuvre cette égalité, les législateurs haïtiens ont transformé l’opportunité offerte par les Nations unies en quotas instrumentalisés contre les femmes elles-mêmes.
Pour une véritable égalité
Les femmes haïtiennes ne peuvent plus rester spectatrices de l’effondrement du pays. Porteuses de vie et de courage, elles ont aussi la capacité d’assumer les combats politiques, de participer à la reconstruction nationale et de défendre la dignité du peuple. Leurs aptitudes physiques, morales et intellectuelles en font des actrices incontournables. Leur exclusion actuelle n’est pas seulement une injustice : elle prive la nation de forces essentielles pour sortir du sous-développement chronique.
Le véritable enjeu n’est pas un quota concédé par les hommes, mais un droit naturel et constitutionnel. L’avenir exige une égalité réelle : 50 % de femmes et 50 % d’hommes, en accord avec la réalité démographique et sociale du pays. Si, dans certaines circonstances, les femmes choisissent elles-mêmes un seuil de représentation différent, ce choix doit leur appartenir — et non être imposé par d’autres.
Les femmes d’Haïti portent un héritage de courage et de lucidité. Leur place ne peut plus être réduite à des quotas symboliques rédigés par des législateurs frileux. Leur intégration pleine et entière dans le champ politique est une condition essentielle pour refonder le pays, renforcer les institutions et consolider la démocratie.
L’histoire le rappelle : les plus grands bouleversements et les renaissances les plus marquantes se sont souvent écrits avec des femmes en première ligne.
Dr. Emmanuel Charles
Constitutionnaliste et spécialiste des élections
Références :
Anciens textes sur le thème du même auteur :
- La participation politique des femmes en Haïti : entre exclusion, quotas et espoir https://www.lenational.org/post_article.php?soc=1898 (23 septembre 2025)
- Le quota pour les femmes, une illustration de l’inégalité entre les deux sexes https://www.lenational.org/post_article.php?soc=1914 (30 septembre 2025)
- Les femmes en politique : actrices ou simples témoins institutionnels ? https://lenational.org/post_article.php?soc=1917 (2 octobre 2025)