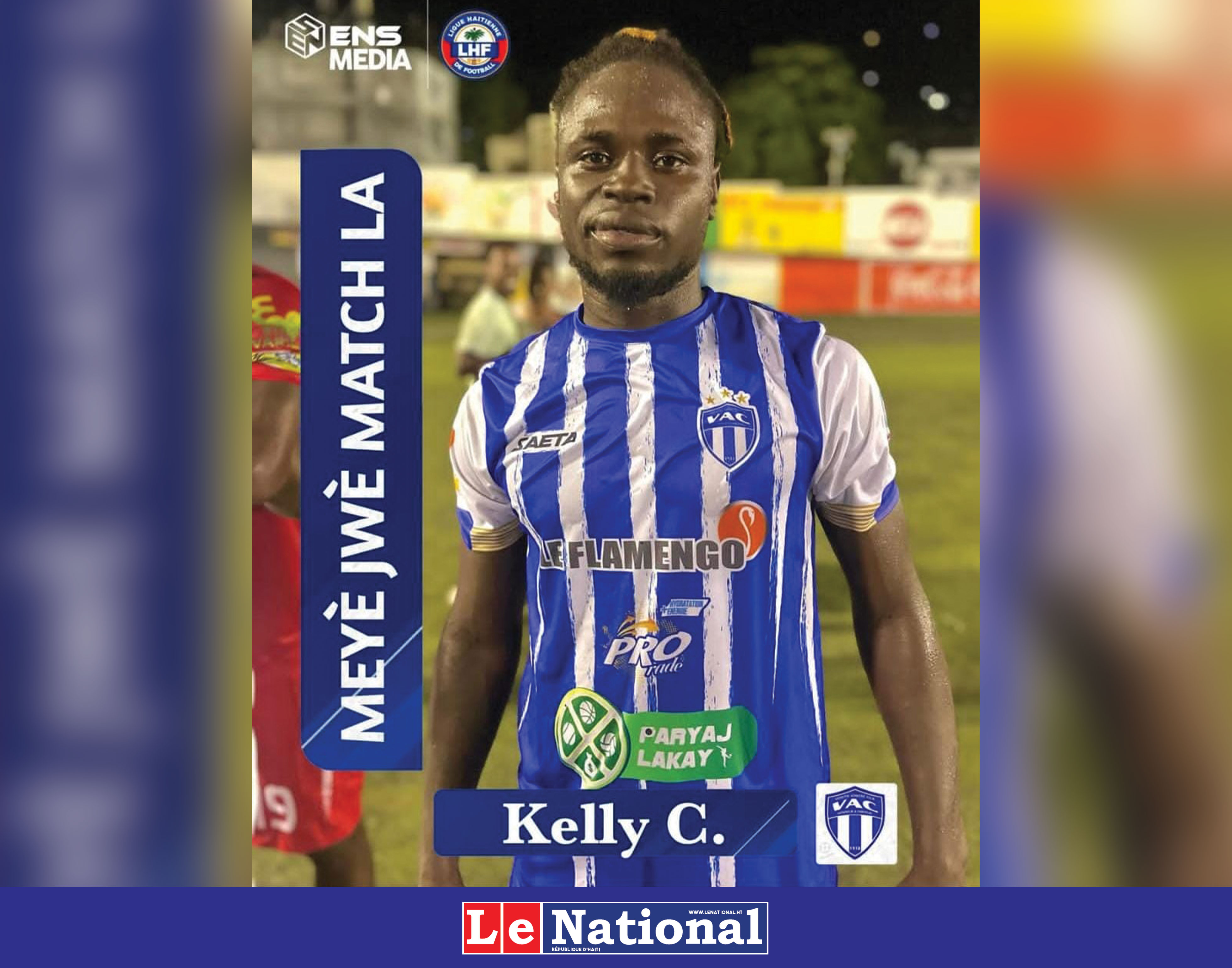Cinquante-deux ans après l’épopée de 1974, Haïti est de retour en Coupe du Monde.
Le 18 novembre, jour du 222ᵉ anniversaire de la bataille de Vertières, les Grenadiers ont validé leur billet pour le Mondial 2026 (États-Unis, Canada, Mexique) en s’imposant 2-0 contre le Nicaragua à Curaçao.
Une qualification historique, arrachée loin du pays, dans un contexte de crise profonde… et sous la direction d’un sélectionneur qui n’a encore jamais mis les pieds en Haïti.
Depuis le séisme dévastateur de 2010, Haïti vit au rythme des crises politiques, économiques et sécuritaires. Des gangs armés contrôlent une large partie de Port-au-Prince, plus d’un million de personnes ont été déplacées et les voyages vers le pays sont déconseillés en raison des risques d’enlèvements, de violences et d’instabilité.
Dans ce contexte, les Grenadiers ne peuvent plus accueillir leurs adversaires à domicile : leurs « matches à la maison » se jouent à plus de 800 kilomètres, à Curaçao. Conséquence directe : leur sélectionneur français, Sébastien Migné, 52 ans, nommé il y a dix-huit mois, n’a jamais pu se rendre sur le sol haïtien, jugé trop dangereux et désormais privé de vols internationaux réguliers.
Habitué à vivre dans les pays qu’il entraîne, l’ancien adjoint du Cameroun au Mondial précédent a dû inventer une sélection à distance. Appels téléphoniques, échanges permanents avec les responsables de la Fédération haïtienne de football, visionnage de matchs en ligne : c’est ainsi qu’il a identifié les talents issus de la diaspora et bâti un groupe désormais 100 % basé à l’étranger. Parmi eux, le milieu de Wolverhampton, Jean-Ricner Bellegarde, né en France de parents haïtiens. Le staff espère aussi convaincre d’autres binationaux, comme l’attaquant de Sunderland Wilson Isidor.
Haïti – Nicaragua : le match qui a fait basculer l’histoire
Face au Nicaragua, les Grenadiers savaient que l’équation était simple : gagner pour ne pas dépendre des autres. Ils n’ont pas tremblé.
Dès la 9ᵉ minute, Don Deedson Louicius – titularisé à la place de Dandley Jean-Jacques, suspendu pour accumulation de cartons jaunes – ouvre le score sur une passe bien dosée de Josué Casimir (1-0, 9ᵉ).
Dans le temps additionnel de la première période, Ruben Providence, servi par Carlens Arcus, profite d’un nouvel espace dans la défense nicaraguayenne pour doubler la mise (2-0, 45ᵉ+1).
Avec cet avantage acquis avant la pause, les Grenadiers gèrent leur seconde période avec sérieux, solidité et discipline tactique, jusqu’au coup de sifflet final. Le 2-0 ne bougera plus. À cet instant, Haïti a fait le plus dur, mais doit encore attendre l’autre résultat clé du groupe : le duel entre le Costa Rica et le Honduras.
Le match nul 0-0 entre Costa Rica et Honduras viendra parachever la soirée. Grâce à ce résultat, Haïti termine en tête du groupe C avec 11 points (+3). Le Honduras, pourtant combatif, finit deuxième avec 9 points (+3), le Costa Rica troisième (7 points, +2) et le Nicaragua bon dernier (4 points, -8).
Mais le destin du Honduras se joue ailleurs. Dans le groupe A, le Suriname arrache la deuxième place qualificative pour les barrages grâce à une meilleure attaque, malgré le même nombre de points (9, différence de +3) : 9 buts marqués pour les Surinamiens contre seulement 5 pour les Honduriens. L’autre ticket de barrages revient à la Jamaïque, deuxième du groupe B avec 11 points (+8).
Les deux autres pays directement qualifiés en provenance de la zone Concacaf, aux côtés d’Haïti, sont :
• Panama, leader du groupe A (12 points, +5)
• Curaçao, leader du groupe B (12 points, +10)
Ainsi, pour la première fois depuis 1974, les Grenadiers rejoignent le gratin mondial.
Lors de leur unique participation précédente, ils avaient affronté l’Italie, la Pologne et l’Argentine, quittant la compétition au premier tour.
Cinquante-deux ans plus tard, grace aux inlassables efforts des membres d’un Comité de Normalisation (CN) qui a su faire une gestion experte du concept de “représentation Internationale”, la page qui s’ouvre est celle d’un symbole plus grand que le football.
Et pour cause, cette qualification dépasse largement le cadre sportif.
Tandis que le pays vit une des périodes les plus sombres de son histoire contemporaine, la sélection nationale offre une image différente d’Haïti : celle d’un peuple résilient, talentueux, déterminé à exister autrement que par la violence et le chaos.
Le CN, le staff technique et les Grenadiers ont écrit cette page loin du Champ de Mars, loin des rues de Port-au-Prince, dans un stade de Curaçao vide de vrais tambours haïtiens mais rempli d’espoir. Le paradoxe est cruel : un pays trop dangereux pour accueillir ses héros, une équipe trop méritante pour ne pas être célébrée.
Le 18 novembre au soir, des millions d’Haïtiens, sur l’île comme dans la diaspora, ont laissé éclater leur joie en complimentant tous les acteurs.
De nouvelles générations, qui n’avaient connu la Coupe du Monde qu’à travers les récits de 1974, découvrent enfin leurs propres Grenadiers qualifiés.
Il revient maintenant aux autorités de permettre à ces 23 vaillants Grenadiers et à toute l’équipe dirigeante de venir au pays et de les accueillir sur le sol dessalinien, pour célébrer ensemble cette qualification.
Ce serait un geste fort : celui d’un pays qui refuse de laisser le rêve se jouer uniquement à l’étranger.
En attendant, le message est clair :
Rèv la reyalize, apre 52 zan, nou foot nan Mondyal anko.
Et cette fois, le monde entier devra compter avec Haïti.
Gérald Bordes