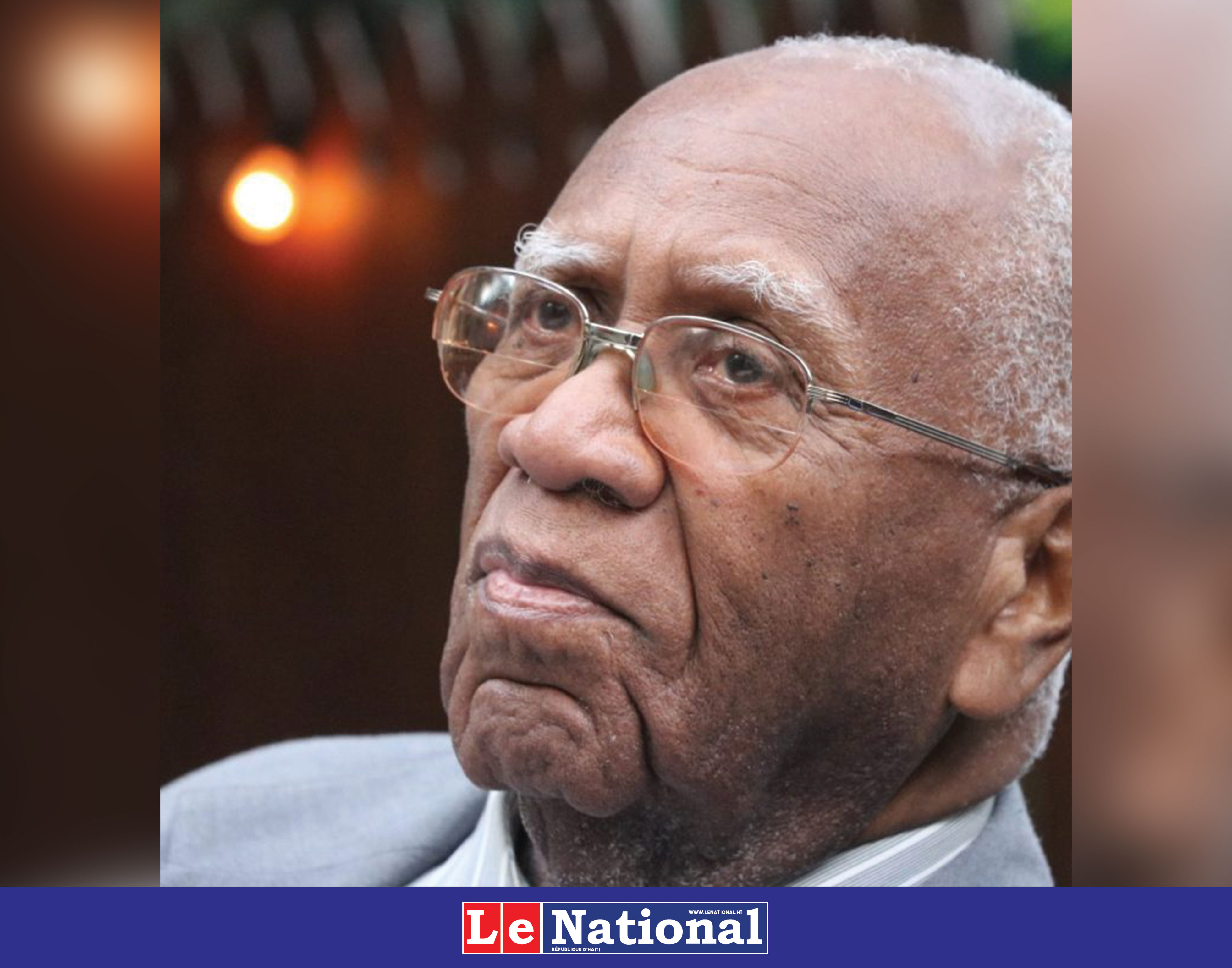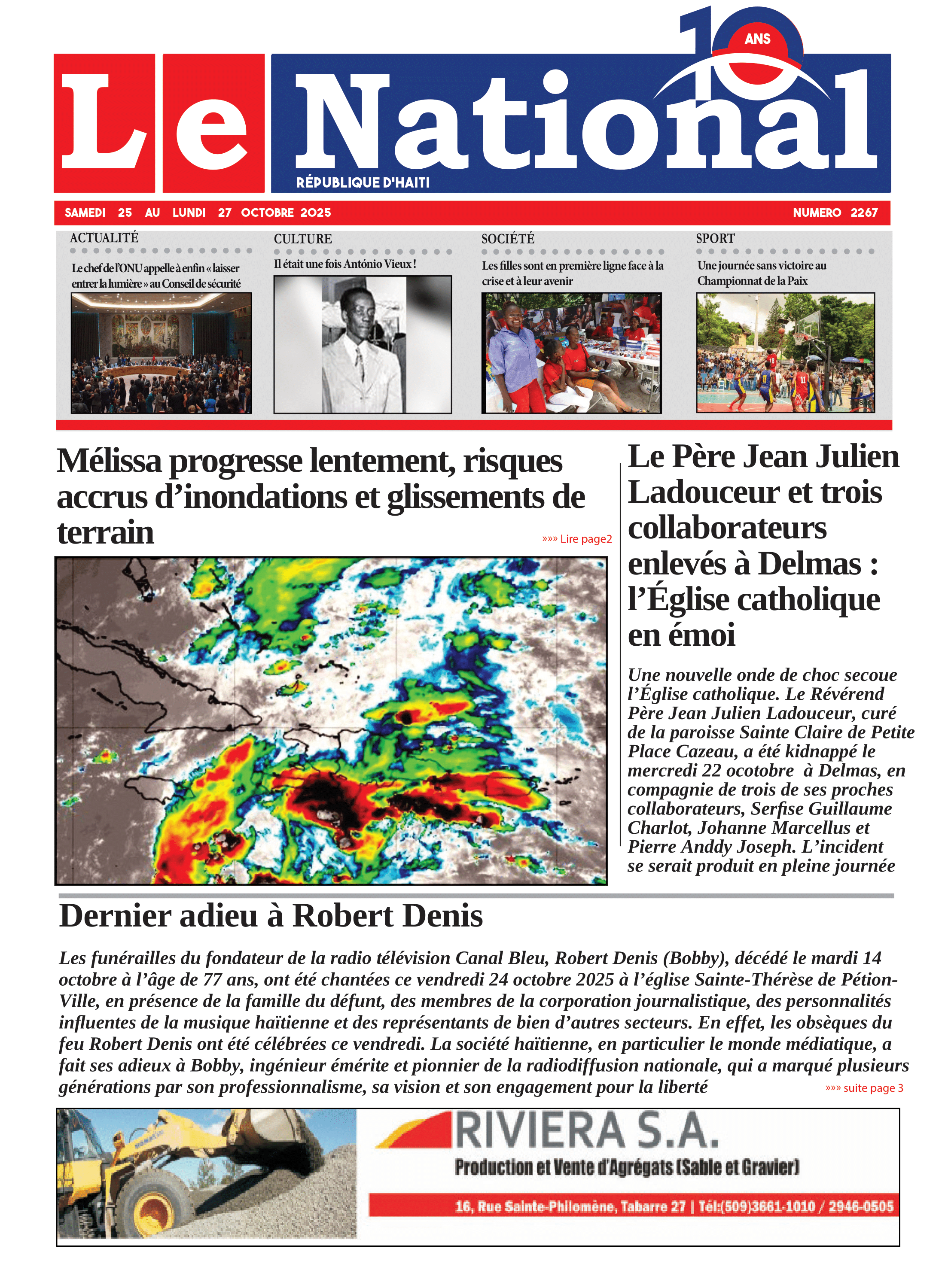Dans le cadre du Festival des Solidarités Internationales de la Ville de Lyon qui se tiendra les 21 et 22 novembre 2025, la création théâtrale « Rose, es-tu là » sera présentée autour des trajectoires de femmes confrontées à des tribunaux religieux ou des diagnostics psychiatriques, et qui montrent que les différences, entre tabou et idées reçues, font toujours aussi peur. Retour sur l’entretien avec l’artiste peintre et autrice de l’œuvre en question Agnès Pizzichetti Glele ?
DD : Présenter en quelques lignes l'ouvrage et le personnage central ?
AP: La pièce de théâtre « Rose, es-tu là ? » est une adaptation de mon roman « Au bois de Rose » réédité chez Matrem Editions (2018). Ce récit retrace la vie de mon arrière-grand-mère qui était spirite à Lyon entre les années 1920 et 1930. Du plus loin que je m’en souvienne, son histoire a toujours été nimbée de mystère, de gêne, voire de honte…
Autour d’elle, évoluent Auguste, un mari moralement démuni face à la pression d’un patriarcat représenté par le prêtre et le médecin qui lui demandent de contrôler une épouse qu’il ne comprend pas. Ainsi, face à l’autorité religieuse qui condamne injustement pour faire taire Rose spirituellement trop libre et face à un représentant de la science qui se trouve des réponses rassurantes mais fausses en pathologisant les pratiques de Rose, Auguste n’est pas plus soutenu par une famille et un voisinage à peine sorties des traumatismes de la Première Guerre Mondiale. Le roman propose une version de l’histoire délibérément écrite du côté de Rose, ouvrant une troisième voie : celle de l’histoire d’amour entre Rose et un être invisible.
DD: Pourquoi un tel hommage et quel message pour les générations actuelles et futures ?
AP: Il s’agit bien d’un femmage, en effet. Dans ma famille, on ne parlait jamais de Rose, sauf sur un ton feutré et condescendant. Elle faisait pitié ou peur, notamment à cause de sa mort tragique et inexpliquée, à l’époque comme aujourd’hui : cet univers fut un terreau fertile pour une arrière-petite-fille en perpétuelle et irrépressible quête de sens. Folle ? Envoûtée ? Il fallait que je retrouve la mémoire et le secret de celle qui fut tôt et vite remplacée au côté d’Auguste.
En m’appuyant sur les quelques bribes de souvenirs rarement répétés par ma grand-mère qui n’a pas eu le temps de connaître sa mère (elle est la fille unique de Rose), à travers les non-dits d’une famille engoncée dans une morale étriquée et ancrée dans une tradition lyonnaise taiseuse, en triant préjugés et incertitudes, j’ai reconstruit une partie de la mémoire qu’il me manquait. Enthousiaste, inspirée, en communion transgénérationnelle, pendant toute l’écriture du récit, il m’a semblé qu’elle me dictait tendrement l’impensable à mon oreille. Ainsi, dès les premiers instants de son existence, jusqu’aux derniers, j’ai écrit son histoire avec le parti pris de restituer justice et vérité, pour elle comme pour moi sans doute...
DD: Comment les concepts tels qu’histoire et mémoire pourraient-ils se transformer en un miroir symbolique pour les lecteurs et spectateurs ?
AP: Écrire sur une existence écartée du souvenir familial, ce n’est pas seulement faire œuvre de mémoire. C’est un acte fondateur de son identité personnelle et sociale. Connaître son histoire familiale, c’est savoir d’où l’on vient, comprendre comment nos valeurs, nos idées et nos comportements ont été façonnés. En explorant l’existence de mon arrière-grand-mère, cette inconnue pourtant si familière, m’a permis de prendre conscience des périmètres mouvants de mon inconscient, de mettre en évidence cette blessure transgénérationnelle muette, de tisser une loyauté invisible. Prendre conscience de ce que mon ancêtre a dû surmonter, m’a inspiré force et courage pour m’affirmer sincèrement, librement.
En mettant des mots sur l’existence de cette femme mystérieuse, en étant sa voix, c’est la compréhension de mes propres choix et de mes décisions que j’ai pu éclairer. Ainsi j’espère que les lectrices et les lecteurs seront touchés par ce sentiment de nécessité de transmission intergénérationnelle de valeurs, de repères et de tradition à la condition expresse qu’elles construisent les fondations d’une vie et qu’elles ne soient pas intoxiquées du repli sur soi, du sexisme ou du racisme.
Car transmettre, c’est aussi prévenir, lutter contre la répétition des erreurs du passé, tant du point de vue personnel que sociétal. A travers l’histoire de Rose, c’est aussi tout un pan de la réalité de la santé mentale des femmes dont il est question. Sous l’angle de la pathologisation de la spiritualité, à travers une narration que j’ai voulue sensible, sensuelle et immersive, j’interroge les mécanismes de pouvoir, les croyances populaires et les formes de résistance face à la misogynie.
La spiritualité des femmes a toujours été suspecte : les femmes ont longtemps été exclues des fonctions spirituelles des religions monothéistes, alors que les traditions anciennes évoquaient des déesses, des prêtresses, des femmes prophétisant, autant de femmes spirituellement puissantes effacées de l’histoire ou réinterprétées sous le prisme masculin pour en dompter l’influence. J’ai tenté de tisser un lien entre mémoire collective, spiritualité et santé mentale, tout en résonnant avec des enjeux contemporains comme celui des inégalités flagrantes en matière de santé mentale, les femmes étant plus touchées que les hommes.
La création théâtrale « Rose, es-tu là » présentée lors du Festival des Solidarités Internationales de la Ville de Lyon les 21 et 22 novembre 2025, explore les trajectoires de femmes confrontées à des tribunaux religieux ou des diagnostics psychiatriques, et montre que les différences, entre tabou et idées reçues, font toujours aussi peur.
DD: Quels sont les principaux matériaux utilisés pour fabriquer une telle œuvre multidimensionnelle ?
AP: Le roman et la pièce de théâtre qui en a été tiré, utilisent la mémoire de faits réels intimement mêlée à une part fictionnelle, le tout au service des amnésies, de non-dits, qui jalonnent l’existence de Rose. Je me suis appuyée sans restriction, sur les réminiscences sensorielles provoquées par ces lieux de mon enfance, par des photos énigmatiques surgies de tiroirs quand on vide les commodes des défunts, par des sons et des parfums d’une rue, d’un bord de rivière…
En face de mon bureau, j’ai installé le seul portrait Rose qui doit exister. Il m’interroge quotidiennement, doucement, humblement mais sans jamais baisser le regard, me guidant vers ma propre introspection grâce à la douceur inspirante de son regard. Rose m'a-t-elle hantée pendant l’écriture du récit ? J’en suis certaine. De même que je suis certaine qu’elle veille encore, tout prêt.
DD: Quels sont les ponts qui peuvent relier l'essentiel de cette œuvre avec d'autres cultures lointaines ou proches, à travers la formulation de cette question « Rose, es-tu là ? » ?
AP: Le spiritisme de Rose et le vodou, bien que très distincts tant par leurs origines que par leurs pratiques, ont vocation à dialoguer avec le monde invisible : le vodou interpelle les esprits (les Vodoun ou les Lwa), le spiritisme communique avec les défunts. Mais sous l’angle des ancêtres, ces deux spiritualités les considèrent comme des guides à qui demander conseil et protection. On assiste actuellement à une réappropriation du sacré.
Après des périodes où la science a remplacé l’intuitif et la croyance par la raison, où la colonisation a pillé les biens sacrés et les esprits en interdisant les cultes locaux, après des mouvements d’émancipation féministe qui ont rejeté les religions comme outils d’oppression sur les femmes, les femmes développent partout dans le monde des pratiques spirituelles alternatives (chamanisme, méditation, rituels, cercles de femmes…) qui échappent aux normes religieuses. Redevenues actrices de leur propre développement, les sorcières sont désormais présentées comme des icônes de sororité, dédiabolisées symboles de liberté, d’autonomie et de puissance sociale même si la chasse aux sorcières perdure dans certaines sociétés traditionnelles dans le monde.
La passerelle la plus évidente que je constate, est cette idée de résistance culturelle qui imbibe le spirituel, dans un monde incertain, dangereux et clivant, qui offre des espaces « horizontaux », des refuges aux exclus, aux laissés pour compte des sociétés libérales ou/et en guerre.
En conclusion, si Rose transmet un message aux lectrices et aux lecteurs d’ici et d’ailleurs, c’est celui de la défense sans faille de nos imaginaires, de nos désirs, de nos identités singulières et de nos héritages invisibles. Elle nous souffle à travers ses incantations silencieuses que la spiritualité doit être cet espace de résistance intérieure, face à l'uniformisation imposée par la mondialisation. Rose nous convoque pour que nous renouons avec nos mémoires enfouies ! Préservons la diversité de nos formes de sagesse multiples afin que le marché global ne les annihile jamais !
Propos recueillis par Dominique Domerçant