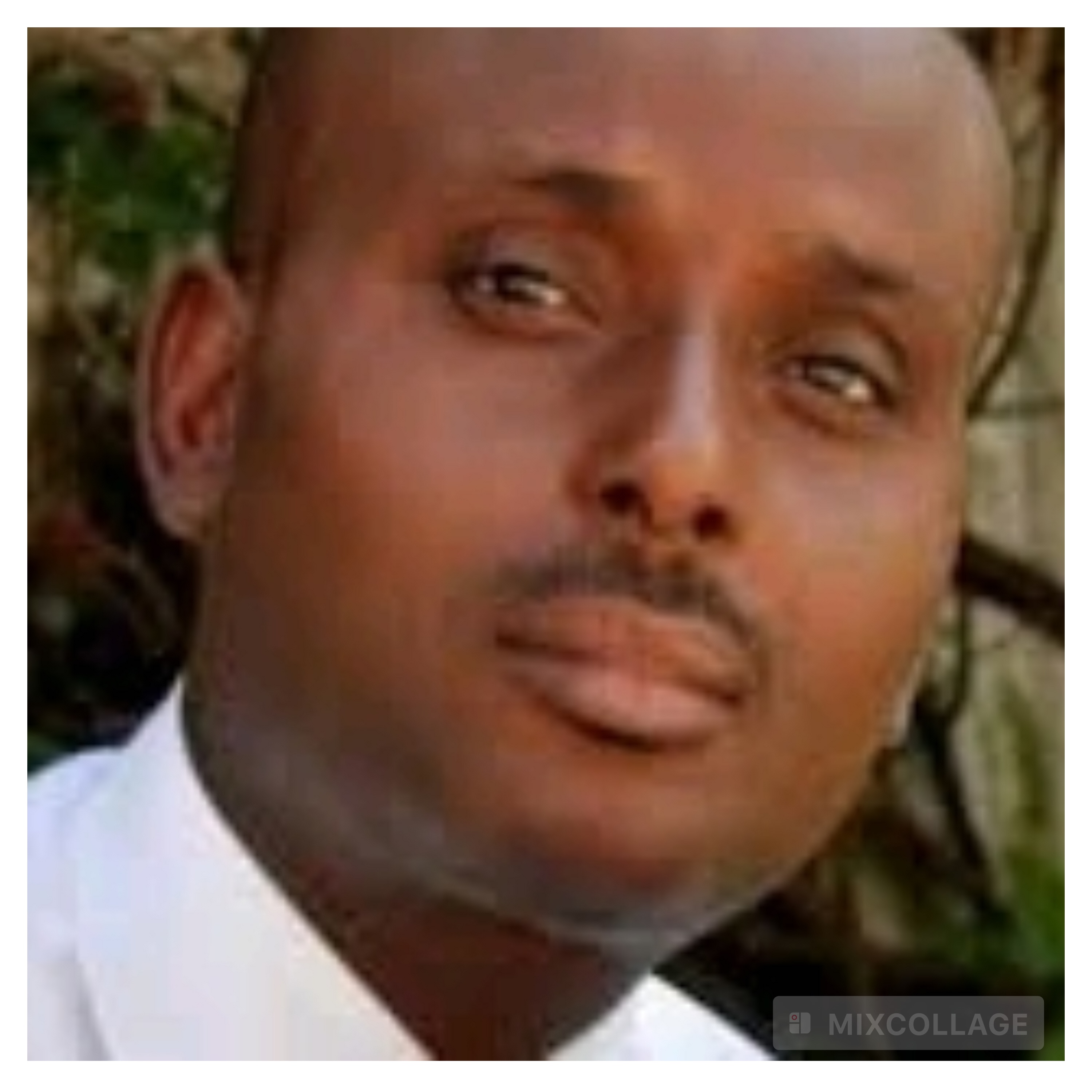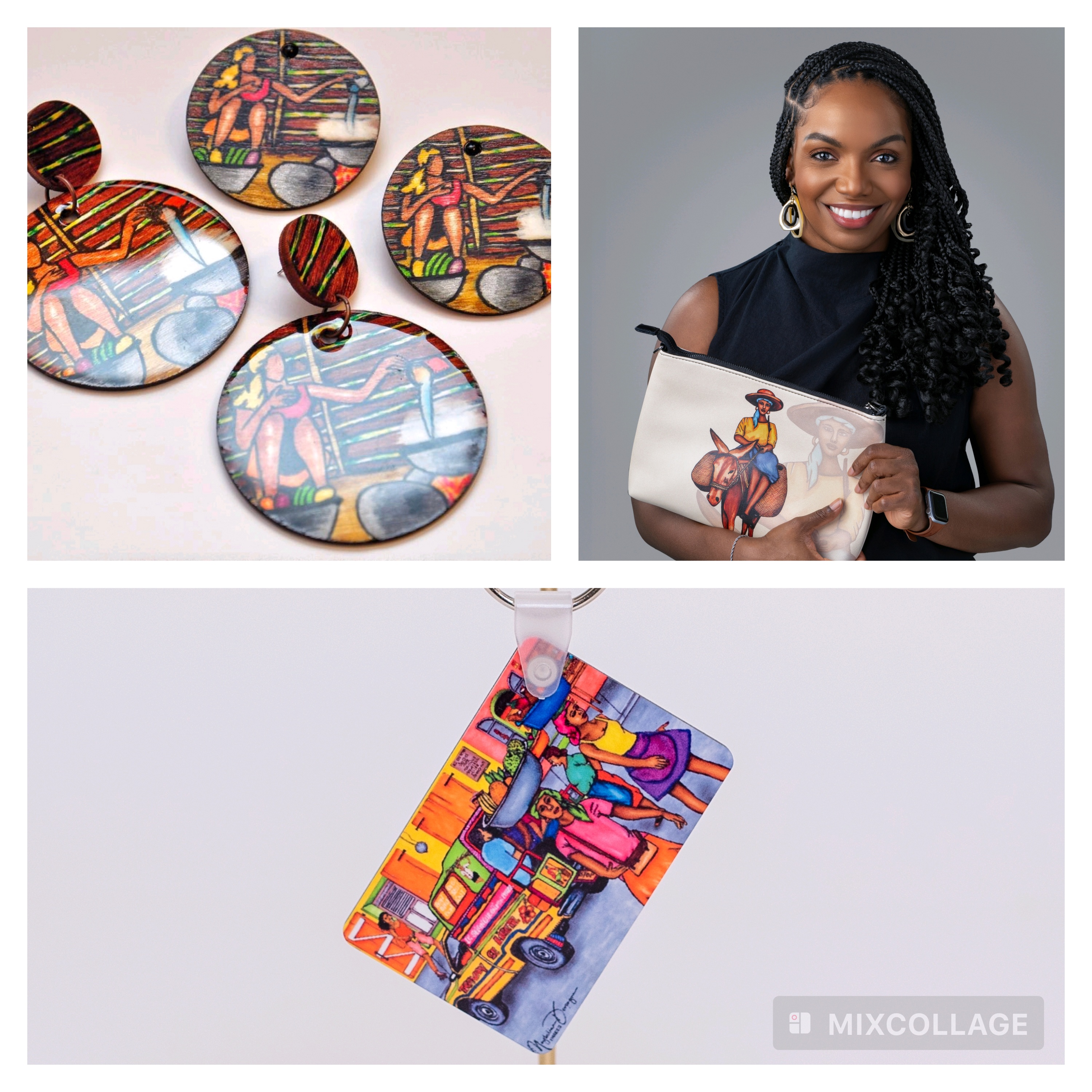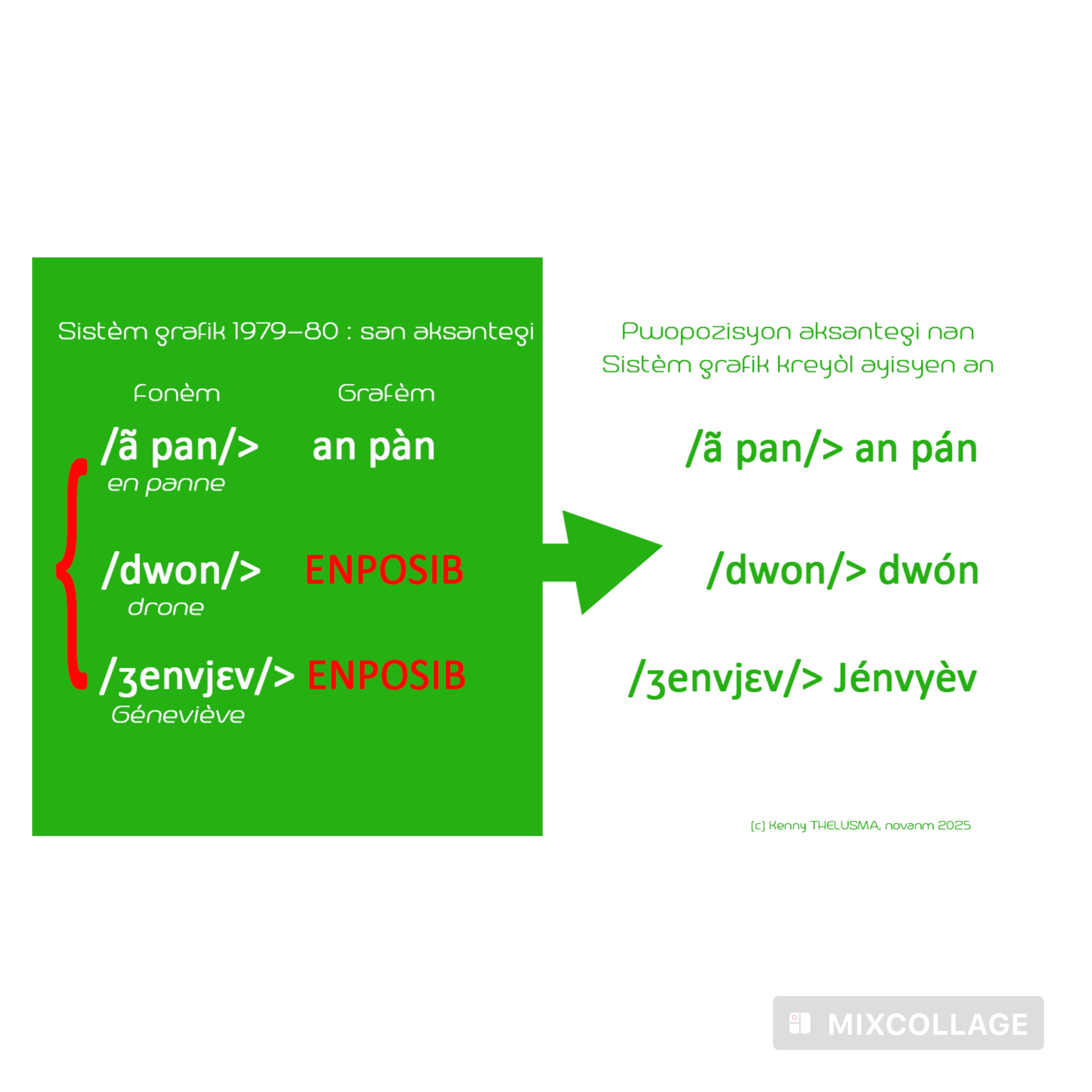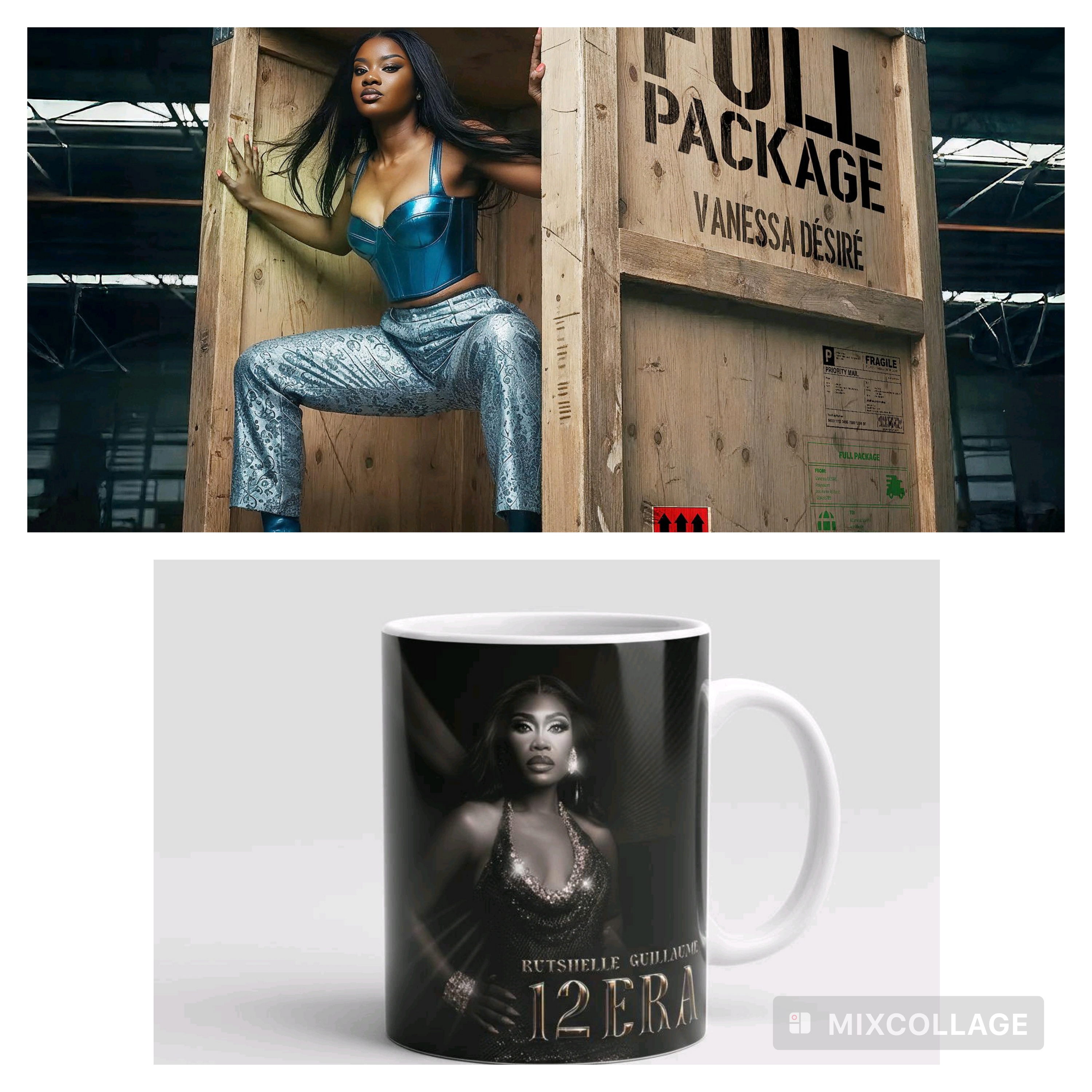Depuis 1987, au lendemain de l'avènement de l'ère démocratique en Haïti et jusqu'en 2025, l'Etat haïtien, les élites et les masses, la société civile et les partis politiques et une partie des représentations diplomatiques et des organisations internationales accréditées en Haïti, continuent de s'investir dans l'organisation des élections à tous les postes électifs, à chaque occasion. A chaque fois, on a l'impression que le pays fait son premier pas dans la démocratie ?A chaque nouvelle planification des élections en Haïti, on a l'impression d'assister à une première fois ? Et si ce grand mal politique était avant tout lié à une absence de culture de la mémoire électorale ?
Dans l'histoire politique contemporaine de la nation qui s'apprête à commémorer ses 222 ans d'existence le 1 janvier 2026, les campagnes électorales comme partout ailleurs, sont souvent marquées par des discours passionnés, des promesses de changement et une mobilisation intense des masses. Pourtant, un acteur discret mais potentiellement stratégique reste largement sous-exploité : la culture de la mémoire qui se traduit par l'un des meilleurs gardiens, le musée.
Dix ans après la publication de l'ouvrage : "Pouvoir politique et responsabilité culturelle", en 2015. Deux ans après, en février 2017, j'allais offrir un exemplaire à l'ancien président nouvellement élu à l'époque Jovenel Moïse. Dans l'après midi après les funérailles du père de ce dernier, dans le plus célèbre restaurant de la ville du Cap-Haitien, j'avais une fois de plus soulevé encore une fois, le sujet de la problématique de la culture de la mémoire dans le pays, avec l'un des influents conseillers de ce dernier, Guichard Doré.
Dommage cet ancien président assassiné, dont le pays ne dispose pas de manière officielle les archives et la mémoire de ces deux années de campagne électorale, à la fois comme souvenir et comme objet d'études et de thématique d'exposition pour les prochaines élections et pourquoi pas pour la prochaine administration présidentielle, en se demandant si l'assassinat du chef de l'Etat n'avait pas été signé le jour ou il a choisi d'assumer cette candidature, tout en sachant que la résistance au changement dans ce pays a la vie dure ?
Dans le même sens que la chute de Jean-Bertrand Aristide en février 2004, avait été scellée depuis les contestations des élections de mai 2000 ; Et qui sait, si le coup d'état du 29 septembre 1991 n'était pas l'aboutissement de l'attentat du 5 décembre 1990 ? A travers une exposition autour de la mémoire électorale et politique durant les quarante premières années sous le vocable de la démocratie, il sera certainement possible d'éduquer les nouvelles vagues de candidats improvisés et les jeunes qui souhaitent s'investir dans la politique dans ce pays.
Dans les engrenages de la mémoire électorale, les candidats autant que les chefs d'Etat et les membres de leurs partis doivent apprendre et comprendre l'importance et la place stratégique de la culture. Pour gagner les élections en Haïti, il faut inévitablement disposer au sein de son équipe des acteurs qui maîtrisent la culture électorale dans toutes ses dimensions, ses composantes et ses opérations avant, pendant et après la journée du vote. La seule mobilisation des partisans et les menaces ou hostilités lancées sur les médias sociaux ne feront pas gagner les élections.
Dans ce cadre conceptuel, il y a lieu de rappeler que la muséologie électorale désigne l’intégration des musées dans les dynamiques électorales, non comme outils de propagande, mais comme espaces de médiation citoyenne, de mémoire politique et de débat public.
Dynamique, éducative et constructive, cette approche repose en particulier sur l’idée que les musées peuvent contribuer à la formation civique, à la compréhension historique des enjeux politiques et à la légitimation des institutions démocratiques.
Dans un contexte où la légitimité démocratique est fragile et où l’histoire nationale est souvent instrumentalisée, penser une « muséologie électorale » revient à interroger le rôle que peuvent jouer les institutions muséales dans la formation de l’opinion publique, la valorisation du patrimoine politique et la consolidation de la démocratie. Cette publication vise ainsi à explorer les possibilités, les limites et les implications d’une telle approche en Haïti.
Les musées peuvent-ils devenir des lieux de débat électoral sans perdre leur neutralité ?
Deux questions clés parmi d'autres pourraient nous aider à comprendre le sens de cette démarche, en se demandant pourquoi et comment : Les musées peuvent-ils devenir des lieux de débat électoral sans perdre leur neutralité ? Comment éviter l’instrumentalisation politique du patrimoine ?
Du nombre des publications et des thématiques utilisées par le Conseil international des musées (ICOM), durant les dernières décennies, on retient que: « les musées ont le pouvoir de transformer le monde qui nous entoure », et qu’ils sont également reconnus comme des lieux de « découverte incomparable » et de « renforcement de la communauté par l’éducation »
Dommage pour le paysage muséal haïtien, partagé entre la mémoire, la marginalisation et le potentiel isolé, face aux catastrophes naturelles et humaines, entre le séisme de 2010 et les violences urbaines et le terroriste qui contraignent ces institutions patrimoniales à la fermeture depuis 2023. On comptait plusieurs musées importants, dont le Musée du Panthéon National Haïtien (MUPANAH), le Musée Ogier-Fombrun, le Centre d'Art, le musée du Bureau national d'Ethnologie, le Musée d’Art Haïtien du Collège Saint-Pierre, le musée Nader, le musée Wallace, le musée de Limbé, le musée Georges Liautaud, et le dernier en date, le musée des Femmes d'Haïti inaugurée en décembre 2020. Ces institutions conservent des artefacts liés à l’indépendance, à la révolution haïtienne et aux figures politiques fondatrices, contemporaines et de riches collections de toutes sortes.
Détruits, abandonnés, délocalisés ou décapitalisés dans la majorité des cas, les musées haïtiens se trouvent dans une situation critique, par le manque de financement, la faible fréquentation, les infrastructures fragiles et l'absence de politique culturelle cohérente. Malgré cela, leur potentiel éducatif et symbolique reste immense. Pratiquement, Jean-Claude Duvalier et Jean-Bertrand Aristide restent les deux seuls anciens chefs d'Etat qui ont investi dans la création de musée en Haïti depuis 1983 à 2025.
Duvalier et Aristide, les derniers présidents haïtiens à créer des musées dans le pays ?
Duvalier a laissé au pays le MUPANAH, tandis que Aristide a créé le Musée de la Restitution, détruit dans les heures qui suivent son deuxième départ pour l'exil, en mars 2004. L'initiative de l'administration Martelly d'ignorer un espace de mémoire au sein de la Citadelle du roi Christophe ne peut en aucun cas s'inscrire dans une contribution innovante ou inédite dans l'histoire de la politique haïtienne. Il en est de même pour les travaux de réaménagement du Champ de Mars, incluant l'élévation de la statue de l'Empereur Jean-Jacques Dessalines pendant le deuxième mandat du président Préval, ne représentant qu'une simple action esthétique et symbolique, encore moins historique.
De nombreuses questions restent encore sans réponse : ou sont passées les collections de ce dernier musée ? Qui sont les responsables de la destruction de ces biens culturels ? Quelles sont les rares occasions ou les passifs et actifs culturels de certaines personnalités politiques sont utilisés lors des élections en Haïti ? Que reste-t-il de la mémoire électorale en Haïti, comme archives des affiches, aux urnes et aux bulletins de votes, aux maillots et aux communications électorales ?
De l’UNESCO, on retient que « la culture joue un rôle central dans la vie haïtienne, à la fois économiquement et socialement » et qu’elle peut être « un moteur de reconstruction », à travers les discours et les rapports. A travers le cas qui nous intéresse autour de la muséologie électorale, on pourrait se demander : Pourquoi les musées haïtiens sont-ils absents des stratégies électorales ? Comment les intégrer dans les politiques publiques de manière durable ?
Dans cette nouvelle ère électorale qui prend sa source dans le vacarme des médias sociales de nos jours, à travers laquelle les opinions parfois menaçantes de la majorité, se limitent au fantastisme creux et aveugle, sans aucune base mémorielle tant sur la culture politique et la mémoire électorale, pour conforter certains arguments et des choix politiques, on pourrait se demander s'il n'y a pas lieu d'offrir le rapprochement entre les musées et les campagnes électorales en Haïti, dans une perspectives d'éducation civique, politique et électorale des masses. Quelles synergies possibles ?
Devant un tel tel, on doit rappeler à qui veut l'entendre, à la fois aux critiques et aux esprits coincés, que les musées peuvent organiser des expositions thématiques sur l’histoire électorale, les constitutions, et les figures politiques. Il peut également, en parallèle accueillir des forums citoyens, des débats entre candidats et des ateliers de sensibilisation. A travers les collections thématiques, les musées peuvent autant valoriser les figures historiques dans les discours électoraux, en lien avec les idéaux, les problématiques et les valeurs de la République.
Dans un autre sens, on ne pourrait ne pas prendre en compte les points faibles d'une telle démarche, en termes de risques à prévenir, comme l’instrumentalisation du patrimoine à des fins partisanes, qui pourrait nuire à la crédibilité des musées.
De la nécessité de se questionner sur l'utilisation des musées comme lieux de campagne sans compromettre leur mission première éducative ? Face à la destruction des vies et des villes en Haïti, qui participe du même coup à la destruction des biens culturels et du patrimoine national dans toutes ses composantes, quels sont les femmes et les hommes politiques, parmi les partis politiques et les futurs candidats aux prochaines élections qui prendront la peine de proposer un agenda de politique culturelle cohérente, qui prendra en compte la problématique muséale dans leur programme ?
De nombreuses considérations, des propositions et d'autres recommandations ont ete formulées au cours des dernières annees, en particulier dans les conclusions des actes des Assises nationales de la Culture en Haïti, en juillet 2011, et à travers de nombreuses publications, des rencontres, conférences et colloques.
Vers une stratégie muséale pour la démocratie haïtienne ?
Dans l'intérêt de la nation et des biens communs qui symbolisent sa fierté et sa grandeur, à travers les différentes institutions publiques, incluant la machine électorale, on ne pourra passer outre de principales propositions capables de : Créer un partenariat entre le Conseil Électoral Provisoire et les musées pour des campagnes d’éducation civique ; Intégrer les musées dans les programmes scolaires pour renforcer la culture démocratique ; Impliquer les jeunes dans des projets muséaux participatifs liés à l’histoire politique.
D'une pierre à plusieurs coups, il sera possible d'offrir une meilleure place pour la culture dans les prochains débats électoraux, sur la sécurité, les crises économiques, politiques et environnementales dans le pays à travers des questions clés : Comment les musées peuvent-ils devenir des acteurs de la démocratie participative ? Quel rôle pour les présidents haïtiens dans la valorisation du patrimoine ?
De la culture politique à la mémoire politique pour réussir sa campagne et occuper les plus hautes fonctions au sein du pouvoir en Haïti, jusqu'à marquer son passage, matérialiser ses promesses de campagne, et laisser un héritage réel et symbolique dans la mémoire collective, seule la culture, dans toutes ses composantes linguistique, mémorielle, anthropologique, sociologique, artistique, créative, psychologique et mystique, finit par triompher.
De la nécessité de repenser la citoyenneté par le prisme du musée. La muséologie électorale en Haïti n’est pas une utopie, mais une voie innovante pour réconcilier la mémoire, la culture et la démocratie. En valorisant les musées comme espaces de dialogue et de formation civique, Haïti peut renforcer sa démocratie et offrir à ses citoyens une compréhension plus profonde de leur histoire politique.
Dominique Domerçant