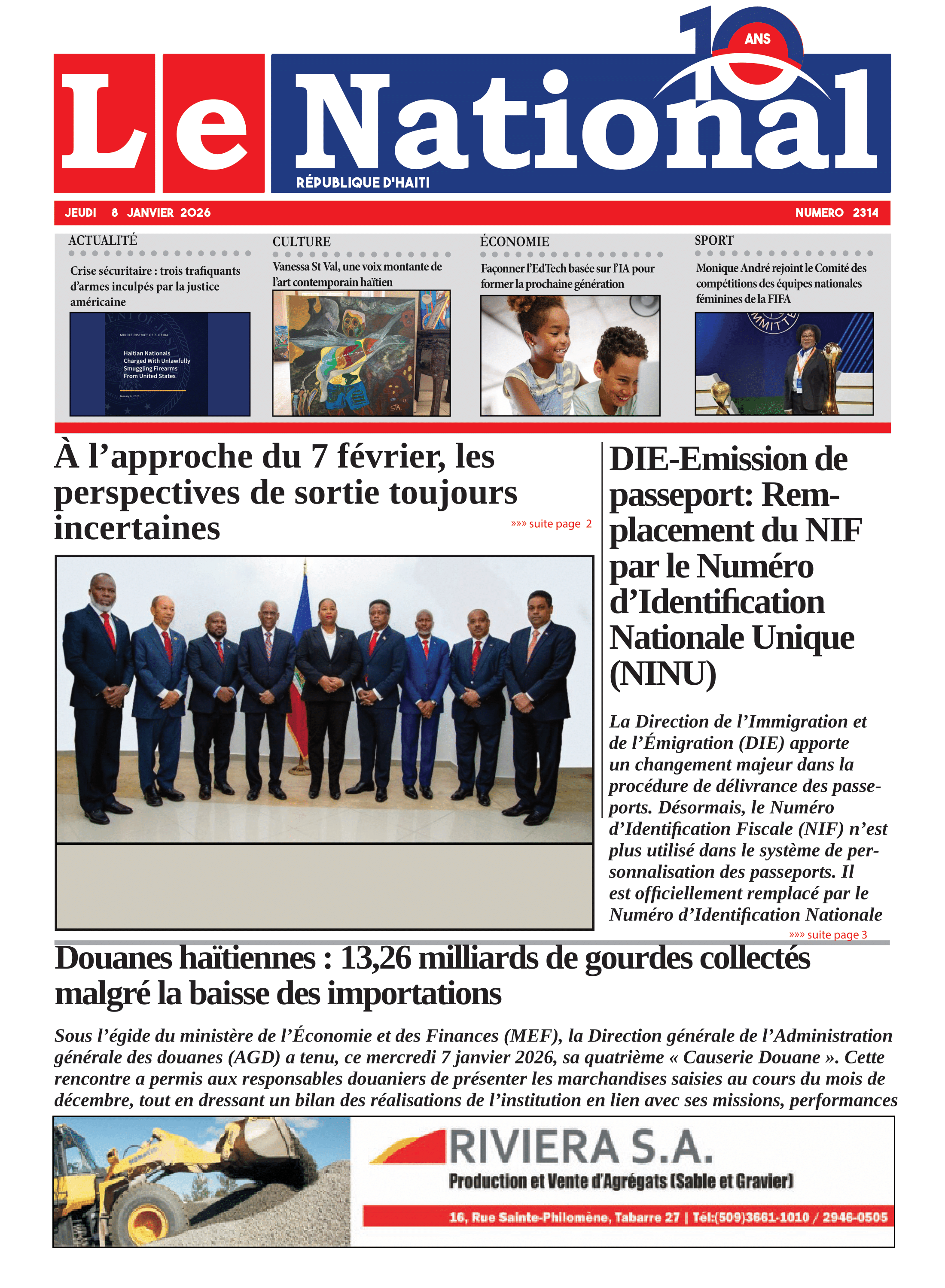(3e partie et fin)
Par Jean-Rénald Viélot
Auteur d’un poème d’amour titré ’’Ha llegado el invierno y tu no estas aqui’’, (1945) était dédié à Magda à leur cinquième année de fréquentation. Les tristes présages que lui donne le seul titre du poème ne sont que trop vérifiés en ce moment particulier. Très vite il fit la connaissance d’une jeune géologue, avec qui la relation ne semblait pas être de la plus grande innocence et dont le père, un richissime, travaille pour l’ONU à la place Trocadero. Depuis 1946, l’année de ses noces avec Magda Castañer, c’est la première fois qu’on voit José Maria en si galante compagnie, alors que sa femme n’était pas loin dans la ville lumière. Etait-ce aussi là cette conceptualisation tellement vaste du produit appelé horizons vastes par le romancier? Dans l’idée de résoudre cette « question » et d’autres questions relevant de circonstances atténuantes, entre en scène une démarche de sa part auprès de la maison Flammarion, laquelle fera que soit traduit en français par un nommé Francis de Miomandre le manuscrit de son deuxième roman La marea, qu’il avait apporté à Paris. Copie qui ne sera pas prête avant l’année 1949, bien trop long temps pour quelqu’un qui veut sortir d’embarras. L’un des premiers admirateurs de Paris succombant à son charme, Gironella écrit : Todo lo que habia imaginado era cierto : en Paris habia un alma antigua en cada ventana. !Y gatos ! … Y hombres en calles estrechas, con sacos de botellas vacias a la espalda… Aquella ciudad era mi meta. En ella seria feliz y escribiria un libro inmortal.
Nous sommes en 1949, il doit encore s’écouler quatre autres années pour la parution de Los cipreses creen en Dios, son œuvre maîtresse, et José Maria cherche et accepte à Paris des petits boulots bien pire, que ceux qu’il avait dans son pays. Ce ne fut pas seulement une entreprise liée à la question des besoins primaires, mais aussi tertiaires dont dépend l’écriture de cette œuvre dont il dit qu’elle serait immortelle et qui devrait aussi contribuer à éveiller l’intérêt pour la production littéraire espagnole du moment. Intérêt qui, après avoir été provocant par moment avec les écrits des meilleurs écrivains espagnols, était sur l’heure modeste par le fait même d’un pays jusque-là toujours en ébullition, Baltasar Porcel ne nous le fait pas dire avec son livre La revuelta permanente, et qui pouvait continuer à l’être davantage avec Francisco Franco, n’eut été l’habile cohabitation de Son Altesse Juan Carlos. Celui qui a sauvé et sauvegardé la démocratie espagnole.
La traduction de son livre confiée au bon soin de la maison Flammarion a comme tout autre entreprise fonction de faire avancer le projet d’écriture de son prochain roman et avait commencé à porter ses fruits. En plus d’avoir croisé des gens pour le moins étrange (intellectuels, bohémiens, homosexuels), une rencontre inattendue apporta de grands allègements à sa mauvaise situation économique. En la personne d’un élégant écrivain du nom de Fernand Hayward, un célibataire, spécialiste des livres religieux (un des biographes de Pie XII), qui partait souvent pour de long voyage, lui permit d’habiter pendant longtemps (sans bourse délier) sa maison de l’Avenue de Villiers au numéro 74. Le signe le plus assuré du vrai contentement de José Maria Gironella est la bibliothèque de plus de huit mille titres qu’il y trouva, la majorité étant d’auteurs français.
Pour se préparer à l’écriture de ce roman, et brulant de toutes les ardeurs religieuses d’antan, quoique les flammes devenaient au fil du temps vacillantes, José Maria fera un pèlerinage aux lieux réputés saints à Paris, cherchant l’inspiration. Il visite les cimetières de Passy, Père Lachaise, Montmartre, les maisons (le biographe se tut sur le nombre) où vivaient les grands écrivains français. Là, il laissait mûrir en lui l’idée conçue durant son embrigadement, « el alistamiento » (service s’apparentant à celui du service militaire auquel il fut astreint un temps en Espagne). Il tâchera de raconter la guerre civile de l’Espagne, de manière la plus impartiale et exhaustive possible (sous forme d’une trilogie qui reflète les causes, le conflit et le dénouement), se disait-il. Pour cela, toutes les familles espagnoles seront symbolisées en une seule ; toutes les villes en une : Gerona, et toutes les tendances politiques, parce que le mot avant-garde n’a pas cessé d’être à la mode depuis le temps où il se déconnectait des cénacles de Madrid. Le terme dépasse ainsi sa propre définition ; être comme des cercles concentriques c’est aussi une posture d’avant-garde.
Enrichi par la production littéraire de son pays, quoique se trouvant à Paris, le processus suivi par la narrative gironélienne durant ce temps de résidence ne résulte pas difficile à préciser. Pour doter la trilogie d’une certaine cohérence, il doit recourir à une référence connue, que les écrivains et lecteurs espagnols peuvent départager : les deux courants de pensées politiques en présence lors de la guerre civile constituent cette référence. Durant un temps, alors qu’il était dans le métro, Gironella, en bon équilibriste, eut une lueur d’intelligence dans le regard, laissa tomber le titre Las dos orillas - assez suggestif - pour lui préférer Los cipreses creen en Dios, un titre avec nuance de jugeote, qu’il trouve plus approprié pour décrire le « drame » espagnol. Il convertit ainsi cette narrative en une manifestation de la pensée légendaire, en pénétrant les strates profondes du réel où se produisait la rencontre avec quelque chose éloigné de l’espace et du temps, avec des structures ignorant peu ou prou les particularités d’un quelconque pays. L’épaississement de tels projets (celui qui culmina dans Los cipreses creen en Dios) obtint un succès phénoménal de sorte que le réel merveilleux et le réalisme mythique parurent définitivement associés à la narrative pas seulement espagnole, sinon universelle. « (…) Niña… ! !Que estoy cansado de pagar recargo de solteria ! ». A una le susurro inclinandose hacia su oido : - ?Te vienes conmigo, chachi ? Ignacio le advirtio : - Vete con cuidado, que esto no es Madrid. -!Bah! Todas las mujeres son lo mismo aqui y en Pekin ».
Assis sur un banc du Bois de Boulogne, José Maria décide de créer la famille protagoniste : les Alvear. Ces derniers seront un fac-similé de sa propre famille. Matias et Carmen (les parents) seront les siens ; il sera lui-même Ignacio ; Pilar, sa sœur Concepción, et le mystique Cézar, presqu’un visionnaire, sera un mélange de sa sœur Carmen et d’un père claretiano qu’il connut. Il n’y est pas fait mention de Juan, son frère ainé, qui était pourtant d’un commerce agréable avec l’auteur.
Les matériaux essentiels devant favoriser l’écriture de ce roman en préparation étant déjà en place, sauf qu’il manquait à José Maria quelque chose d’important: l’appui intellectuel. L’écrivain, en dépit d’avoir déjà démontré un certain talent pour la narration, pour avoir déjà produit deux romans, savait qu’il lui manquait encore une formation de base ; de sorte que son témoignage puisse paraître plus fiable. Ses préparations en son étape parisienne abondent en allusions à de nouvelles rencontres - Jean Chuzeville, entre autres ; figure intellectuelle, sexagénaire, célibataire endurci, polyglotte, voyageur infatigable et connaisseur en prérequis de la création littéraire. En antécédents et indications de toutes sortes de son livre biographique, José Antonio Salso Suarez rappelait comment le travail de composition de Los cipreses creen en Dios mit particulièrement l’auteur de Un hombre et La marea (ses deux premiers romans) en contact avec quelques personnalités du monde littéraire. Sans doute Chuzeville fut l’un des contacts les plus étroits et représentait pour José Maria le maître, le guide le plus important, qui lui clarifiait les concepts, enseignait la charpente de la narration, la technique d’écriture du roman. En réfléchissant sur l’importance du travail de ce professeur et intellectuel francais, Gironella confesse :
‘’Monsieur Chuzeville, arquetipo del humanista francés, se
gano a pulso una incuestionable autoridad moral sobre mi, y confieso con alegria que le debo gran parte de cuanto pueda haber de diafano y seguro en mi manera de escribir’’. Je m’arrête sur un passage de ’’Los cipreses creen en Dios’’, fruit de cet enseignement programmé que je considère capital pour reconnaître ce qui y est lyriquement dilué :
(…) La entrada de José en Gerona fue triunfal. Acudieron a la estacion Matias e ignacio, y éste, con solo verle saltar del coche al andén, le admiro. Le admiro por una especie de espontaneidad que se desprendio de un salto, y luego porque le estrecho la mano con camaraderia, sin besarle en la mejilla, y porque de ningun modo permitio que ni él ni Matias le llevaran la maleta, maleta extraña, de madera, atada por el centro con un cinturon.
Carmen Elgazu, al ver aquella maleta, penso : « !Dios mio, tiene pinta de esconder un par de bombas ! », y no era la verdad. A menos que se consideraran bombas unas hojas de propaganda de la FAI y una cajita de preservativos.
‘’Préservatifs’’ : synonyme de la dynamique du désir, mais la possession d’une chose en donne des idées plus justes. Gironella dialogue avec ses nouvelles facultés intellectuelles en se servant même du terme même. Montrant à partir de ce moment, et à un plus haut degré, les facultés transcendantes que Joaquin, son père, fabricant de bouchon de liège, déployaient dans l’art de subvenir aux besoins la famille. N’est pas si différent le désir intellectuel, où l’on connait une pulsion identique. Seulement, le contraste associatif négatif (‘’la FAI’’) en relation aux périodes agitées antérieures signale l’organisation comme l’exportatrice de cette situation dramatique à laquelle il fait allusion par métonymie, en même temps sur le plan local qu’il signale la fin de l’ambiance festive créée au sein de la famille à l’arrivée de José chez sa tante Carmen. Il fait écho de cette multiplicité de perturbations de l’organisation anarchiste syndicale comme la fin de toute joie, de toute vie. Un des fragments de Un millon de muertos, le deuxième volume de la trilogie, reproduits José Antonio Salso Suarez, le biographe, est assommant en affrontant le thème, non de la « révolte permanente » titre d’un livre de Baltasar Porcel, mais celui des mutations permanentes que manifeste l’anarchiste, à travers ce court passage : ‘’(…) En Barbastro, un miliciano de Ascaso se presento en la carcel del pueblo para ver a su padre, detenido por carlista, y en cuanto lo tuvo delante le pego dos tiros’’.
Le troisième volume de la trilogie s’auto-représente comme d’éblouissants feux d’artifice mêlant aux étoiles leurs panaches de feu, sorte d’allégorie qui produit un écho diffus de ’’Ha estallado la paz’’, que Gironella publiait treize années après, juste avant qu’il n’entreprenne un long périple en Orient : Thaïlande, Vietnam, Formose, Philippines, Hong-Kong, Macao, Cambodge, l’Inde. Pourquoi l’aventure littéraire de José Maria Gironella ne s’arrêta pas avec ce troisième titre de la trilogie ? Est-ce une révolte contre sa propre révolte ? Nous ne ferons aucune évaluation des possibles réponses, si ce n’est que ses fins sens semblent percevoir une douleur de vide dans l’air sans les livres ; donc, il a continué d’écrire au-delà même de la succession à la Haute Magistrature de l’Etat en 1975.
En cette année 2025 si les espagnols faisaient une prospection sur leur démocratie du temps où elle pouvait avoir été sur un fil raide avant cette succession qu’entrevoyait l’auteur de Conversaciones con Don Juan de Borbon, et sa robustesse depuis, il se trouverait une figure de proue de très grande dimension dans l’architecture de cette construction, qui avait abdiqué à un moment pour permettre d’autres ajustements. Savoir se retirer à temps, même avant le temps est aussi un art, et plus qu’un art c’est du génie. Dans plusieurs livres de Gironella il y a un personnage qui porte un projet sensé, intellectuel démesuré. Comme ce personnage, Ignacio, qui avait la prétention de servir d’éclaireur à l’entiché José, un autre personnage de Los cipreses creen en Dios. « -Vete con cuidado, que esto no es Madrid ». Et quand il ne s’agissait pas de fiction, c’était tout simplement la réalité comme avec Joaquin, le père de Gironella, qui embrassait une mission (celle de sauver la vie de son fils José Maria) et qui pourrait garder des échos de discussions intenses en Espagne comme partout ailleurs sur la futilité des guerres, de la guerre civile en particulier.
« No debe haber guerra civil entre nosotros ».
Auteur de plus d’une vingtaine de livres desquels quelques-uns ont été récompensés par des prix littéraires, José Maria Gironella, est l’un des auteurs espagnols le plus lus de sa génération. Dans un papier que lui a consacree la gasette de Lausanne le 12 septembre 1954, on puvait lire : « Pour la première fois dans l’histoire de la littérature consacrée à la guerre d’Espagne, les causes et les débuts de ce grand drame sont rapportés dans un roman où l’auteur, sans prendre parti, laisse s’expliquer les hommes. Par là cette fresque magistrale dépasse le témoignage pour atteindre à l’objectivité du grand art ».
Jean-Rénald Viélot