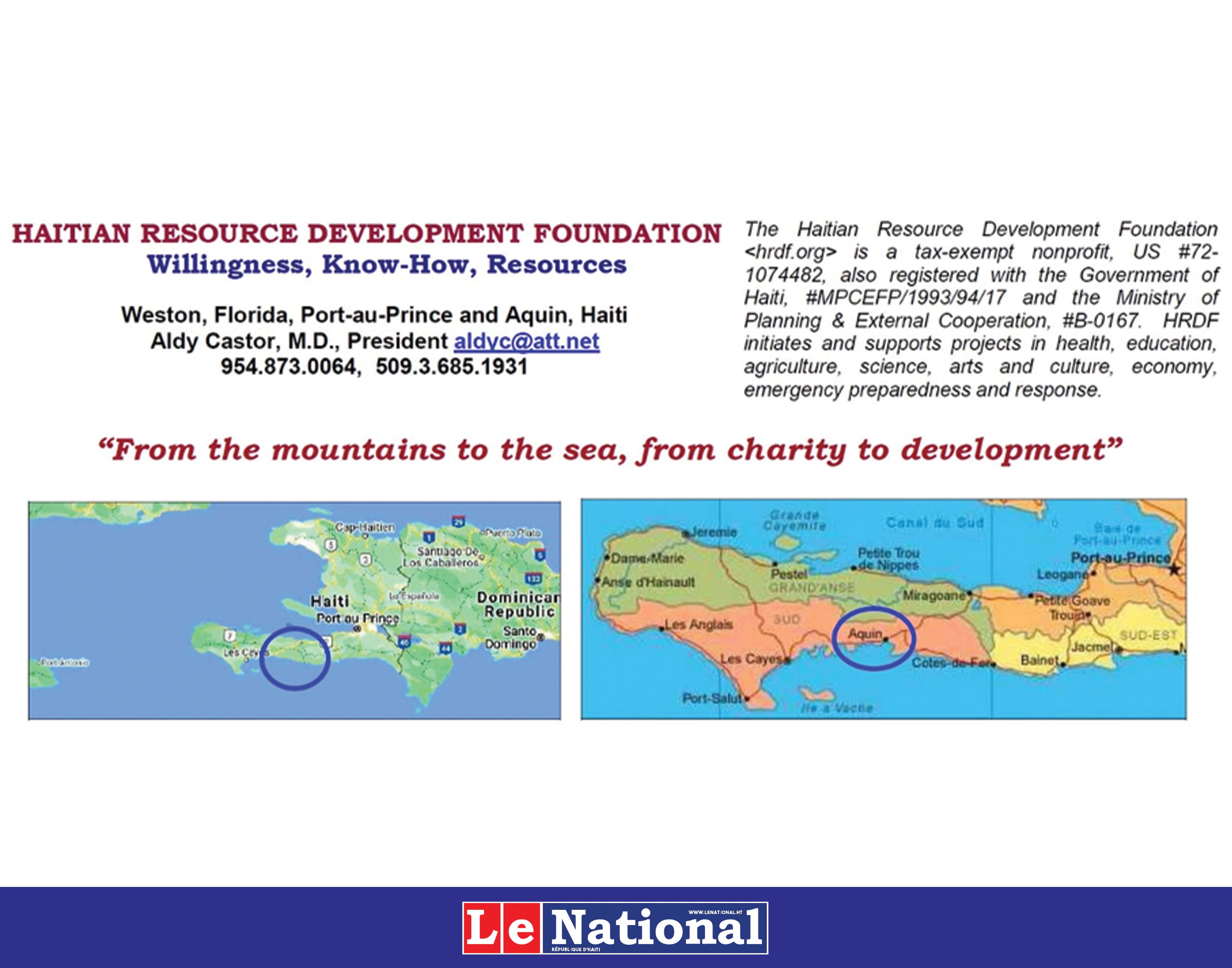Un Nobélisable est un scientifique, un politique ou un écrivain dont l’œuvre ou les accomplissements sont d’une telle portée qu’ils pourraient justifier l’attribution d’un prix Nobel. Par exemple, avant de décrocher le Prix Nobel de la Paix en 2006 en raison de son engagement dans l’entrepreneuriat social pour inciter à l’éradication de la pauvreté au Bengladesh, Muhammad Yunus a été pressenti à ce prestigieux prix plusieurs années avant sa nomination. À l’instar du titre MVP (Most Valuable Player) ou du Ballon d’or dans l’arène sportive, ce n’est pas au moment spécifique de l’octroi d’un trophée que l’on se surprend de son récipiendaire. En toute logique, le cumul des simples réalisations aux productions les plus complexes auxquelles se sont investis les aspirants sont des facteurs précurseurs à leurs apothéoses puis aux honneurs qui leur sont judicieusement réservés dans leurs champs respectifs. Par sa carrière scientifique notoire auréolée de gloires, son esprit de créativité et son impact académique au-delà des frontières associés à sa vertu humaniste et son engagement social, Samuel Pierre prouve qu’il a du sang Nobel qui coule dans ses veines. Nous tenons à étayer cette thèse d’un Pierre cheminant sur le même sentier qu’ont su emprunter les récipiendaires du Prix Nobel à travers quelques comparaisons et une esquisse de ses nobles réalisations.
Dans un ensemble de domaines et à des périodes particulières, un potentiel lauréat du Prix Nobel - de la paix, de l’économie, de la littérature, etc. - peut être prévisible. Suivant cette ligne d’idée, même si Daron Acemoglu avait attendu jusqu’en 2024 pour que le Prix Nobel d’Économie lui soit décerné, le projecteur a été longtemps braqué sur ses chefs-d’œuvre portant notamment sur l’automation et les institutions. Cela fait plusieurs années que des économistes avisés percevaient cet illustre professeur de la MIT comme un Nobélisable. Sur le plan politique par exemple, Nelson Mandela, un Nobélisable incontestable au cours de la décennie 1990, avait été guidé par une sagesse surhumaine pour réconcilier toute une nation avec elle-même. La poignée de main divine entre Nelson Mandela et Frederick de Klerk a eu la magie de faire taire les forces criminelles de l’apartheid en Afrique du Sud. L’humanité regorge de ces gestes inspirants qui sont dotés de la capacité d’hypnotiser les cœurs et les esprits jusqu’à les transformer au profit de l’intérêt collectif. Le pardon et la réconciliation possèdent ce pouvoir magnanime de guérir des plaies séculaires tout en créant une harmonie sociale favorable au développement économique inclusif.
Épris de cette vision de promouvoir l’inclusion économique et sociale, Samuel Pierre œuvre de manière dynamique dans la construction d’une société pacifique et prospère. Sans conteste, Samuel Pierre figure dans cette niche restreinte d’intellectuels au caractère polymathe dont la militance sociale et l’inestimable contribution au progrès scientifique les place au rang des Nobélisables. Pendant qu’il reste hyperactif dans le monde académique en publiant de profondes réflexions scientifiques et en contribuant à la formation d’une pléiade de chercheurs et cadres administratifs, Samuel Pierre fait un grand impact dans le panorama social. À travers moults projets, il se consacre à apporter une contribution majeure pour bâtir une Haïti caractérisée par des indicateurs socioéconomiques reluisants.
Samuel Pierre, le galvanisateur
À un maximum deux clics de chaque Haïtien de l’élite, a-t-il lancé dans un optimisme inébranlable, Samuel Pierre possède cette aptitude magnétique à connecter les ressources rares de la diaspora avec celles du terroir. Le projet catalyseur du Groupe de réflexion et d’action pour une Haïti nouvelle (GRAHN) dont il est le fondateur est l’expression d’un mouvement porteur qui rassemble des ressources et des expériences chevronnées dans des disciplines transversales pour insuffler une synergie salvatrice à Haïti. L’initiative GRAHN-Monde émanait de ce besoin urgent de réunir des personnes d’expertises et de sensibilités diverses pour étudier minutieusement les problèmes du pays afin de proposer des pistes de solutions soutenables. Par la persuasion du professeur Pierre, GRAHN a établi des partenariats techniques et financiers avec des institutions locales et internationales qui subventionnent ou investissent dans plusieurs projets aux effets positifs en Haïti.
Soutenue par des pylônes centraux en Haïti et au Canada, l’institution s’étend aux États-Unis, en France et en Suisse tout en envisageant de s’élargir dans les autres régions où s’installe la diaspora haïtienne. GRAHN-Monde est garni de chercheurs, experts et professeurs d’université à la l’étranger et en Haïti qui s’engagent à peindre un nouveau tableau, pour redorer le blason de la Première république noire du monde. Parmi des projets phares du GRAHN-Monde figure la Cité du Savoir, une école d’excellence qui inclut la formation depuis la petite enfance jusqu’au niveau de doctorat. À travers ce réseau de l’élite intellectuelle haïtienne au niveau local et à la diaspora, professeur Pierre conçoit des structures dynamiques pour réinventer des citoyens consciencieux et responsables, consacrés au service du bien commun. Il développe des stratégies et des partenariats judicieux pour faciliter des étudiants et des professionnels à gravir des échelons de la pyramide sociale par le biais d’une formation moderne et de qualité.
Tant au Canada qu’en Haïti, Samuel Pierre est devenu un gourou infatigable qui accompagne chaque année plusieurs candidats dans la rédaction de leurs thèses. Il détient à son actif de directeur de recherche plus d’une centaine d’étudiants de deuxième et troisième cycles universitaires. Cet académicien de calibre international ne produit pas que des idées ; plus important, il construit aussi des chercheurs, de meilleurs professionnels et donc un meilleur capital humain capable de servir l’université, l’administration publique et privée en Haïti. Dispensant une formation fondée sur l’honnêteté et le patriotisme, il plaide pour des serviteurs publics qui concilient paroles et actions.
Samuel Pierre, l’académique distingué
Par son impact dans les milieux académiques et intellectuels, Samuel Pierre se distingue dans les domaines de l'informatique mobile, de l’intelligence artificielle, du téléapprentissage ainsi que des réseaux de communication câblés et sans fil. Samuel Pierre s’est illustré en tant qu’auteur et coauteur de plusieurs livres, essais et articles scientifiques. Devenu une sommité de rang mondial, il a reçu au Canada, aux États-Unis et en France de nombreuses distinctions pour ses œuvres académiques. Il a occupé des fonctions de rédacteur associé à des revues scientifiques de renom telles que l’IEEE Communications Letters, IEEE Canadian Journal of Electrical and Computer Engineering, Journal of Computer Science, Telematics and Informatics publié par Elsevier Science, ainsi que du International Journal of Technologies in Higher Education (IJTHE).
Samuel est un éminent scientifique honoré pour son leadership et sa vision à la Feuille d’Érable. Visionnaire et chercheur de grand acabit, il est à l’origine d’innovations technologiques qui ont un impact tangible sur le quotidien des Canadiens et bien au-delà. Il est reconnu pour l’excellence de ses travaux accomplis sur plus de trente ans qui lui ont valu des titres prestigieux comme Chevalier de l’Ordre national du Québec en 2009 et la Médaille d’Ingénieurs Canada en 2021. En 2020, il a été couronné de la plus haute distinction de l’Ordre des Ingénieurs du Québec (OIQ). En plus de ses précieuses contributions scientifiques, Samuel éprouve un immense intérêt à transformer la société haïtienne en la dotant de stratégies de création de richesses et d’un pool de ressources humaines compétitives.
À travers la Cité du Savoir qui incorpore l’ISTEAH, cette éminente figure universitaire a construit un réseau de compétences locales et à la diaspora pour faire fonctionner l’université, avec de grandes ambitions. S’érigeant comme une alternative par rapport à la fuite de cerveaux chronique qui ronge le pays, l’ISTEAH offre aux étudiants des modules de cours de standard international tout en leur inculquant l’esprit d’entrepreneuriat. Cet institut est la plus grande institution académique en Haïti consacrée à l’enseignement supérieur dans les disciplines scientifiques et technologiques. Il est doté de plus de 200 professeurs associés, d’une centaine d’étudiants au programme de premier cycle en sciences et en ingénierie et de plus de 600 étudiants répartis dans 40 programmes de formation aux niveaux maîtrise et doctorat.
Samuel Pierre, l’entrepreneur innovateur
Scientifique de grand acabit maîtrisant les outils à la pointe de la technologie, Samuel Pierre combine efficacement des compétences académiques à des initiatives pragmatiques pour sortir la population de la pauvreté. Son sens humaniste est aiguisé à travers ses projets de développement à base communautaire qui le positionnent proche des groupes marginalisés, notamment les paysans dans les régions souvent traités en parents pauvres. Supporté par une équipe dynamique qui partage sa vision et ses valeurs, Samuel travaille à propulser un développement via les potentialités des pôles géographiques. La première phase de ce projet d’envergure nationale se concentre dans le Nord avec le Pôle d'innovation du grand Nord (PIGRAN).
Visant des structures de développement qui mettent en évidence les avantages compétitifs du pays, ce projet émane de l’expérience de la Silicon Valley qui illustre le succès de la Triple Hélice, à la base de l’extension de la plupart des pôles technologiques viables. La Triple Hélice soutient que le développement économique et l'innovation reposent sur une collaboration étroite entre l'université, l'industrie et le gouvernement. Ces trois secteurs sont vitaux, chacun devant apporter des perspectives et des ressources spécifiques. PIGRAN a déjà attiré des partenariats et des investissements dans plusieurs secteurs tels que la construction et la production agricole. Samuel a innové dans le secteur des affaires en Haïti en facilitant des compatriotes à se procurer des actions dans les projets d’investissements entrepris dans le cadre du programme PiGran. D’autres pôles de développement similaires sont également envisagés dans les autres axes géographiques du pays. La réussite complète de ce modèle d’écosystème entrepreneurial dépend de l'interaction dynamique entre les trois acteurs principaux.
La noble vision de l’ingénieur haïtianno-canadien, visant à répandre un savoir pragmatique au pays tout en le rendant utile pour la transformation et l’amélioration de l’économie locale, ressemble à celle exprimée par Frederick Terman. Cet ingénieur américain, servant au Conseil de l'Université de Stanford, a joué un rôle pivot dans le développement de l’écosystème technologique et entrepreneurial de la Silicon Valley. La similitude est patente avec l’ingénieur Samuel Pierre, car à l’instar de la Stanford, l’ISTEAH a pris l’option d’assurer une fonction motrice dans le projet de développement de la plupart des pôles géographiques en Haïti.
Le modèle expérimenté dans le Grand Nord promet d’énormes résultats ; cependant, il souffre de la dynamique inadéquate d’un acteur clé : le gouvernement. Cette absence de collaboration souhaitée depuis les structures communautaires de base comme les CASEC inhibe l’expansion et les effets multiplicateurs de l’initiative du développement à travers les potentialités des pôles géographiques.
Dr. Yunus de la Grameen Bank
À l'origine de la découverte de mission chez les visionnaires qui transforment le cours de la vie se trouve bien souvent un élément déclencheur : une expérience marquante, capable de susciter un focus générateur d’insomnie créatrice. Les grands inventeurs sont passés par ce tourment personnel en s’offrant en holocauste pour léguer des héritages durables sur lesquels s’appuie le progrès de l’humanité. Tandis qu’en classe, dans ses productions scientifiques et à des conférences, professeur Yunus vantait la beauté des théories économiques qui projettent de fournir des solutions aux problèmes de société, il s’était rendu compte qu’il vivait dans une bulle illusionniste. À l’analyse des conséquences désastreuses de la famine qui sévissait au Bengladesh au cours des années 1974, Muhammad Yunus était inspiré à faire le lien entre les connaissances théoriques et la triste réalité des couches sombrées dans la pauvreté abjecte.
Quand ses yeux avaient été ouverts soudainement sur les écarts saisissants entre les paradigmes et les résultats empiriques, professeur Yunus planifiait des missions pour côtoyer des nécessiteux qui vivaient dans des villages pauvres du Bengladesh. Il était profondément ému par la situation de ces gens croupis dans la misère pendant qu’ils représentaient de potentiels entrepreneurs. Dans une expérience pilote, il avait fourni à 40 personnes, notamment à des femmes, un financement de 27 dollars chacune, qu’il tirait de ses propres fonds. Ce généreux financement leur avait permis de faire fonctionner leurs petites entreprises et améliorer les conditions de leurs familles.
Cette expérience judicieuse avait convaincu professeur Yunus de la viabilité d’un tel projet qu’il hallucinait d’étendre à une échelle nationale. Ainsi, il avait approché des banques de la place pour élargir la possibilité de financer plus de familles dans la nécessité. C’est à ce moment qu’il allait découvrir tant d’obstacles et de rigidité dans le système bancaire qui ne facilitait guère des prêts aux gens pauvres. Dans la perspective de combler cette lacune des crédits inaccessibles aux couches défavorisées, professeur Yunus avait pris l’initiative de créer la Grameen Bank en 1983.
Sa réponse pragmatique aux mythes et clichés du système bancaire a facilité plusieurs millions de personnes pauvres, surtout des femmes, d'accéder à des prêts sans garantie, leur offrant une fascinante opportunité d’inclusion financière et d’autonomie économique. C’est cette prise de conscience qui le menait à l’invention de la Grameen Bank qui constitue la toile de fond du prix Nobel décerné à l’économiste et entrepreneur social bangladais, pionnier du microcrédit et de la finance solidaire.
Dr. Pierre du GRAHN-Monde
Qu’en est-il du déclic chez professeur Samuel Pierre tant impliqué dans des réflexions et des projets de résolution des problèmes structurels en Haïti ? Une réponse laconique serait le séisme du 12 janvier 2010. En effet, depuis cette catastrophe meurtrière qui a davantage aiguisé son esprit de partage et de solidarité, professeur Pierre s’engage avec une détermination sans relâche dans la transformation sociale en Haïti. Le directeur de laboratoires et chercheur émérite a descendu de son piédestal – laissant sa zone de confort académique de l’enceinte du Polytechnique de l’Université de Montréal – pour poursuivre cet objectif ultime de servir et d’améliorer les conditions de vie des plus vulnérables tout en renforçant les capacités académiques et professionnelles des serviteurs publics.
Professeur Pierre fait regagner confiance aux Haïtiens qui étaient découragés en leur offrant des opportunités d’émancipation et d’acquisition des nouvelles compétences. Il est animé de la noble vision de découvrir des trésors et de raffiner d’autres Pierres à son pays natal pour qu’ils participent activement à changer le tableau en Haïti. À titre de président du GRAHN-Monde, une entreprise sociale mise en œuvre au lendemain du tragique séisme de 2010, Samuel Pierre s'investit également en tant que philanthrope dans des initiatives sociales. Il fait montre d’un rare humanisme et d’une résilience imperturbable pour surmonter les risques et les défis en renvoyant l’ascenseur au pays d’origine, tant assoiffé d’espoir.
À bien des égards, la sensibilité sociale et l’esprit qui habitent le professeur Pierre sont identiques à celui du professeur Yunus. Le prix Nobel de la paix de 2006b a été décerné au professeur Muhammad Yunus en contrepartie de ses efforts consistants qui visaient à créer un développement socioéconomique à partir de la base, notamment grâce à l’invention et la diffusion du microcrédit. En Samuel Pierre, nous percevons les mêmes gênes du professeur Muhammad Yunus et bien plus. Muhammad Yunus a mérité le Prix Nobel de la paix par son intelligence pragmatique à combiner ses connaissances scientifiques via des mécanismes qui ont drastiquement transformé la vie de plusieurs millions de pauvres. Samuel Pierre, pour sa part, a adopté des stratégies innovantes pour transformer le décor socioéconomique en Haïti par le partage de la connaissance scientifique et la création d’un bien-être au profit des communautés vulnérables.
Au-delà de son niveau de science avéré, Samuel Pierre s’intéresse aux défis socioéconomiques confrontés par la société. Dans un pays où la population peine à satisfaire les besoins de base de la Pyramide de Maslow, si le gouvernement s’impliquait suffisamment, les projets sociaux d’envergure entrepris sous le leadership de Samuel Pierre contribuerait à améliorer les conditions de vie d’une bonne partie de la population. Afin de mieux contrecarrer les défis engendrés par les désastres naturels, Samuel Pierre fait des propositions techniques concernant des constructions parasismiques au coût réduit. Fort souvent, la toile savoure un Samuel Pierre qui délivre un discours engagé et rassembleur pour inviter les dirigeants à assumer leurs responsabilités de garantir la cohésion sociale. Lors de ses interventions dans les médias, il exhorte les institutions locales et les partenaires de coopération à promouvoir le bien-être collectif dans la sincérité.
En s’appuyant sur l’importance de promouvoir la méritocratie, les réalisations de l’illustre professeur Pierre doivent être exposées de manière proactive afin d’habituer les esprits à ce narratif d’un potentiel Prix Nobel haïtien. Évidemment, les œuvres sont fondamentales, mais elles ne suffisent pas pour garantir l’obtention de certains prix prestigieux. En plus de se positionner pour décrocher un titre honorifique au plus haut niveau, quand les structures optent d’ouvrir le livre Samuel Pierre pour qu’il soit lu par la génération présente, elles offriront une bonne source d’inspiration à la société.
Carly Dollin
Pour consulter les articles précédents, cliquez ici
References
- Pierre, S. et al. (2022). Construction d’une Haïti nouvelle : vision et contribution du GRAHN – Groupe de réflexion et d’action pour une Haïti nouvelle. Presses internationales Polytechnique
- Pierre, S., Dupénor, J., Kernizan, R., Vincent, M. D., Dauphin-Pierre, S., & Pierre, J. (2023). Analysis of an Entrepreneurial Ecosystem in Northern Haiti to Stimulate Innovation and Reduce Poverty. The Journal of Entrepreneurship, 32(2_suppl), S117-S141.
- Leslie, S. W., & Kargon, R. H. (1996). Selling Silicon Valley: Frederick Terman's model for regional advantage. Business History Review, 70(4), 435-472.
- Yunus, M., & Yusus, A. J. M. (2007). Banker to the Poor. Penguin Books India.