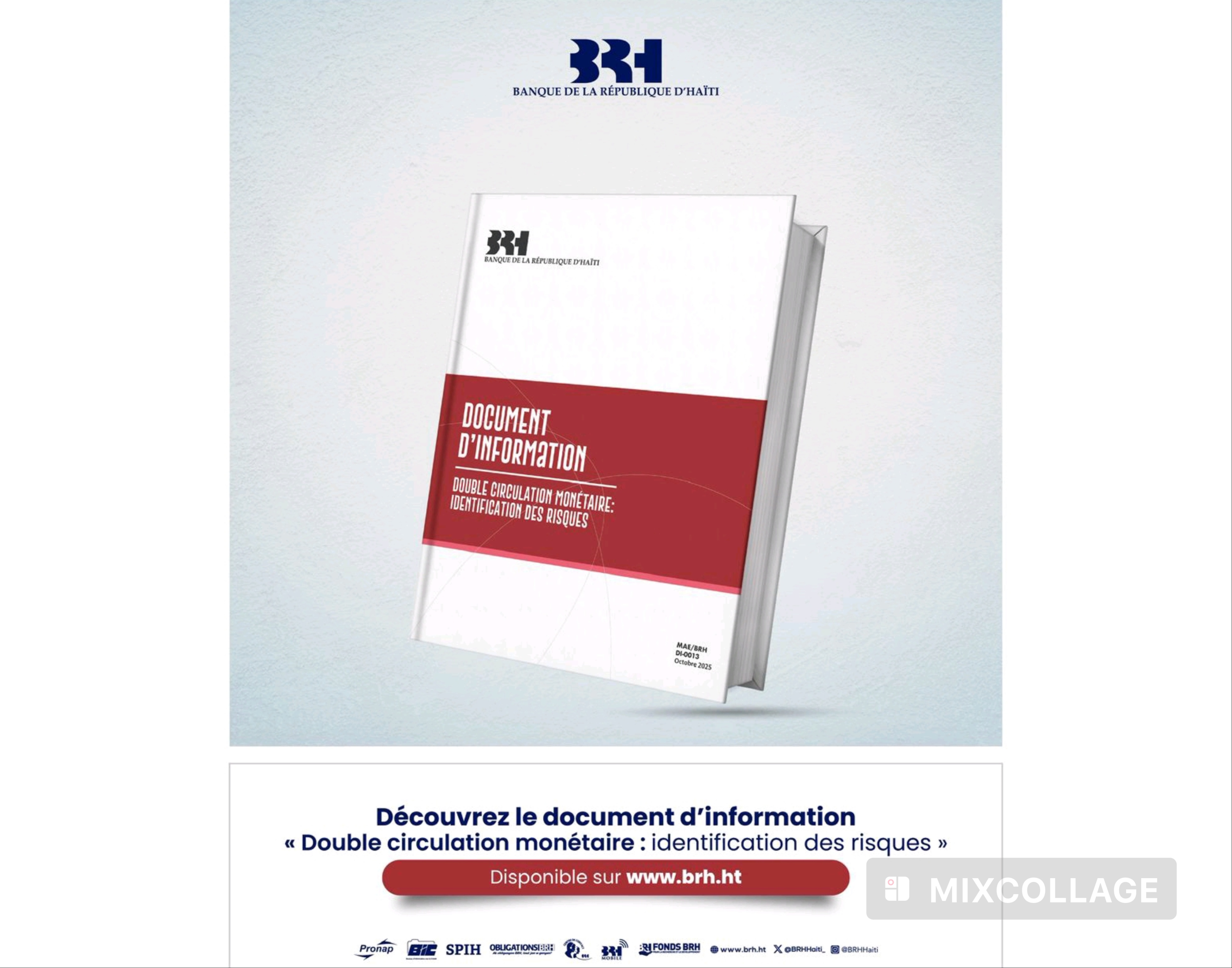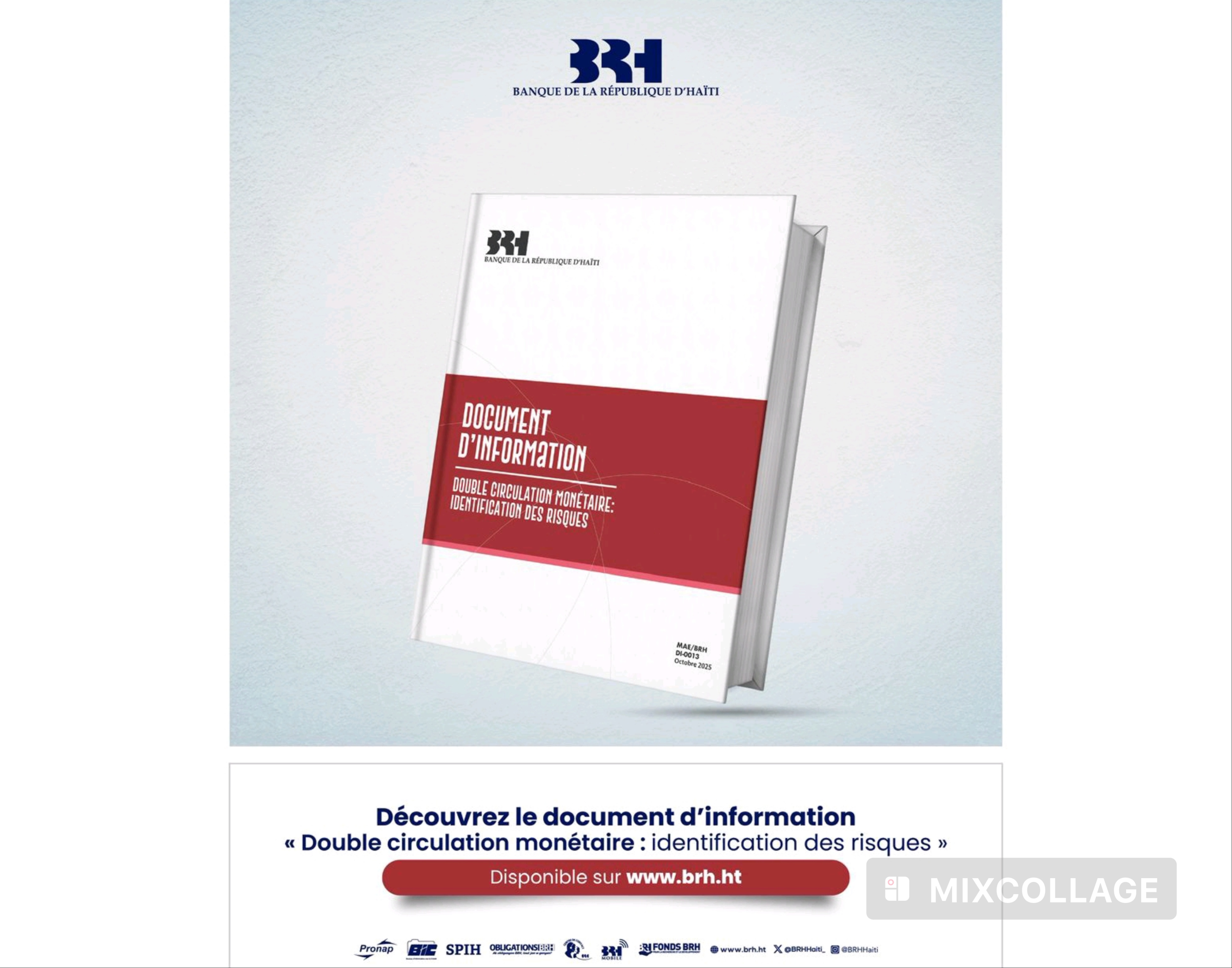Dans une note publiée par le premier des banquiers en Haïti, l’économiste Ronald Gabriel, gouverneur de la banque centrale, ce dernier souligne: “L’un des défis majeurs de notre économie réside dans la coexistence du dollar américain et de la Gourde dans les transactions quotidiennes.”. Il poursuit: “Cette situation, appelée double circulation monétaire, reflète des déséquilibres structurels hérités de plusieurs décennies: instabilité socio-politique, progression rapide des prix, intégration commerciale, dépendance aux transferts sans contrepartie, etc.”.
Durant le mois d’octobre 2025, un nouveau document d’information d’une quinzaine de pages, s’ajoute dans la bibliothèque numérique de la Banque centrale haïtienne. La Banque de la République d’Haïti entend ainsi proposer une lecture à la fois académique, critique et objective sur la thématique, ou principalement autour de la problématique de la : « Double circulation monétaire : identification des risques ».
Décliné autour des différents sous-thèmes, ce document d’information expose dans son contenu les parties suivantes : Introduction qui est suivie par la Double circulation monétaire: Généralités et Causes structurelles ; Déterminants de la double circulation monétaire dans l’économie haïtienne ; Inflation ; Dépréciation de la monnaie locale ; Facteurs institutionnels et Instabilité politique.
D’autres parties viennent compléter la littératie financière expliquée dans un langage clair et accessible au plus grand nombre. On retiendra les autres parties abordant la mesure de la dollarisation en Haïti ; Risques associés à la dollarisation en Haïti, les exemples de pays ayant maîtrisé les risques et réduit leur dépendance à l’égard du dollar Etats-Unis, la conclusion.
Depuis les trente dernières années, l’économie haïtienne évolue dans un environnement où les déséquilibres macroéconomiques, alimentés par des chocs d’ordre externe (crise de 2008, pandémie de Covid-19 en 2020, etc.), socio-politique, des catastrophes naturelles et des chocs climatiques (séismes, ouragans, tempêtes tropicales, etc.) continuent d’impacter négativement la valeur interne et externe de la monnaie nationale.
De telles considérations sont formulées dans la conclusion de la partie introduction du document, et tentent de rappeler : “Conséquemment, la gourde s’est retrouvée de plus en plus concurrencée dans ses fonctions par le dollar américain. Or, une utilisation croissante du dollar américain pour des transactions économiques peut fragiliser le système financier, alimenter la dépréciation de la gourde et aussi constituer une contrainte à la transmission des impulsions monétaires de la Banque centrale. Considérant les incidences négatives de la double circulation monétaire sur l’économie, notamment pour la conduite de la politique monétaire, ce document d'information présente les déterminants de la dollarisation en Haïti, et analyse le degré de dollarisation de l’économie haïtienne, tout en mettant en exergue les risques pesant sur une économie dollarisée.”.
Dans l’introduction de la partie conclusion du document, on peut lire : “Le phénomène de double circulation monétaire s’observe généralement dans les économies ouvertes, fragiles ou fortement intégrées aux marchés internationaux. Dans le cas d’Haïti, le degré élevé de dollarisation s’impose comme un facteur structurel limitant l’efficacité de la politique monétaire et la stabilité macroéconomique. L’analyse des expériences d’autres pays montre que des politiques monétaires cohérentes associées à une gestion rigoureuse des finances publiques afin d’assurer une stabilité durable des prix dans l’économie, peuvent contribuer à une maîtrise progressive du phénomène.”.
Double circulation monétaire: généralités et causes structurelles, à travers cette publication qui porte la signature de la Direction Monnaie et Analyse Économique de la banque centrale, les lecteurs et lectrices sont invités à explorer considérations qui alimentent ou argumentent : “La coexistence de plusieurs monnaies dans une économie”, autour des différents facteurs tels : L’instabilité socio-politique... ; La progression rapide de l’inflation et/ou du taux de change... ; L’intégration commerciale et financière et/ou les transactions internationales élevées des acteurs économiques... ; Les montants significatifs de transferts sans contrepartie reçus par les bénéficiaires peuvent renforcer la disponibilité de ces devises dans l’économie... ; La législation/ La politique monétaire/ La confiance dans la monnaie nationale...
Dans le cas de l’instabilité sociopolitique, les auteurs du document soulignent que : “La récurrence des chocs d’ordre socio-politique entraîne des déséquilibres au niveau des fondamentaux macroéconomiques. En favorisant la fluctuation des prix dans l’économie, cette instabilité peut porter les agents économiques à préférer, à la monnaie locale, une devise étrangère moins volatile.”. Ces experts en profitent pour rappeler que : “Les montants significatifs de transferts sans contrepartie reçus par les bénéficiaires peuvent renforcer la disponibilité de ces devises dans l’économie.”.
Devant un tel constat, ils en profitent pour déduire que : “Cette situation peut induire une augmentation des importations dans une économie caractérisée par une faible élasticité de la production à la demande. Ceci tend à encourager les agents économiques à en faire un usage plus accru ou à préférer la monnaie étrangère dans leurs transactions pour se protéger contre une éventuelle dépréciation de la monnaie nationale.”.
Des “déterminants de la double circulation monétaire dans l’économie haïtienne”, sont pris en compte dans ce document au début de la page 6. On peut lire : “La double circulation monétaire en Haïti renvoie à une situation de « dollarisation partielle ». Elle est caractérisée par l’utilisation concomitante de la monnaie nationale, la gourde (HTG), et une devise étrangère, le dollar américain (ÉU). Les déséquilibres macroéconomiques traduits par la forte volatilité de certains indicateurs ont contribué et entretenu la coexistence de ces deux monnaies dans l’économie haïtienne depuis les quarante dernières années.
Dans l’optique d’une dédollarisation éventuelle de l’économie haïtienne, il convient aussi de prendre en compte les facteurs psychologiques. “Ces derniers sont liés notamment aux conditions sécuritaires et à l’instabilité sociopolitique, lesquelles alimentent les anticipations négatives et ont une incidence non négligeable sur la stabilité de la valeur de la monnaie nationale.”, par ces mots les auteurs s’entendent pour boucler ce document d’information qui aborde une problématique assez pertinente dans la vie politique, sociale et en particulier économique et financière de la République d’Haïti. Plus qu’une simple invitation, le document invite le plus grand nombre des lecteurs et lectrices à s’informer et se former, mais également à élargir les débats sur le sujet, tout en prenant en compte les différents concepts, les réflexions et les repères proposés.
Dominique Domerçant