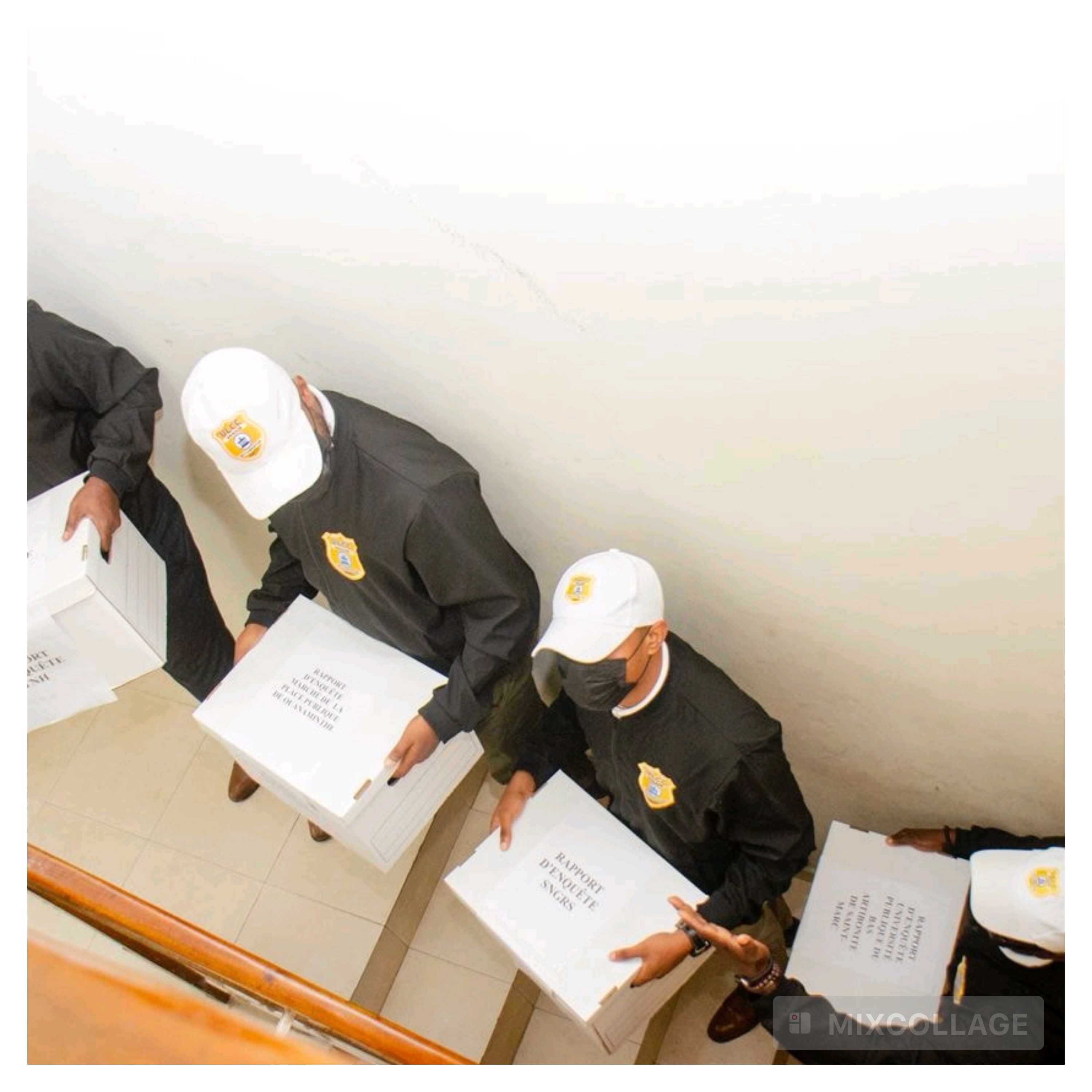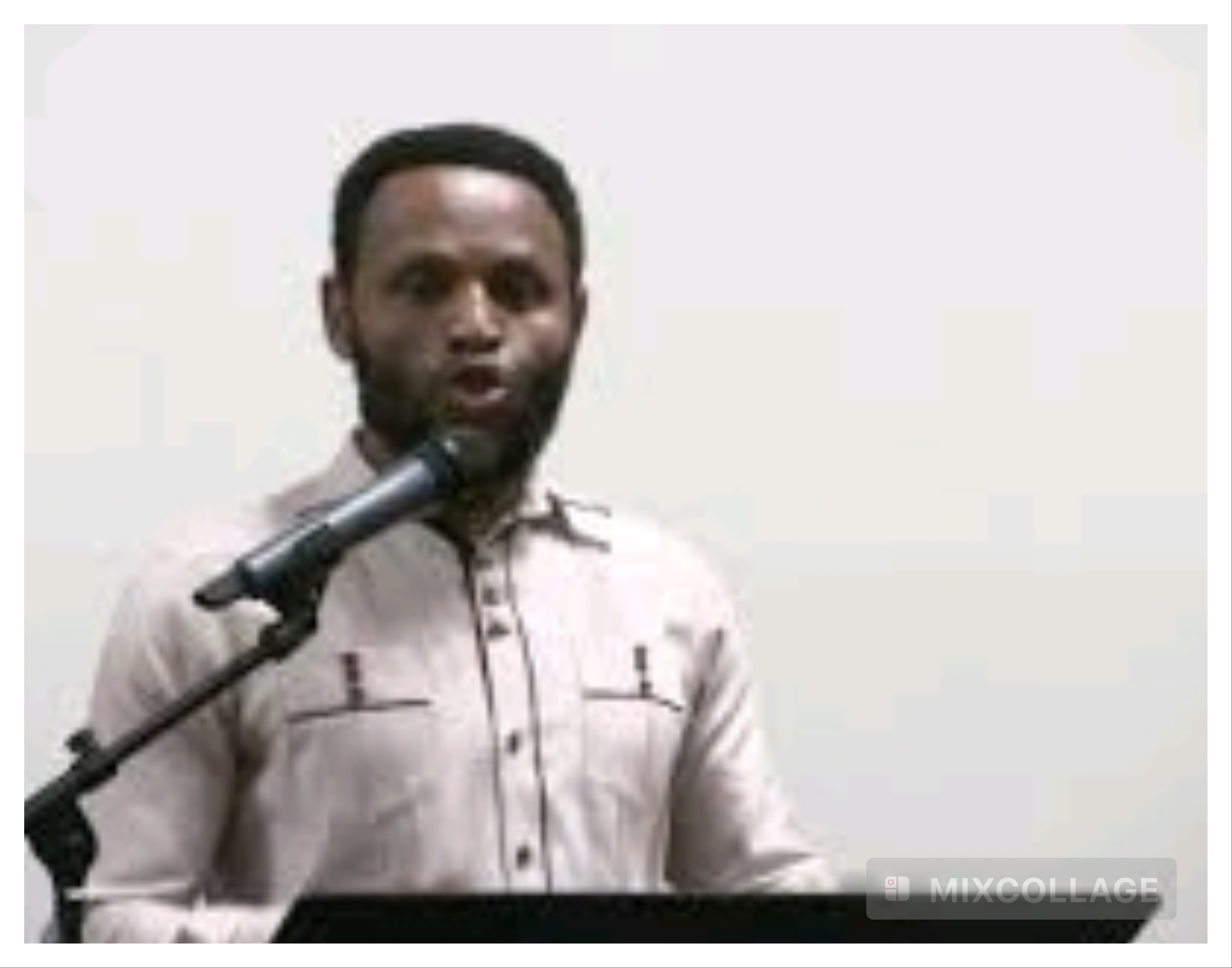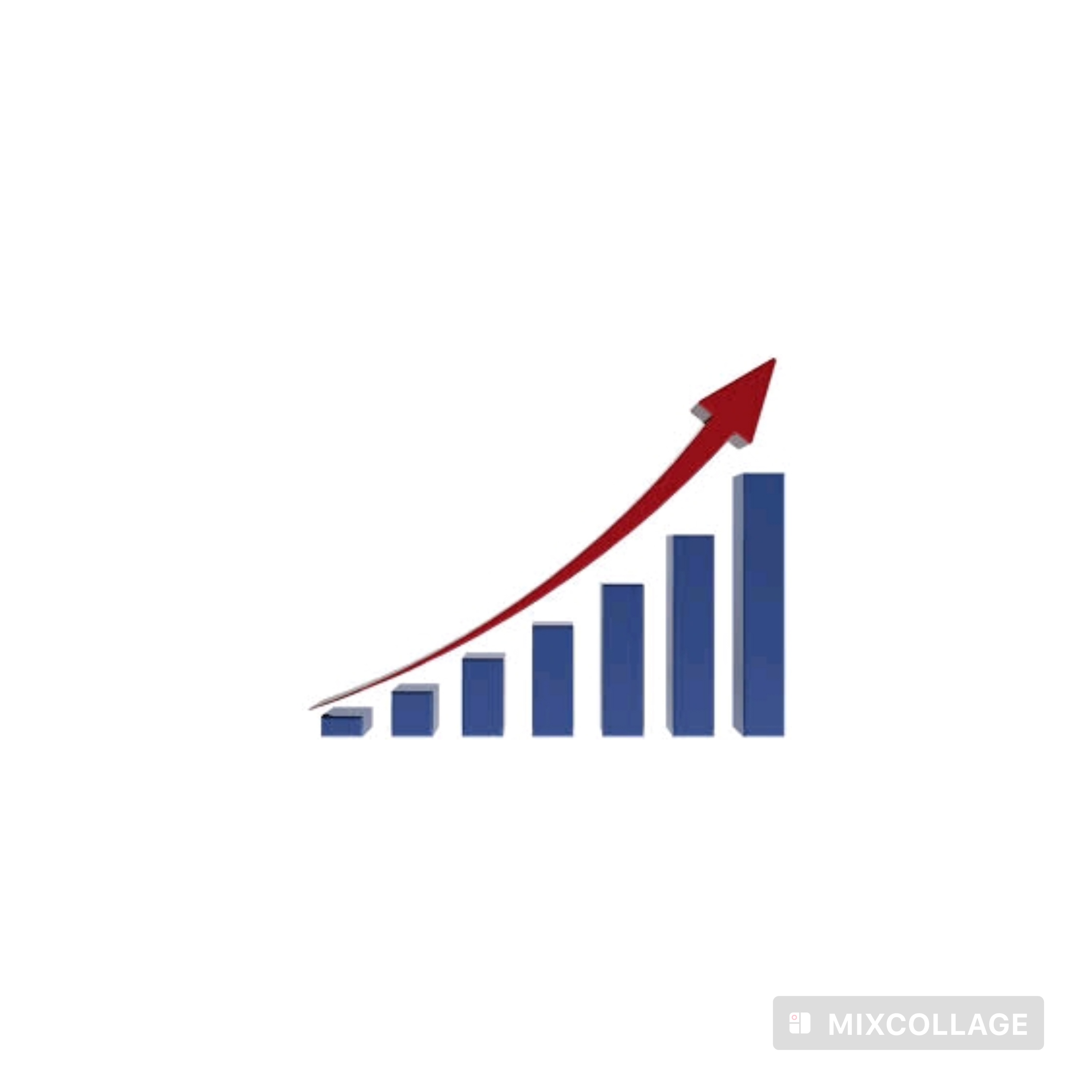En collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, le Centre d’analyse et de recherche en droits de l’homme (CARDH) a organisé, ce mercredi 26 mars, une conférence-débat dans le cadre de la Table sectorielle sur la sécurité (TSS), un espace de discussion et de concertation sur les enjeux de la lutte contre l’insécurité.
Haïti fait face depuis quelques années à une montée vertigineuse de l’insécurité, marquée notamment par une expansion sans précédent de la violence extrême des gangs armés. Ces groupes criminels continuent d’étendre leurs zones d’influence, notamment dans l’aire métropolitaine de Port-au-Prince et dans le département de l’Artibonite. Ils multiplient les cas de meurtres et de blessures, ainsi que les actes de rapt et de pillage contre une population déjà fragilisée par un contexte humanitaire désastreux, alors que l’État peine à assurer pleinement et efficacement sa mission de protection.
Face à cette situation, plusieurs quartiers mettent en place des groupes d’autodéfense, communément connus sous le nom du phénomène « Bwa Kale », qui visent à se prémunir contre les attaques des gangs armés et à assurer la sécurité de leurs zones. Bien qu’ils cherchent à répondre à un besoin de protection, ces groupes mènent souvent des actions assimilables à la justice populaire, voire expéditive, qui nécessitent donc des analyses du point de vue de l’État de droit et des droits de l’homme, a expliqué maître Gédéon Jean, directeur exécutif du CARDH.
Avec la collaboration du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, cette matinée de discussions a pour objectif d’analyser le « Bwa Kale » dans le contexte actuel de la lutte contre la violence des gangs armés.
Il arrive souvent que les responsables de l’application des lois d’un État fassent usage de la force pour maintenir ou rétablir la sécurité et l’ordre public dans des situations de conflit armé ou d’autres situations de violence.
L’emploi de la force dans des opérations de maintien de l’ordre est réservé à des personnes qui exercent des pouvoirs publics, notamment la police et les forces armées. Cet usage de la force est surtout régi par le droit international des droits de l’homme et la législation nationale et doit être strictement réglementé par les États.
En Haïti aujourd’hui, les civils armés nous donnent l’impression que c’est eux qui mènent la danse, en dépit des efforts de la PNH pour les contrecarrer. La population, livrée à elle-même, tente autant que faire se peut de se rendre justice. Le terme « usage de la force » ou « recours à la force » est souvent défini dans le droit national.
Cependant, il est généralement compris comme toute contrainte physique imposée à une personne, allant de la contention manuelle ou à l'aide d’un instrument de contention à l’usage d’armes à feu ou d’autres armes. La force ne peut être employée que si les autres moyens restent sans effet ou ne permettent pas d’escompter le résultat désiré. Un élément à prendre en considération pour respecter le droit à la vie si l’on doit recourir à l’usage de la force létale ou proportionnellement létale.
Rappelons tout de même que ce phénomène a vu le jour à la fin du mois d'avril dernier en réponse à l'augmentation alarmante de la violence liée aux gangs. Avec ce mouvement, le peuple prend les choses en main et établit des organisations d’autodéfense pour se protéger contre les gangs.
Gérard H. Résil