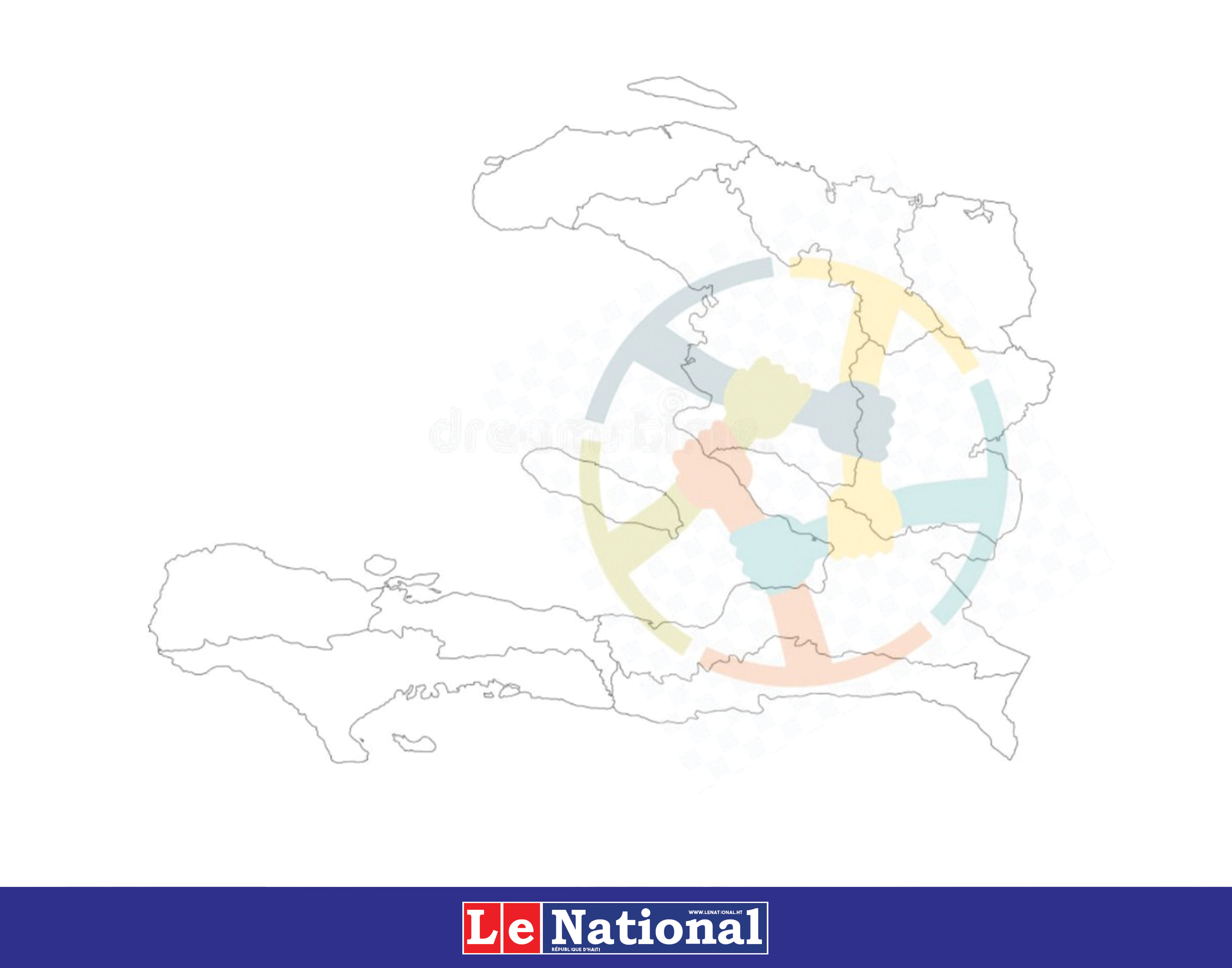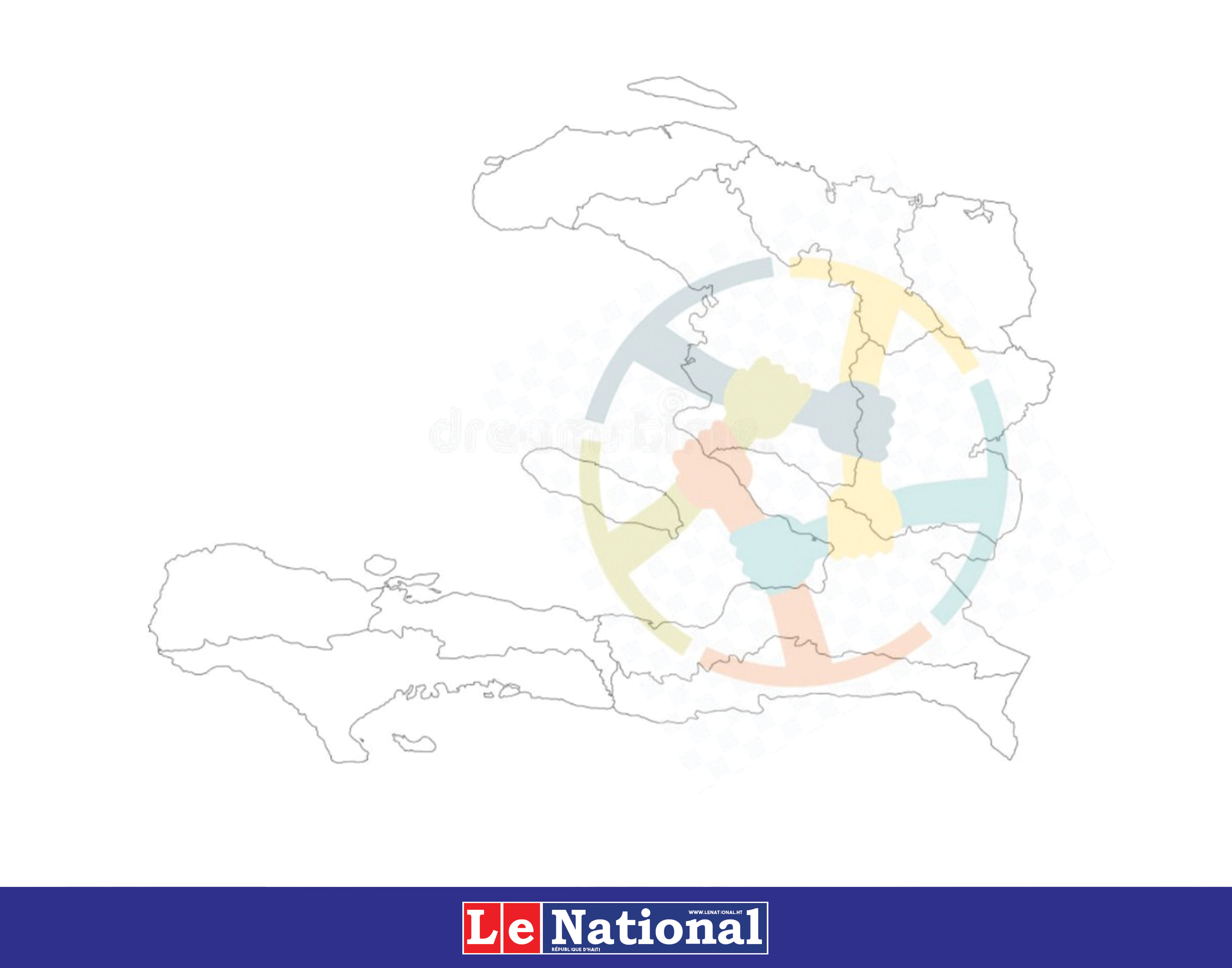Depuis 2021, Port-au-Prince, la capitale d’Haïti, la ville qui a accueilli la première exposition touristique des caraïbes en 1950 se voit plonger dans une situation d’insécurité généralisée sans précédent. En effet, cette réalité n’est pas sans conséquence sur la structure socio-économique et démographique du pays.
D’une part, les membres de la population détenant un capital économique ou culturel ont laissé le pays pour immigrer ailleurs soit pour effectuer des études, soit pour travailler dans les pays d’accueil. D’autre part, la grande majorité de la population, celle qu’on appelle dans le langage populaire « la masse » en grande partie, est obligée de laisser sa demeure pour des horizons inconnus ou parfois incertains. C’est ce que l’Organisation Internationale de la Migration (OIM) appelle « les déplacés internes ».
Ainsi, selon le rapport de l’Organisation Internationale de la Migration (OIM), les déplacés internes sont divisés en deux grandes catégories : les ménages déplacés et les personnes déplacées. L’OIM dans son rapport paru en 2022, estime que les déplacés internes de la capitale pour d’autres horizons sont évalués à près d’un million.
En outre, on peut observer dans le tableau que les zones d’accueil se divisent en cinq (5) grands pôles. La zone métropolitaine de Port-au-Prince ainsi que le grand sud sont les zones d’accueil des déplacés internes les plus représentatives.
Par ailleurs, en dehors des dispositifs sécuritaires à mettre en place dans ces zones d’accueil qui sont des collectivités territoriales, l’arrivé des déplacés internes génère de nouveaux besoins au niveau des territoires. Dès lors, il
incombe aux dirigeants des collectivités de prendre en compte les ersonnes déplacées puis d’inscrire leurs actions publiques dans une logique de développement local en priorisant une démarche de co-construction avec les acteurs locaux tout en prenant en compte les besoins de tous.
Dans ce contexte, il est essentiel de mettre en place un dispositif de budget participatif d’investissement (BPI) pour mieux dynamiser les territoires. En effet, le BPI est un dispositif visant à inclure le citoyen dans la procédurebudgétaire annuelle, tout en rappelant qu’un budget public se caractérise par le fait qu’il est à la fois un acte de prévision et d’autorisation des dépenses et des recettes, adopté par une assemblée élue par les citoyens-contribuables.
Plus globalement, le budget participatif est un symbole fondamental de démocratie participative permettant aux citoyens d’affecter une partie de leur budget d’investissement local à des projets d’intérêt général. Cet instrument constitue un outil d’aide à la décision publique qui, dans un contexte de restriction budgétaire (baisse continue des dotations de l’État) et de crise socio-politique, conduit à mobiliser l’expertise citoyenne tout en priorisant l’expertise politique.
En conséquence, le succès du dispositif budget participatif d’investissement est lié à la nécessité de concilier logique économique (performance de l’action publique) et logique politique (légitimité des décideurs publics). Cela tend vers la mise en place d’un modèle adapté de gouvernance territoriale et de développement des collectivités territoriales.
Lanotion de « Gouvernance » rappelons-le, a pris naissance au milieu des années 1970. Depuis, cette dernière a suscité beaucoup de débats, et a connu beaucoup d’évolution. Au cours des années 1980, les institutions financières internationales ont utilisé le concept de « Bonne gouvernance » pour faire face aux résultats catastrophiques des programmes d’ajustement structurel (PAS). Ce dernier représentait à l’époque l’outil fondamental de mise en œuvre et d’efficacité des politiques publiques. De son côté, la gouvernance territoriale désigne « un décentrement de la prise de décision, avec une multiplicité des lieux et des acteurs impliqués dans les décisions prises ». Elle peut être comprise comme la manière dont les sociétés développent des règles, des processus et des comportements nécessaires à leur survie et à leur développement. Son fondement est axé sur trois (3) piliers fondamentaux : la transparence dans la gestion publique, la responsabilité des décideurs ou élus locaux et la participation citoyenne.
La gouvernance territoriale active la participation des différents acteurs dans les processus de prise de décisions et permet de renforcer la sensibilisation et l'apprentissage. Elle conduit à une meilleure acceptabilité des décisions dont elle améliore ainsi la qualité, et contribue à l'autonomisation des acteurs et à la promotion d’une citoyenneté démocratique [...]. La participation est basée sur la confiance, la communication et la coopération entre toutes les personnes et tous les groupes impliqués dans le processus […]. Cependant, la mise en œuvre de la participation des acteurs dans les processus de prise de décisions implique l’utilisation des méthodes et des outils pour promouvoir le développement au sein du territoire.
À cet effet, à la suite de l’éclatement de la crise économique des années 70, les autorités locales ont compris et activé la nécessité d’améliorer les conditions matérielles d’existence des habitants sur leurs territoires. Ainsi, à travers des études approfondies et une bonne compréhension de la dynamique territoriale, les élus locaux sont parvenues à identifier les obstacles et faciliter le développement. C’est dans ce contexte qu’on parle de développement local.
Ce type de développement se réalise en considérant une harmonie entre les composantes économique, sociale, culturelle, politique et environnementale. Pour inscrire ce développement dans la durabilité, il convient a priori d’adopter une démarche intersectorielle, systémique et globalisée capable de mettre en perspective toutes les ressources dont dispose le territoire. Il s’agira bien d’une démarche intégrée centrée sur les caractéristiques propres des localités avec leurs atouts et opportunités propres à faire du citoyen un acteur dans le processus.
Dès lors, face à la catastrophe urbaine ou encore l’urbanicide que provoque l’agissement des gangs au sein de la premièreville de la république, des centaines de milliers de déplacés internes sont éparpillés partout à travers les différentes collectivités du pays, et dans un contexte de décentralisation, il appartient aux autorités locales de mettre en place des dispositifs d’intégration mais aussi de mettre en place des projets locaux d’intérêt commun en vue de satisfaire les besoins de tous.
Tout compte fait, le dispositif budget participatif d’investissement (BPI) consiste à mettre en lumière le paradoxe qui existe au sein des collectivités territoriales qui sont historiquement riche, culturellement valorisante et naturellement égorgées de ressources minières. En plus, ce dispositif est un outil fondamental pour favoriser une bonne dynamique sociale et de l’attractivité au niveau des territoires. En conséquence, face aux grands enjeux territoriaux, les autorités de l’Etat central, territoriales et locales à travers leur modèle de gouvernance ont pour principal objectif de répondre aux différents besoins des habitants sur les territoires en s’inscrivant dans une logique de développement économique local.
Jeff PIERRE-LOUIS Economiste/Consultant en évaluation des politiques publiques
Professeur de Management public à l’UEH