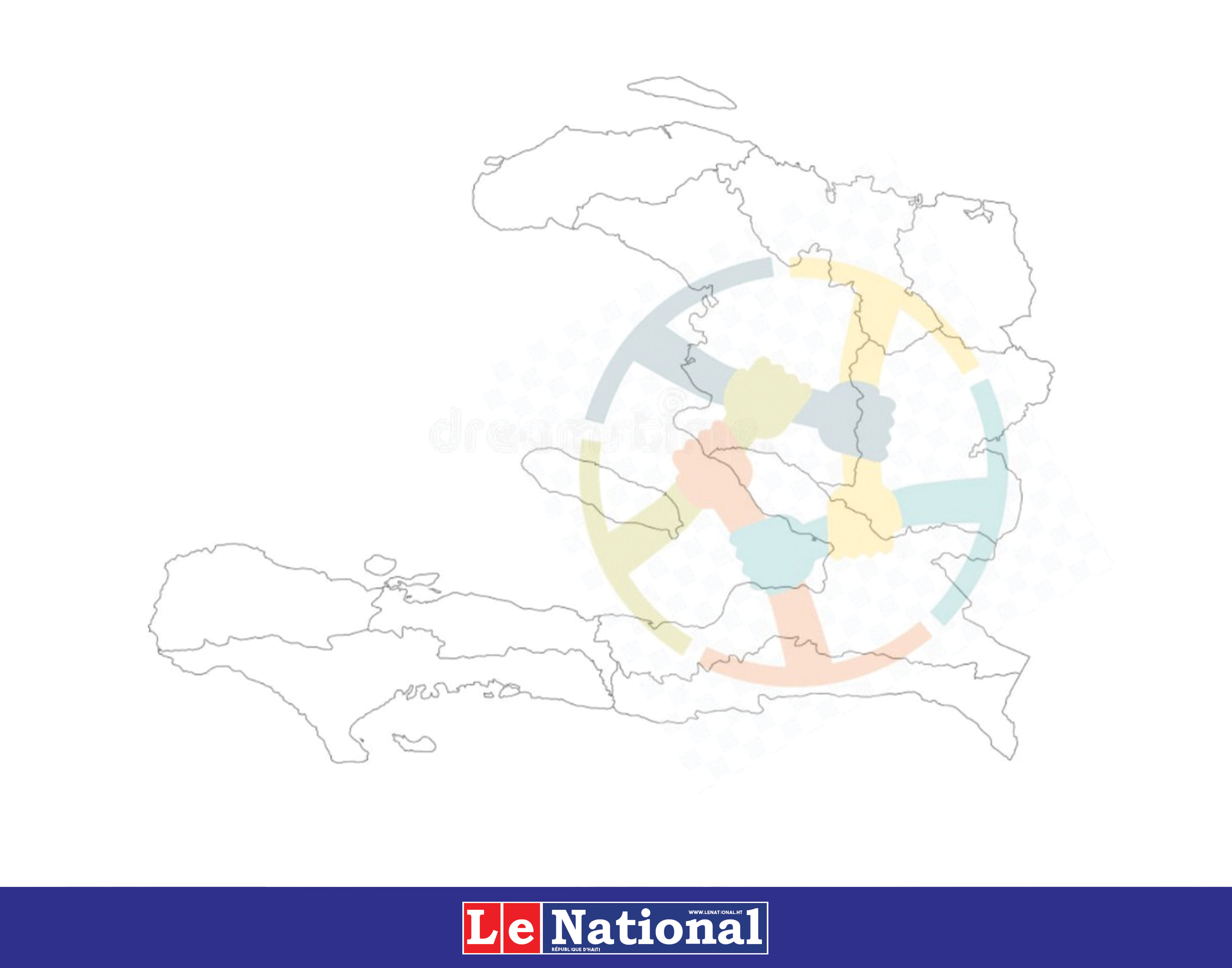Hayti se tient aujourd’hui au seuil d’un gouffre où l’histoire sociopolitique semble se dévorer elle-même. République proclamée, mais non vécue à la dimension de sa gloire jusque-là. État écrit, mais non incarné comme le voulait le père de la Patrie, le réalisateur de l'égalité de/pour tous les genres du monde. Nation rêvée, mais jamais réalisée en justice-sociale. À chaque aurore, c’est un crépuscule prématuré qui s’impose. L’éclat des mots s’éteint devant l’implacable nudité des faits : insécurité rampante, institutions exsangues, gouvernance disloquée, CPT pété sans répit.
En revanche, il nous reste une arme fragile mais décisive : la pensée. Penser Hayti, c’est refuser son anéantissement face à l'ordre subordinatif de l’international. C’est oser la nommer au moment même où elle se défait au terrorisme d’en haut. Ce texte n’est ni consolation ni pamphlet. Il est égal constat Un cri. Une tentative de lucidité au milieu des décombres de la criminalité douce des forces économiques.
De la République de papier à la République de cendres
L’histoire récente d’Hayti (2021-2025) pourrait se résumer en une lente descente aux enfers. Les lois s’empilent comme des parchemins sacrés dont nul ne respecte les commandements. Les gouvernements passent. Des chefs d'État se succèdent. Certains se contredisent. d’autres se balancent. Et l’État demeure un spectre. Une fiction juridique bien modelée. Une façade craquelée par l’épreuve du réel. Ce pays qui a su donner le rare exemple de la réalisation de l'égalité de tous les hommes et de toutes les femmes, vit dans une tension permanente entre le texte de lois et le terrain d'exécution. Les lois disent une chose, les pratiques en dictent une autre. La République, telle qu’annoncée, n’est plus qu’un mot creux. Bastion de liberté pour tous et pour toutes. Sur du papier, se proclame démocratique et sociale ; dans la réalité, elle n’est qu’un marché d’intérêts, une foire d’illusions pour la population en termes de justice-sociale, une tragédie sans metteur en scène pour les plus vulnérables.
Chaque réforme annoncée se dissout dans la corruption ou la violence au profit de groupements politiques et du secteur des affaires. Chaque promesse de renouveau s’écrase contre la dureté des faits. De Nation-État à l'État-nation, il ne reste que des fragments : un drapeau encore brandi dans certaines institutions publiques; un hymne encore chanté dans certaines radios, et des institutions qui survivent par habitude plus que par conviction et respect des normes banalisées administratives.
Hayti n’est plus gouvernée. Elle est gérée – ou plutôt, mal gérée. Ce qui devrait être un ordre républicain est devenu une succession de bricolages et d’improvisations, où le pouvoir n’obéit qu’à la loi du plus fort, du plus riche ou du mieux armé. Le CPT donne les coups de sifflet. L’ULCC passe à l'action. La République n’existe plus qu’en surface. En dessous, ce n’est qu’une République de cendres, au-dessus d'une transition politique qui dure éternité.
Dysfonctionnements institutionnels et fractures sociales
Le dysfonctionnement n’est pas accidentel, il est structurel. L’administration publique fonctionne par improvisation. Les services se réduisent à une mécanique fragile où l’usager est perçu non comme un citoyen, mais comme un obstacle à gérer.
À la base, la relation entre l’État et le peuple est viciée. Le citoyen n’attend plus rien des institutions sinon tracasseries, lenteurs ou extorsions déguisées. Les agents, eux, privés de moyens et de reconnaissance, s’enferment dans un corporatisme de survie.
Le droit lui-même s’effrite. Les textes juridiques, censés être le socle de la Res Publica, se transforment en instruments manipulés, interprétés selon les circonstances et les intérêts de groupes. Dans cette zone grise, prospèrent l’arbitraire, la méfiance et la contrefaçon, la gangstérisation, tout court.
Cette fracture institutionnelle se double d’une fracture sociale. Le fossé entre l’élite minoritaire et la masse démunie ne cesse de s’élargir. Le pays vit dans une asymétrie brutale : une petite minorité qui s’approprie la République, malade, et une majorité qui en est exclue.
La République du possible
Penser Ayiti, c’est aussi esquisser l’improbable, la possibilité d’une République réelle. Il ne s’agit pas d’utopie, mais de redressement. La question n’est pas de savoir si Hayti peut renaître, mais comment elle pourrait se relever, se questionne-t-on.
Trois exigences fondamentales se dégagent. D’abord c’est de réinventer l’État, car L’État doit cesser d’être une fiction pour redevenir une autorité légitime. Cela exige un retour à la rigueur procédurale, à la clarté des règles, à l’application impartiale de la loi. Car un État qui se contente d’exister sur papier n’est qu’un cadavre juridique. Deuxièmement, refonder le service public. L’administration doit passer d’une logique de survie à une logique de service. Cela implique : une digitalisation progressive des procédures ; des rapports périodiques (trimestriels) pour évaluer les performances ; une signalétique claire, accessible en créole et en français, pour réduire l’opacité ; un contrôle qualité interne et indépendant. Servir n’est pas un privilège, mais une responsabilité, ai-je appris. La République se mesure dans la dignité de l’accueil réservé aux plus humbles. Comment réconcilier l’État avec la population? La population haytienne ne demande pas l’impossible, elle réclame juste un minimum de justice, de sécurité et de respect. Restaurer la confiance exige une réforme dont on tuyaute l’éthique de responsabilité, une lutte résolue contre la corruption, une pédagogie civique et un langage de vérité je nan je (le Kreyol ayitien).
Hayti est à la croisée des chemins : persister dans l’effondrement ou s’arracher à la spirale de la déchéance. Le choix n’est pas abstrait, il se joue chaque jour dans les guichets de l’administration publique, dans les tribunaux, dans les rues de Port-au-Prince livrées à l’arbitraire de la criminalité des hommes armés.
Ce regard plongé au cœur de la machine administrative, n’a fait que confirmer l’évidence, en ce sens que la République n’existe que si elle se vit. Elle ne peut rester un texte ou un symbole. Elle doit être action, rigueur et responsabilité de toutes et de tous.
La tâche est immense, mais la lucidité est un premier pas. Écrire, penser, témoigner : voilà une manière de résister. Ayiti n’est pas condamnée à mourir de ses ruines. Elle peut encore choisir de renaître, si la volonté de servir la Res Publica l’emporte sur les calculs individuels, claniques.
joseph.elmano_endara@student.ueh.edu.ht
Formation : Masterant en Fondements philosophiques et sociologiques de l’Éducation/CESUN Universidad, California, Mexico; Juriste- Sciences Juridiques/FDSE, Communication sociale/Faculté des Sciences Humaines (FASCH/UEH)