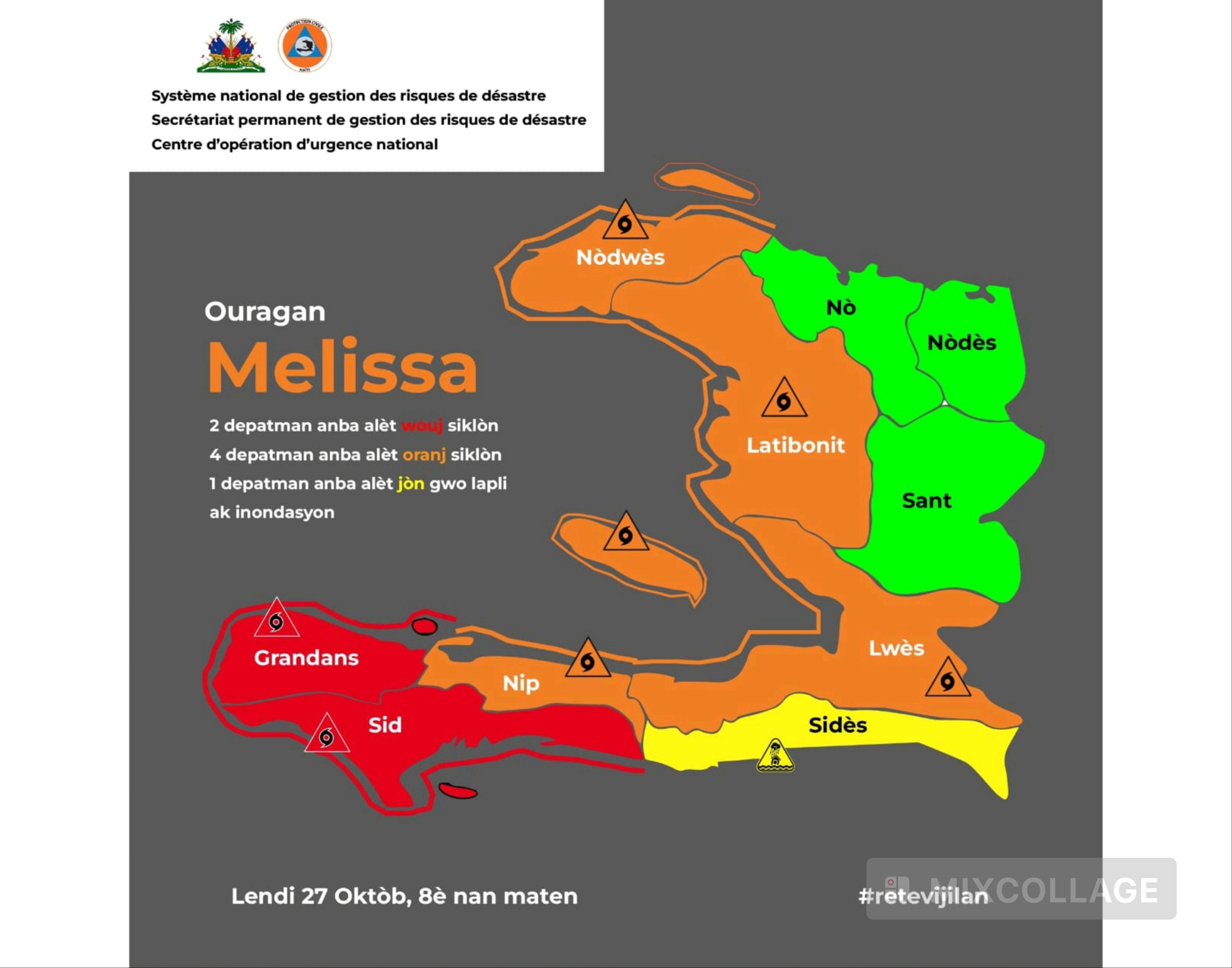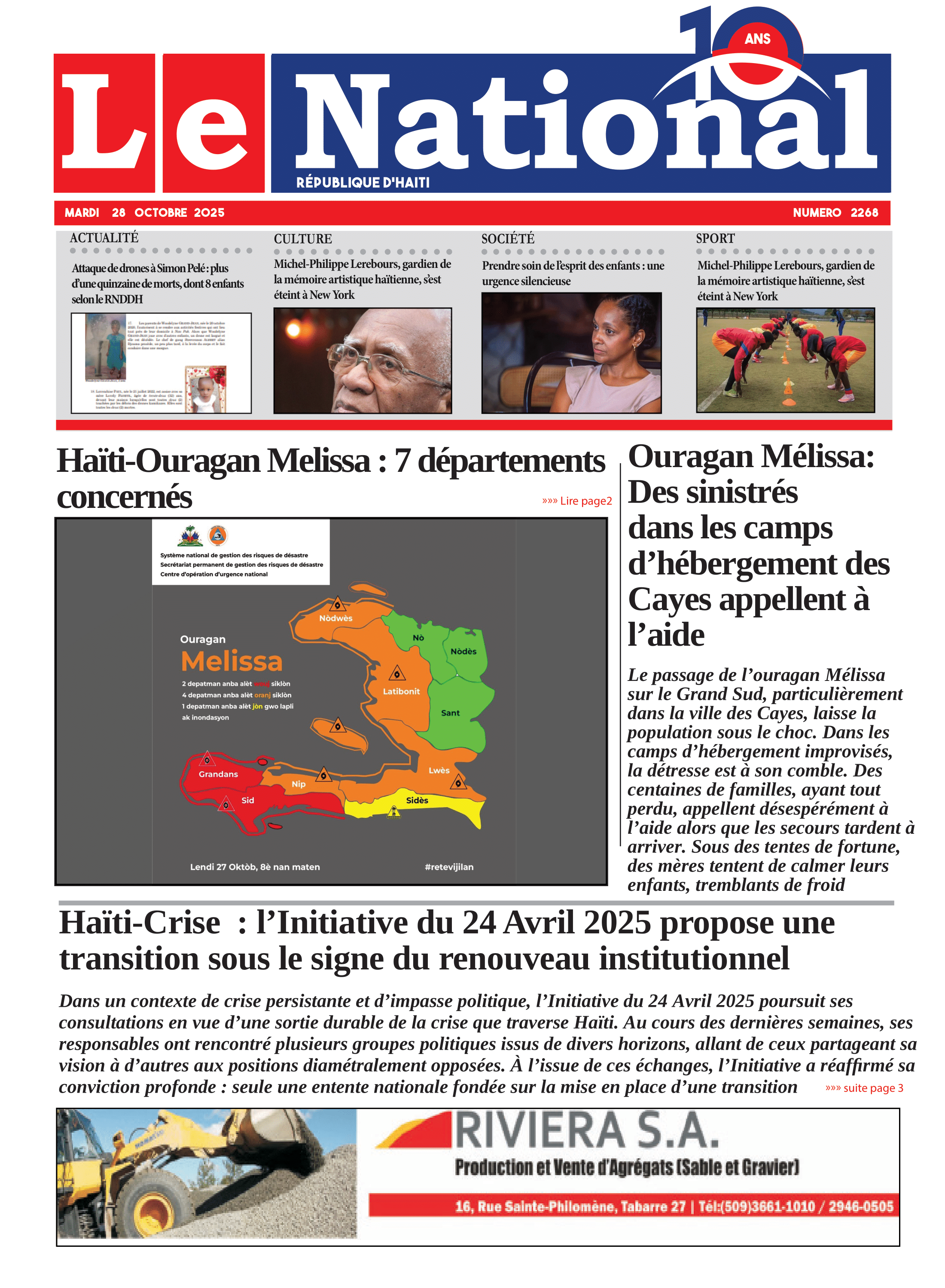La santé est le bien le plus précieux. Mais dans un contexte d’insécurité croissante, la couverture médicale déjà fragile s’effondre. Plus que jamais, les autorités sont appelées à réagir.
À Port-au-Prince, la situation hospitalière est extrêmement critique. D’après des informations issues de diverses sources, les plus récentes datant de mars 2024, seulement trois hôpitaux publics y sont encore fonctionnels : l’Hôpital universitaire La Paix (HUP), le Centre hospitalier de Petite Place Cazeau et l’Hôpital Eliezer Germain.
Sur les 21 hôpitaux publics recensés dans la région métropolitaine, 18 sont hors service en raison de l’insécurité, des pillages et de l’effondrement des services. Même des établissements majeurs, comme l’Hôpital de l’Université d’État d’Haïti (HUEH) et l’Hôpital Saint-François de Sales, ont été contraints de fermer temporairement leurs portes. Il en va de même pour l’Hôpital Canapé-Vert, l’Hôpital Bernard Mevs et bien d’autres.
Quant à l’organisation humanitaire médicale internationale française, Médecins Sans Frontières (MSF), elle gère actuellement trois cliniques mobiles qui interviennent régulièrement dans les quartiers les plus touchés par la violence urbaine. Ces unités se déplacent au moins quatre fois par semaine, avec à leur bord une équipe pluridisciplinaire composée de médecins, d’infirmiers, de psychologues, de sage-femmes et de logisticiens. Cependant, elles se concentrent principalement sur la prise en charge des blessés par balles et des urgences vitales.
Par ailleurs, on apprend qu’en plus de ces centres de soins itinérants, MSF gérait jusqu’à récemment deux structures médicales fixes : le centre d’urgence de Turgeau et l’hôpital traumatologique de Carrefour. Malheureusement, en avril 2025, l’organisation a été contrainte de suspendre temporairement ses activités dans ces deux établissements, en raison de l’intensification des violences et des attaques ciblées contre ses équipes.
Autrement dit, les trois unités mobiles de santé restent aujourd’hui les seules opérations actives de MSF à Port-au-Prince, assurant des soins de première nécessité dans des zones où les structures de santé sont fermées ou carrément inaccessibles.
Les plus riches partent
La grande majorité de la population de la capitale n’a pratiquement plus accès aux soins de santé. Les plus aisés peuvent encore se permettre d’acheter un billet d’avion pour se rendre dans l’île voisine, à Cuba ou aux États-Unis.
Comme pour aggraver la situation, l’aéroport international Toussaint Louverture est fermé depuis plus d’un an, après qu’un terroriste — venu d’on ne sait où ni pour quelle raison — a tiré sur deux aéronefs américains –Spirit Airlines et jetBlue. Ce qui a conduit les États-Unis à interdire temporairement les vols civils vers Haïti jusqu’à nouvel ordre. Dans d’autres rapports, American Airlines est également mentionnée comme ayant découvert un impact de balle sur un de ses appareils décollant de Port-au-Prince vers Miami.
Dans tout pays sérieux, un tel criminel aurait été arrêté et jugé. Mais en Haïti, où l’État s’affaiblit toujours davantage, la conséquence a été la fermeture pure et simple de l’aéroport, un scandale sans précédent. Les citoyens ignorent qui est réellement responsable de cette décision drastique et quand la piste sera de nouveau accessible.
Désormais, quiconque souhaite voyager à l’étranger doit passer par l’aéroport du Cap-Haïtien. L’an dernier, un père ayant perdu son fils de 40 ans, tué par balles, témoignait que les prix des vols variaient entre 2 000 et 7 500 dollars américains. Seules les personnes disposant de moyens considérables peuvent supporter de telles dépenses. Et encore, tout dépend des circonstances. En cas de maladie grave, il arrive souvent que les patients n’arrivent pas à destination à temps, surtout lors d’urgences où chaque minute compte. Beaucoup meurent en route.
Le drame sanitaire touche ainsi toutes les couches sociales. Même ceux qui ont accès à des médecins privés ne sont pas à l’abri du pire lorsqu’il s’agit d’urgences nécessitant des soins rapides ou des interventions sophistiquées.
Il n’y a pas que Port-au-Prince qui souffre de cette grave pénurie de soins : l’arrière-pays est tout aussi touché. Déjà très mal doté en infrastructures médicales, il ne dispose que de quelques rares centres de santé et encore moins d’hôpitaux. La population se tourne alors vers les remèdes maison, utiles pour les petits maux du quotidien ou certaines affections, mais totalement inefficaces face aux maladies graves ou aux situations nécessitant une intervention chirurgicale.
Avec la montée de l’insécurité et la fermeture de l’aéroport, l’accès aux soins est devenu encore plus difficile. Déjà confrontés à la rareté des services médicaux, les Haïtiens doivent désormais affronter une véritable crise sanitaire.
Il faut agir et vite !
La crise sanitaire en Haïti ne résulte pas seulement d’un système structurellement fragile, surtout dans les provinces, mais aussi de l’insécurité qui entraîne aujourd’hui la fermeture des rares hôpitaux de Port-au-Prince. Comment soigner quand médecins et patients craignent pour leur vie ?
Si rien n’est fait, le pays risque de devenir un immense mouroir où seuls les organismes les plus résistants survivront. Est-ce l’avenir que nous voulons pour notre société ? Une nation ne peut se bâtir sur la sélection naturelle. La santé est un droit fondamental et universel, qui doit bénéficier à tous — non aux seuls riches ou aux chanceux dotés d’un bon métabolisme. Garantir ce droit, c’est garantir la dignité et l’avenir même du pays. Il faut agir !
Certes, l’État manque de moyens et de volonté, mais cela ne saurait justifier l’inaction. Si les secteurs concernés se concertent avec sérieux et confiance, des solutions sont possibles.
Pourtant, des pistes existent. Elles passent d’abord par l’accès immédiat aux soins, grâce aux dispensaires communautaires, aux agents de santé formés, aux cliniques mobiles et, lorsque c’est possible, au recours à la télémédecine. Elles exigent aussi un renforcement des moyens structurels : une meilleure organisation des hôpitaux, le développement de partenariats avec des ONG, la diaspora et les pays voisins, ainsi que la création d’un fonds de santé populaire capable d’assurer l’approvisionnement en médicaments essentiels et la couverture des soins d’urgence.
Enfin, elles supposent de sécuriser l’espace sanitaire : faire des centres de santé des zones neutres protégées, instaurer des couloirs humanitaires pour soignants et ambulances, et mobiliser la société civile dans des réseaux de vigilance. Mais rien ne sera possible sans une riposte efficace à l’insécurité. Cela suppose une meilleure coordination entre forces de l’ordre et initiatives locales de protection (genre « bwa kale »[1] par exemple), afin de garantir la sécurité des patients et du personnel médical face aux gangs.
Car protéger la santé, c’est protéger la vie, et sans vie il n’y a ni avenir ni nation. Sans la santé, il n’y a ni éducation, ni économie, ni futur. Laisser le pays sombrer dans un immense mouroir n’est pas une fatalité : c’est un choix politique. Et ce choix, la société doit le refuser.
David Sidney
Candidat au master en Santé publique
Orlando, Floride
[1] Forme d’exécution sommaire (par le feu) en vigueur dans les quartiers populaires à l’encontre de gens présumés être des bandits, des membres de gangs armés.