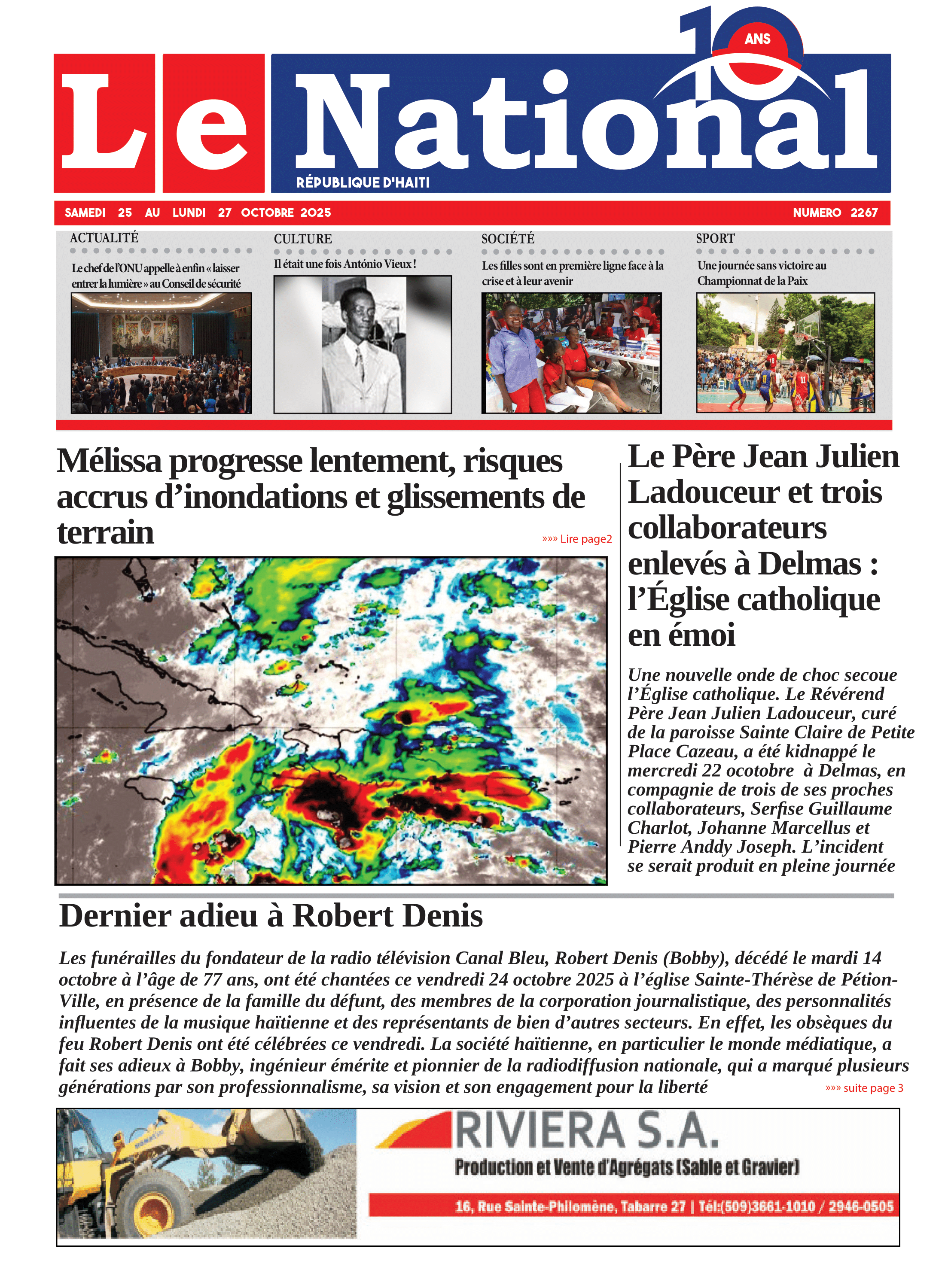Résumé
Dans un pays où les pouvoirs provisoires semblent devenir permanents, la présence d’un Conseil Présidentiel de Transition (CPT) depuis 2024, suscite des interrogations alarmantes quant à l’impératif de reconfigurer l’architecture de l’Etat. Un CPT qui devrait, en temps normal, travailler avec assiduité pour le retour à l’ordre démocratique, met à nu les contradictions morales et institutionnelles d’une élite en panne d’haitiannité. Cet article propose de relire la situation à la loupe de l’œuvre de Frédéric Marcelin, Thémistocle Épaminondas Labasterre, roman publié en 1901. Dans ce roman, Marcelin dresse le portrait d’une société haïtienne déchirée entre ambition, corruption et recherche de légitimité. En croisant la fiction et la réalité politique contemporaine. Nous tenterons de montrer que les critiques adressées par Marcelin à la classe dirigeante d’hier résonnent tragiquement dans le fonctionnement du CPT d’aujourd’hui.
Introduction générale
Le Conseil Présidentiel de Transition (CPT) a pris naissance dans un contexte d’urgence nationale. Haïti, sans président depuis l’assassinat de Jovenel Moïse dans la nuit du 6 au 7 juillet 2021, cherche à se reconstruire sur des bases fragiles telles que: absence d’institutions stables, déséquilibre économique, méfiance populaire, violence endémique, en un mot le disfonctionnement littéral de l’Etat. Dans ce vacuum politique, le CPT, qui regroupe des entités de diverses tendances de la vie nationale, devait traduire le point d’équilibre entre les forces sociales et politiques du pays. Toutefois, cette mission se transforme en une réalité vieille de plus d’un siècle : celle d’une élite qui confond service public et privilège personnel. Ainsi, cette situation invite à regarder le pays à la loupe de Frédéric Marcelin. Écrivain et homme d’État, il a, dans Thémistocle Épaminondas Labasterre, mis à nu la psychologie des élites haïtiennes. À travers le personnage Labasterre, homme éduqué, ambitieux mais moralement faible, Marcelin montre comment la quête du pouvoir peut se transformer en piège moral. Sa plume, à la fois ironique et lucide, dénonce une classe politique qui parle au nom du progrès historique tout en détruisant les fondements même de la République.
La question centrale qui guide cet article est donc la suivante : comment la critique marcelinienne du pouvoir peut-elle aider à mieux appréhender les contradictions et les limites du CPT dans l’Haïti contemporaine ? Nous estimons que les échecs répétés du leadership haïtien trouvent leurs racines dans un déficit moral et civique déjà identifié par Marcelin depuis le début du XXᵉ siècle.
Frédéric Marcelin et l’éthique du pouvoir
Fréderic Marcelin (1848–1917) appartient à une période importante dans la littérature haïtienne « génération de la ronde ». La littérature, pour les écrivains de cette période, constitue un instrument de réforme sociale. L’œuvre romanesque de Marcelin, à caractère économique et morale, pose un diagnostic sévère sur la société haïtienne post indépendante. Dans « Thémistocle Épaminondas Labasterre », il dépeint une élite urbaine qui a perdu tout sens du devoir envers la chose publique. La réussite, dans ce cas est mesurée à l’aune de la richesse, du rang social et du réseau d’influence, non à celle du mérite et du travail.
Selon Marcelin, la faillite de l’État découle d’une crise de conscience. Sans éthique, le pouvoir devient une mascarade. Le progrès, loin d’être collectif, se réduit à une accumulation d’intérêts privés. L’État, dont son rôle est de protéger la nation, devient un instrument guidé par une minorité. Dans cette perspective, les seules et vraies réformes possibles sont celles de la morale, de la conscience citoyenne et celle reflétant le sens du bien commun.
Le CPT et la reproduction du syndrome de Labasterre
Selon l’accord du trois (3) Avril portant la création du Conseil Présidentiel de Transition (CPT), l’urgence, en fait les discours s’orientaient vers la rupture ; toutefois dans les faits, cela traduit très visiblement la continuité d’un système politique basé sur le partage de pouvoir, les alliances temporaires et la méfiance réciproque. Derrière les discours d’unité et de réconciliation nationale, se cachent les mêmes logiques d’intérêts particuliers que celles que Marcelin dénonçait il y a plus d’un siècle.
Dans le roman, Labasterre incarne un type d’homme public prisonnier de ses ambitions. Il veut servir la patrie, mais finit par servir ses désirs de reconnaissance. De la même manière, nombre de figures de la transition affichent la volonté de sauver la nation, tout en reproduisant les pratiques du passé : promesses creuses, recherche d’appuis étrangers, et incapacité à dialoguer avec le peuple.
Chez Marcelin, la corruption n’est pas seulement financière, elle est culturelle. Elle consiste à trahir l’idée même du service public. Le CPT, par ses divisions internes et ses compromis incessants, révèle cette même fragilité : un pouvoir sans conviction, une autorité sans vision. Ainsi, le drame du CPT n’est pas uniquement politique ; il est éthique. La transition, au lieu d’être un moment de refondation, devient un espace d’attente, une sorte d’entre-jeux où personne ne veut vraiment agir. Dans Labasterre, Marcelin écrit en substance que “la médiocrité morale précède la ruine des États”. Cette phrase pourrait, aujourd’hui servir de diagnostic à la situation haïtienne.
En conclusion, relire Thémistocle Épaminondas Labasterre ans le contexte du Conseil Présidentiel de Transition (CPT) actuel, c’est comprendre que l’histoire d’Haïti se répète parce que les élites n’ont jamais rien tiré du passé. Marcelin n’a pas seulement écrit un roman, il a dressé un miroir dans lequel se reflètent, encore aujourd’hui, nos contradictions. Le CPT, qui devrait être le symbole d’un renouveau, dessine la faillite morale et prend sa forme.
Désormais, comme Labasterre, il devient le théâtre d’une ambition sans âme. L’œuvre de Marcelin nous rappelle que la vraie transition n’est pas politique, mais intérieure. Elle commence là où le pouvoir se transforme en service, et où l’intérêt national prime sur la vanité individuelle.
Frantz Sinoble
Bibliographie
Marcelin, F. (1901). Thémistocle Épaminondas Labasterre. Port-au-Prince : Imprimerie nationale.