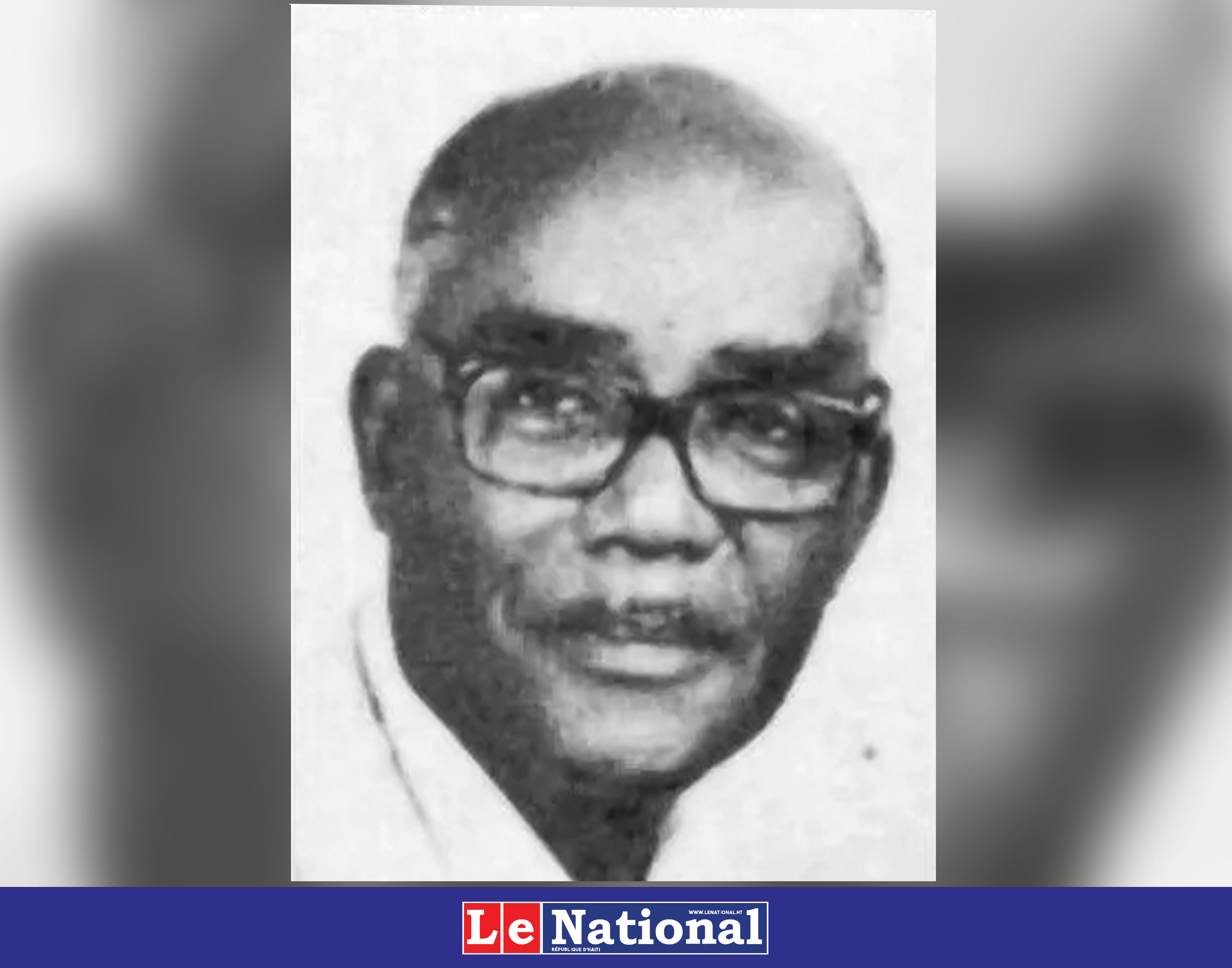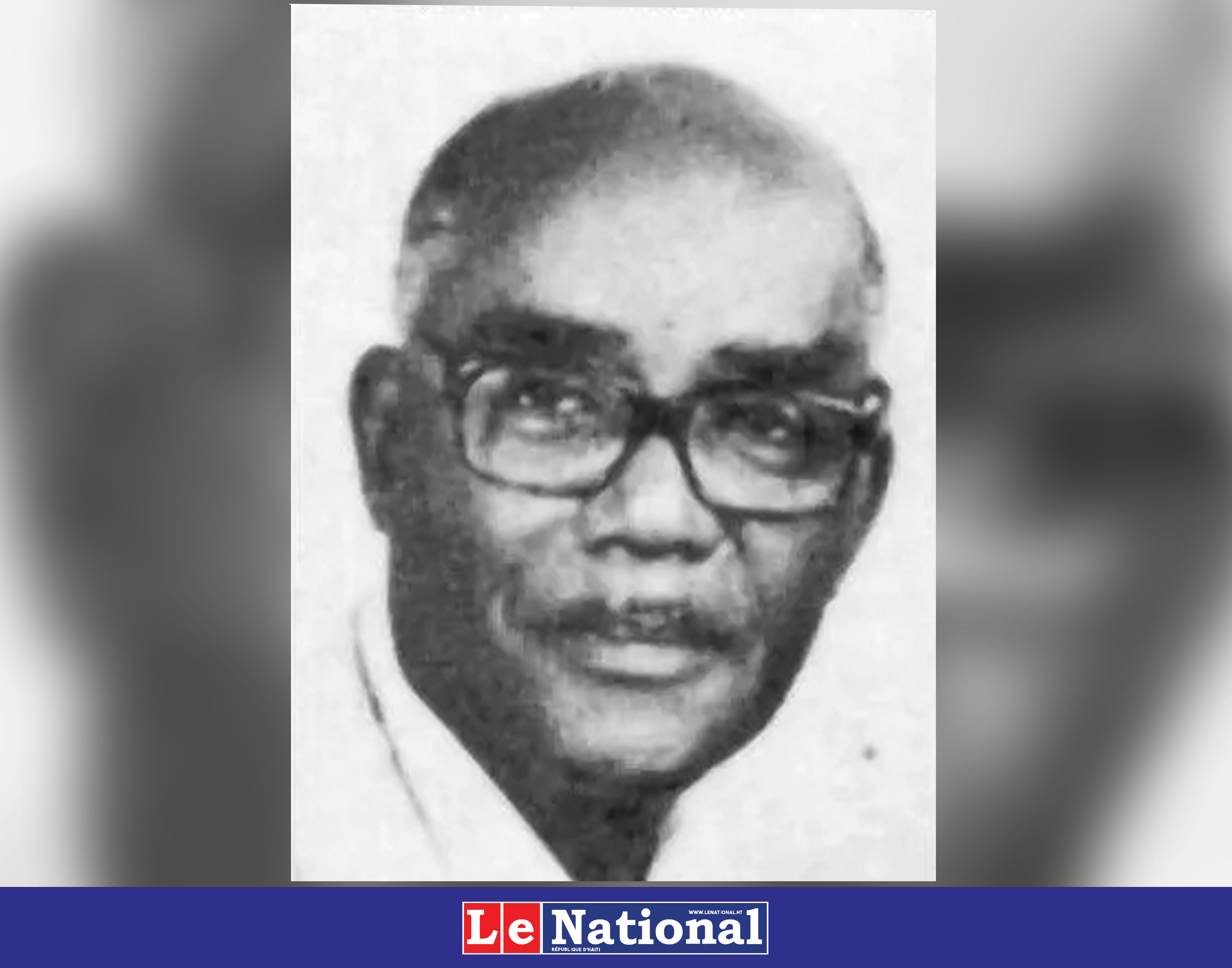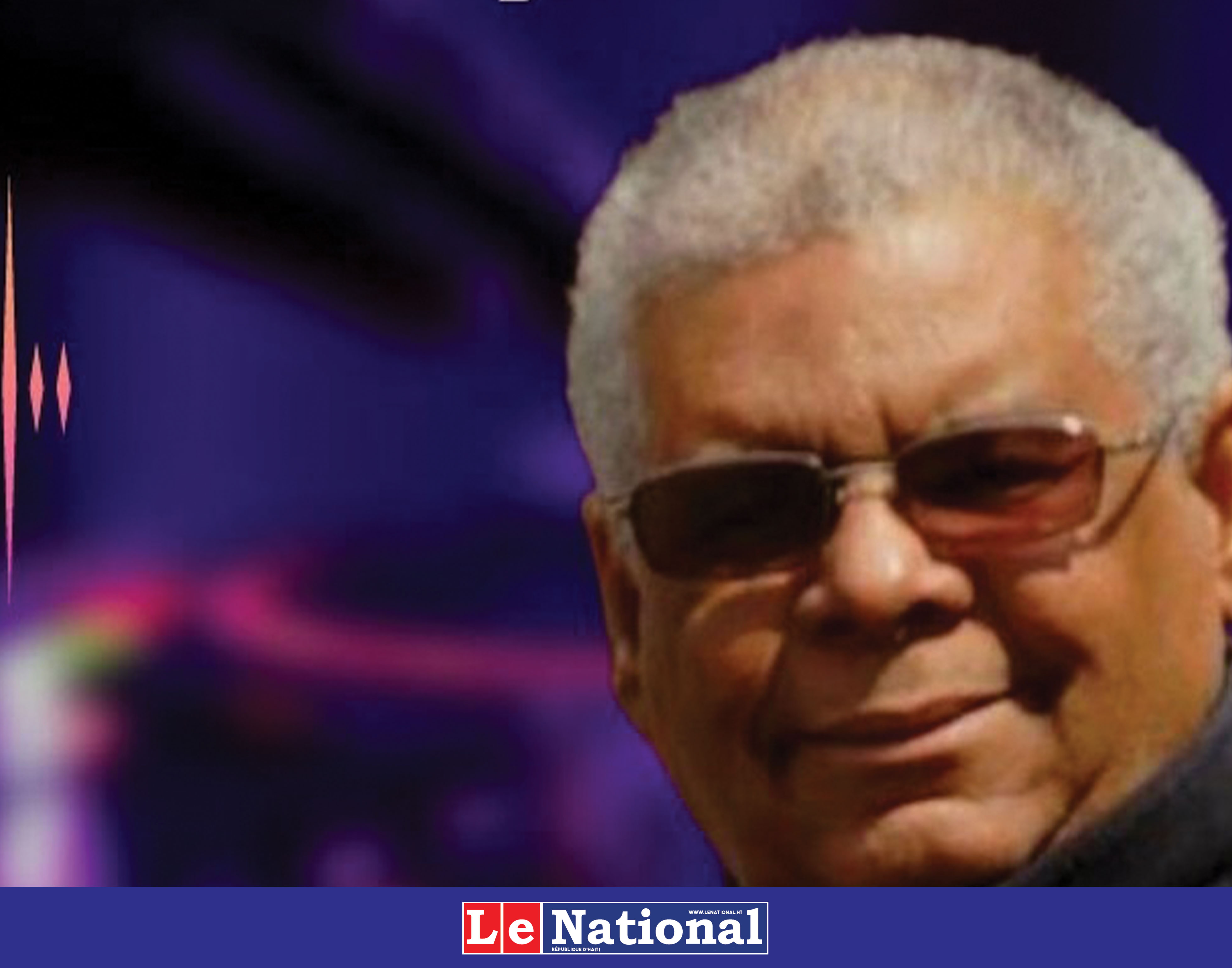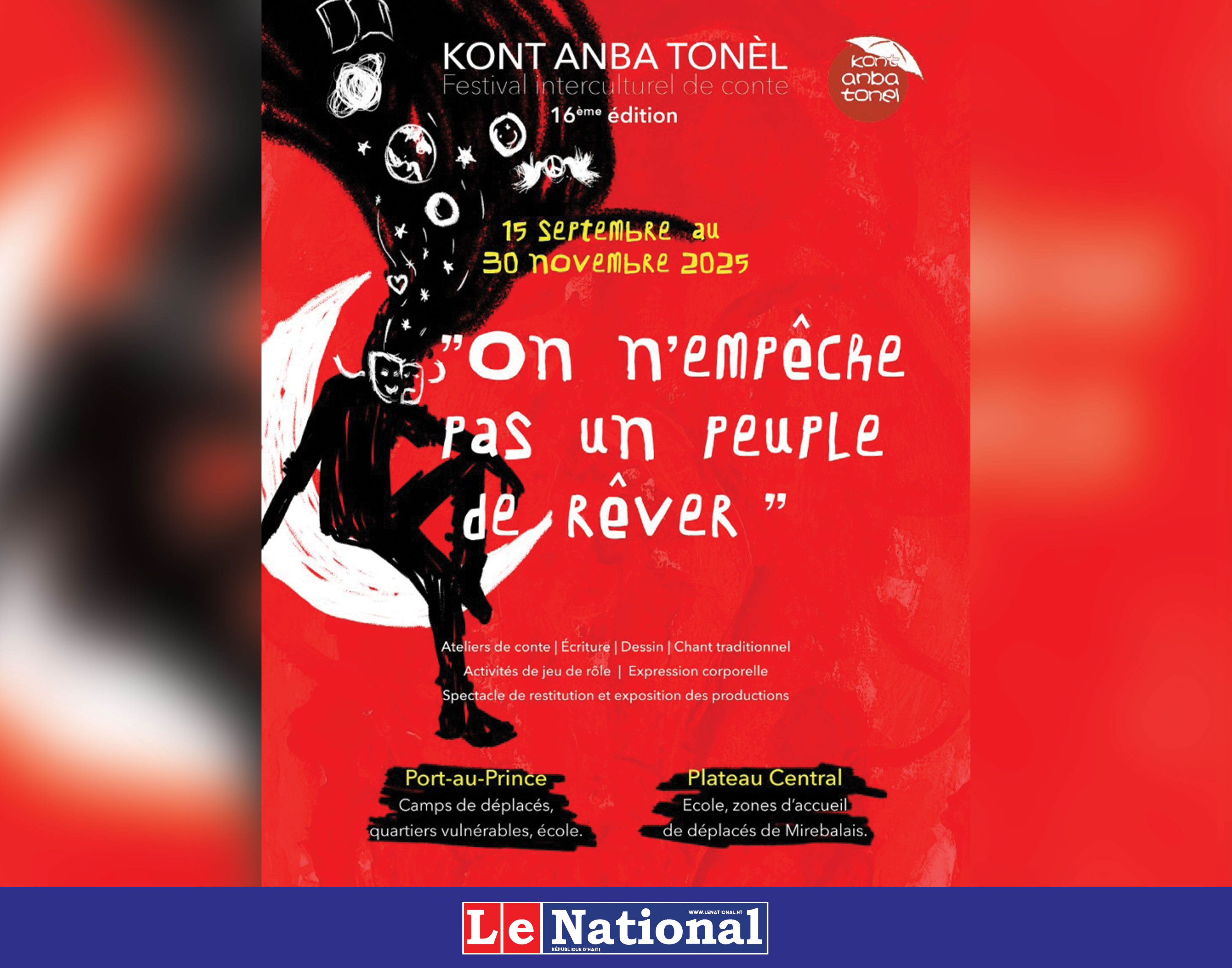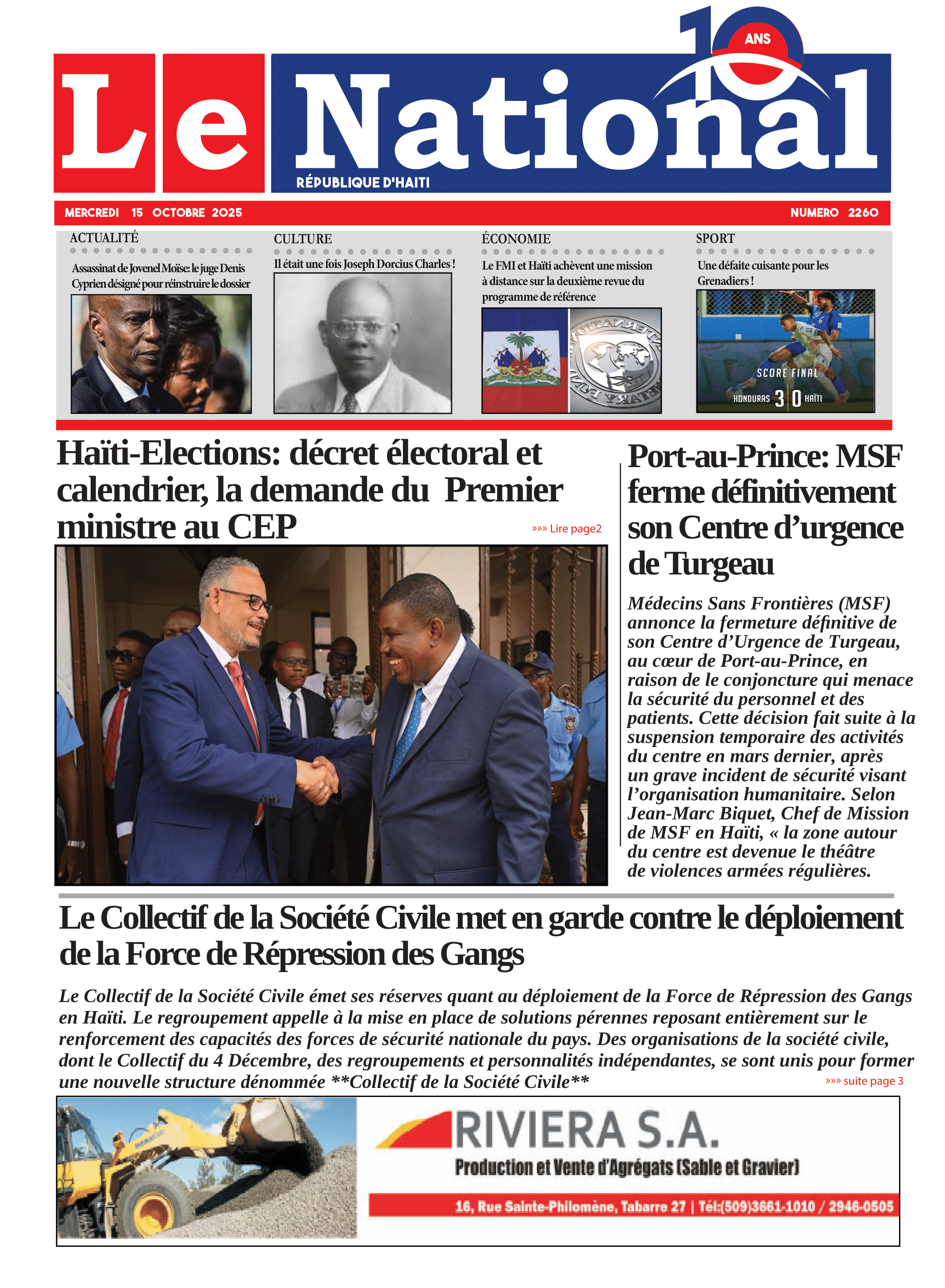Roger Hénec Dorsinville (11 mars 1911 – 12 janvier 1992) fut un véritable homme-orchestre de l’histoire haïtienne, un intellectuel aux mille talents qui fit de sa vie une symphonie. Dans la bibliothèque de son père, Henec Dorsainville, journaliste renommé, bibliothécaire et directeur du journal L’Essor, il dévorait les livres comme un marin avide d’horizons nouveaux.
Sa soif de savoir était torrentielle : il lisait Hugo comme on partage le pain quotidien, et Mallarmé comme un vin enivrant. Dans un entretien accordé à un journal africain, il confia que son horizon n’était pas une ligne, mais une muraille de livres, une forêt bruissant de pages. Très tôt, il sut qu’il serait poète — ou du moins, un tisseur de métaphores, lançant des lianes de mots au-dessus des gouffres.
Journaliste, professeur, poète, romancier, diplomate, homme politique, militaire formé à l’Académie de Port-au-Prince, dramaturge et essayiste : il fut tout cela à la fois, un arbre aux mille branches. Noiriste sincère, il voulut élever les masses déshéritées comme on dresse une torche dans la nuit pour éclairer les chemins invisibles.
Sa carrière diplomatique fut une symphonie de rigueur et de passion. Il la qualifiait lui-même de « pèlerinage diplomatique », se percevant moins comme un fonctionnaire que comme un marcheur de l’histoire, porteur des flammes ardentes de 1804 — ces braises toujours vives de la première république noire. Chaque pas dans le monde était, pour lui, une manière de rappeler que le combat de Vertières n’était pas clos, mais qu’il se poursuivait désormais dans les chancelleries et sur les tribunes internationales.
Retour aux sources
Ce pèlerinage diplomatique le mena jusqu’en Afrique, lui qui tenait les ancêtres pour des étoiles tutélaires guidant ses pas. Et quel symbole plus éclatant que sa nomination au Liberia, ce pays frère né comme un écho d’Haïti, façonné par les rêves et la volonté des dirigeants haïtiens du XIXᵉ siècle ? En foulant le sol libérien, Dorsinville n’était pas seulement ambassadeur : il devenait passeur de mémoire, reliant deux continents par le fil invisible du sang versé et du rêve noiriste.
Le voilà sur le continent originel, mariant poésie et diplomatie, mêlant la rigueur des chancelleries à l’émerveillement romanesque d’un retour aux sources. Mais avant cela, il avait parcouru l’Amérique latine des dictatures, observant les atrocités commises par ces hommes en kaki qui imposaient la peur comme une nuit sans lune. Ses carnets résonnaient de silences contraints, de cris étouffés et de blessures humaines.
Pourtant, Dorsinville ne fut jamais un simple duvaliériste. Comme beaucoup de sa génération, il était animé par le sentiment d’une injustice sociale implacable, qui écrasait la masse laborieuse de ses compatriotes. Bourgeois socialiste, il portait le fardeau d’un idéal trahi, confisqué par une minorité arrogante s’accaparant à la fois la richesse et la parole. C’est dans cette tension permanente — entre le pouvoir qu’il côtoyait et la justice qu’il appelait de ses vœux — que se forgea son œuvre : témoin, acteur et poète de son temps.
Homme aux mille visages, il brillait comme une lumière insolente sous le soleil de minuit tropical, tenant entre ses mains un recueil de poésie dont il tressait les vers comme une guirlande de feu. Écrivain-diplomate, poète dandy de haute voltige, il séduisait autant par l’éclat de son intelligence que par la flamboyance de sa présence. Maryse Condé le décrivit comme un Don Juan littéraire, au magnétisme irrésistible, capable de susciter chez les femmes de véritables tempêtes intérieures.
Treize romans à son actif
Son œuvre romanesque, riche de treize titres, embrasse tous les domaines de l’existence : les contradictions sociales, les fractures raciales, la violence politique, mais aussi l’amour, l’espérance et la dignité des humbles. Chaque récit est une pierre ajoutée à l’édifice de la mémoire collective.
Son aventure théâtrale débuta très tôt avec Barrières, pièce en trois actes qui fit scandale et se joua à guichets fermés à Port-au-Prince. Franc-tireur social, Dorsinville y dénonçait les préjugés de couleur et mettait en scène deux sociétés coexistant dans un même pays, séparées par des murs invisibles.
Plus tard, des romans comme Kimby explorèrent la condition de l’individu pris dans un ordre social rigide ; Mourir pour Haïti résonna comme une déclaration d’amour tragique à la patrie ; Les Vèvès du Créateur plongea au cœur de l’imaginaire spirituel haïtien, convoquant le vaudou comme langage de mémoire et d’identité. D’autres œuvres, telles que La Dernière goutte d’eau ou Marche arrière, témoignent de sa quête constante : comprendre comment l’homme haïtien, face à ses contradictions, lutte, espère, chute et se relève.
À côté de ces fictions, l’ancien plénipotentiaire au Sénégal nous a laissé plusieurs essais majeurs. Toussaint Louverture ou la vocation de la liberté (1965, réédité en 1987) restitue le héros de 1804 dans toute sa grandeur. Publié en 1962, Le Grand devoir est un poème épique retraçant la tragédie du Nouveau Monde, marquée par l’esclavage et le pillage des richesses d’Haïti, alors soumise à la dictature des Duvalier.
Mais c’est sans doute dans la poésie que Dorsinville livra la part la plus intime de son âme. La première fois que je lus un recueil de lui, c’était en Haïti, dans les années 1980 : Pour célébrer la terre, suivi de Poétique de l’exil — deux recueils comme deux respirations, l’un enraciné dans le sol natal, l’autre tourné vers l’arrachement.
Dorsinville n’était pas seul à emprunter cette voie : sous la dictature héréditaire des Duvalier, l’exil devint le pain quotidien d’une génération entière d’écrivains déracinés. Lui aussi, après avoir longtemps représenté Haïti comme diplomate, finit par quitter le navire. Sa poésie porte dès lors cette double empreinte : la ferveur de l’appartenance et la douleur de l’exil. De Pour célébrer la terre (1955) à Le Grand devoir (1962), jusqu’à Pour célébrer la terre, suivi de Poétique de l’exil (1972, réédité par Mémoire d’Encrier en 2005, son œuvre poétique demeure le chant d’un homme qui n’a jamais cessé de porter son pays en lui, même loin de ses rives.
Cette génération d’écrivains-diplomates haïtiens des années 1950 mérite d’être redécouverte. Trop souvent relégués aux marges de la mémoire nationale, ils furent pourtant les éclaireurs d’une diplomatie où la plume et la parole avaient la même force que les traités et les signatures. Nos étudiants en relations internationales et en diplomatie doivent savoir qui ils furent, car on ne bâtit pas l’avenir dans l’oubli de ceux qui ont tenu la flamme. Ne pas les enseigner, c’est consentir à l’amnésie ; les redécouvrir, c’est rallumer la certitude que la diplomatie peut être à la fois art, combat et poésie.
Ainsi se révèle Roger H. Dorsinville : journaliste et poète, diplomate et romancier, essayiste et dramaturge, Don Juan flamboyant et noiriste sincère. Il fut tout cela à la fois — une lumière qui, au cœur de la nuit haïtienne, n’a cessé de tresser des mots comme des flammes, pour rappeler que 1804 n’était pas seulement une date, mais un héritage vivant à porter au monde.
Maguet Delva
France