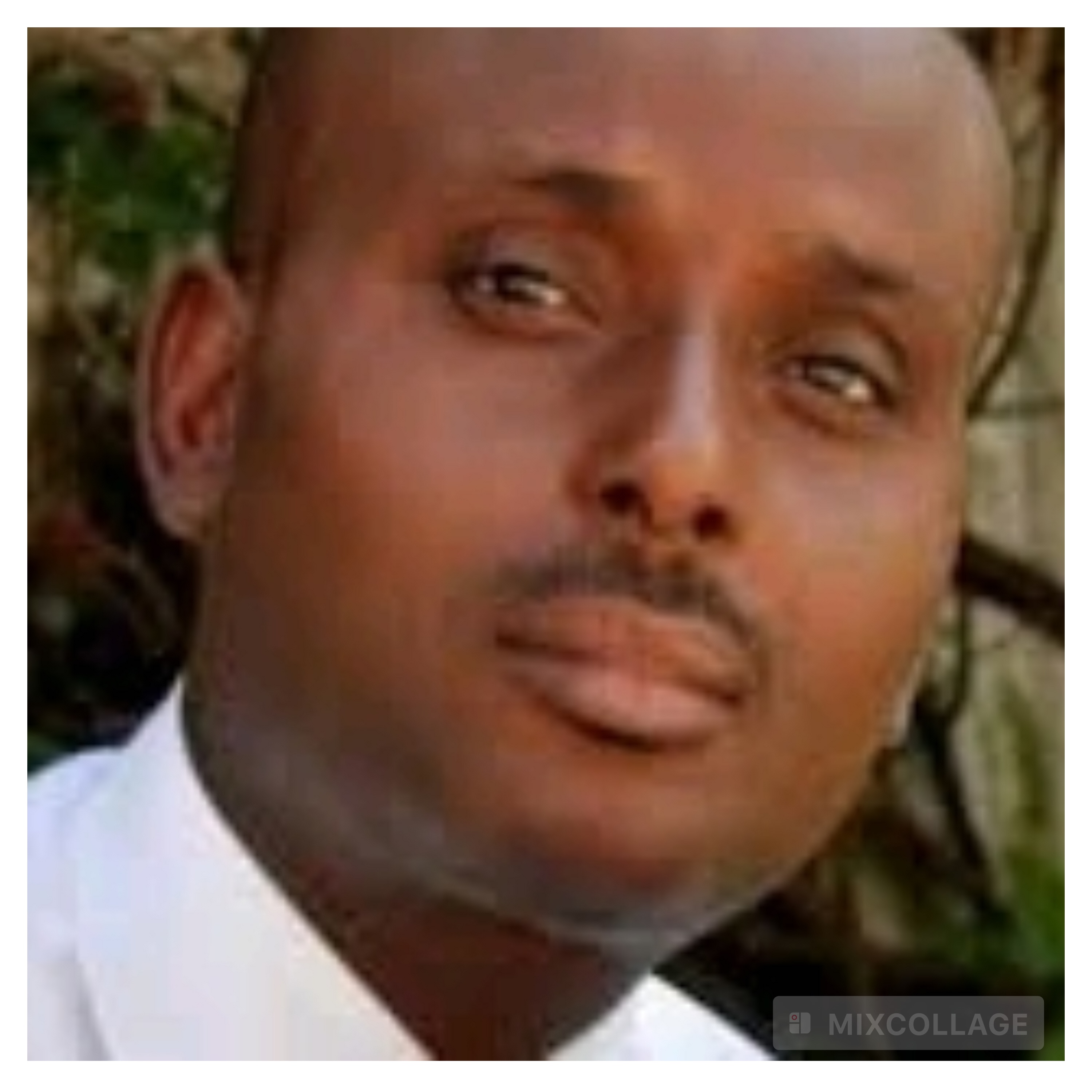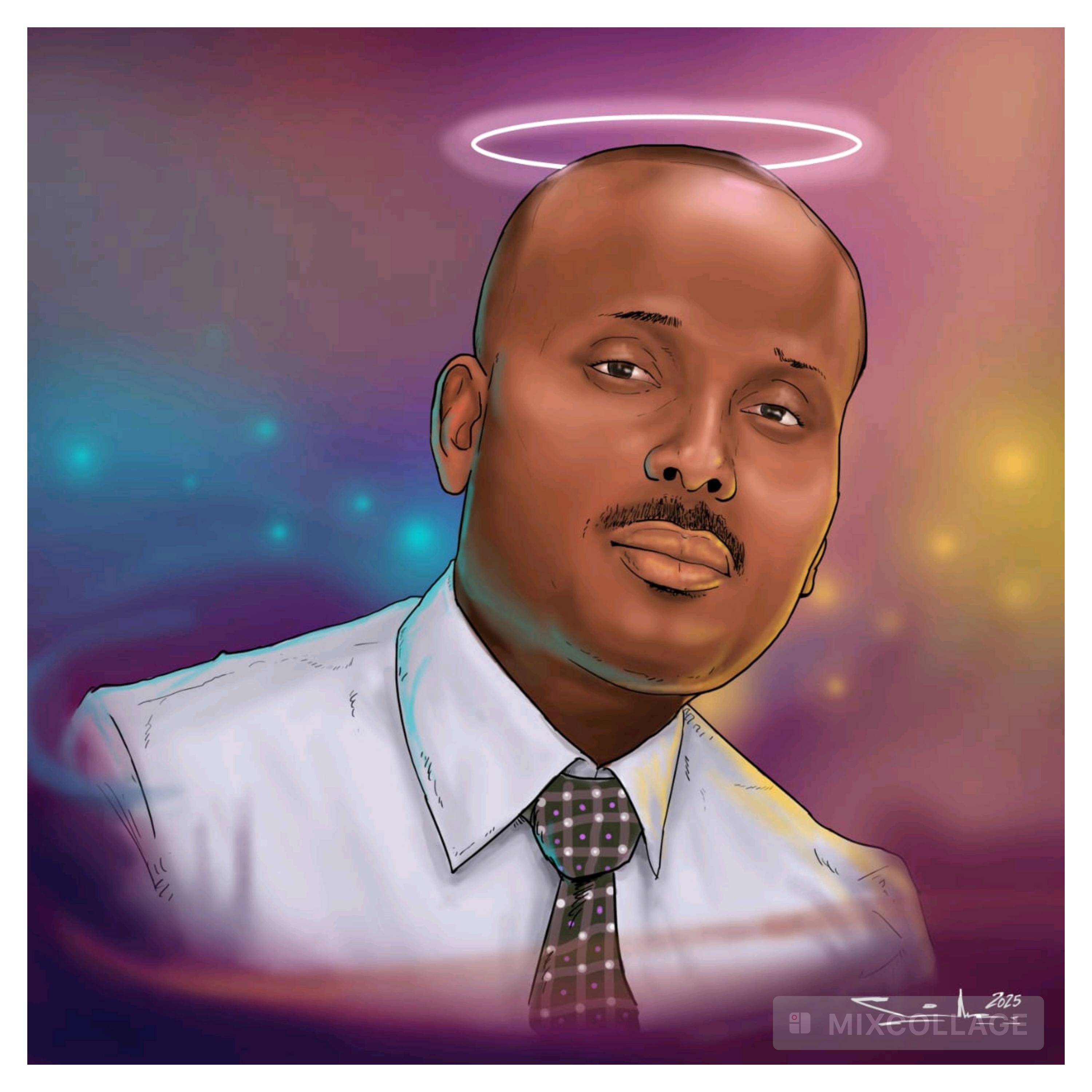D’un côté, des collines rocailleuses scandaleusement dénudées et de l’autre des bas-fonds inondables et très mal habités par des Haïtiens, des bêtes et leurs déchets. Hazel, Inez et plus près de nous Jeanne, Matthew et Mélissa ont mis en lumière, de la plus cruelle des manières, l’extrême vulnérabilité du territoire haïtien de par sa position géographique et par la dévastation (depuis le littoral jusqu’aux pics montagneux) de son environnement. Et à chaque début de la saison cyclonique, l’inquiétude et l’anxiété deviennent légitimes. Trop souvent, ce qui est de l’ordre du malheur devient banalité.
Comme si la République ne peut pas se renouveler sans compter les morts et faire, de manière récurrente, l’évaluation des pertes et des dégâts. Exercice, ordinairement suivi de folles prétentions, d’intenses prières et de grandes promesses.
Si c’est un don d’espérer, la collection des désillusions n’aide pas à imaginer des lendemains meilleurs. En Haïti, nous sommes les habitants d’un territoire qui ne se contente pas d’être dangereux. Il suffit que la nature se mette en colère, l’espace haïtien devient létal. Le pire est que la négation du risque chez la population est un paramètre considérable à prendre en compte.
Alors que la saison cyclonique avance vers sa fin, d’autres difficultés sont à prévoir.
Il est tout à fait louable de produire des plans de gestion, mais il est actuellement urgent de convaincre la population à adopter un comportement responsable et salvateur. Il est difficile de faire respecter les lois et l’autorité en Haïti. Soit ! Toutefois, la peine à venir risque d’être sans secours.
La Rédaction