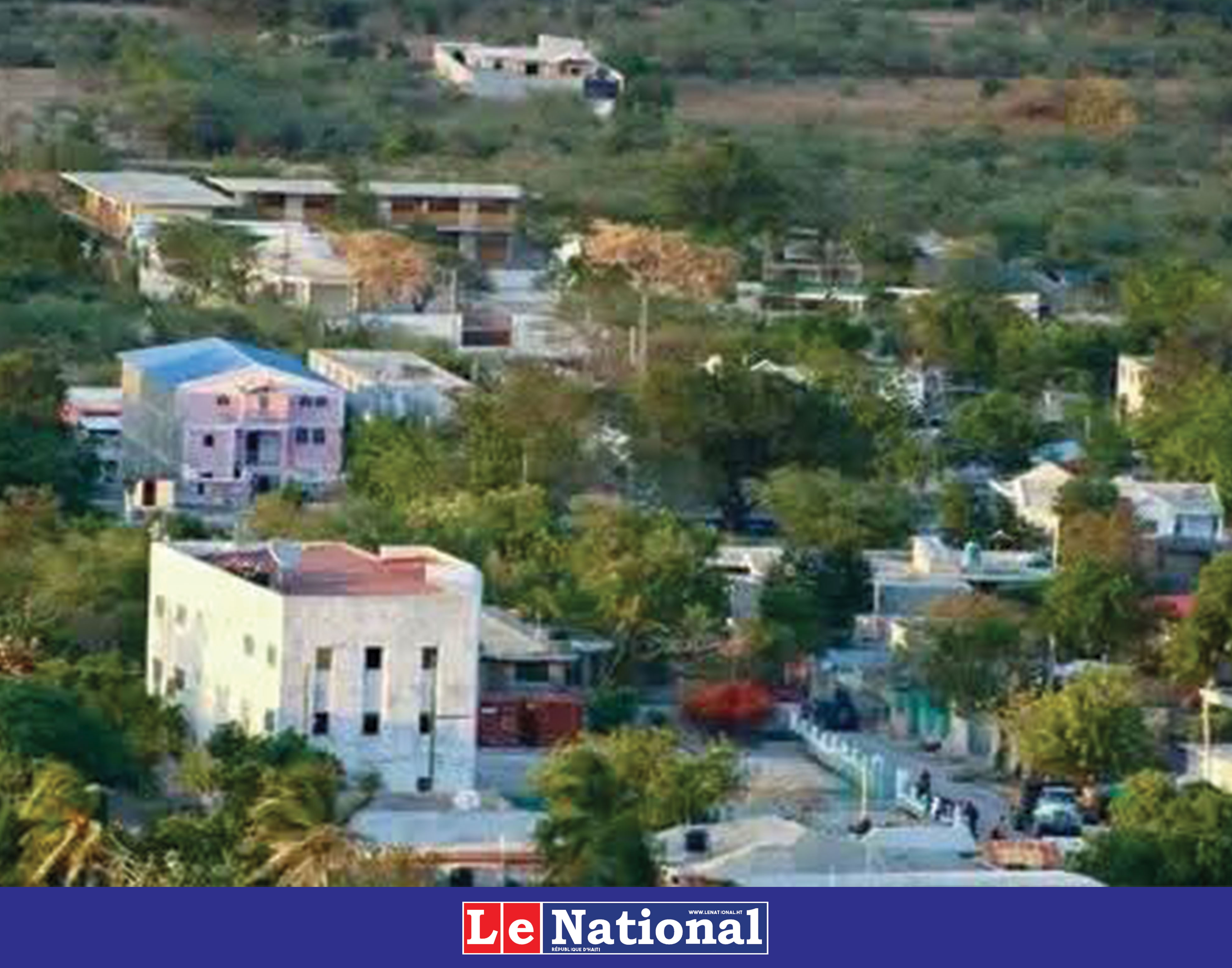À l'opposé de ce qui se fait dans le régime de pseudo démocratie haïtienne, l'exigence ultime de toute démocratie fondée sur les principes des droits de l'homme et du citoyen, c'est la vérité comme fondement de la communication entre les citoyens et entre ceux-ci et les gouvernants. Cette vérité doit favoriser la confiance et le droit à la justice dans les situations de dommage et de préjudice. C'est pourquoi le serment qui engage à témoigner au nom de la vérité et l'aveu dans le procès juridique sont nécessaires pour garantir la certitude sur l'innocence et la culpabilité des justiciables. Mais, dans les démocraties où les citoyens, qu'ils aient le statut du gouverné ou celui du gouvernant, ne sont pas vertueux ou du moins continents pour refouler leurs vices, l'innocence et la culpabilité n'ont pas de frontière et sont souvent des objets de confusion et de la mauvaise foi. Et cela s'explique par des causes liées aux passions et aux intérêts égoïstes et mesquins des hommes et des femmes qui vivent dans ces formes caricaturées de la démocratie. Quelles sont donc ces causes pour les analyser et comprendre leurs effets négateurs pour le respect des droits du citoyen et pour la promotion d'une démocratie fondée sur la transparence des comportements de ses promoteurs et ses bénéficiaires?
La démocratie semble, au regard des principes qui doivent la fonder, s'affirmer contre la raison d'État qui peut se passer de la transparence et de la vérité. C'est pourquoi, il est souhaitable de trouver cette correspondance platonicienne entre les vertus des citoyens et celles de la cité, et la vertu des gouvernants. Cela rend improbable tous les actes qui pourraient menacer la sureté de l'état, et donc engager les autorités dans la voie détournée des principes du droit et de la transparence, pour agir au nom de la raison d'État, avec tous les moyens artificieux que cela implique.
Dans le cas d'Haïti, où les citoyens ont reçu une éducation lacunaire des vertus et où la morale et la justice ne peuvent contribuer à favoriser le comportement de continence chez eux, se soustraire des normes légitimatrices de l'action sociale à une récurrence. Cette déviance, susceptible de créer l'état d'anomie sociale, comme cela est observable dans certains points géographiques d'Haïti, est néfaste pour l'harmonie entre le commandement et l'obéissance, l'action gouvernante et la confiance citoyenne, entre l'acteur du pouvoir et la source de sa légitimité. Aussi, la nécessité d'un regard de vigilance et d'un discours critique sur les réactions du pouvoir étatique, face à cette situation de conflits qui s'enracinent dans un mode d'organisation sociétale et des mécanismes défectueux de socialisation, doit être urgente et permanente. Malheureusement en Haïti, cette vigilance et cette critique n'existent guère. C'est pourquoi les réactions de l'état contribue plus à criminaliser des comportements dont il est le principal responsable. Des comportements qu'il devrait sanctionner pour les corriger à des fins de réintégration sociale.
En effet, dans une société où il n'est pas créé les conditions pour l'applicabilité des lois, avec un état de pauvreté et d'exclusion presque généralisé, les déviances sont imminentes, et critiquer l'irresponbilité de l'état et des élites politiques et économiques devient une responsabilité du citoyen et de l'intellectuel organique qui sont doublement menacés. D'abord, par les crimes que provoque les déviances, ensuite par la répression qui peut créer des zones d'incertitude. Absence de sentiment de sécurité dans les milieux de mobilité, angoisse existentielle, perte de confiance dans les élus. En effet, nombreux sont les citoyens du secteur démocratique et populaire, l'usage de cette expression devant être pris dans un sens différent de celui du SDP qui avait une actualité politique dans la période de protestation contre les présidents Michel Joseph Martelly et Jovenel Moïse, qui sont les victimes des violences des groupes armés et pourchassés de leurs quartiers. Sans omettre de souligner qu'ils aussi les principaux victimes de l'irresponsabilité des gens qui sont au pouvoir, dans les couloirs de l'opposition, et le secteur économique.
Incertains et méfiants vis-à-vis d'une classe politique et économique, et délaissés par une intelligentsia haïtienne inactive, ces gens sont tentés d'obéir aux groupes armés qui les invitent à retourner dans les quartiers qui ne sont pas récupérés et pacifiés par les forces de l'ordre. Cette situation remet en cause l'ordre démocratique haïtien et les acteurs qui doivent le protéger, avec un contexte qui laisse la place à la dialectique des armes comme arguments. Une situation qui ne justifie point l'idée qu'il y aurait une autorité étatique affirmée et respectée, pouvant donc créer les conditions d'une obéissance citoyenne.
Mais, cela s'explique par des logiques politiques contribuant à fabriquer ceux et celles qui devraient répondre au statut des citoyens intégrés et participants à un ordre policier démocratique, en des ennemis d'État. Et le recours exclusif à la répression traduit une incompétence du pouvoir public en matière d'ingénierie sociale, et aussi l'impossibilité du dialogue entre, d'abord les gouvernants mandatés qui ont été en perte de légitimité, puis les gouvernants de facto et les gouvernés éreintés par la succession des transitions. Le sociologue Jean Casimir explique cette difficulté à créer le dialogue entre l'état, les élites, et les citoyens qui recourent à la violence comme argumentaire pour exprimer leurs revendications. D'autant plus qu'ils n'ont jamais eu accès au droit d'être scolarisés pour développer les compétences discursives nécessaires pour la communication permanente en régime de démocratie. Sans oublier qu'ils n'ont jamais été capitalisés par des emplois pour ne pas se risquer au monnayage politique, combinant la corruption, les trafics d'influence, et l'instrumentalisation du leadership communautaire (OCB, OP, Militant populaire) et la délinquance juvénile.
Sans donner lieu à la justification de la violence illégale et illégitime, il faut comprendre les comportements criminels des groupes armés en Haïti par un détour qui permet d'analyser et de rendre intelligible les artifices de la démocratie haïtienne. En effet, comme le développement ne peut se confondre à la croissance économique qui doit être un outil pour y arriver et qui est originaire d'une forme de l'économicisme libéraliste, la vision trop politicienne de la démocratie met en marge les nécessités économiques et sociales, sans lesquelles voter demeure un acte sans effet sur la vie quotidienne des citoyens et des citoyennes. Donc, une démocratie qui renouvelle un personnel politique, sans mettre en place les mécanismes pour satisfaire les besoins sociaux et économiques, ne peut être que génératrice de chômeurs, de mendiants, de délinquants, et de désœuvrés, susceptibles d'être instrumentalisés au profit des intérêts contraires à l'intérêt général. Elle transforme ses citoyens en ennemis d'état pour justifier l'usage du monopole de la violence légale et légitime, sans tenir compte de la justice sociale absente dans une société où les mécanismes politiques et économiques ne favorisent que l'enrichissement personnel au détriment de la majorité croupissant dans la misère infrahumaine. Fondée sur le mensonge et la rhétorique politique faussaire, dissimulant donc les intentions inavouables et jamais avouées dans les micros de la presse, car le criminel et le voleur ne parlent jamais de leur intention publiquement, la démocratie en Haïti est un leurre, un mirage, une ombre qui n'est pas l'objet que fait réfléchir la lumière se propageant. Et certaines réactions du pouvoir politique ne peuvent pas s'appuyer sur la raison d'État, quand les revendications populaires restent insatisfaites. Aussi, la transparence des décisions, la démission ou la mise à l'écart des hommes et des femmes impliqués dans la corruption et dans le pillage des caisses publiques peuvent contribuer à protéger une raison d'État qui ne condamne pas la critique citoyenne, mais œuvre à rétablir un ordre sécurisé pour la défense et la promotion de l'intérêt général.
Cheriscler Evens
Professeur et journaliste
Contre la fabrication du citoyen dans les fausses démocraties!