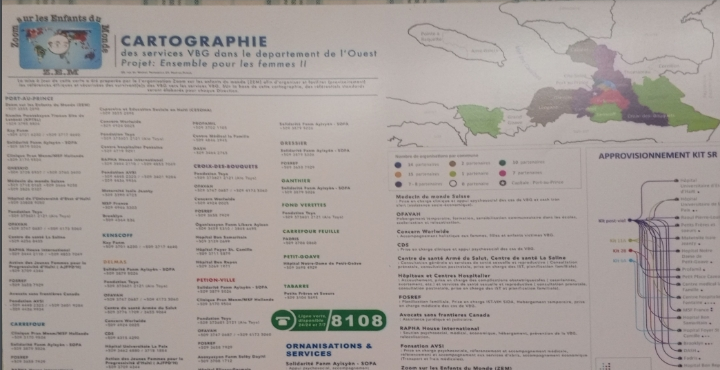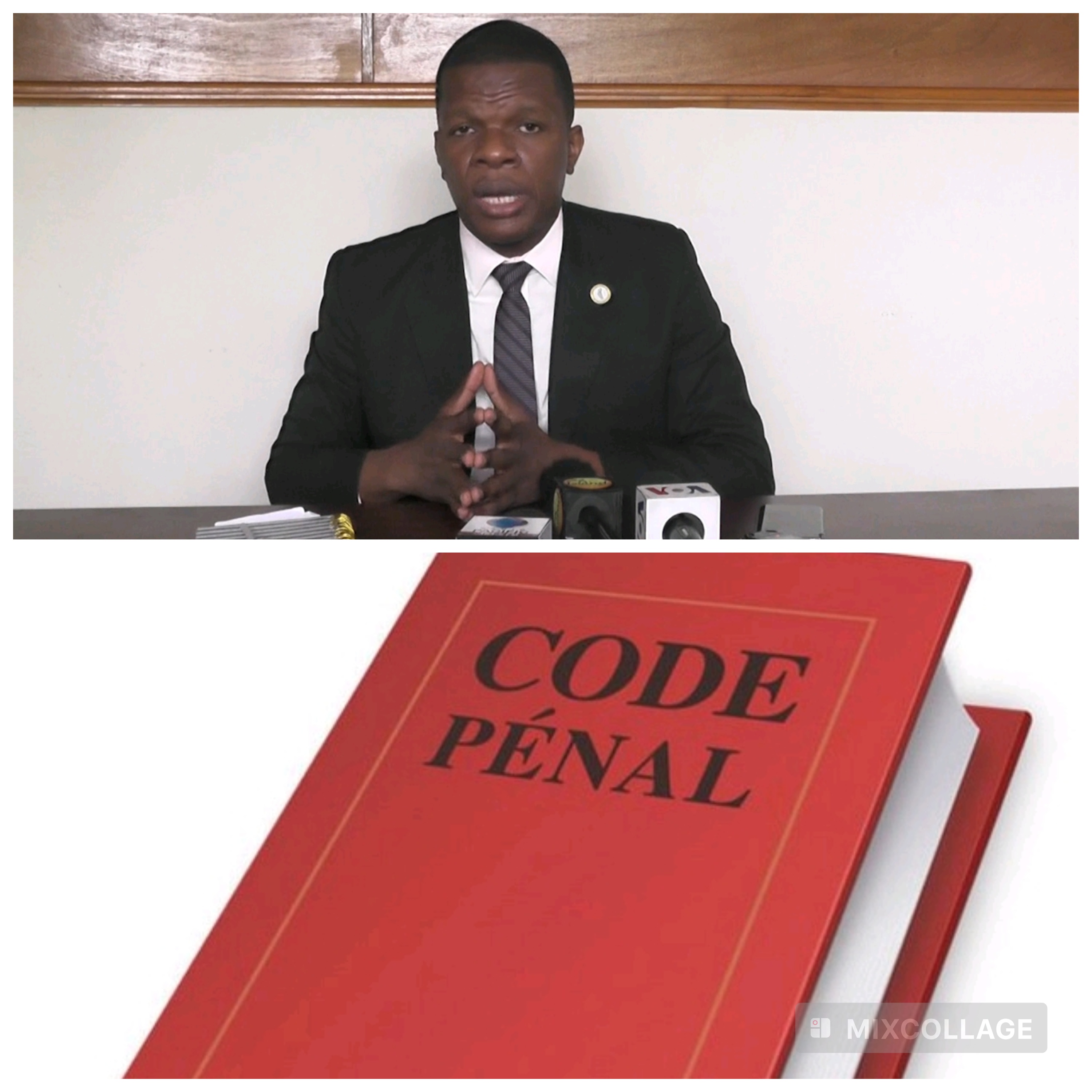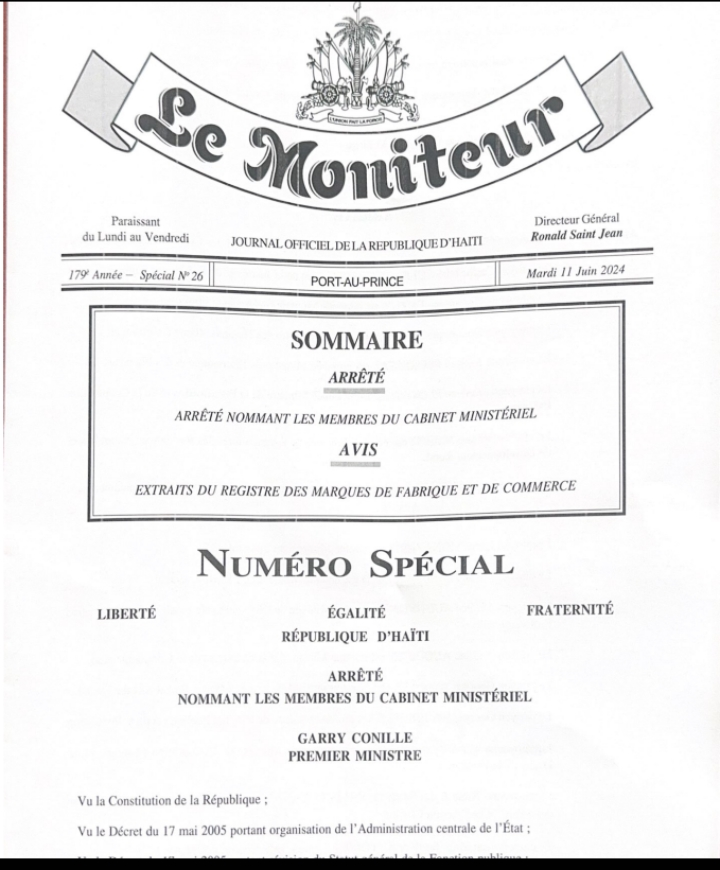INTRODUCTION
Le journalisme et les relations publiques sont deux parmi les métiers de la communication sociale. Avec la multiplication des NTIC, il est difficile de définir explicitement le journalisme. Peu importe, c’est un métier dont l’objectif consiste à informer un public par l’intermédiaire d’un ensemble de genres au travers d’un canal de diffusion comme la radio, la télévision et l’Internet. Il s’inscrit, selon Bernard Dagenais (2004), dans une démarche de défense du bien public. Quant à elles, les relations publiques sont considérées comme une forme de manipulation. Appelés parfois «spin doctors», les relationnistes sont toujours qualifiés de tout propos soupçonné d’être un maquillage de la réalité.
Chacun à sa manière, le journalisme et les relations publiques, contribuent à la démocratie. Mais pour Jean-Marie Charon (2004), il est banal d’envisager le rôle des relationnistes dans la vie politique de celle-ci. Parce que, selon lui, il s’agit des stratèges en manipulation de l’opinion dans les préparatifs et la conduite de la guerre […]. Comment les relationnistes font agir et parler les journalistes comme ils veulent? Pour répondre à cette question, nous allons non seulement exposer les rôles de ces deux métiers, mais encore montrer comment les relationnistes dominent l’espace médiatique. À la lumière de Jean-Marie Charon, l’objectif de cette réflexion est de montrer le rôle d’éminence grise des relationnistes dans l’instrumentalisation des journalistes.
En tant qu’institution sociale, les médias ont pour rôle, pour reprendre Bernard Dagenais (2004, op. cit.,), d’informer, d’éduquer, de divertir, de surveiller les acteurs et les débats et de hiérarchiser les nouvelles de l’actualité. Mais comment accomplir ces tâches? Comment arrivent-ils à collecter les informations? Les journalistes sont les jambes des relationnistes, mais pas leur tête. Par définition, Bernard Dagenais (1999) entend par relations publiques, la façon de mettre en valeur les entreprises et les organisations qui y ont recours et de créer un sentiment de sympathie entre elles et leurs différents publics. De surcroît, pour Danielle Maisonneuve (1998), les relationnistes définissent le savoir construit par la mise en circulation des informations qu’elles détiennent.
À cela, plusieurs chercheurs s’affrontent. Mais pour le compte de cet exercice, nous nous appuyons sur certains travaux de Bernard Dagenais et de Jean Charron (2000). Pour ce dernier, les relationnistes occupent une grande place dans les médias et ne laissent filtrer que l’information qui les favorise. Contrairement à Jean Charron, d’autres arguments sont avancés pour prouver l’indépendance des journalistes dans le traitement des informations. En voici quelques-uns :
Tout d’abord, ce sont les journalistes qui sélectionnent les informations afin de constituer l’ordre du jour. D’un côté, cet argument est fondé. Mais, à en croire Bernard Dagenais, ceux qui soutiennent ce raisonnement oublient que cette sélection passe, avant tout, par une série de gardes-barrières, les «gatekeepers», qui ont filtré, orienté et teinté la couleur de l’information à partir des préoccupations des médias. Par ailleurs, ils montrent que les informations en temps direct, par exemple un accident, ne sont pas imposées, travaillées par les relationnistes, puisque les journalistes sont présents sur les lieux de l’évènement. Mais tout n’est pas terminé, en arrivant à ce stade.
Les relationnistes accaparent toujours les évènements, les habillent, entre autres, les créent. Les journalistes reçoivent, reproduisent et commentent les nouvelles des acteurs politiques, culturels et économiques travaillées par les professionnels des relations publiques. Sur ce, Dagenais confirme qu’avant que la nouvelle arrive aux mains des journalistes, elle est déjà travaillée, préparée, soupesée par des équipes de relationnistes qui sont engagés par des entreprises […]. Donc ce ne sont pas les journalistes qui filtrent l’information, mais plutôt ce sont les relationnistes qui leur imposent des points de vue.
Il revient aux professionnels des relations publiques de préparer les contenus à diffuser, d’émettre les communiqués et les notes de presse, d’organiser les conférences de presse, des évènements-médias. Ce sont eux qui servent de porte-parole et répondent aux questions des journalistes. Ces rôles leur permettent de bien centrer l’information sur les éléments qui vont servir le mieux leur organisation et ses intérêts.
Selon Philippe Guilhaume, pour faire la une des médias, il ne suffit pas d’organiser et d’annoncer l’évènement. Il faut aussi apprendre à appâter les journalistes pour qu’ils viennent le couvrir. À ce niveau, les relationnistes font appel au «syndrome du merle» qui, selon Guilhaume, se définit «comme [des] ces oiseaux qui se regroupent pour s’envoler dans la même direction quand ils entendent un bruit». Cela dit, en Haïti, les journalistes ne font que répéter les informations travaillées par les relationnistes.
Au lieu de mener des enquêtes sur des problèmes de base, les directeurs de l’information se réunissent chaque matin, dans les conférences de rédaction, pour évaluer les sollicitations reçues à couvrir les conférences de presse et choisissent, parmi elles, celles qui sont les plus importantes. Or les relationnistes ne filtrent que l’information allant dans le sens de ses intérêts. Donc les journalistes haïtiens véhiculent ce qu’ils entendent. D’où le syndrome du merle du journalisme en Haïti.
CONCLUSION
En somme, l’objectif de cet exposé était de montrer le rôle des relationnistes dans l’instrumentalisation des journalistes. Pour ce faire, nous avons exposé le rôle de chacun et montré comment les relationnistes imposent les journalistes leurs points de vue. Dans le contexte haïtien, seul le «journalisme public» peut faire la tempête des relations publiques change de direction.
Élaboré par Jay Rosen, «le journalisme public» n’a rien à voir avec Emmanuel Kant ou Jürgen Habermas. C’est une nouvelle approche qui, selon Thierry Watine (2003), vise à «accroître l’utilité sociale des professionnels de l’information au sein de leur environnement immédiat afin de garantir un meilleur fonctionnement de la vie démocratique». Selon les propos de Watine, le «journalisme public» repose sur les principes suivants: a) les auditeurs, les téléspectateurs sont a priori des citoyens actifs, et non pas de gens passifs de l’actualité quotidien ; b) la presse doit aider la population à régler concrètement ses problèmes plutôt de les inciter ; c) contrairement à leur inclination naturelle à mettre de l’huile sur le feu, les journalistes doivent davantage contribuer à une amélioration de la qualité et de l’utilité des débats publics ; d) les entreprises de presse ont un rôle déterminant à jouer dans la vie publique.
BIBLIOGRAPHIE
CHARON, Jean-Marie. «Les spin doctors au centre du pouvoir», in Internationale et stratégique, no. 56, 2004, pp. 99-108.
CHARRON, Jean. «Journalisme et démocratie», communication au séminaire de la CEFAN, Médiations et processus culturelles, Laval, 2000.
DAGENAIS, Bernard. «Les relations publiques, véritables instrument de démocratie», in Communication, vol. 23, no. 1, 2004, pp. 19-40.
DAGENAIS, Bernard. Le métier de relationniste, Québec, PUL, 1999.
GUILHAUME, Philippe. «L’information est malade», in Hugues HOTIER (dirigé par), Éthique et communication, Université de Montaigne-Bordeaux, ISIC, 1990, pp. 11-15.
MAISONNEUVE et aliae. Danielle. Les relations publiques dans une société en mouvance, Sainte-Foy, PUQ, 1998.
WATINE, Thierry. «Le modèle du journalisme public», in Hermès, no. 35, 2003, pp. 231-239.
Wilner JEAN
Communicateur social