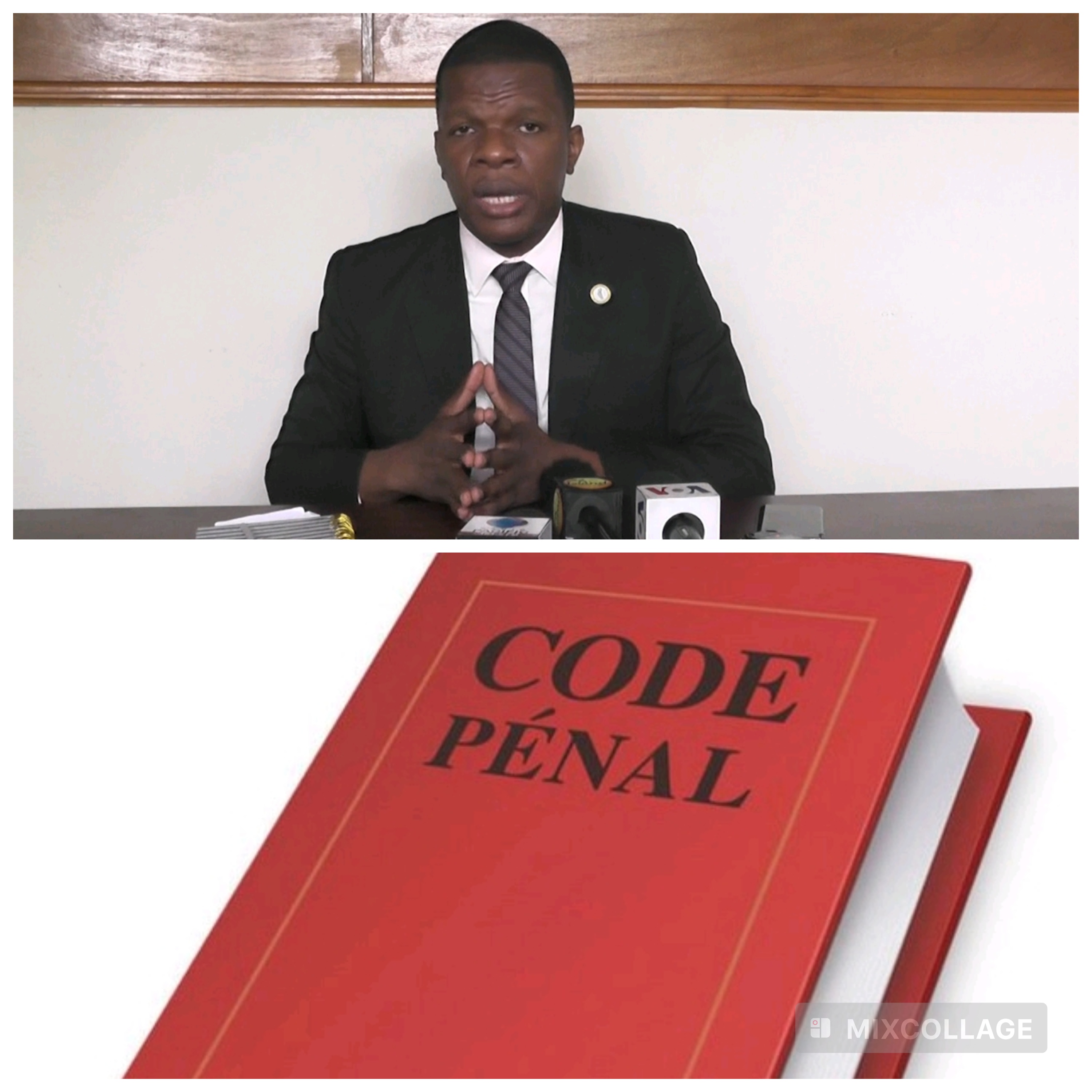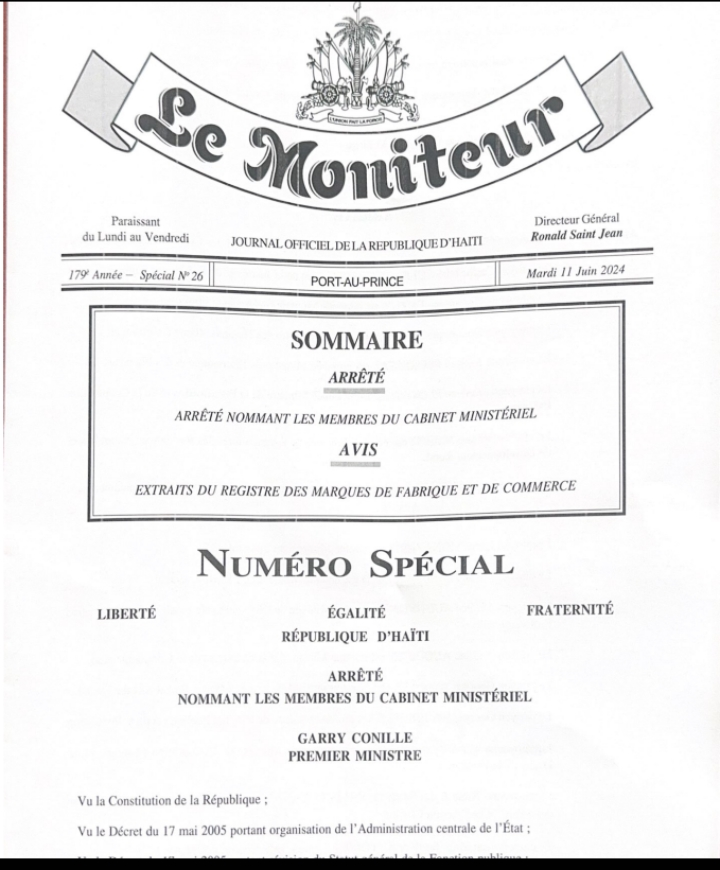Face à la dégradation de la situation sécuritaire par les groupes de gangs armés qui bouleversent considérablement toute la société haïtienne et paralysent les sphères d’activités au niveau social et économique, le gouvernement haïtien, à la fin de l’année 2022, avait lancé plusieurs appels auprès de l’Onu pour le déploiement d’une mission de sécurité en Haïti pouvant aider à la gestion de la crise.
C’est en date du 3 octobre 2023, que le Conseil de sécurité a autorisé la création et le déploiement en Haïti d’une Mission multinationale d’appui à la sécurité (MMAS), pour une période initiale de douze mois, par des États Membres qui ont informé le Secrétaire général de leur participation. Et le Kenya a accepté en juillet 2023 de mener cette force multinationale composée de 2500 à 2600 hommes. Suite à la résolution 2699 de l’Onu, qui a autorisé le déploiement de la force pour une durée d’un an, avec un réexamen au bout de neuf mois. En date du 25 juin 2024, les kenyans sont arrivés sur le territoire haïtien à la tête de cette mission soutenue par l’ONU, qui regroupe des officiers de plusieurs nations dans le but de porter assistance à la police nationale d’Haïti (PNH) afin de lutter contre la violence des gangs armés.
Cette situation de crise sécuritaire qui entrave la vie de la population, et le déploiement des troupes kenyanes pour la première fois sur le territoire haïtien afin d’aider à la résolution de la crise qui met le pays dans une situation d’instabilité totale représente le moment idéal pour les autorités haïtiennes d’engager une communication qui passe par la légitimité, la crédibilité et la confiance. Une communication qui implique les membres de la population locale comme les premiers acteurs de la construction de la paix, comme des partenaires impliqués dans le processus de paix que les troupes kenyanes viennent mener de concert avec l’institution policière. La pratique de la démarche communicationnelle invite à penser l’hétérogénéité, la pluralité des logiques sociales qui coexistent au même moment, avec leurs rythmes et leurs références propres. Cela suppose que l’on se donne les moyens de comprendre les logiques qui traversent les différents groupes d’acteurs, leurs représentations, leurs intérêts (Béatrice Pouligny, 2001).
Un travail de communication qui demande de ne pas voir uniquement les membres de la population comme des victimes de l’insécurité mais comme des partenaires, des sujets capables de s’affirmer au moins partiellement comme des acteurs à part entière, signalant des préférences, qui ont des préoccupations et des perceptions ,qui ont besoin d’ information et qui veulent une écoute active de la part des autorités. Car, les acteurs gardent en mémoire les interventions passées, ils font des comparaisons et cherchent des points communs en construisant un discours ayant plusieurs variables socio-anthropologique.
Il nous faut une communication publique de crise capable de prendre en considération la relation entre les autorités et les membres de la population victimes de l’insécurité et des évènements atroces de la part des groupes armés qui menacent de plus en plus la vie des gens. Le contexte actuel fait appel à deux types de communication, une communication d’urgence, qui demande une occupation physique du terrain communicationnel, ce qui exige une écoute active des messages envoyés par les membres de la population. Aussi un moyen de communication qui pourra permettre aux troupes kenyanes de communiquer avec la population même s’il y aura la présence des interprètes. Et une communication sensible fondée sur une approche intégrée de la communication en prenant en considération les situations pouvant conduire à des controverses, des polémiques et des affrontements communicationnels entre la population et la présence des troupes Kenyanes afin d’analyser les émotions qui animent la population impactée par les évènements et leur perception sur la présence de ces policiers. L’approche intégrée de la communication sensible prévoit une intervention en amont de la communication lors qu’un sujet d’action est potentiel source de polémique, considérer la sensibilité d’un sujet comme une construction, en ce sens il faut une communication régulière et incarner la communication pour lui redonner la sincérité qu’elle mérite (Didier Heiderich , 2020).
Face à cette crise, la communication est devenue incontournable et la population attend une communication rassurante venant de l’Etat, qu’elle considère comme un interlocuteur légitime ayant la capacité de gérer cette situation de crise. Le moment est crucial à ce que les autorités puissent mettre en œuvre une communication spécifique capable d’informer la population sur les objectifs de la mission, la limite de la mission , le document stratégique qui définit le mode opératoire de cette mission menée par le Kenya , les noms des policiers kenyans présents sur le territoire haïtien , les attitudes et les comportements à adopter à l’égard de ces policiers qui seront de proximité avec la population. Donc, une communication pouvant établir un climat de confiance avec la population afin de saisir les préoccupations locales et éviter des frustrations pouvant engendrer des risques additionnels pour ces policiers kenyans et des discours de haine.
Les autorités concernées doivent se positionner comme référent de l’information fiable et vérifiée face à des acteurs qui s’exprime déjà sur la crise. Et d’autres personnes qui ne sont pas spécialisés du sujet mais qui font des analyses et donnent des informations uniquement dans l’objectif d’assurer une audience médiatique. Les message envoyés par les autorité devraient être en cohérence avec la réalité du terrain en tenant un discours qui prend en considération les dispositifs de mise en place pour assurer la gestion de la crise.
La grille d’analyse du déploiement des policiers kenyans demande de prendre en considération la perception de la population à l’égard des policiers kenyans qui rentrent pour la première fois en Haïti. C’est en fonction de cette perception qu’on pourra créer des moyens de communication adaptés aux groupes ciblés et aux collectivités territoriales. Une négligence de cette perception pourrait rendre inaudible toute diffusion de consigne et tout message rassurant. Être écouté en temps de crise, c’est aussi faire en sorte que les consignes soient reconnues, acceptées comme naturelles et logiques, que la population s’approprie les réflexes de sécurité en tant que citoyen responsable et acteur de la gestion de crise à son niveau (Anne -Lise Cœur –Bizot , 2020).
La qualité de la communication établit par les autorités du Conseil Présidentiel devrait permettre aux policiers kenyans de respecter les populations locales et de prendre le temps d’entendre et de comprendre les interlocuteurs haïtiens afin qu’ils ne se sentent pas étouffés, frustrés de ne pas être considérés comme des interlocuteurs responsables et capables d’agir physiquement et symboliquement. Il faut mettre en place des mécanismes à ce que les policiers qui sont envoyés dans cette mission arrivent à aborder le contexte avec rationalité, savoir identifier les cibles du mandat et reconnaitre que les acteurs qu’ils auront à rencontrer sur le terrain ont une histoire, des références, une culture propre, un mode de vie et des qualités traditionnelles .
Le gouvernement en place a la possibilité de développer une politique de communication qui prend en compte la communication stratégique et l’information publique dans le but d’assurer une communication interactive avec la population locale. Ce qui demande d’analyser le public, de fixer les objectifs et voir la stratégie des messages. C’est le moment à éviter tout vide informationnel capable de soulever un sentiment de méfiance auprès de la population.
Frandy Jasmin
Communicateur Social
Référence
Didier Heiderich , 2020 : Pour une approche intégrée de la communication sensible, revu LIREC ; file:///C:/Users/50941/Downloads/Lirec%20-Crise.pdf
Anne -Lise Cœur –Bizot , 2020 : Le «temps zéro» en communication de crise : le temps de la synchronisation, revu LIREC ; file:///C:/Users/50941/Downloads/Lirec%20-Crise.pdf
Béatrice Pouligny, 2001 : Perception des missions civiles de paix par les populations locales ; https://www.irenees.net/bdf_fiche-analyse-746_fr.html