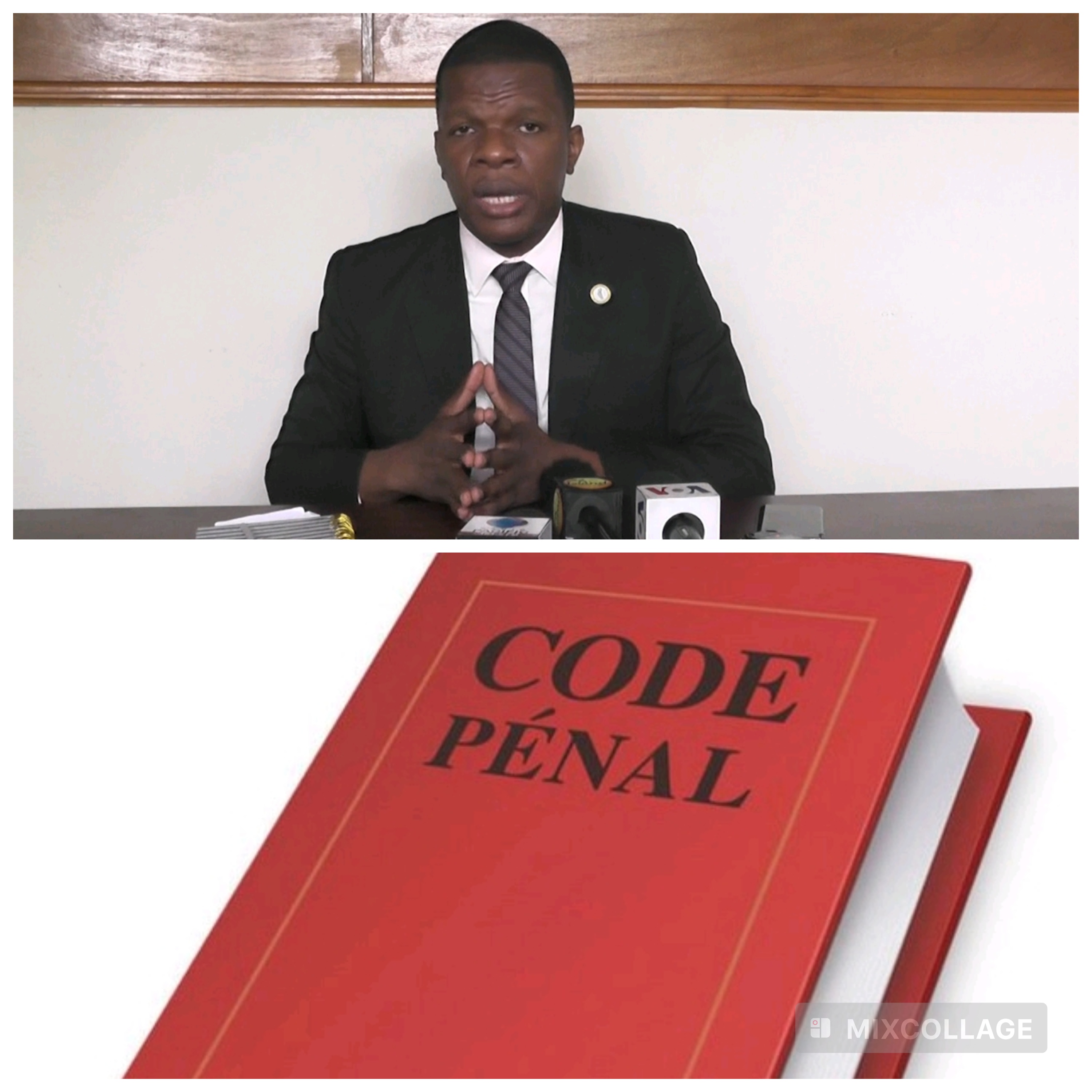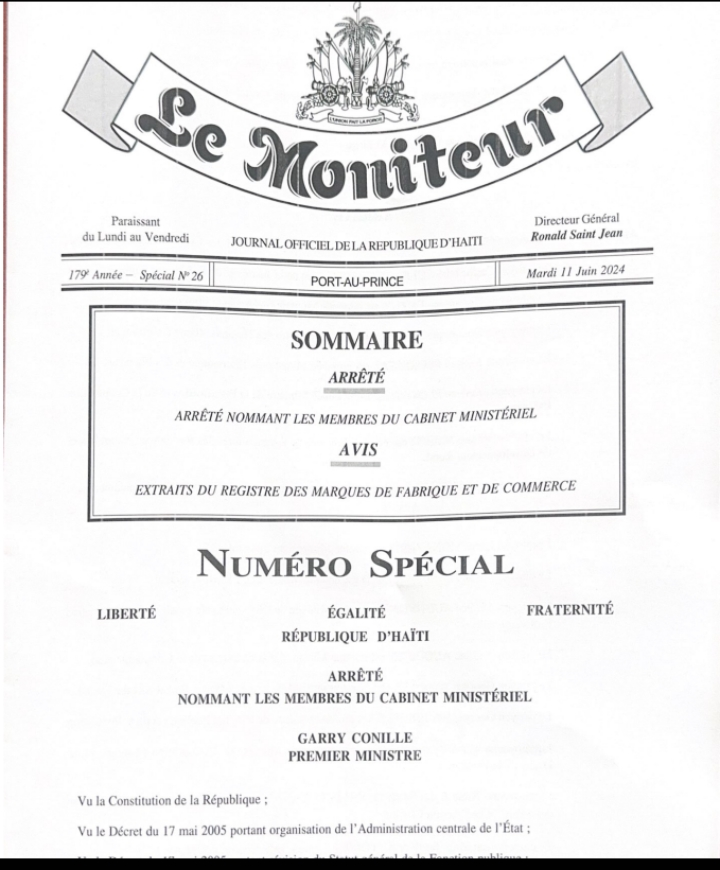Contexte
Une société est comme un système mécanique composé de différentes parties qui fonctionnent en synergie pour atteindre un objectif commun. Toute anomalie au niveau d’une partie peut produire un effet domino pouvant engendrer le dysfonctionnement du système, si la cause n’est pas vite identifiée. La déchéance sociétale que vit Ayiti aujourd’hui traduit parfaitement cette situation et s’explique en partie par l’incapacité du système d’enseignement supérieur de produire des connaissances appropriées à la réalité du pays et de former adéquatement des cadres techniques capables d’aider à concrétiser la quête du bien-être collectif. En conséquence, toutes les autres parties dont le fonctionnement en dépend n’arrivent pas à y jouer correctement leur partition. Cette considération met en ligne de mire l’Université d’Etat d’Haïti (UEH) qui, pendant longtemps, porte-étendard du système d’enseignement supérieur du pays, avait pour rôle de guider les responsables dans le processus de gestion du pays. Ce texte vise à démontrer que l’inexistence d’un système de veille administratif capable de faciliter un fonctionnement administratif fluide, handicape l’Université d’Etat d’Haïti dans la réalisation de sa triple mission dont l’académique, la recherche et le service à la communauté. Pour ce faire, il :
I : évoque comment le prestige académique d’antan de l’UEH est terni ;
II : explique que les tentatives de l’Etat de réformer l’UEH restent vaines ;
III : dresse le diagnostic du mal institutionnel de l’UEH qui en résulte ;
IV : invite à adopter un système de veille administratif indépendant pour réparer le système.
En conclusion, il esquisse les bienfaits dudit système si introduit dans le fonctionnement de l’UEH.
I : Le prestige académique terni de l’UEH
Il est à noter que le comportement organisationnel atypique à l’UEH n’a pas manqué de ternir son prestige académique dont elle jouissait dans le temps comme toute autre université du reste du monde. Incapable de s’adapter aux pratiques modernes de l’enseignement universitaire, l’UEH s’engage dans une course régressive en prodiguant une formation universitaire problématique à des générations successives d’étudiants dont beaucoup ont du mal à compléter le cycle de licence dans le temps réglementaire de quatre ou cinq ans. Sur une longue durée, ils vieillissent dans le cycle universitaire basique et peinent à développer leur potentiel académique pour devenir aussi compétitifs que les étudiants du reste du monde.
Les diplômes décernés, qui auparavant étaient favorablement reçus ailleurs, subissent aujourd’hui une évaluation microscopique pour non seulement soupeser la formation académique qu’ils symbolisent, mais aussi pour déterminer l’authenticité des actes académiques délivrés, surtout quand ils sont présentés en Amérique du Nord. En effet, l’organisation d’évaluation desdits actes de l’étranger, World Education Services, s’assure toujours auprès de la Direction du Registraire que tout diplôme présenté par un candidat à une université nord-américaine soit authentique. En outre, l’enseignement académique inadapté aux besoins actuels des sociétés et les méthodes pédagogiques surannées comme véhicule de transmission du savoir enlèvent toute confiance placée en elle, et les diplômes non uniformisés issus de ses entités sont remis en question pour renforcer l’inquiétude générale.
II : Les vaines tentatives de l’Etat de réformer l’UEH
Avant l’explosion du secteur privé de l’enseignement supérieur, l’Etat qui en avait la responsabilité initialement, a tenté par le décret du 16 décembre 1960, d’unifier légalement toutes les entités d’enseignement supérieur. Cette démarche a été entérinée dans les articles 208 et 211 de la Constitution amendée respectivement sous le chapeau de l’Université d’Etat d’Haïti (UEH) comme partie intégrante du système Étatique et par la création d’un organisme public de régulation et de contrôle de l’enseignement supérieur tant privé que public. La fièvre démocratique qui, au départ des Duvalier, a intensifié le besoin de réorganiser l’UEH pour l’immuniser de toute influence d’un gouvernement, a enfanté les Dispositions Transitoires (DTs) de février 1997, un accord entre les différentes entités de l’UEH et les autorités du gouvernement, notamment le ministre de l’Éducation nationale d’alors, Monsieur Jacques Edouard Alexis, afin d’instituer un système de gestion démocratique pour choisir ses dirigeants.
Ledit acte devrait régir l’UEH jusqu’à la promulgation d’une loi organique. Le 30 avril 1997, un Conseil provisoire de l’Université a été investi en attendant les élections du Conseil Exécutif (CE). La prescription était que dans les 30 jours après son entrée en fonction, l’exigence lui était faite de constituer une commission de réforme avec une mission particulière de formuler un projet de loi organique. Lequel travail final de réforme devrait être communiqué 6 mois après la première réunion de ladite commission. L’UEH, en tant qu’organisation d’enseignement supérieur principalement, avait pour devoir d’entamer une réforme exhaustive touchant non seulement son système d’enseignement académique, mais aussi le système de recherche pour doter l’UEH de la capacité scientifique de se mettre au service de la communauté comme le requiert ledit accord.
Depuis une génération environ, il n’y a jamais eu de Loi organique ni de Réforme en soi, malgré la succession de différents conseils exécutifs élus depuis 2002-2003 pour répondre à cette obligation. A date, les DTs vieilles de 27 ans, pour être plus précis, n’arrivent toujours pas à uniformiser le fonctionnement de chaque entité ayant des pratiques issues de leur naissance respective indépendamment de l’une et de l’autre. Il est donc normal que chaque entité développe une certaine culture de fonctionnement propre à elle. La décision sage de l’État de tirer ces entités de leur hétérogénéité pour les rassembler en une université et former l’UEH sans y instituer un levier harmonisateur, est restée un vœu pieux. L’effet de morcellement des entités distinctes l’une de l’autre n’a jamais disparu.
III : Le mal institutionnel de l’UEH
Si à l’université, il convient de parler de règlements de fonctionnement standard régissant ses activités d’enseignement, de recherche et de service à la communauté, et d’une structure organisationnelle uniforme, à l’UEH en revanche, il coexiste une diversité de règlements et de structures organisationnelles. Même quand ces différences sont palpables dans une entité ou dans une autre avec des Doyens et Vice-doyens, Directeurs, et Coordonnateurs, elles reflètent à peu près le profil organisationnel de l’unité centrale de gestion de trois membres formant le corps exécutif composé du recteur et de deux vice-recteurs. Malgré tout, elles dévoilent des règlements de fonctionnement propres selon une tendance vers le détachement de l’unité administrative centrale plutôt que de son rapprochement effectif.
Si aujourd’hui, une gouvernance unitaire semble se manifester, c’est en raison de l’autonomie de gestion financière de l’UEH attribuée par l’État à l’unité centrale de gestion. En effet, l’allocation budgétaire globale de l’UEH, subit une proposition de réallocation aux différentes entités incluant le Rectorat dont le Recteur jouit du droit d’ordonnateur final pour valider tous les débours initiés par chaque entité. Cette gestion financière unifiée de l’UEH ne se reflète aucunement au niveau de la structure administrative. En fait, chaque entité a sa propre manière de gérer ses activités et souvent outrepasse les décisions émanées de l’unité centrale de gestion. Si l’autonomie financière accordée à l’UEH était perçue comme un moyen de freiner les dictées d’un gouvernement, elle est loin d’être l’outil idéal de gouvernance universitaire centralisée efficace.
Pendant que le gouvernement cesse d’influencer le fonctionnement administratif et financier des entités, celles-ci échappent à l’emprise de l’unité centrale de gestion, et conservent le pouvoir de suivre ou de ne pas suivre les directives de celle-là, pour conduire à leur guise leur gestion. La résultante est un effet d’absence d’autorité descendante rationnelle sur toute la pyramide de commande tant au niveau administratif qu’au niveau académique. D’un côté, les professeurs et le personnel administratif ne suivent pas les normes établies par le décanat ou la direction d’une entité, et de l’autre, la majorité des étudiants ne respectent pas ces derniers et agissent à leur guise.
En retour, les décisions prises par une entité qui, à la suite des litiges, devraient être validées par l’unité centrale, ne sont pas souvent respectées. Ce qui résume en un circuit de complicité pour tolérer les méfaits de l’un et de l’autre, et faire tourner la roulette. Ce mode de gestion universitaire génère des effets pervers qui compromettent le développement de l’UEH, la formation académique des jeunes et hypothèquent simultanément l’avenir du pays. Ce qui est imputable à la nature contradictoire de la gestion faite de l’ensemble de l’université.
IV : Vers un système de veille administratif indépendant
Il est clair que l’UEH, une organisation d’enseignement supérieur, souffre d’une déficience institutionnelle due à l’inexistence d’un mécanisme administratif central de planification, de contrôle, d’évaluation, de récompense et de sanction. Sa gestion conduite au gré d’un responsable et animée de laxisme, engendre souvent un abus de pouvoir. Dans ce contexte, elle est inadéquatement administrée et est privée du dynamisme nécessaire pour être effective dans sa triple mission. Cette faille identifiée invite à tout corriger en instituant un système de veille permanent indépendant pour non seulement rationaliser le fonctionnement administratif de l’université, prévenir d’éventuelles dérives, mais aussi sanctionner toute violation des normes et procédures en vigueur. N’étant sujet d’aucune influence interne ni externe, ledit système serait habilité à se prononcer auprès des autorités compétentes pour une décision punitive contre toute violation indifféremment du statut hiérarchique du contrevenant dans le système.
Cette nouvelle approche administrative entend accorder les actions administratives à la vision d’un tout afin de concrétiser le projet universitaire commun recherché légalement sous le chapeau de l’UEH. L’harmonisation du fonctionnement administratif recherchée via ledit système, tiendra compte de la diversité de modes de gestion, malgré la structure administrative similaire des différentes entités de celle de l’administration centrale formalisée par les DTs, sans affecter la gestion propre des entités. Vu que l’objectif des DTs était de faire fonctionner l’UEH comme un tout, conserver les pratiques individuelles des différentes entités tend à l’inhiber dans sa course de modernisation. Le fait de ne pas y avoir introduit ce système de veille permanent, la réforme de l’UEH espérée traîne encore au-delà de la durée de vie prévue par les DTs.
Avec le système de veille administratif, le cadre de gestion adopté sera simultanément centralisé et décentralisé respectivement au niveau du Rectorat et dans les entités où les directives et politiques administratives délimiteraient clairement les champs d’intervention légitime des entités incluant le Rectorat sans aliéner leur liberté individuelle de fonctionnement. Quand les politiques générales sont édictées, les entités auront la liberté de les adapter à la nature propre de leur enseignement sans se démarquer de l’objectif poursuivi par l’administration centrale. En ce sens, une prise en charge commune de certaines activités par l’administration centrale ne doit pas être considérée comme ingérence dans la gestion interne d’une entité. Elle serait simplement circonscrite à la mutualisation effective et efficiente d’un même type de ressources pour faciliter son alimentation, sa distribution ou son utilisation par toutes les entités selon leurs besoins.
Ce faisant, l’université cesserait de patauger dans l’inefficience administrative quand chaque entité s’en chargeait elle-même. L’UEH ne fonctionnerait plus en manque de quelque chose. En outre, la charge d’activités des responsables d’entités deviendrait moins lourde avec un ratio de 80% de temps alloué à la gestion de l’enseignement, de la recherche et du service à la communauté contre 20% au fonctionnement administratif. Plutôt que de conduire les entités à perdre leur autonomie, ce système allègerait leurs tâches et lui permettrait de répondre efficacement à ses différentes missions dépendant d’une gestion rationnelle des ressources qui leur sont allouées.
Conclusion
L’inexistence d’un système de veille permanent handicape le fonctionnement administratif de l’UEH dans sa triple mission. Vu que leur pleine réalisation dépend d’un fonctionnement fluide, disposer d’un tel système pouvant conditionner les décisions finales au strict respect des normes établies et de rationnaliser l’utilisation des ressources en vertu des programmations d’activités prévues, aurait mieux aider l’UEH à remplir ses missions. En outre, toute tendance menant à assimiler le pouvoir de signature ou de décision aux finalités de l’université aurait été jugée inappropriée dans la conduite des activités de l’UEH. Il est clair que l’UEH conserverait intact son statut d’université modèle d’antan à suivre face au pullulement sans directives des entités d’enseignement supérieur privés, lesquelles n’arrivent toujours pas à la devancer.
Ce faisant, elle continuerait pleinement à jouir de son droit d’ainesse dans le système d’enseignement supérieur du pays, pour finalement imposer sa voix d’autorité dans la gestion des affaires de la société, faire valoir son statut légitime de membre à part entière de l’État d’Ayiti, et accompagner ce dernier dans la conception des politiques publiques appropriées afin de garantir le bien-être collectif. Il ne s’agirait plus de prodiguer simplement la formation universitaire basique aux citoyens ni de continuer à constater passivement la déchéance de la société face à laquelle les gestionnaires du pays qui, en quête de solutions, se croient incompétents sans l’assistance internationale. Cette croyance, qui fait tache d’huile chez les dirigeants du pays n’a pas épargné ceux de l’université animés par cette dépendance externe. En effet, ils font du besoin d’accompagnement financier par les organisations internationales et de l’appui technique, un pilier de leur stratégie de développement à l’université en guise de mettre en valeur les compétences des cadres académiques et administratifs, moyennant une gestion rationnelle des ressources de l’UEH.
De surcroît, si à un niveau de la structure administrative de l’UEH, personnaliser la gestion de l’université prédomine, la centralisation abusive des ressources financières risque de s’en suivre et créer en conséquence une dépendance infantile des entités en mal de ressources pour se développer. Cela constitue un obstacle majeur qui a toujours entravé les initiatives de réforme visant au développement de l’UEH depuis. Cependant, s’il est encore souhaitable de faire de l’UEH l’université phare très impliquée dans les affaires du pays et de la positionner favorablement dans la région caraïbéenne, il est impératif d’instituer le système de veille administratif permanent et indépendant ébauché en-dessus.
Jean POINCY
Vice-recteur aux affaires académiques
Université d’Etat d’Haïti