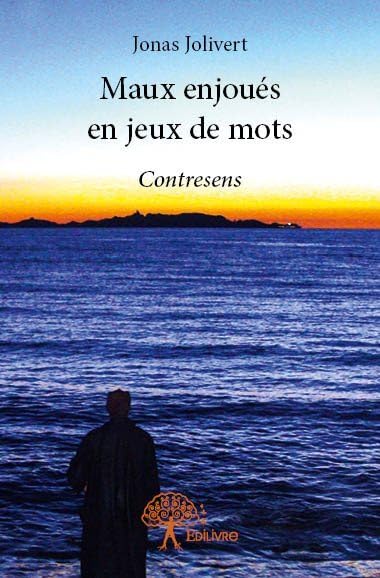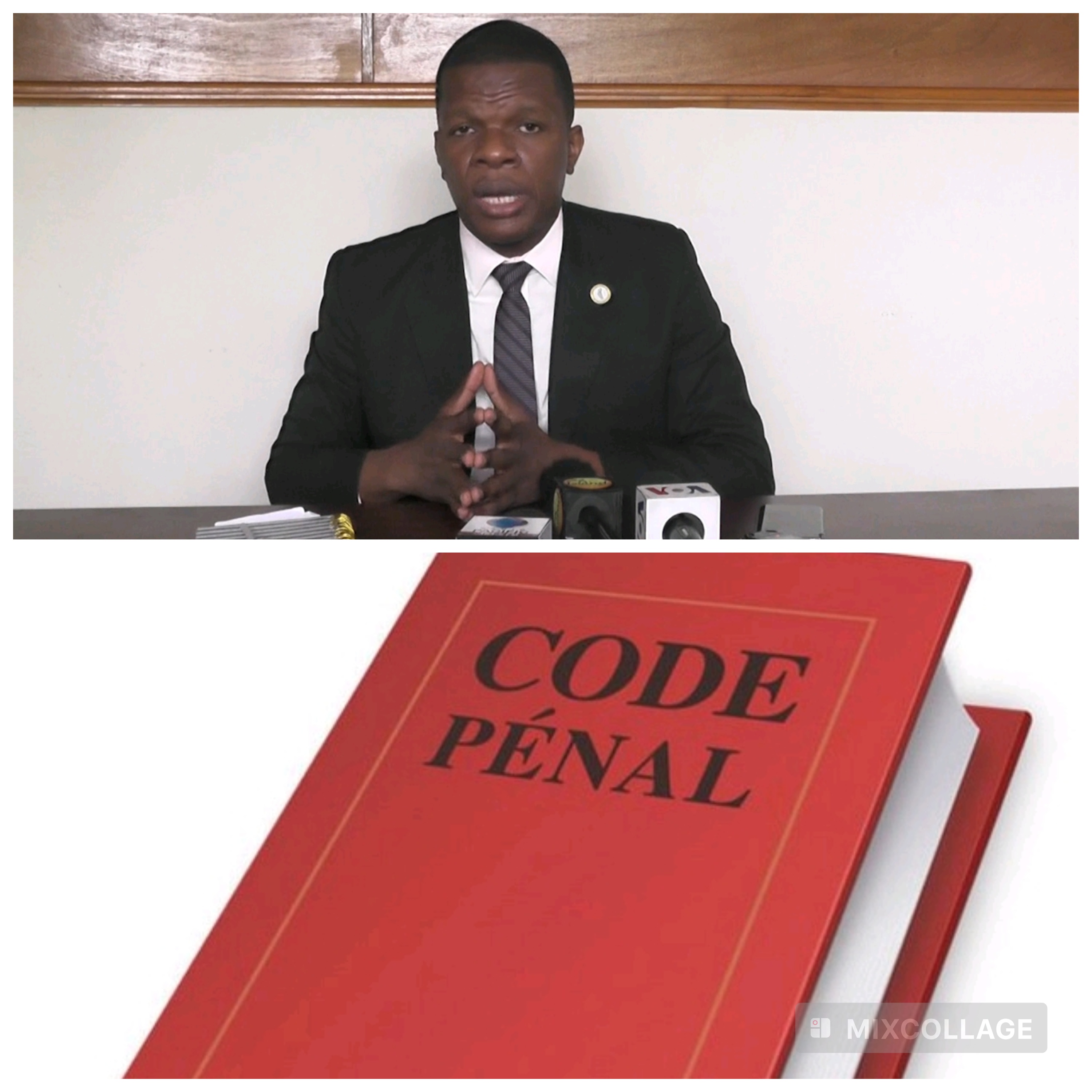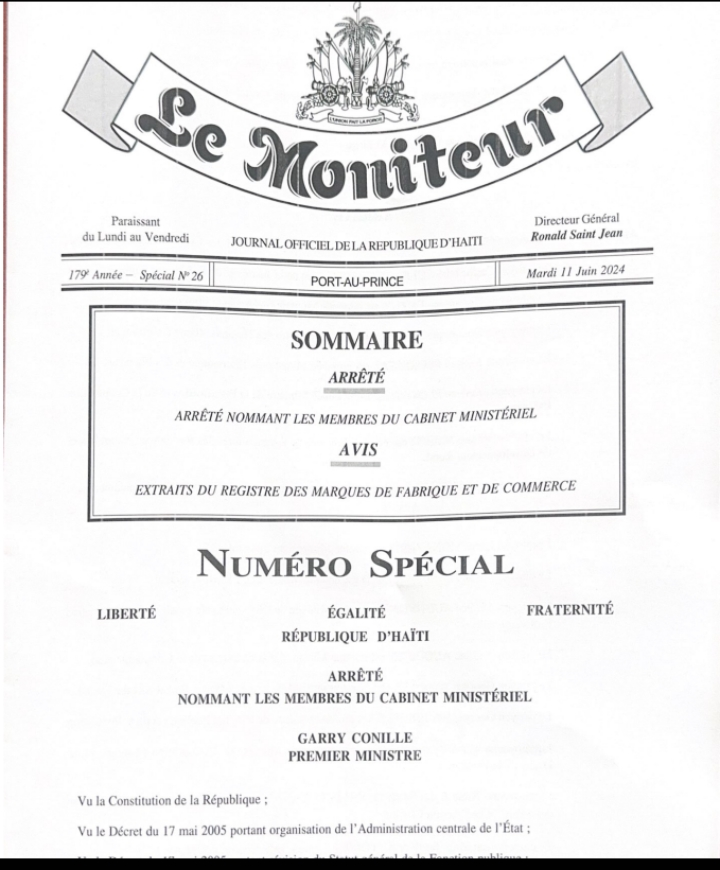L’assassinat du fondateur de la nation haïtienne, Jean Jacques Dessalines, 17 octobre 1806, entraîne ipso facto le premier gouvernement intérimaire de l’histoire politique haïtienne. Suite à cette vacance forcée, Henri Christophe devient président par intérim. Il ne prête pas serment, mais il occupe de fait le pouvoir du 28 décembre 1806 au 27 janvier 1807.
Mais les tensions sont telles entre les héritiers de Jean-Jacques Dessalines que le futur roi Henri Christophe, bousculé de toutes parts, est amené à abandonner le pouvoir. Un autre intérim devient obligatoire. Cette fois, c’est l’un des généraux de la guerre de l’Indépendance qui prend la tête du pays en la personne de Bruno Blanchet qui aura régné du 19 janvier 1807 au 10 mars 1807 comme Secrétaire d'État chargé de l'Exécutif.
Chaque époque apporte sa propre dénomination. La mort d’Alexandre Pétion comme président de l’Ouest conduit automatiquement Jean-Chrisostôme Imbert à lui succéder, du 29 mars 1818 au 30 mars 1818, en qualité de Secrétaire d'État chargé de l'Exécutif par intérim. Cette prise en charge ne dure qu’un jour et comme on pouvait le prévoir, l’armée en la personne de Jean-Pierre Boyer va prendre le pouvoir et sera celui qui réunifiera le pays.
Sa longue présidence (30 mars 1818-13 février 1843) ne débouche pas sur un intérim, jusqu’à son renversement par les révolutionnaires de Praslin en 1843. Parmi ceux-ci, se trouvaient l’écrivain, journaliste, parlementaire et diplomate Hérard Dumesle et son cousin, président Charles Rivière Hérard. S’ouvre une nouvelle période d’instabilité politique chronique.
Dans cette longue bataille pour le pouvoir, trois présidents émergent rapidement : il s’agit de Jean-Louis Pierrot en poste pendant 11 mois (16 avril 1845-1er mars 1846), Jean-Baptiste Riché quelques jours (1er mars 1846- 27 avril 1846) et un nouveau chef d’État provisoire Céligny Ardouin (frère de l’historien Beaubrun Ardouin) en qualité de Président du « Conseil des secrétaires d'État (27 avril 1846-1er mars 1847). Si Ardouin est de tous les pouvoirs depuis 1804, dans les coulisses il faisait et défaisait les présidents.
Une période de terreur commence et se solde par le retour à la monarchie. Après deux ans de présidence (1er mars 1847 au 26 août 1849), Soulouque devient empereur pendant dix ans (26 août 1849-15 janvier 1859). L’ingrat monarque n’a pas hésité à fusiller Céligny Ardouin, à l’origine de son accession au pouvoir. Son frère, premier ambassadeur d’Haïti en France, Beaubrun Ardouin, a démissionné dans la foulée. Sa monarchie tyrannique durera plus de dix ans.
Il fallait un coup d’état, cette fois réussie de Fabre Geffrard en 1859, pour arrêter le robinet de sang de l’ancien soldat. Geffrard lui-même (15 janvier 1859-13 mars 1867) régnera à peu près dans les mêmes conditions que son prédécesseur et sera forcé de laisser son pays pour un exil à la Jamaïque où il décède le 31 décembre 1878, à 72 ans. Encore une fois, le pouvoir revient à celui qui, en tant que militaire, peut mettre en branle ses troupes pour forcer l’Assemblée nationale à lui confier un mandat.
Le dévolu est jeté sur Nissage Saget qui, dans un premier temps, assure l’intérim de la présidence (13 mars 1867-4 mai 1867). Moins de deux mois plus tard, le pouvoir revient à Sylvain Salnave dont on connaît les épopées. S’il était un progressiste pour avoir créé les magasins de l’État afin de venir en aide au petit peuple, il a pris part à la guerre civile dans un pays divisé en trois républiques jusqu’à sa mort par balle devant un peloton d’exécution le 19 décembre 1869. Ce châtiment suprême consacre le retour de Nissage Saget avec des titres différents : d’abord président du gouvernement provisoire (19 décembre 1869-19 mars 1870), président de la République (19 décembre 1869-19 mars 1870).
À la fin de son mandat, le pays retombe dans le cycle de la crise politique et il fallait trouver un autre adjectif pour désigner la présidence haïtienne. Comme aujourd’hui, on opte alors pour une collégialité appelée « Conseil des Secrétaires d’État » composé de quatre membres : Joseph Lamothe, Saul Liautaud, Octavius Rameau et Raoul Excellent. Ils restent un mois en poste, du 14 mai 1874 au 14 juin 1874.
Après deux années de présidence, Michel Domingue (1874-1876), celui-ci est renversé. Encore une longue période d’instabilité politique qui va durer plus de dix ans. Une autre appellation a fait son apparition : « Comité révolutionnaire de Port-au-Prince » composé de 17 membres (1) c’était la plus pléthorique de toutes nos histoires des collégialités politiques pour gérer une transition.
Par la suite, une autre dénomination qui avait fait son entrée dans le vocabulaire politique pour connoter le processus. Il s’agissait tout simplement d’un gouvernement provisoire que dirigeait l’inénarrable et habile homme politique Pierre Théoma Boisrond-Canal. Il faut noter ici, il s’agissait d’un intérim dans un autre, comme aujourd’hui entre Ariel Henry et le Conseil présidentiel de transition (CPT). En effet Pierre Théoma Boisrond-Canal président et assisté de 3 autres membres (2) (23 avril 1876-19 juillet 1876). Cependant le rusé Boisrond Canal s’était arrangé pour se faire élire président de la République pendant trois années (19 juillet 1876-17 juillet 1879). À sa chute, l’intérim se poursuit quelques jours et prit le nom du « Comité d’Ordre Public » du 17 juillet au 26 juillet 1879. Il fut composé de deux hommes haut en couleur Darius Denis et Demesvar Delorme. Cependant rien n’y fit on prolongea l’intérim tout en lui changeant de nom : Président du gouvernement provisoire présidés respectivement par Joseph Lamothe (28 juillet 1879-3 octobre 1879) et Florvil Hyppolite (3 octobre 1879-26 octobre 1879).
Après la longue stabilité avec Lysius Salomon Jeune ayant passé neuf années au pouvoir, l’instabilité reprend de plus belle avec le retour de Pierre Théoma Boisrond-Canal aux affaires pour assurer l’intérim (10 août 1888-16 octobre 1888). La première fois, il est resté au pouvoir 3 ans (du 19 juillet 1876 au 17 juillet 1879). Quatorze ans après sa première haute fonction, il accédera encore au pouvoir, tout aussi brièvement (du 26 au 21 décembre 1902).
L’entrée sur la scène politique haïtienne du Général Denys François Légitime se fait en deux temps. Dans un premier temps, il succède à Boisrond-Canal du 16 octobre 1888 jusqu’au 22 août de la même année. Puis, il s’arrange pour rester au pouvoir comme président de la République (18 décembre 1888-22 août 1889).
Mais l’intérim de Légitime n’arrive à son terme car entre-temps un autre nom surgit pour continuer le processus en la personne de Borno Monpoint Jeune qui passera un mois et 24 jours à la tête de l’État (23 août 1889-17 octobre 1889).
L’arrivée de Florvil Hyppolite au pouvoir le 17 octobre 1889 où il passera 7 ans au pouvoir met fin à cette instabilité politique chronique. Mais pas pour très longtemps car à l’issue de son mandat, l’instabilité pointe à nouveau son nez. On recourt à un système de gouvernement déjà expérimenté : le « Conseil des secrétaires d'État », composé de cinq membres : Tirésias Simon Sam, Tancrède Auguste, Callisthène Fouchard, Pourcely Faine, Thimoclès Labidou. Cette équipe reste au pouvoir 7 jours, du 24 mars au 31 mars 1896.
Tirésias Simon Sam, l’un de ceux qui assuraient l’intérim, est devenu président de la République pour une période de six ans (31 mars 1896-12 mai 1902). Cependant l’insurrection ayant à sa tête l’ingénieur formé en Allemagne Cincinnatus Leconte dépose Tirésias Simon Sam mais son intérim n’avait duré qu’un seul jour (12 mai 1902-13 mai 1902). Toujours à l’affût du pouvoir, Boisrond-Canal signe pour la quatrième fois son retour à la présidence, assurant l’intérim comme Président du « Comité d'ordre de salut public » du 13 mai 1902 au 21 décembre 1902.
Il a fallu l’arrivée du vieux tonton Nord à la tête de ses paysans armées et une partie de l’Armée sous ses ordres pour mettre fin à cet intérim. Comme c’était la coutume à l’époque, avec ses armes braquées sur les tempes des parlementaires, ceux-ci lui confient un mandat de six ans. Il met aussitôt en place un cycle de répressions débouchant sur l’exécution des frères Coicou dont le poète diplomate Massillon et ses deux frères Horace et Pierre-Louis. Le peuple de Port-au-Prince quelques années après se soulève contre le vieux tyran qui n’a d’autre choix que de s’exiler à la Jamaïque où il mourra. Une nouvelle équipe intérimaire s’installe qui en dit long sur la conjoncture politique « Commission de l'Ordre public » composé de 8 membres (2).
Cependant le Général Antoine Simon piaffant d’impatience, il masse ses troupes et entre à Port-au-Prince en triomphateur. L’homme du sud s’autoproclame chef du pouvoir exécutif et conserve ce poste quelques jours (6 décembre 1908-21 décembre 1908). Une mise en bouche avant de se proclamer président de la République, occupant le Palais national pendant 2 ans et 8 mois (21 décembre 1908 -3 août 1911). C’est là qu’arrive pour la deuxième fois sur la scène politique Cincinnatus Leconte. Cette fois, il met toutes les chances de son côté en armant les paysans du Plateau Central. Ses troupes marchent sur la capitale, cueille le pouvoir comme un fruit mûr à la pointe de leurs baïonnettes. Le chef suprême de la révolution autoproclamé attend le feu vert des parlementaires pour lui donner les pleins-pouvoirs, y compris celui de tuer ses adversaires politiques. Ce qui fut fait sans coup férir.
Ce président de la République restera à peine un an au pouvoir car le 8 août 1912, il périt lors d’une violente explosion qui détruit le Palais national, ainsi que des membres de sa famille et plusieurs centaines de soldats. Après ce drame, c’est un vieux routier de la vie politique haïtienne en la personne de Tancrède Auguste qui assura l’intérim comme Président de la République jusqu’à sa mort le 2 mai 1913. Cette fois c’est une collégialité pléthorique qui assura l’intérim avec six membres (3) sous la dénomination de « Conseil des Secrétaires d’État », ce gouvernement reste deux jours en poste (2 mai 1913-4 mai 1913). Enfin le titre du président de la République échut à Michel Oreste pour quelques huit mois (4 mai 1913-27 janvier 1914).
Après cette éclipse présidentielle, Haïti retombe dans la longue et tragique instabilité politique avec pas moins de six présidents en moins d’un an. Une situation qui va déboucher sur un drame national : l’occupation américaine de 1915 sur laquelle nous reviendrons dans une prochaine publication consacrée à la présidence intérimaire en Haïti.
Maguet Delva
Notes
(1) Rivière (Président), Charles Archin, Darius Denis, Saint-Ail Saint-Victor, Jean-Louis Hyppolite, Morin Montasse, A.-P. Mitton, Henry Granville, Dujour Pierre, Louis Oriol, Camille Nau, David fils aîné, Sauveur Faubert, Tracy Riboul, Turenne Carrié, Francin Thézan, Richard Azor.
(2) Michel Oreste, Louis-Auguste Boisrond-Canal, Maximilien Laforêt, Renaud Hippolyte, Auguste Bonamy, MacDonald Appolon, Luders Chapoteau, Prudent Jeune.
(3) Seymour Pradel, Beaufossé Laroche, Jacques Nicholas Léger, Tertulien Guilbaud, Edmond Lespinasse, Guatimosin Boco.