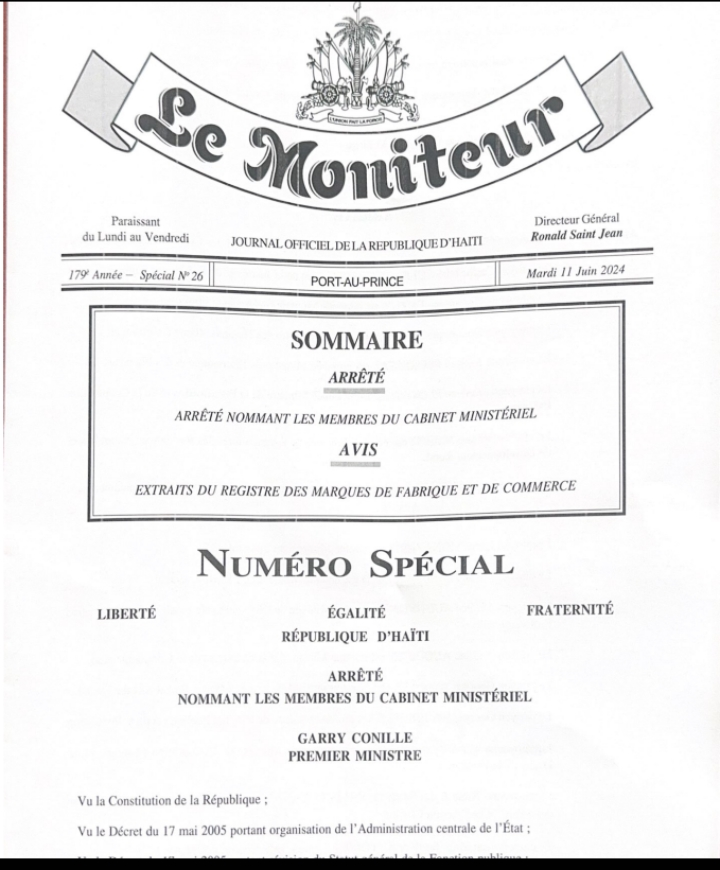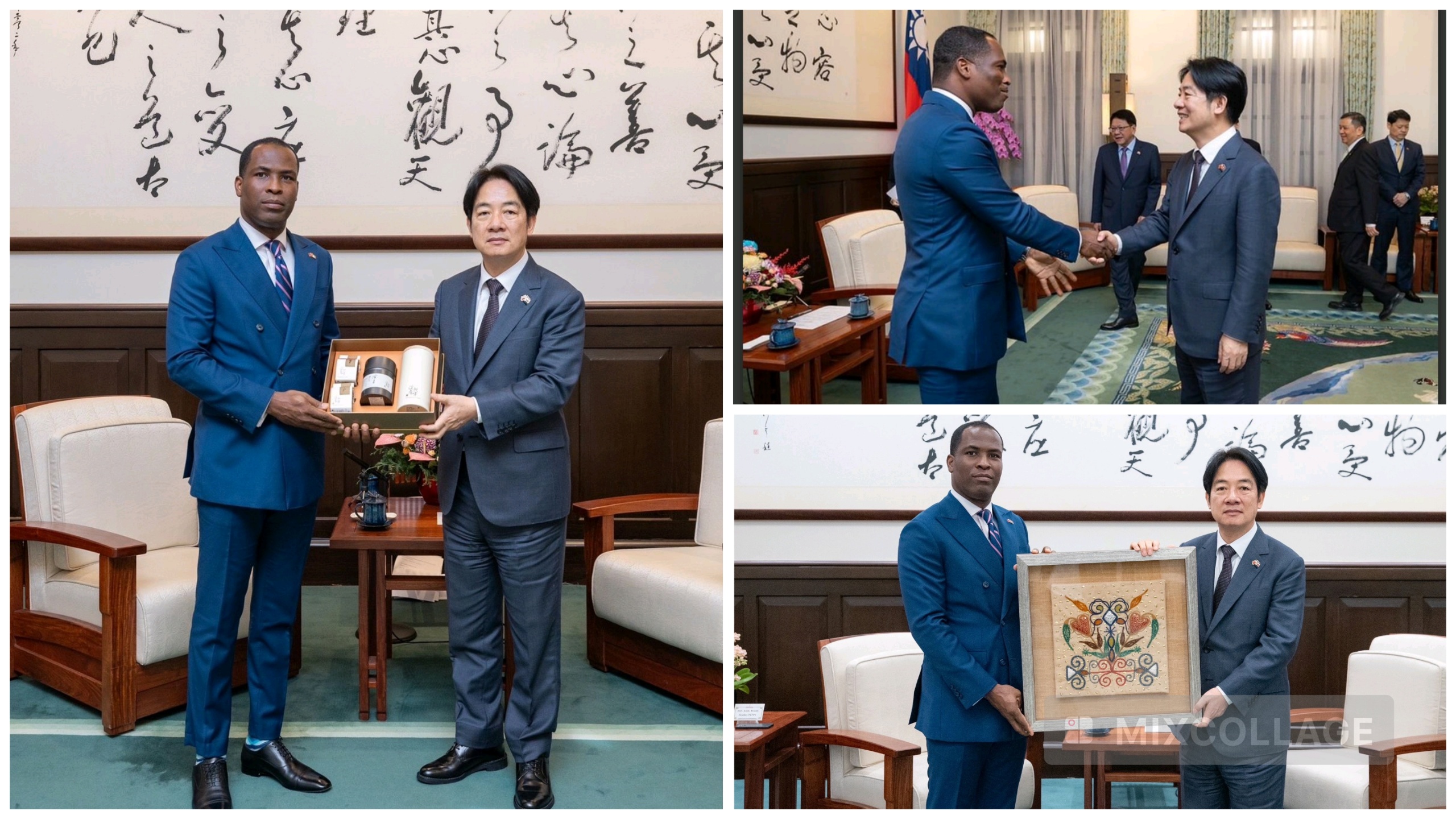Au cours du mois de novembre 2002, l'Université de Porto-Rico, de concert avec l'Association des bibliothécaires de Porto-Rico et le chapitre de la représentation d'ACURIL[1] en ce pays, avait organisé un grand séminaire réunissant les spécialistes portoricains et étrangers autour de la thématique : La lectura: clave del Éxito. Pendant cinq jours, à l'amphithéâtre de la Faculté des Sciences Naturelles, ont été exposés et débattues les différentes approches de la lecture, ainsi que ses fondements techniques dans un contexte de plus en plus dominé par l’immédiateté avec les nouveaux médias. Les débats, de très haut niveau, ont été focalisés sur la lecture non seulement comme mode privilégié d'accès à la connaissance et au savoir, mais aussi comme « fait de civilisation » dans la perspective que le conçoit le philosophe Ortega y Gasset. La Dra. Luisa Carmen Carolina Vigo-Cepeda, notre professeure à la Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información (EGCTI), avait eu plusieurs savantes interventions sur la place de la lecture et son processus d'organisation tendant vers l'efficacité en termes de résultats pour l'acquisition des savoirs. La Dra. Vigo avait aussi insisté sur la place de la lecture dans la vie comme une caractéristique spécifique et fondamentale de l'humaine condition. Et, paraphrasant le Cogito Ergo Sum de Descartes, la Dra. Vigo-Cepeda avait alors revigoré toute l'assistance avec la phrase latine Lego ergo Sum. Je lis, donc je suis. La Dra. Vigo-Cepeda a rappelé les recommandations de la American Library Association (ALA) et d'ACURIL aux responsables des pays et des municipalités en matière de promotion permanente de la lecture comme clave del Éxito[2]. Il y a des activités à mettre en place pour promouvoir la lecture auprès des secteurs les plus divers de la société. Ce, dans une perspective d'amélioration constante de cette condition humaine dont parlait M. André Malraux. Lire, certes, mais bien sélectionner et bien organiser ses lectures en fonction de ses objectifs de formation académique et personnelle est d’une grande pertinence. La Dra. Susan Freiband, pour sa part, avait insisté sur le rôle de l'alphabétisation dans le processus d'acquisition du savoir par la lecture en formation continue et le rôle que les bibliothèques publiques, communautaires et municipales doivent jouer dans le processus, la bibliothèque elle-même étant conçue comme animant un espace permanent d'apprentissage. La bibliothèque municipale de Bayamón avait présenté son expérience de promotion de la lecture en formation continue et de façon permanente. Ce qui se fait de concert avec les écoles, les associations de jeunes, de négociants et de propriétaires de médias de la commune. La lecture, selon les principaux intervenants à ce grand séminaire, représente un outil pour l'avancement de la société et le relèvement moral de la population dans son ensemble. En même temps, bien encadré par des bibliothécaires professionnels de la lecture, lisant avec techniques et méthodes, le lecteur peut arriver effectivement à se mettre dans un cadre de formation permanente. Il augmentera à coup sûr son savoir. Mais, il pourra développer d'autres visions du monde plus positives, plus ouvertes, plus en adéquation avec les exigences du nouveau siècle. Dans tous les pays, il faut bien une politique publique d’éducation garantissant le libre accès à tous et à toutes en fonction du mérite. Les bibliothécaires viendront en appui à cette action durable de l'État. À Porto-Rico, la question de la lecture est prise en compte au niveau de l'Université qui, par le biais de son École de bibliothéconomie forme les bibliothécaires et assure l'évaluation et la supervision de toutes les bibliothèques municipales, communautaires et publiques du pays. On évalue non seulement les collections, mais aussi leurs utilisations en termes de statistiques des demandes et des activités de promotion de la lecture ou de projection de la bibliothèque publique dans la communauté. Dans le cadre de ces évaluations, nous avions été dans toutes les communes de Porto-Rico. La semaine de la lecture, dernière semaine du mois d'avril, est un grand évènement. Il y a grande mobilisation à l'Université et dans tout le secteur des bibliothèques et des libraires: expositions, séances de lectures publiques, Théâtres de rue, émissions de radio et de télévision, discours du Recteur... En cette occasion, le Conseil de l'Université (Senado académico) honore de façon spéciale un Professeur qui s'est distingué pendant toute l'année par son enseignement, ses recherches validées et publiées. En 2004, ce fut le Professeur Mariano Maura-Sardó du Cours d'Évaluation des revues scientifiques de notre École de Bibliothéconomie qui a été distingué. Cela avait causé beaucoup d'émotion, beaucoup de chaleur dans les milieux universitaires et éditoriaux. En effet, le Dr. Maura Mariano-Sardó, spécialiste international reconnu des normes de présentation et d'évaluation des revues scientifiques, expert pour LATINDEX et du suivi des indices de citations des articles de revues dans des bases de données du facteur d'impact d'Eugène Garfield, a été récompensé pour ses recherches publiées et la promotion de la lecture des revues scientifiques à l'Université. L'expérience de Porto-Rico dans le cadre de la lecture nous a marqué. Nous avions eu un parcours dans l'accompagnement de plusieurs bibliothèques publiques de ce pays, particulièrement à Caguas, à Ponce, à Mayaguez, à Bayamón et au sein de la Carnegie Public Library de San Juan.
En Haïti, les pratiques de lecture sont « profondes et vivaces » et se retrouvent depuis la période coloniale au sein même de la communauté des esclaves. D'ailleurs les premiers Africains captivés et emmenés de force par les Français à Saint-Domingue étaient des Mandingues islamisés qui savaient lire l'arabe. L'anthropologue Gérard Barthélemy a effectué, dans le Nord et le Nord-ouest du pays, des recherches sur des pratiques de ces communautés dans le cadre des « Lakou Mori ». De nos jours encore, la controverse sur l'appartenance du leader Boukman à ces communautés islamisées fait rage dans les journaux[3]. Beaucoup d'esclaves savaient lire et les pratiques de la lecture, de l'écriture et de la transmission de ces connaissances et aptitudes étaient beaucoup plus répandues qu'une vue sommaire de la réalité coloniale voudrait bien le faire accroire. L'historiographie haïtienne retiendra les travaux de l'historien Jean Fouchard[4] en la matière, particulièrement ses ouvrages de base comme les Marrons du syllabaire ou encore les Plaisirs de Saint-Domingue. Dans le premier livre, Fouchard nous montre comment les journaux venus de France étaient lus par des esclaves. Il nous informe sur les stratégies utilisées sur la plantation même pour la transmission des techniques de lecture et de l'écriture. Pour sa part M. Patrick Tardieu nous a montré comment fonctionnait l'imprimerie au Cap-Français et comment les journaux étaient en circulation[5]. Le Cas de Toussaint Louverture est toujours cité en la matière. Mais, il est révélateur par simple logique déductive, de beaucoup d'autres situations pareilles inconnues, parce que non rapportées. Il lève seulement le voile sur d'autres cas inconnus, mais non moins déterminants au sein d’un « processus souterrain de transmission » du savoir dans un contexte difficile et de répression permanente. Nous avons toujours pensé que des recherches doivent être menées sur le rôle des congrégations religieuses présentes dans la colonie à l'époque eu égard à la diffusion des pratiques de lecture au sein de la communauté des esclaves. Nous pensons ici au rôle qu'auraient joué les Jésuites en ce sens. Selon l'historiographie officielle, Pierre Baptiste, l'oncle et le parrain de Toussaint Louverture qui l'avait appris à lire a été formé, lui, par les Jésuites. Il y a ici matière à approfondir la recherche sur les activités réelles de la Compagnie de Loyola à Saint-Domingue conformément au principe directeur Ad majorem Dei Gloriam[6] si difficile à déterminer et à saisir dans l'action historique concrète[7]. Il convient d'approfondir par exemple l'apport du Professeur François Kawas[8] sur la question. Car, bien des ombres persistent sur les raisons qui ont conduit à la première expulsion de la Compagnie de cette terre de Saint-Domingue qui redeviendra Haïti sur la Place d'Armes des Gonaïves le dimanche 1er janvier 1804. L’historien Pierre Pluchon[9], citant un mémoire du colon de Livoy, nous apprend que Toussaint Louverture avait été, lui, instruit par un jésuite. Le Précurseur de l'Indépendance restera d'ailleurs toute sa vie un catholique fervent. Le sociologue des religions Laennec Hurbon[10] avait montré le rôle de certains curés, comme le R.P. Bienvenu du Dondon dans la révolte de 1791. D'autres aspects du problème restent encore à éclaircir et conduiront à coup sûr, à toute une révision de certaines formules et formulations toutes faites que l'on fait répéter à nos écoliers pour des motifs idéologiques. Il en est de même du rôle de ces « Esclaves de maison » catégorie sociale que l'on tend de nos jours à stigmatiser[11], tant sur le plan international que national, sur la lecture clandestine des journaux venus de France et qui parlaient des « Droits de l'homme ». Comment cette « rumeur » de congé de trois jours par semaine qu’aurait accordé le roi Louis XVI aux esclaves et refusé par les colons et les administrateurs de la colonie, comment cette « rumeur » a-t-elle pu se propager dans toutes les habitations les plus reculées de Saint-Domingue et se retrouver à la base du Grand Rassemblement de Bois-Caïman? Un autre point à éclaircir. L'historien Pierre Pluchon a retrouvé la même « rumeur » en Martinique et en Guadeloupe vers la même époque... La circulation des « écrits » y était-elle pour quelque chose? L’historien haïtien Jean Fouchard a un grand mérite. Celui d'après nous nous, d'avoir produit une recherche inestimable sur le livre et la lecture dans la colonie de Saint-Domingue. Dans ce document de très grande importance, Jean Fouchard[12] rejette d'un revers de main la fausse idée généralement diffusée voulant faire croire que l'on ne lisait point à Saint-Domingue. À partir de l'exploration approfondie des journaux de l'époque notamment des collections de la Gazette de Saint-Domingue, du Journal de Saint-Domingue, les Avis de Saint-Domingue et des Affiches américaines, l'historien Fouchard a montré clairement que les journaux de France circulaient dans la colonie, qu'il y avait des collections d'ouvrages et des bibliothèques privées dans les résidences des colons. Bien plus, il y avait au Cap-Français, aux Cayes, à Jacmel, à Saint-Marc et à Léogane des « Cabinets littéraires », véritables ancêtres des bibliothèques publiques actuelles où l'on venait lire moyennant paiement d'une petite contribution. Donnons ici la parole à M. Fouchard lui-même pour l'importance et la portée de l'affirmation. « Ces exemples indiquent l'existence de bibliothèques et donc du goût de la lecture chez les colons. C'est du moins l'interprétation que nous accordons pour notre part à ces annonces multipliées »[13]. Pour l'auteur, « la production littéraire des classiques, l'Histoire, le Théâtre, la Musique, les Belles-Lettres ou des Traités scientifiques utiles composent généralement le catalogue des arrivages signalés par les libraires »[14]. Et Jean Fouchard précise pour nous: « il n’y a pas que les marchands libraires et les imprimeurs à distribuer au public les joies de la lecture. Dans toutes les grandes villes de la colonie, au Cap, au Port-au-Prince, à Léogane, aux Cayes, à Saint-Marc fonctionnent des cabinets littéraires. Ce sont des salles de lecture ou l'on va passer des heures agréables ou instructives en compagnie de ses auteurs préférés avec l'agrément supplémentaire des derniers journaux et revues de Paris »[15]. Au Cap même, selon Jean Fouchard, « l'ancien local abritant la Comédie jusqu'en 1764 fut utilisé pour l'organisation d'un cabinet littéraire dont Moreau de Saint-Méry a vanté l'agrément : On a établi dans son premier étage un cabinet littéraire, au moyen d'une cotisation faite par quatre-vingt personnes qui ont donné quarante-deux piastres-gourdes chacune. Ce local, très élégamment meublé renferme outre une bibliothèque utile et tous les journaux intéressants, trois pièces destinées au jeu de billard, a celui de tric-trac et aux jeux de société »[16]. C'est tout dit. Les livres circulaient dans la colonie de Saint-Domingue et la matière était disponible pour que des esclaves, « de véritables marrons du syllabaire », suivant l'expression célèbre de Jean Fouchard, puissent vaincre tous les obstacles et accéder eux-mêmes, aux « joies de la lecture ». À méditer. Des séances d'apprentissage de la lecture et de l'écriture se faisaient en cachette, la nuit, à la lueur des chandelles. Pour Fouchard, « il n'est pas interdit de penser à l'existence d'écoles clandestines avec toutes les ruses que durent employer les infortunés esclaves pour enfreindre les abominables règlements et se préparer à la vie d' hommes libres »[17].
Après la proclamation de l'Indépendance du pays sur la Place d'Armes de la ville des Gonaïves le dimanche Premier Janvier 1804, les pratiques de lecture au sein de la population, n'en étaient pas moins déterminantes. Des journaux se fondèrent comme l'Abeille Haytienne, le Temps, le Télégraphe, Le Phare, la Feuille du Commerce. Ce qui laisse présumer logiquement l'existence d'un lectorat, si réduit qu'il puisse être. Par la suite, les premières mesures prises en matière de l'instruction publique, particulièrement dans le Royaume du Nord avec Christophe, seront déterminantes pour les pratiques de lecture. Le Président Pétion, pour sa part, tout en fondant le Lycée National qui deviendra par la suite Lycée Alexandre-Pétion, nous apprend l'historien J.C. Dorsainvil[18], faisait venir des livres de France qu'il distribua aux officiers de l'Armée et aux cadres supérieurs de l'administration publique « afin de les convaincre du besoin de s'instruire »[19]. Dans le Royaume du Nord de Christophe, des livres venaient d'Angleterre conformément à la volonté du Roi d'implanter des écoles lancastériennes dans le pays et d’instaurer la langue anglaise. À partir de la signature du Concordat du 28 mars 1860 entre l'État haïtien et le Saint-Siège, les congrégations religieuses catholiques vont s'implanter en Haïti et installer des écoles en divers points du pays. Il y aura une plus grande diffusion de l’écrit et de son utilisation. D'ailleurs, ces congrégations, particulièrement les Pères du Saint-Esprit et les Frères de l'Instruction Chrétienne (FIC) vont fonder rapidement des bibliothèques et entreprendre un sérieux travail de sélection, de collecte, de classement et de conservation des documents et des collections de journaux disponibles, bref, de la production intellectuelle du nouveau pays. Sous ce rapport, le R. P. Adolphe Cabon, historien lui-même, avait effectué un travail énorme et minutieux de collecte. La génération issue de ces centres d'enseignement et du Lycée Pétion pour lequel le Président Salomon avait engagé une mission de coopération d'enseignement venant de France sous la direction de son fougueux ministre de l'Instruction Publique M. François Saint-Surin Manigat, initiative qui, dans une certaine mesure, allait donner plus tard la grande production intellectuelle, littéraire et scientifique de la seconde moitié du XIXème siècle et nos auteurs de la Génération de la Ronde. Cette production intellectuelle attend toujours, selon le Professeur-chercheur Lewis Ampidu Clorméus d'être profondément explorée[20]. L'occupation américaine, ou « Le choc » de 1915 avait beaucoup impacté sur la vivacité de cette production intellectuelle, notamment avec l'instauration, dès 1918, de ce que l'historien Roger Gaillard[21] appelle « la république autoritaire » et l'institution de tribunaux spéciaux sous la direction du « Grand Prévôt » dans le pays poursuivant les journalistes haïtiens pour « délits de presse », particulièrement le journaliste Elie Guérin, véritable martyr d'opinion, pour son journal Haïti Intégrale. Avec la proclamation de la loi martiale par l'Amiral Caperton au cours de cette même période, le 3 septembre 1915, Roger Gaillard parle alors de « Parole désormais enchainée » en Haïti[22]. Des journalistes célèbres comme M. Elie Guérin, M. Georges Petit et M. Ernst Chauvet allaient connaitre des tracasseries, des persécutions de toute sorte et même la prison. De grandes restrictions furent instituées pour la publication des journaux de l’époque. Néanmoins, c'est au cours de cette même période difficile pour l’expression de la pensée que des intellectuels et historiens de renom comme le Dr. Jean Price Mars, M. Pauléus H. Sannon, M. Dantès Bellegarde et M. Catts Pressoir vont se réunir pour constituer une société savante existant encore de nos jours, la Société haïtienne d’histoire et de géographie et lancer du même coup la Revue de la société haïtienne d'histoire et de géographie[23].
La dictature trentenaire des Duvalier avait beaucoup impacté sur la diffusion des pratiques de lecture et de la diffusion du savoir dans le pays tout entier. C'est à partir des années 1960 que la production intellectuelle du pays s'est massivement déplacée vers l'étranger. On retrouve le même phénomène dans le domaine de la musique. Lisons ce que nous en dit à ce sujet M. Ralph Boncy: « avec le durcissement du régime Duvalier et l'insécurité qui règne sur le « la Perle des Antilles », l’exode massif des Haïtiens vers l'Amérique du Nord décuple vers les années 60 et Haïti devint une nation éclatée. Ce qui explique que 30% de morceaux contenus dans ce premier tome intitulé la chanson d'Haïti ont été conçus et enregistrés hors de l'ile, par des musiciens dits « exilés » pour des raisons économiques ou politiques »[24]. Sur le plan des lettres, il y eut donc, à partir des années 1960, en Haïti, un véritable déplacement de la production intellectuelle vers l’étranger. Une lecture attentive du catalogue public de la Bibliothèque Nationale d'Haïti (BNH) le montre de façon éloquente. Il y a eu alors des « livres interdits » en Haïti dont la simple possession entrainerait la mort ou l'emprisonnement à Fort Dimanche. Les parents apeurés demandaient instamment à leurs enfants de ne pas trop lire pour ne pas devenir fous... Bizarre. Des bibliothèques, des laboratoires de physique ou de chimie furent tout simplement fermés aux lycées Toussaint et Pétion. Des espions de la Préfecture ou du Ministère de l'Intérieur se postaient ou faisaient la ronde aux abords des librairies pour voir, pour « détecter » quels livres les gens achetaient et dresser rapport « à qui de droit ». Les appareils et machines de photocopieuses étaient particulièrement surveillés par les espions de la Préfecture. Les parents demandaient à leur progéniture de ne pas lire ou encore tout simplement de ne point abriter chez eux des « livres dangereux ». Les journaux qui avaient continué de paraitre se mettaient au pas en pratiquant l’autocensure. Ce fut une longue traversée du désert pour la lecture, art indépendant et délibéré par nature. Nombre d'auteurs ont dû laisser le pays en catastrophe, avec parfois des suites fâcheuses pour leurs proches restés au pays et vivant dans une situation de psychose permanente. D'autres y ont laissé tragiquement leurs vies dans des conditions non encore élucidées, comme par exemple le génie M. Jacques Stephen Alexis[25]. D'autres écrivains encore, comme Frankétienne, ont choisi de rester au pays, de continuer à produire et vivre ainsi un véritable « exil intérieur »…[26] À la chute de la dictature le 7 février 1986, les libertés démocratiques sont rétablies, garanties par la Constitution du 29 mars 1987. Le livre haïtien a repris son élan et désormais s'affirme de plus en plus dans l'univers social collectif.
Des auteurs importants reviennent et publient au pays. Des foires du livre s'organisent dans les villes du pays avec succès et forte participation des jeunes. De nouvelles bibliothèques s'installent. De nouvelles maisons d'édition se créent et fonctionnent avec dynamisme et respect des normes de présentation des ouvrages. Des jeunes écrivains s'affirment tant sur le plan national qu'international. Dans ce contexte de liberté retrouvée, il convient de souligner l'action pionnière tenace et continue du Professeur Webert Lahens en faveur du livre et de la lecture avec notamment l'organisation de séminaires de formation sur la question. Récemment, l'écrivain Dany Laferrière vient de faire une entrée fracassante à l'Académie française. Plus près de nous, le Professeur Marc Exavier mène le même combat: Elargir le lectorat. Nos écrivains sont des invités d'honneur dans des foires du livre nationaux et internationaux et donnent des interviews dans les médias de très grande écoute. Des stations de Radiodiffusion comme Espace FM avec le Professeur Marc Exavier proposent des émissions sur le livre et la lecture. M. Dangelo Inrico Néard présente une émission de ce type sur les écrans de la Télévision Caraïbes (RTVC). À l'université, nous retrouvons cette même dynamique. Les fonds documentaires ont été en grande partie reconstitués après les destructions causées par le séisme du 12 janvier 2010. Avec les pratiques de formation continue instituée par le Professeur Jean-Rénol Elie par exemple à la Faculté des Sciences Humaines, des activités de formation sont dirigées à tous les groupes de la population. En dépit des difficultés de toute sorte, la lecture fait son chemin en Haïti. Il faut continuer à l'encourager en faisant ce qui est possible pour maintenir et élargir le lectorat.
Revenus en Haïti en 2005, nous avons essayé, dans les milieux universitaires et populaires de promouvoir la lecture et la recherche. Pour cela, nous avons initié des expériences d'atelier de lecture et d'écriture. Nous avons animé régulièrement des séminaires sur la bibliothéconomie et avons mis sur pied, avec des jeunes du pays, des bibliothèques publiques dans le cadre d'initiatives citoyennes. Nous avons soutenu fermement les Assises des Bibliothèques ainsi que des initiatives qui se prennent dans le pays pour augmenter le nombre des bibliothèques disponibles. Ce, dans un objectif précis: Elargir de plus en plus le lectorat en Haïti. II y a peut-être des problèmes de moyens et surtout de suivi. Nous avons sous les yeux le compte rendu d'un atelier de deux journées de réflexions tenues à l'Hôtel Xaragua les 29 et 30 avril de l'année 2011 autour de la problématique du livre et de la lecture publique à l'initiative de la Direction Nationale du Livre (DNL)[27]. Nous n'allons pas reprendre ce qui a été dit durant ces assises. Le Nouvelliste en a présenté les points saillants. Nous retenons qu'un bon diagnostic de l’existant a été produit et présenté par les principaux opérateurs du secteur. Des propositions pertinentes ont été formulées par les acteurs intervenant dans la chaine du livre. Il faut penser sérieusement à leur mise en application. Nam sine sciencia, Vita imargo mortis est… Car sans la connaissance, la vie elle- même est à l’image de la mort, disaient les anciens Romains.
Jérôme Paul Eddy Lacoste
Responsable académique de la Faculté des Sciences Humaines
Juin 2024
babuzi2001@yahoo.fr
NOTES
[1] (ACURIL). Association of Carribean University Research and Institutional Libraries Plusieurs institutions documentaires haïtiennes sont membres de cette association comme la Bibliothèque Nationale d'Haïti (BNH), la Fondasyon Konesans ak Libète (FOKAL), et les Archives Nationales d'Haïti (ANH). Haïti avait été le siège de l'organisation du Congrès d'ACURIL en juillet 2017. La Professeure Luisa Vigo - Cepeda du Chapitre de Porto-Rico y avait participé en compagnie de notre amie et camarade de promotion Sra. Pura Centenio.
2 La lecture Clef du succès.
3 Voir sous ce rapport sujet la relation qu’en a fait M. Charles Dupuy (2010) dans le quatrième tome de son ouvrage Le coin de l’histoire. Editions la périchole, Montréal, pp. 39-41.
4Jean Fouchard (1988). Les marrons du syllabaire. Quelques aspects du problème de l'instruction et de l'éducation des esclaves et des affranchis de Saint-Domingue. Editions Henri Deschamps. Port-au-Prince, Haïti.
5 Patrick A. Tardieu. « Pierre Leroux et Lemery. Imprimeurs de Saint-Domingue à Haïti ». Revue de la Société Haïtienne d’Histoire et de Géographie. Numéro 218. Juillet septembre 2004.
6Pour une plus grande gloire de Dieu
7 Sur l’histoire des Jésuites en général, je recommande au lecteur les deux tomes vraiment imposants de l’ouvrage de M. Jean Lacouture. Jésuites, une multibiographie. Tome I : Les conquérants. Tome II : les revenants parus aux Editions du Seuil, Collections Points, au cours de l’année 1991.
8 François Kawas. « Histoire des Jésuites en Haïti ». Le Nouvelliste 12 janvier 2005. Sources documentaires de l'histoire des Jésuites en Haïti au XVIIIème et au XXème siècle (1704-1763; 1953-1964). Ed. L' Harmattan, Paris. Au moment de réviser ce texte, j’ai appris avec douleur la triste nouvelle de la mort subite du Professeur François Kawas le 23 octobre 2022. Le Professeur Kawas avait occupé la chaire de Sociologie politique à la Faculté des Sciences Humaines. Je me retrouvais avec lui dans plusieurs jurys de soutenance de mémoire. C’était un bon collaborateur. Je transmets, une fois de plus, mes condoléances à sa famille et à toute la communauté des Jésuites en Haïti et dans le monde entier. Que le Professeur François Kawas repose en paix ! Ad majorem Dei Gloriam.
9 Pierre Pluchon (1989). Toussaint Louverture. Ed. Fayard. Paris. p. 57. Le texte dit ceci : « Toussaint, nègre, esclave avant la Révolution et instruit par un ex-jésuite, était majoral ayant la surveillance des animaux sur l’habitation Libertat ».
10 Laënnec Hurbon (2003). L' insurrection des esclaves à Saint-Domingue. Ed. Karthala, Paris.
11 Les tenants de cette « stigmatisation » semblent oublier que Toussaint Louverture a été non seulement un esclave domestique, mais également et surtout, homme de confiance de M. Bayon de Libertat. Ils passent totalement sous silence le rôle des esclaves domestiques come les cochers, cuisiniers, tourneurs, gardiens d’habitations et même des commandeurs dans la préparation et l’organisation de la grande Révolte du 22 août 1791. Il faut se rappeler que M. Dutty Boukman a été commandeur. Chaque catégorie d’esclaves avait œuvré dans sa sphère d’action, selon ses marges et possibilités, dans la lutte contre l’esclavage. La « stigmatisation » des esclaves domestiques ou des esclaves à talents à posteriori, selon notre humble avis, est injuste. Sur la participation des prêtres catholiques dans le grand mouvement contre l’esclavage, voir Laënnec Hurbon, Op. Cit.
12 Fouchard Jean. Les joies de la lecture à Saint-Domingue. In: Revue d'histoire des colonies, tome 41, n°142, premier trimestre 1954. pp. 103-111. DOI : https://doi.org/10.3406/outre.1954.1205 www.persee.fr/doc/outre_0399-1385_1954_num_41_142_1205
13 Ibid.
14 Ibid.
15 Ibid.
16 Ibid.
17 Jean Fouchard. Op.cit., p. 84.
18 J.C. Dorsainvil (1934). (Avec la collaboration des Frères de l'Instruction Chrétienne). Manuel d’Histoire d’Haïti. Ed. Henri Deschamps. Port-au-Prince. p. 137.
19Ibid.
20Entretien accordé à l'auteur par le Professeur Lewis Ampidu Clorméus le 2 juillet 2021.
21 Roger Gaillard (1981). Les blancs débarquent : 1916-1917 : La République autoritaire. Imp. Le Natal, Port-au-Prince. En quatrième de couverture de cet ouvrage, Roger Gaillard a mis en exergue une citation du Dr. Jean Price mentionnant qu’avec la suspension du Parlement et des garanties constitutionnelles par l’Occupant, Haïti allait connaitre un « régime d’exception, et c’est là le danger ». Une situation qui n’est pas trop différente de celle que nous connaissons en Haïti depuis l’année 2021 : un régime d’exception. Il faut lire avec beaucoup d’attention, surtout dans la conjoncture actuelle, les écrits de L’Oncle… De plus, j’ai toujours pensé, de la même façon que M. Frantz Duval du Nouvelliste et du Professeur Watson Denis que l’historien Roger Gaillard n’avait pas choisi certains titres de ses ouvrages au grand hasard. Ainsi nous avons : Les blancs débarquent, La République autoritaire, La République exterminatrice, L’État Vassal, Hinche mise en croix, La déroute de l’intelligence… À réfléchir.
22 Roger Gaillard (1981). Les blancs débarquent 1915. Premier écrasement du cacoïsme. Imp. le Natal, Port-au-Prince, p. 57.
23 Selon le site de la Haiti Digital Library / Bibliyotèk Dijital Ayisyen / Bibliothèque Digitale sur Haïti de la Duke University, « La Société d’histoire et de géographie haïtienne a été créé au lycée Pétion à Port-au-Prince en 1923 dans le but exprimé de “l’éducation des Haïtiens eux-mêmes de leur pays et de son histoire ". Les membres fondateurs incluent des figures intellectuelles et politiques haïtiens éminents tels que Dantès Bellegarde, François Denis Légitime, Jean Price-Mars, Sténio Vincent, et Jacques Catts Pressoir ». https://sites.duke.edu/haitilab/french. Accédé le 13 octobre 2021. Pour l’historien Jacques de Cauna, La Revue de la Société Haïtienne d’histoire et de Géographie, par son ancienneté et la régularité de sa parution représente « la doyenne de toute la zone caraïbe » pour ce type de publication.
24 Ralph Boncy, avec la collaboration de Marc Guillaume Lubin et de George Léon Emile. (1992). La chanson d'Haïti. Ed. CIDIHCA, Montréal, p. 14.
25Il faut ici se rappeler le cas du célèbre peintre M. Charles Obas, arrêté et porté définitivement comme « disparu » pendant la dictature. Le peintre M. Charles Obas était le père de l’artiste Beethova Obas, de M. Klébert Obas et du jeune chanteur Emmanuel (Manno) Obas du groupe Mizik-Mizik. Une situation qui avait traumatisé toute la famille et les amis du peintre Charles Obas, figure de proue de la peinture haïtienne. .
26 Nous tenons à faire ces précisions car dans le milieu des nouvelles générations n’ayant pas vécu durant la période de la dictature, il y a une certaine nostalgie d’un « certain ordre » qui aurait existé durant cette période. Attitude de pensée qui trouve son explication dans le désarroi actuel. Il faut prendre garde pour ne pas remplacer un dé pipé par un autre plus pipé encore…Le même cas de figure se présente actuellement, m’a fait savoir un ami congolais, en République Démocratique du Congo (Ex-Zaïre de M. Mobutu Sese Seko) où des gens qui n’avaient point connu les vissicitudes du régime s’en réclament… Le révisionnisme et le négationnisme ont la vie dure en Histoire. De nos jours, le nazisme est réapparu dans toute son hideur et arrogance en Europe. Un parti se réclamant ouvertement du fascisme vient de prendre le pouvoir en Italie. Les récentes élections pour le Parlement Européen nous montrent des partis d’extrême droite ouvertement racistes en train de conquérir le pouvoir. Ces données viennent confirmer la fameuse phrase de M. Berthold Brecht que nous ne citons pas ici, mais que connait très bien le lecteur cultivé.
27 Roberson Alphonse. « Poser la problématique du livre et de la lecture publique
28Roberson Alphonse. « Poser la problématique du livre et de la lecture publique ». Le Nouvelliste. 5 mars 2011.