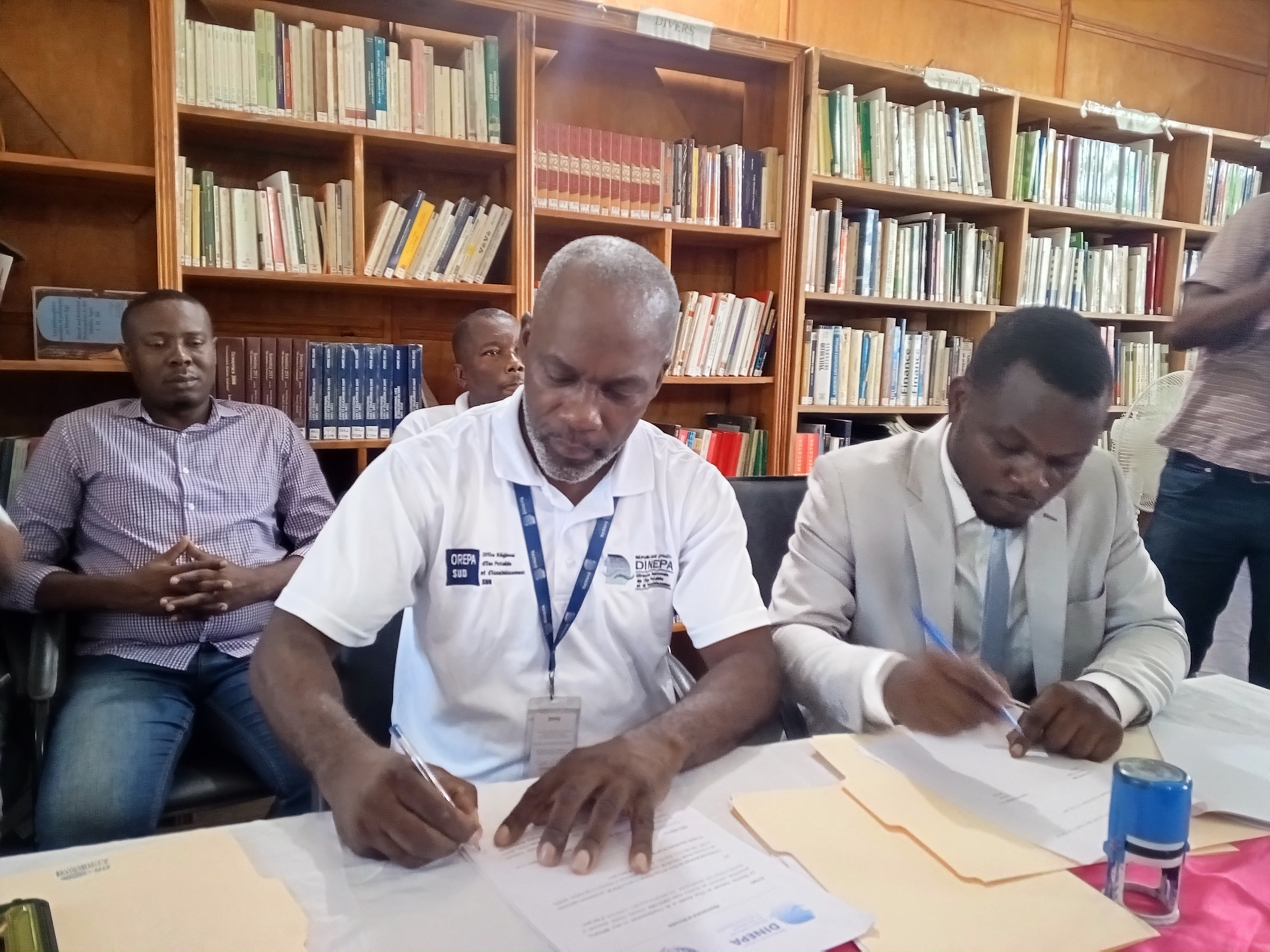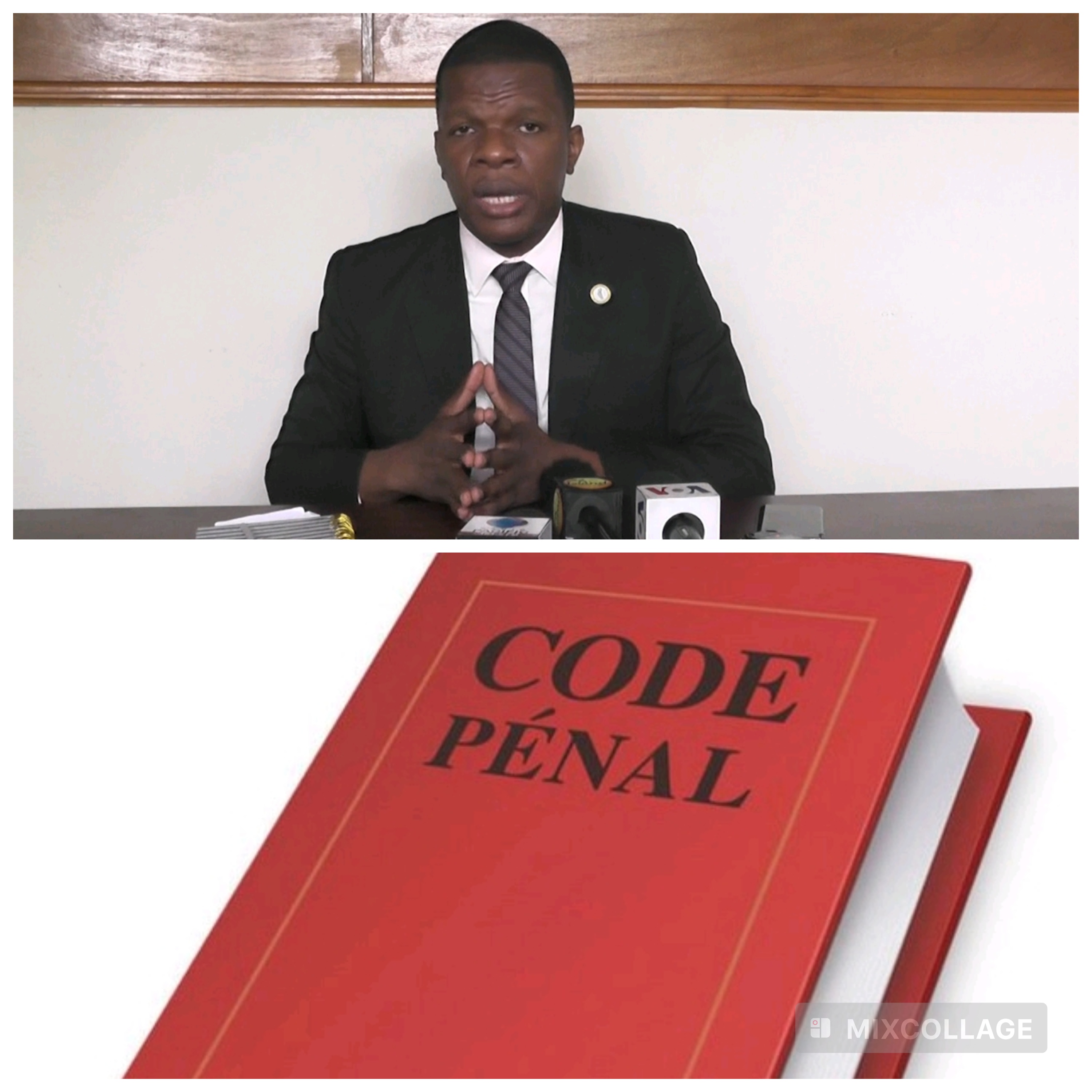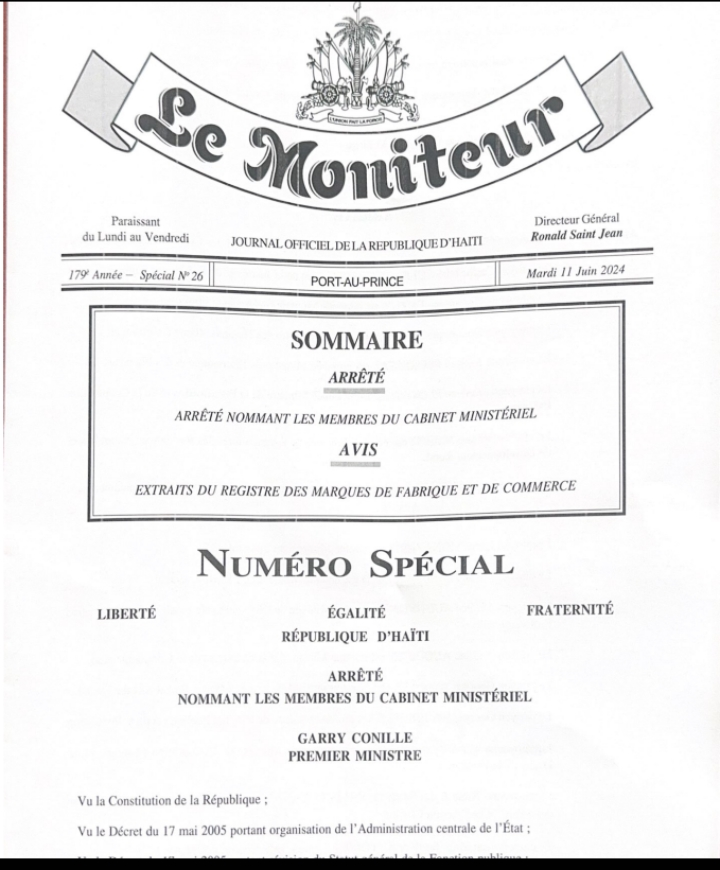L’instabilité politique et les transitions qui en découlent caractérisent la vie politique haïtienne depuis 1806. L’actuel Conseil présidentiel de la transition et la nomination d’un Premier ministre en la personne de Garry Conille est loin d’être la première instance provisoire que le pays ait connue. Il y en a eu au moins dix du même type. Troisième partie d’une série sur ces récurrentes transitions (1).
« Président du conseil militaire de gouvernement ». C’est sous cette dénomination que le Général Léon Cantave va gérer à deux reprises le pays, d’abord pendant 4 jours (2 avril 1957-6 avril 1957) et ensuite durant 5 jours (20 mai 1957-25 mai 1957). Ensuite, il revenait à un autre haut-gradé, le général Antonio Thrasybule Kébreau, chef d’État major de l’armée, de le remplacer au même titre.
Comme ses prédécesseurs, Kébreau a conservé la même appellation. Mais pour Franck Lavaud, celle-ci était légèrement différente : son titre était « Président du Comité militaire exécutif provisoire ».
Au pouvoir, la mission de Kébreau (14 juin 1957-22 octobre 1957) est d’organiser des élections. Celles-ci ne peuvent être que frauduleuses car il s’agit pour lui d’élire quelqu’un de faible pour qu’il pourrait manier à sa guise. Un jouet en quelque sorte. Cet homme fut ce médecin de campagne en la personne de François Duvalier. La suite on la connaît : celui-ci s’est révélé plus malin qu’il n’en avait l’air. Le nouveau venu a ainsi tourné en bourrique Kébreau en le nommant comme diplomate au Vatican puis comme ambassadeur en Italie pour finalement l’empoisonner lors d’un séjour en Haïti.
Le duvaliérisme commence en Haïti par une répression aveugle, même si sous le règne de son fils, Jean-Claude Duvalier, celle-ci avait diminué en intensité. Une gestion de père en fils qui aura duré vingt-neuf ans. Avant même la prise du pouvoir par François Duvalier en septembre 1957, le général Kébreau a commis des massacres dans les bidonvilles entourant Port-au-Prince : la Saline, la Cour Bréa, Bel-air etc. Dans ces quartiers populaires de la capitale se trouvaient des centaines de partisans du candidat, Daniel Fignolé, leader du MOP. Ils ont été tués sans crier gare. Compte tenu que Daniel Fignolé était le favori des présidentielles de 1957, sans ces horribles exécutions, le futur dictateur n'aurait pas pu parvenir à la magistrature suprême.
Dans la pure tradition politique de ce pays, l'armée avait favorisé cette prise du pouvoir comme elle l'avait fait pour Dumarsais Estimé en 1946 et pour Paul Eugène Magloire, en 1950. Parmi les nombreux candidats qui briguaient la présidence haïtienne en cette année-là, le leader du Mouvement Ouvrier Paysan, Daniel Fignolé, se détachait du lot par son charisme, son honnêteté, son éloquence, surtout sa popularité que les envieux et les jaloux ont toujours voulu limiter aux masses populaires.
Fin des Duvalier
L’installation de François Duvalier fut avant une cuisante humiliation pour l’armée d’Haïti qui a attendu plus de vingt-neuf ans avant de pouvoir se refaire une santé politique. Ce matin du 7 février 1986, les Haïtiens médusés étaient massés devant leur transistor écoutant le dernier discours de Jean Duvalier : « Mes chers compatriotes, peuple haïtien ! Aujourd’hui je ne peux déceler dans un examen méticuleux de la situation aucun signe qui pourrait m’encourager à espérer que ce cauchemar de sang serait évité à mon peuple. C’est pourquoi désirant entrer dans l’histoire la tête haute, la conscience tranquille, j’ai décidé de passer ce soir le destin de la nation, le pouvoir aux forces armées d’Haïti en souhaitant que cette décision permette une issue pacifique et rapide à la crise actuelle, mes sentiments de gratitude et d’émotions à vous tous pour le soutien réel que vous m’avez apporté en particulier aux zélés duvaliéristes et jean-claudistes durant ma gestion. Que les dieux tutélaires de la nation continuent de veiller sur la terre de Dessalines que nous vénérons tous ! »
Cette décision fait suite à deux années de manifestations populaires dans les principales villes du pays, notamment aux Gonaïves. Les 29 ans de dictature a entraîné un lourd bilan humain : on avance l’effroyable chiffre de plus de 20.000 Haïtiens tués seulement à Fort-Dimanche sans compter des milliers d’autres.
Jean-Claude Duvalier, celui qui avait droit de vie et de mort sur ses compatriotes s’est enfui dans la nuit du 6 au 7 février 1986 pour la France. Encore une fois, un militaire va prendre les rênes du pouvoir. Un « Conseil national de gouvernement composé de six membres (4) assure l’intérim.
Comme souvent dans notre longue histoire de transitions politiques, ce CNG ne tiendra pas la route car en son sein se trouvaient des militaires ainsi que des civils ayant participé à la répression du régime des Duvalier ; ceux-ci n’arrivaient pas à s’entendre.
Élections de 1987 avortées
De nombreuses manifestations réclamaient le départ du CNG. Après seulement un mois et demi, le gouvernement a été amputé de ses trois membres. Un d’entre eux a démissionné avec fracas : Maître Gérard Gourgues. Il ne restait plus que deux membres : deux militaires avec un nouveau en son sein que son président, le Général Namphy, est allé chercher dans son nord natal, maître Luc D. Hector. Ces trois-là officiels avaient en charge d’organiser les premières élections libres et démocratiques du pays de l’après-duvaliérisme.
Au petit matin du 29 novembre 1987, des individus soutenus par l’armée ont pénétré dans les bureaux de vote, assassinant des électeurs. Les forces armées n’avaient jamais accepté ces deux piliers de la Constitution de 1987 : le conseil électoral provisoire et l’organisation des élections indépendantes du pouvoir militaire. L’armée d’Haïti renoue avec ses vieux démons en tentant d’empêcher la société d’évoluer vers un régime démocratique. Les militaires voulaient tout bonnement rester maîtres du jeu politique.
Au lendemain de l’écrasement des élections de 1987, l’armée institue son propre conseil électoral chargé d’organiser de nouvelles élections. Un scrutin dont les urnes ont été scellées par les militaires qui ont contrôlé le processus du début à la fin. Sans surprise, Leslie Manigat, candidat des militaires, entre le 7 février 1988 au palais national. Quatre mois plus tard, le 20 juin 1988, il sera destitué.
Aussitôt s’installe la permanence d’un combat politique fratricide qui allait à petits feux détruire l’institution militaire usée par des coups d’État sur fond d’instabilité politique et des crises économico-sociales.
Le jeu de la chaise musicale
L’armée en tant qu’institution essentiellement politique ne pouvait échapper à la crise sociétale qui éclatait lors du retour au pouvoir du Général Namphy (20 juin 1988-17 septembre 1988). Plus de CNG : l’homme était seul en piste. D’ailleurs, il est apparu à la télévision avec un uzi en main, casque vissé sur la tête pour baragouiner que l’armée assure désormais le pouvoir.
C’était la deuxième fois qu’il assura un intérim. Cette fois, il est seul à bord avec un autre titre : « Président du gouvernement militaire » ; avant il était « Président du Conseil national de gouvernement ». Son aventure n’avait duré que deux mois et quelques jours (20 juin 1988-17 septembre 1988). Ce fut un coup d’État militaire dans un autre coup d’État militaire avec une nuance de taille, le général Namphy a été renversé non pas par un autre général comme c’est toujours le cas mais par la base de l’armée ayant à sa tête, le soldat Sergent Hébreux. Mais celui-ci s’était empressé de remettre le pouvoir au Général Prosper Avril (17 septembre 1988-10 mars 1990) tout en gardant la dénomination du gouvernement militaire.
À l’instar de Namphy, le nouvel homme fort a laissé éclater l’incompétence de l’institution militaire à gérer le pays. L’intérim continue sa course avec les crises politiques qui l’accompagnent. Quand on a épuisé les généraux, les militaires passent à un autre niveau et c’est ainsi que le Général Prosper Avril a pu échapper de justesse à un autre coup d’État orchestré par le colonel Himmler Rebu.
Finalement épuisé par un pouvoir dont il ne contrôlait plus, Avril fut poussé dehors par l’ambassadeur américain de l’époque, le tout-puissant Alvin Adams. Et le pouvoir intérim courait toujours avec frénésie dans les décombres de nos malheurs de peuple. C’est à un vieux militaire, homme d’appareil militaire haïtien, faisant figure de modéré parmi les généraux, que revient le pouvoir militaire en la personne du Général Hérard Abraham (10 mars 1990 -13 mars 1990) sous le titre de « Président du gouvernement militaire à titre provisoire ». Trois jours, le temps pour les États-Unis d’Amérique, par l’intermédiaire de son représentant de transférer le pouvoir à un civil. Cette fois-ci, comme le veut la Constitution, on a recouru à la Cour de cassation pour choisir un chef d’État : la juge Ertha Pascale-Trouillot (13 mars 1990-7 février 1991).
Les élections organisées par le gouvernement de Trouillot ont porté Jean-Bertrand Aristide au pouvoir, avec le soutien actif de la diplomatie américaine en Haïti. L’organisation des Nations unies avait inauguré sa première mission en Haïti sous le nom de Groupe d'observateurs des Nations unies pour la vérification des élections en Haïti (ONUVEH). Cette institution, en flagrante violation de la souveraineté d’Haïti, avait tordu la main aux militaires pour leur enlever le pouvoir qu’ils monopolisaient depuis le départ de Jean Claude Duvalier.
Fin éphémère de la transition
Le 16 décembre 1990, la transition entamée depuis 4 ans a connu un épilogue heureux. Entre 1986 et 1990, l’armée aura été au pouvoir d’une manière ou d’une autre. Cependant, la prise de pouvoir de manière démocratique par Jean-Bertrand Aristide n’avait rien changé dans la mentalité des militaires haïtiens qui n’ont pas cessé de convoiter le pouvoir.
Huit mois plus tard, en septembre 1991, l’armée intervient et renverse Aristide en septembre 1991. Celui-ci se rend à Caracas dans un premier temps puis aux États-Unis. Des violations flagrantes des droits de l’homme ont eu lieu, notamment à l’encontre des partisans de l’ancien président exilé Jean-Bertrand.
Cette fois les militaires, auteurs du coup d’État, n’avaient pas osé de s’attarder au pouvoir. Las de se faire tancer par les Nations unies et les partisans du président en exil qui manifestaient en grand nombre dans la diaspora, les généraux (Raoul Cédras et Michel François) qui ont gardé le pouvoir du 29 septembre au 8 octobre 1991, ont fini par le remettre à un civil, juge à la cour de cassation en la personne de Joseph Nerette (8 octobre (1991-19 juin 1991) à titre de président provisoire et Jean-Jacques Honorat comme premier ministre. Ce gouvernement de facto ne sera pas reconnu par la communauté internationale
Comme les deux hommes n’arrivaient pas à organiser des élections comme prévu, ils ont fini par s’en aller et passer les rênes du pouvoir à Marc Bazin qui gouverna sans président de la République pendant deux longues années. Marc Bazin occupa les fonctions présidentielle et législative pendant deux longues années en tant que premier ministre (19 juin 1992- 12 mai 1994).
De guerre lasse, Bazin aussi allait lui aussi échouer sur l’autel de la réalité politique et traîna une non reconnaissance internationale et un embargo, véritable arme politique dont disposait le président légitime qui, depuis Washington, laissait aucun répit ses adversaires politiques. Pendant cette longue crise de trois ans, on a assisté à un affrontement quotidien entre deux gouvernements - l’un légitime en exil et l’autre illégitime occupant le pouvoir sur place - sous l’œil « bienveillant » des Nations unies qui ont voté pas moins d’une vingtaine de résolutions contre les putschistes.
Le dernier président provisoire né du coup d’État sanglant des militaires, le 30 septembre 1991, issu aussi de la cour de cassation fut Émile Jonassaint. Un original, au sens vrai du terme mais un homme honnête au-dessus de tout soupçon de corruption. Mais lui aussi allait achopper dans un intérim interminable qui n’en finissait pas d’épuiser militaires comme civils. Il faut dire que dans ce rapport de force politique, le coup d'État de septembre 1991 avait échoué, car en octobre 1994, le président déchu reprenait son poste sous la protection d'une force internationale américano-onusienne. Ce n'est pas pour autant la fin des gouvernements intérimaires; au contraire, cela semble même devenir le principal mode d'exercice du pouvoir. (à suivre)
Maguet Delva
Paris France
Notes
(1) Première partie trouvable sous le lien suivant:https://lenational.org/post_article.php?cul=1761
(2) Deuxième partie trouvable sous le lien suivant: https://lenational.org/post_article.php?cul=1790