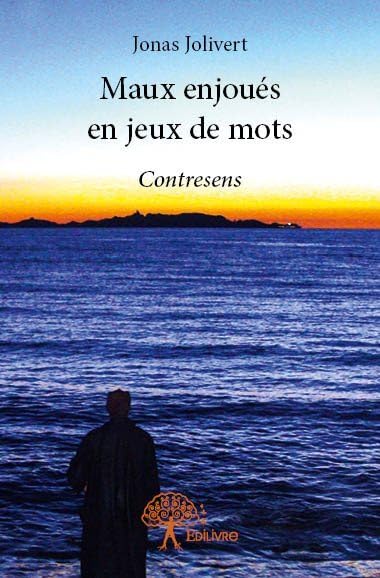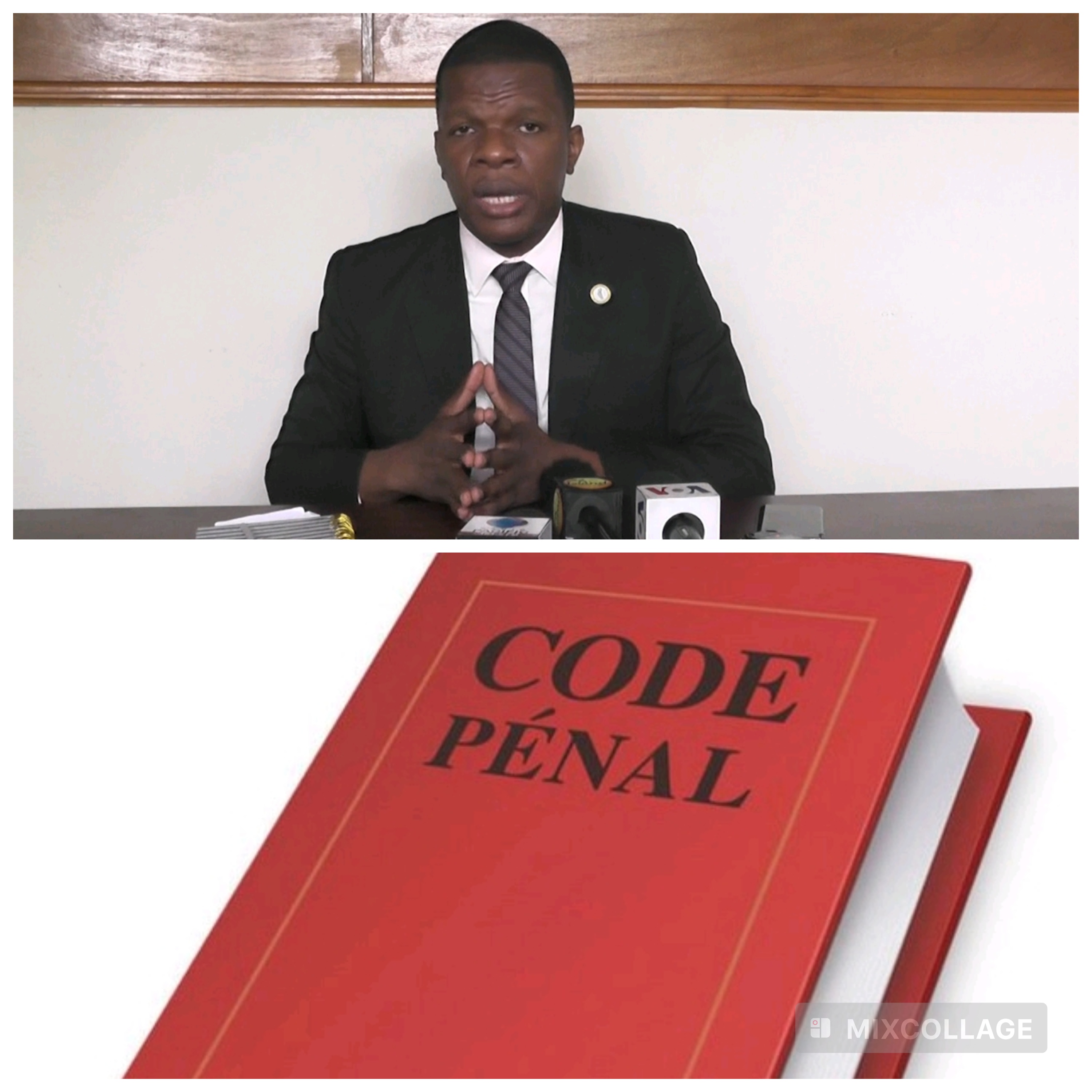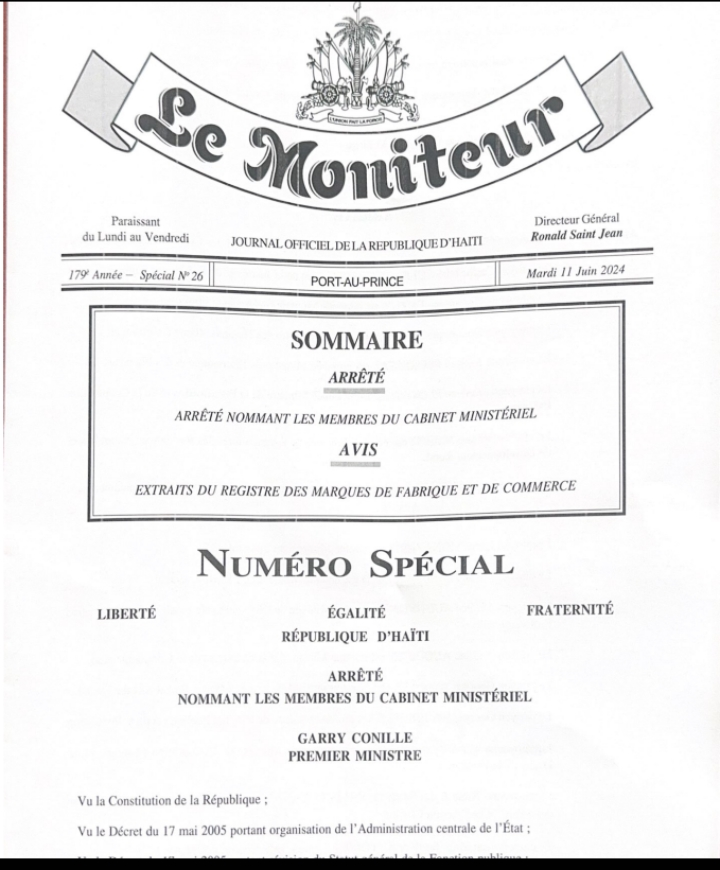(2e partie)
L’instabilité politique et les transitions qui en découlent caractérisent la vie politique haïtienne depuis 1806. L’actuel Conseil présidentiel de la transition est loin d’être la première instance provisoire que le pays ait connue. Il y en a eu au moins dix du même type. Deuxième partie d’une série sur ces récurrentes transitions (1).
« Comité de l’ordre public », « Président du Comité militaire exécutif provisoire », la liste est longue. Le pléthorique actuel Conseil présidentiel de transition (CPT) est le dernier avatar d’une longue tradition. Et il n’est pas le plus peuplé de notre histoire : le record national est détenu par le « gouvernement collégial » (2) qui a géré le pays du 6 avril 1957 au 20 mai 1957.
Cela a commencé sous Henri Christophe qui fut, le 28 décembre 1806, « Président de la République d'Haïti par intérim » le 28 décembre 1806. À la suite de son suicide, celui qui deviendra par la suite Roi est remplacé par Bruno Blanchet, « Secrétaire d'État chargé de l'exécutif » par intérim pendant deux mois (19 janvier 1807-10 mars 1807). Après les deux présidences provisoires et normales de Nissage Saget respectivement (19 décembre 1869-19 mars 1870 et 20 mars 1870-14 mai 1874), un « Conseil des secrétaires d'État » assure l’intérim.
Mais celle qui porte le titre le plus curieux est le fameux « Comité révolutionnaire de Port-au-Prince » qui est en fonction à titre intérimaire après la démission de Michel Domingue (15 avril 1876-23 avril 1876).
Les gouvernements provisoires se succèdent au fur et à mesure que le pays sombrait dans l’instabilité politique. Deux comportements rédhibitoires de la classe politique haïtienne : la division et son pendant, l’instabilité politique chronique. Dès lors, il n’est pas étonnant que ce processus historique chaotique ait conduit à l’humiliation de 1915. La substitution de l’influence française à celle des États-Unis a ouvert la voie à une intervention américaine en Haïti.
Dans cette période troublée, le militaire Edmond Polynice fut à deux reprises président par intérim sous la dénomination de « Président du Comité de salut public ». Pendant 12 jours (27 janvier 1914-8 février 1914), il succédait à Michel Oreste. À la chute du président Oreste Zamor, il revient aux affaires à la tête de ce même Comité pour 8 jours (du 29 octobre 1914 au 6 novembre 1914).
Comme aujourd’hui, c’est une autre transition dans la transition qui s’est mise en place avec la prise du pouvoir par Joseph Davilmar Théodore qui inaugura une présidence éphémère moins d’un mois (6 novembre 1914-10 novembre 1914) puis une présidence permanente à partir d’un coup d’État (10 novembre 1914-22 février 1915).
À la veille de l’occupation américaine
La course à la présidence éphémère continue de plus belle avec des menaces sérieuses de guerre civile, comme à chaque renversement par les armes. Vilbrun Guillaume Sam accède à la magistrature suprême à un moment où les bruits de bottes américaines résonnaient de partout. Guillaume Sam, fils du dictateur Tirésias Simon Sam, reste moins de 5 mois au pouvoir, assez en tout cas pour massacrer ses ennemis politiques dont Rosalvo Bobo et Oreste Zamor.
En juillet 1915, Oreste Zamor organise une révolte populaire. Sam fait arrêter puis liquider tous ses adversaires, y compris Zamor. Horrifiés, d’autres opposants se réunissent et déclenchent une nouvelle révolution. Comme on devait s’y attendre, Sam ordonne la répression mais les soldats de l'ordre sont vaincus et le président, lynché par la foule au sein même de l’Ambassade de France en Haïti. Ses rares partisans encore en vie prennent la fuite.
À la suite de cette sauvagerie sans borne, un comité révolutionnaire (3) dirige le pays pendant moins d’un mois (28 juillet 1915-11 août 1915). C’est dans ce contexte que débute l’occupation américaine d’Haïti que l’on peut considérer à juste titre, comme un changement de paradigme au sein de la société haïtienne. Au cours des dix-neuf années de présence américaine, une dictature bicéphale haïtiano-américaine s’est mise en place. Les quatre présidents haïtiens (3) ont été choisis par les États-Unis avec des artifices démocratiques qui ne trompaient personne. Un obscur conseil d’État contrôlé par des partisans du futur Président Borno porta celui-ci à la présidence le 15 mai 1922 et il restera au pouvoir jusqu’au 15 mai 1930.
À la tête de cette camarilla se trouve un poète-écrivain, historien et militaire : Saint Cyrien, Alfred Auguste Nemours. Auteur de plusieurs livres d’histoire dont « les Borno dans l’histoire d’Haïti », il deviendra ambassadeur de la République d’Haïti en France (1926-1930). C’est lui qui présidait la fameuse séance du conseil d’État portant Borno à la tête de l’État.
Les Américains ont quitté le pays en 1934 mais les méthodes n’avaient guère changé à telle enseigne que c’était l’ancien ambassadeur d’Haïti à Washington, Elie Lescot, qui devint président de la République (15 mai 1941-11 janvier 1946).
Lescot succède à Sténio Vincent, lui aussi ancien ambassadeur de la République d’Haïti en Europe. Elie Lescot présidait un cabinet ministériel, à la tête d’un gouvernement ouvertement raciste. Ses ministres étaient tous des mulâtres à l’exception du poète et diplomate Antonio Vieux. C’est contre ce régime ségrégationniste que les jeunes de 1946 avaient gagné les rues de Port-au-Prince et avaient en quelques jours chassé le dictateur Lescot. Le poète et romancier haïtien René Depestre et ses camarades dont Gérald Bloncourt (décédé en 2018 à Paris) furent les héros de cette révolution qui avait emporté l’un des affidés le plus zélé des États-Unis en Haïti.
L’après 1946
Au terme de ce tumulte révolutionnaire, la présidence revient aux militaires, avec le Général Franck Lavaud à la tête d’un « Comité militaire exécutif provisoire » pendant 7 mois (11 janvier 1946-16 août 1946). Celui-ci organise des élections législatives à la faveur desquelles Dumarsais Estimé est élu député des Verrettes avant de devenir président de la République. On connaît les réalisations de ce fils de paysan de l’Artibonite à la tête du pays. Mais il sera renversé par l’armée et les États-Unis, parce que trop progressiste à leurs yeux. Par leur obsessionnelle peur du communisme, les Américains avaient en quelque sorte donné un blanc-seing aux militaires haïtiens pour le renverser.
Après le putsch, le pouvoir revient encore une fois de plus à Franck Lavaud, avec le titre de « Président du Comité militaire exécutif provisoire» (10 mai 1950-10 décembre 1950). Ce pouvoir militaire va organiser pour la première fois des élections au suffrage universel direct dont le seul candidat est un militaire : Paul Eugène Magloire. Le 6 décembre 1956, il obtient un mandat de six ans selon les vœux de la constitution de 1950 et reste 6 ans au pouvoir. Mais le Général Magloire ne voulant pas quitter le pouvoir à la fin de son mandat, assura un court intérim comme chef de l’Exécutif.
De 1956 à 1957, Haïti connaît une succession de présidences éphémères avec deux principaux postulants : l’Armée et l’institution judiciaire. Joseph Nemours Pierre-Louis devient Président de la République d'Haïti à titre provisoire (12 décembre 1956-3 février 1957).
L’intérim sur fond d’instabilité politique poursuit sa course et un autre membre de cette auguste institution, Franck Sylvain rafle la mise et ne reste même pas deux mois au pouvoir ( 7 février 1957-2 avril 1957). Il écrira ses mémoires dans Les 56 jours de Franck Sylvain.
Brusquement l’armée d’Haïti intervient et renverse le juriste. Le Général Léon Cantave, une tête galonnée, s’empare sans coup férir du pouvoir et s’accorde le titre de « Président du Conseil militaire de gouvernement » (2 avril 1957-6 avril 1957), comme si c’était toute l’armée qui l’avait hissé au pouvoir. Mais le putschiste ne fera pas long feu puisqu’il reste au pouvoir 4 jours seulement, (2 avril 1957-6 avril 1957). Il est remplacé par un pléthorique gouvernement collégial, 13 membres (5).
Dans cette logique d’instabilité généralisée, le Général Léon Cantave, assidu de tout premier ordre, revient au pouvoir du 20 au 25 mai 1957 avec le même titre Président du Conseil militaire de gouvernement
Las d’une situation politique désastreuse, les faiseurs des présidents provisoires finissent par opter pour un régime civil issu de la classe politique en ébullition. Ainsi le rusé François Duvalier avait-il habilement suggéré Daniel Fignolé qui malheureusement, accepta. Le piège se referma sur le leader charismatique du MOP qui reste moins d’un mois à la tête du pays (25 mai 1957-14 juin 1957)
L’armée toujours là en embuscade, s’empara de Daniel Fignolé qu’elle envoya en exil. François Duvalier exulte, son machiavélique plan fonctionnait comme il le voulait. Le Général Antonio Kébreau assure l’intérim pendant 4 mois (14 juin 1957-22 octobre 1957) comme « Président du Conseil militaire de gouvernement » et organise des élections qui ont vu l’accession du médecin François Duvalier à la magistrature suprême. Le reste, on connaît !
Maguet Delva
Notes
(1) Première partie publiée sous le lien suivant:https://lenational.org/post_article.php?cul=1761
(2) Léonce Bernard, Georges Bretous, Stuart Cambronne, Antoine Pierre-Paul, Vilfort Beauvoir, Weber Michaud, Seymour Lamothe, Raoul Daguilh, Théodore Nicoleau, Ernest B. Danache, Emmanuel Bruny, Max Bolté, Grégoire Eugène
(3) Charles de Delva, Edmond Polynice, Charles Zamor, Léon Nau, Ermane Robin, Eribert Saint-Vil Noël, Samson Monpoint.
(4) Sudre Dartiguenave (12 août 1915-15 mai 1922) ; Louis Borno (15 mai 1922-15 mai 1930) ; Louis Eugène Roy (15 mai 1930-18 novembre 1930) à titre de Président provisoire de la Républiqu; Sténio Vincent (18 novembre 1930-15 mai 1941)
(5) Le Gouvernement collégial (6 avril 1957-20 mai 1957) est composé de Léonce Bernard, Georges Bretous, Stuart Cambronne, Antoine Pierre-Paul, Vilfort Beauvoir, Weber Michaud, Seymour Lamothe, Raoul Daguilh, Théodore Nicoleau, Ernest B. Danache, Emmanuel Bruny, Max Bolté, Grégoire Eugène.