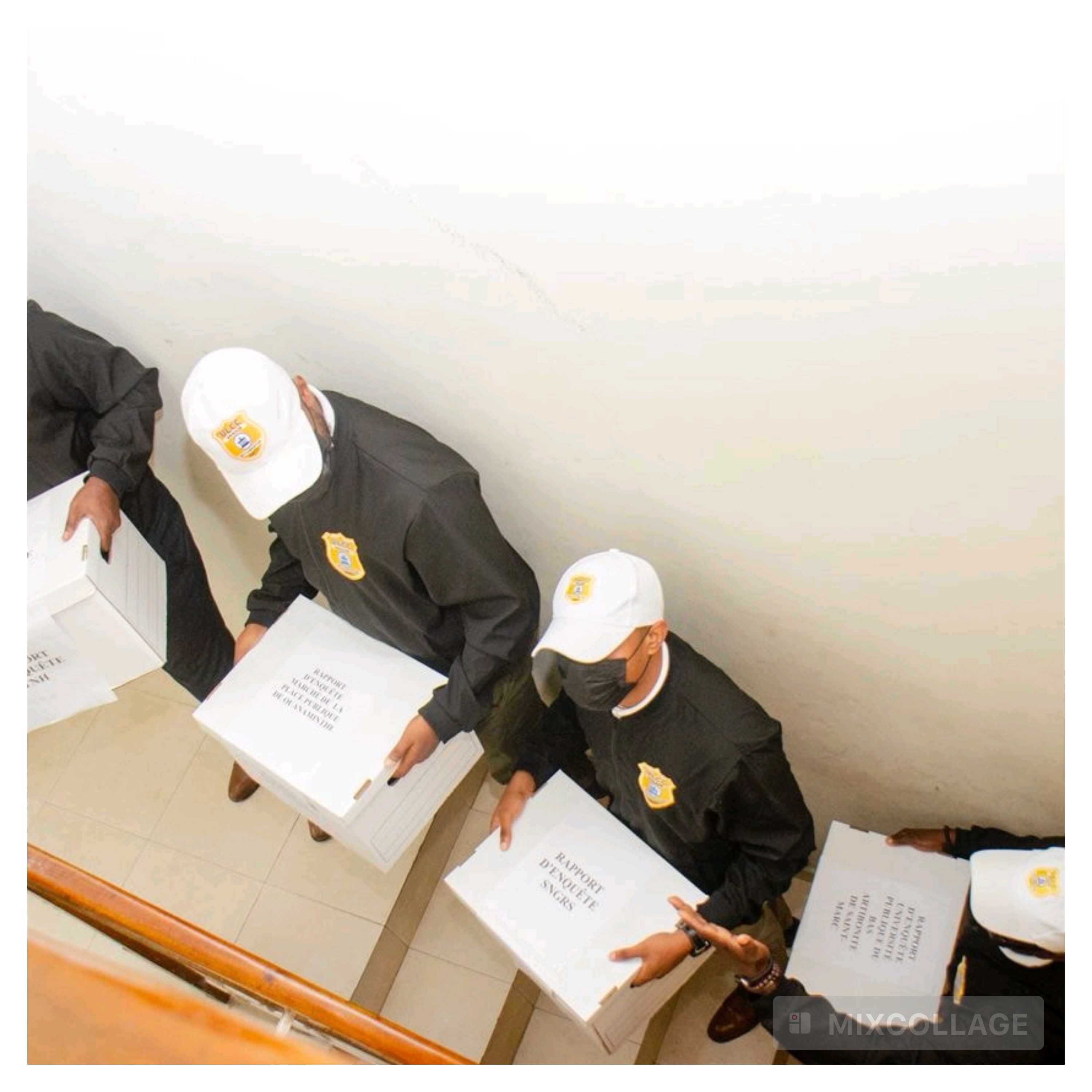Partie III
Par Savannah Savary
Regards extérieurs, comparaison et issue possible.
Regards internationaux : Marco Rubio, Trump, et la tutelle minière. Sur la scène internationale, les prises de position autour de la crise haïtienne oscillent entre condamnation de façade et agendas soigneusement dissimulés. Comme d’habitude, au-delà des touchants discours de solidarité, les mêmes grandes puissances qu’au temps des colonies, fidèles à leurs pratiques ancestrales projettent en Haïti leurs propres logiques de sécurité et d’intérêts stratégiques.
Dans une déclaration spectaculaire, le sénateur et Secrétaire d’État américain Marco Rubio a publiquement qualifié le gouvernement haïtien d’illégitime, dénonçant son incapacité à rétablir l’ordre et sa compromission supposée avec des acteurs liés aux gangs. Sous son impulsion, Washington a justifié l’expulsion de résidents permanents, y compris des titulaires de green cards, accusés de soutien à l’organisation criminelle et terroriste autoproclamée « Viv Ansanm ». Cette mesure, présentée comme un impératif de sécurité nationale, illustre la tendance américaine à considérer la crise haïtienne d’abord à travers le prisme migratoire et sécuritaire, davantage qu’en matière de souveraineté et de stabilisation politique. Sous l’administration Trump, cette logique s’est affirmée avec encore plus de vigueur. Tout en dénonçant la violence des gangs et les inscrivant sur la liste des organisations terroristes, la Maison-Blanche a maintenu une politique d’expulsions massives vers Haïti et suspendu partiellement son aide économique. Ce double discours, condamnation de la violence d’un côté, privation de moyens de redressement de l’autre a contribué à isoler davantage un État exsangue.
La tutelle minière : un agenda voilé. Mais derrière les déclarations publiques, un autre agenda, plus discret, s’est imposé, l’exploitation des ressources minières. Haïti, que la grande majorité nationale veuille y croire ou pas, dispose de gisements aurifères, bauxitiques et cuprifères considérables, attisant depuis longtemps les convoitises de multinationales étrangères. Qu’on le nie ou qu’on feigne de l’ignorer, ces richesses souterraines, patiemment façonnées par des millénaires de formation géologique, sont bien réelles et constituent l’un des secrets les plus jalousement gardés par les autorités haïtiennes. Pour les incrédules, Haïti serait trop pauvre pour avoir des ressources minières, et ce ne serait pas la raison de l’intérêt porté par les grandes puissances à ce petit territoire. Disons-le clairement. Ce n’est pas l’absence de richesses qui condamne notre pays à la misère, c’est le pillage, le déni et la dépendance imposée, c’est la corruption, l’impunité, la démission citoyenne, le manfoubinisme, la gourmandise de l’oligarchie, la démission de toutes les élites. Croire qu’un si petit territoire suscite l’attention des grandes puissances uniquement par compassion ou par hasard relève de la naïveté. Ce sont précisément ces trésors miniers, encore inexploités, qui attisent depuis des décennies les appétits, nourrissent les interventions masquées et expliquent en grande partie pourquoi Haïti demeure au centre des manœuvres géopolitiques.
Dans un contexte d’endettement massif, d’insécurité chronique et d’absence de gouvernance effective, les négociations menées en marge de l’État haïtien permettent à certains investisseurs d’obtenir des concessions à des prix dérisoires, sous prétexte de « relance économique ».
Cette « internationale » économique, souvent masquée par le langage hypocrite et sournois du développement et de l’aide, rejoint des logiques néocoloniales plus subtiles, exploiter les failles d’un pays affaibli pour sécuriser des contrats favorables, sans se soucier des retombées sociales ni environnementales. Le chaos devient ainsi une opportunité et l’État haïtien, vidé de son autorité, se transforme en simple décor derrière lequel s’organise une véritable tutelle minière.
Entre sécurité et prédation. Ces regards internationaux montrent que la crise haïtienne est instrumentalisée à deux niveaux. Au niveau sécuritaire, par la criminalisation des réseaux et la gestion migratoire. Au niveau économique, par la captation des ressources stratégiques dans l’ombre de l’instabilité. Ainsi, au lieu d’un engagement sincère pour la souveraineté et la reconstruction, Haïti se retrouve piégée dans une dynamique où les condamnations officielles côtoient des pratiques de prédation. Cette duplicité internationale ne fait qu’aggraver le sentiment d’un pays placé sous tutelle, où les décisions se prennent ailleurs, et où le peuple demeure le grand absent de son propre destin, l’éternelle victime de prédateurs nationaux et internationaux.
Multipolarité et enjeux géopolitiques actuels. Dans ce vaste jeu des grandes puissances, Haïti n’apparaît pas comme un acteur central, mais comme un terrain périphérique où se reflètent les rivalités de l’ordre multipolaire. Si longtemps l’île fut perçue comme relevant de l’« arrière-cour » des États-Unis, l’affaiblissement structurel de l’État haïtien et l’érosion du leadership américain ouvrent désormais des brèches qu’explorent d’autres puissances émergentes. Ironie cruelle, la Déclaration du 15 septembre 2025 martèle que « Haïti est trop pauvre pour susciter l’intérêt ». Trop pauvre pour se gouverner ? Trop pauvre pour se rêver un avenir ? Mais, apparemment jamais trop pauvre pour que les grandes puissances s’y pressent, carnet de concessions à la main, prêtes à marchander des richesses qu’elles jurent introuvables. La Misère, cette bonne cliente, c’est pour le peuple, les gisements, eux, n’ont rien de misérable.
La Chine, forte de son expansion mondiale dans le cadre de la Belt and Road Initiative, observe attentivement la fragilité haïtienne. Elle se positionne comme alternative en proposant des infrastructures, prêts et investissements, souvent sans conditionnalité démocratique. L’argument de Pékin est simple. La stabilité par l’économie, quitte à enfermer l’État haïtien dans une nouvelle logique d’endettement et de dépendance technocratique.
La Russie avance plus subtilement mais non moins stratégiquement. Dans un contexte où les gangs sont désormais qualifiés d’organisations terroristes, Moscou pourrait offrir une coopération sécuritaire, armes, formations, mercenaires, à un gouvernement défaillant en quête de survie. La logique n’est pas celle d’une reconstruction, mais d’un ancrage géopolitique. Grignoter un espace d’influence au détriment de l’Occident, au prix d’une militarisation accrue du territoire.
L’Inde, souvent absente des radars car plus discrète, n’est pas en reste. Elle voit dans la vulnérabilité d’Haïti, un potentiel pour y projeter ses entreprises de télécommunications, pharmaceutique ou services numériques. Ce « soft power » économique s’accompagne de technocratie et capitaux, et pourrait séduire une élite haïtienne méprisable par ses prises de position dans l’histoire récente, une élite invertébrée en quête de solutions rapides, mais comporte le risque d’un nouvel enfermement dans des logiques d’exploitation asymétriques.
Au fond, la question demeure entière. L’ouverture à de nouveaux partenaires permettra-t-elle un véritable rebâtissement, reposant sur la souveraineté et le développement durable, ou mènera-t-elle à une domination indirecte renouvelée, où les puissances extérieures, anciennes ou nouvelles, poursuivent leurs œuvres destructrices et intérêts sous couvert d’aide ? Dans un monde multipolaire, Haïti court le risque de devenir non pas un sujet, mais un objet de stratégie, utilisé comme levier dans un échiquier global qui le dépasse.
Ainsi en est-il arrivé, au 15 septembre 2025, que le Premier Empire Nègre des Amériques et de Jean-Jacques Dessalines l’Immortel, Hayti ou Haïti, se retrouve nu devant l’Histoire, dépouillé de ses institutions, livré aux factions et calculs étrangers, sans autre boussole qu’une Constitution mise en veilleuse et trahie par ses propres gardiens. Ce désordre n’est pas né d’un accident unique, mais d’une longue sédimentation de crises. Usure de l’État. Fragilisation du droit. Abdication des élites. Instrumentalisation des masses. Pourtant, ce qui paraît aujourd’hui singulier à l’œil haïtien n’est pas inédit à l’échelle du monde. D’autres nations, dans la tourmente des XXᵉ et XXIᵉ siècles, ont connu semblable vacance de la souveraineté et semblable effondrement du pacte institutionnel. Ces précédents ne sont pas des fatalités à imiter, mais des éclats d’histoire à méditer : de leur lointaine clarté surgissent les balises qui indiquent encore aux Haïtiens et Haïtiennes les issues possibles de leur propre destin. L’Histoire étant la boussole des peuples, encore faut-il avoir le courage de la lire, l’intelligence de la comprendre, et la dignité de s’en réclamer pour ne pas sombrer définitivement dans la nuit de l’oubli.
C’est à cette lumière qu’il convient désormais de tourner le regard vers d’autres expériences du XXᵉ et du XXIᵉ siècle : comparaisons contemporaines où des nations, elles aussi confrontées au vide institutionnel, ont su retrouver le chemin d’un ordre constitutionnel.
Comparaisons contemporaines : le retour à l’ordre constitutionnel. Le cas d’Haïti, aussi singulier qu’il paraisse, n’est malheureusement pas une exception. Le XXᵉ et le XXIᵉ siècles regorgent d’exemples de nations privées à la fois de président et de Parlement, ballotées entre vacance du pouvoir, effondrement de l’État et convulsions sociales. La Somalie dans les années 1990, la Libye en 2011 et la Centrafrique dans les années 2010 illustrent comment un vide constitutionnel conduit à la fragmentation et la tutelle internationale. En Syrie, Somalie, Libye, l’écroulement des institutions a laissé place à la loi des milices, aux ingérences étrangères et guerres par procuration. Au Venezuela, depuis 2013, c’est une lente érosion de l’ossature institutionnelle : présidence contestée, institutions laminées, puis reconquête autoritaire. Haïti, quant à elle, se distingue, comme à son habitude, par une radicalité tragique. Aucune transition civilisée, une imbrication structurelle entre gangs et sphères de pouvoir, une fragilité juridico-constitutionnelle à nu. Et pourtant, l’Histoire offre des précédents. Dans plusieurs cas, le retour à l’ordre constitutionnel fut possible. Une médiation régionale, la CEDEAO au Nigeria, Union africaine en Libye. Une feuille de route claire, négociée entre forces politiques, civiles et militaires. Un calendrier électoral contraignant, placé sous supervision régionale ou onusienne. Une justice transitionnelle, pour solder les crimes des milices ou des régimes déchus à Sierra Leone.
L’Histoire récente offre plusieurs exemples de nations qui, confrontées au vide institutionnel et à l’effondrement de la légalité, ont su retrouver, par des actes exécutifs exceptionnels, le chemin d’un ordre constitutionnel. Au Chili (1989-1990), sous Pinochet, la Constitution militarisée étouffait toute vie civile. Un référendum, suivi d’un décret-loi de la junte, rétablit la Constitution et ouvrit la voie aux élections : ici, le droit ne renaissait pas du suffrage mais d’un acte officiel publié, instrument d’une bascule historique. Au Mali (1991-1992), après la chute de Moussa Traoré, il n’y avait plus de Parlement, plus d’État. Le Comité de transition gouverna par ordonnances, suspendant provisoirement l’ancienne Constitution, avant d’en proclamer une nouvelle au terme d’élections démocratiques. Au Burkina Faso (2014-2015), le départ précipité de Blaise Compaoré plongea le pays dans un vide juridique. La Charte de la Transition, adoptée par arrêté présidentiel, assura la continuité constitutionnelle et prépara le retour à l’ordre après scrutin. Au Niger (2010-2011), le Conseil suprême pour la restauration de la démocratie suspendit la Constitution par ordonnance, puis en organisa le rétablissement après les élections : un pouvoir non prévu par le droit sut ainsi redonner vie au droit. Enfin, en Tunisie (2011-2014), après la chute de Ben Ali, un président provisoire gouverna par décret-loi. La suspension de l’ancienne Constitution, suivie d’une loi constituante transitoire, permit la fondation d’un nouvel ordre civil.
L’analyse des mécanismes utilisés révèle que, dans chaque cas, le retour à la Constitution s’est opéré par un acte unique, décisif et publié, émanant d’un pouvoir provisoire parfois illégitime mais rendu nécessaire par l’Histoire. À travers ces exemples, un fil conducteur se dessine. Au Chili, c’est la junte militaire elle-même qui, par un décret-loi publié au Journal officiel, amorça le retour progressif à la Constitution civile. Au Mali, un comité militaire provisoire prit le relais de l’État effondré et gouverna par ordonnances, suspendant puis rétablissant la Constitution après les élections. Au Burkina Faso, le président provisoire Michel Kafando adopta un arrêté accompagné d’une Charte de transition, également publiée officiellement, qui garantissait le retour automatique à l’ordre constitutionnel une fois le scrutin achevé. Au Niger, le Conseil militaire de transition utilisa, lui aussi l’ordonnance comme instrument pour suspendre puis rétablir la légalité, dans l’attente d’élections démocratiques. Enfin, en Tunisie, le président provisoire Fouad Mebazaa gouverna par décret-loi, suspendant l’ancienne Constitution pour mieux en préparer la restauration, toujours avec la légitimation qu’apporte la publication au Journal officiel.
Dans tous ces cas, l’enseignement est clair. Le retour à la Constitution n’a pas jailli d’une réinvention totale du droit, mais d’un acte unique, décisif, parfois arraché par des autorités provisoires elles-mêmes contestées, mais toujours rendu nécessaire par l’Histoire. Et cet acte, pour prendre force et valeur, devait passer par l’épreuve de la publication officielle, seul sceau reconnu de sa légalité.
Les leçons pour Haïti montrent avec clarté que l’Histoire ne l’a pas condamnée à l’errance, mais lui offre des précédents à invoquer et volontés à appliquer. De ces expériences internationales, quelques enseignements s’imposent. L’acte officiel demeure toujours la pierre d’angle, qu’il prenne la forme d’un arrêté, d’un décret ou d’une ordonnance, même émanant d’un exécutif provisoire, il peut rouvrir la voie constitutionnelle. Mais rien n’existe sans promulgation au Journal officiel, c’est là, et là seulement, que le droit reprend sa respiration. L’objectif n’est pas de réécrire la Constitution par la main d’un pouvoir transitoire, mais bien de rétablir l’ordre constitutionnel, fut-ce de manière provisoire. Et l’appui international n’est jamais secondaire, partout, la communauté régionale ou mondiale a validé ces transitions, à condition qu’elles s’accompagnent d’un calendrier électoral précis et contraignant.
Pour Haïti, une telle démarche suppose la signature du Premier ministre et du Conseil des ministres, même sous l’égide controversée du CPT. Elle requiert aussi l’adossement de l’acte aux grands corps symboliques. Cour de cassation, Université, Barreaux, Églises, afin de conforter sa légitimité. La publication immédiate au Moniteur en garantirait l’ancrage juridique tandis que la création simultanée d’un Conseil électoral provisoire, conformément à l’article 289, et l’annonce d’un calendrier électoral précis, en assureraient la portée pratique. Enfin, une communication diplomatique coordonnée vers l’ONU, l’OEA, la CARICOM, l’Union européenne et le Core Group donnerait à l’acte le sceau de la reconnaissance internationale.
Ainsi, l’Histoire enseigne qu’Haïti n’est pas vouée à demeurer prisonnière de son désordre institutionnel. Les précédents existent, multiples et reconnus. Encore faut-il le courage de les invoquer et la volonté de les mettre en œuvre. Car l’Histoire, avec son ironie sévère, nous enseigne ceci : aucune nation n’est condamnée à l’anarchie éternelle, si elle sait retrouver dans l’acte juridique, si mince fût-il, décret, ordonnance ou arrêté, la semence d’un nouvel ordre. Haïti ne manque ni de précédents, ni de modèles, ni de légitimité pour renouer avec sa Loi fondamentale. Ce qu’il lui faut aujourd’hui, ce n’est pas l’invention d’un énième compromis stérile, mais le courage de réaffirmer que la Constitution n’est pas un simple papier oublié, mais la dernière digue contre le chaos. Là où d’autres ont su restaurer la continuité du droit dans la nuit des ruptures, Haïti peut, elle aussi, se dresser et proclamer au monde : « Le peuple a encore une Loi, et la Loi peut encore sauver le peuple ».
L’Histoire contemporaine nous rappelle que nulle nation n’est seule face au gouffre institutionnel. Du Chili au Mali, du Burkina Faso à la Tunisie, d’autres peuples ont connu le vide du pouvoir, l’effondrement des institutions, le tumulte des armes et le désarroi des foules. Tous ont pourtant trouvé, dans un acte exécutif, décret, ordonnance, arrêté, l’instrument fragile mais décisif d’un retour à la légalité. Toujours, la légitimité est née de la publication officielle. Toujours, la communauté internationale a accompagné, parfois contraint, mais validé le geste lorsque celui-ci s’inscrivait dans une perspective de retour au suffrage.
Haïti n’est donc pas condamnée à l’errance. Elle peut, elle aussi, arracher au chaos une décision fondatrice. Il ne s’agit pas de fabriquer une nouvelle Constitution au gré d’arrangements éphémères, mais de redonner vie à celle qui demeure la Loi fondamentale, unique repère au milieu des tempêtes. Par un acte solennel, signé et publié au Moniteur, l’État haïtien, même amoindri, pourrait proclamer que la continuité juridique n’est pas morte. Alors, dans la nuit qui recouvre la nation, il resterait au moins une certitude : Haïti a encore une Loi, et cette Loi, si elle est réaffirmée avec courage, peut encore sauver le peuple qui l’a portée au monde.
La Constitution haïtienne de 1987 demeure la boussole légitime pour guider la nation hors de l’ornière. Elle institue l’équilibre des pouvoirs, garantit l’indépendance judiciaire, notamment à travers la Cour de cassation, et assure la responsabilité financière par le contrôle de la CSCCA. Elle prévoit qu’en cas de vacance présidentielle, le président de la Cour de cassation — ou à défaut le vice-président ou le doyen par ancienneté — assume la présidence provisoire et organise les élections dans les 45 à 90 jours.
Son rétablissement passe d’abord par le retour d’une Cour de cassation véritablement indépendante, autour d’un président légitime, Jules Cantave, afin de réintégrer le processus constitutionnel dans sa continuité. Il suppose ensuite une transition souveraine, dégagée de toute imposition étrangère et affranchie de la cooptation oligarchique. Il exige également l’organisation immédiate d’élections générales, placées sous un encadrement technique international mais impartial, garantissant leur crédibilité. La restauration de la CSCCA, en tant que source de reddition des comptes et défenseure de l’intérêt public, constitue un autre pilier incontournable. Enfin, cette renaissance institutionnelle ne saurait être complète sans une véritable refondation du contrat social, impliquant la société civile, les syndicats professionnels, les Églises et les communautés de base, afin que l’État retrouve ses racines dans la volonté et la participation du peuple. L’article 284.3 de la Constitution de 1987 interdit formellement tout référendum constitutionnel. Les amendements (art. 282–284) exigent la participation des deux Chambres, ce qui rend tout bricolage extra-constitutionnel illégal en l’absence de Parlement.
La question n’est plus de savoir si Haïti peut survivre. La véritable question est de savoir si, fidèle à l’esprit de 1804, elle saura renaître de ses ruines, non par la charité extérieure ni sous la férule des gangs ou de l’oligarchie, mais par sa propre volonté souveraine. La Constitution de 1987 n’est pas un papier jauni. La Constitution de 1987 non amendée demeure la dernière digue contre le chaos, le socle d’une refondation nationale. Par un seul acte solennel, signé par le Conseil des ministres et publié au Moniteur, l’État haïtien, même amoindri, peut proclamer que la continuité du droit n’est pas morte. Ce geste, appuyé par les grands corps symboliques de la nation et validé par la communauté internationale, rallumerait la flamme de la légitimité et tracerait la voie vers des élections générales.
À la veille de bouleversements mondiaux majeurs, alors que toutes les nations réajustent leur destin, Haïti se retrouve à un kalfou danjere. Si les Haïtiens et Haïtiennes du dedans et du dehors ne prennent pas conscience des dangers et prédateurs qui nous encerclent, si nous ne rallumons pas la flamme de 1804, notre peuple sombrera dans l’oubli des nations disparues. Par contre, si nous savons entendre l’appel puissant de l’Histoire, alors le sursaut d’âme pour une Cérémonie du Bois Kay Iman, autrement libératrice, une révolution non pas armée de machettes et poudre, mais armée de conscience citoyenne, dignité et courage devra s’imposer comme l’acte fondateur d’une nouvelle ère. Elle devra rallumer dans chaque foyer la conviction que le destin d’Haïti ne se quémande pas, il se conquiert. Elle devra transformer la peur en espérance, l’abattement en révolte créatrice, et unir toutes les forces vives de la nation pour reprendre le flambeau de la liberté universelle.
La puissance d’un peuple de notre essence ne meurt jamais. Nous sommes les descendants des fiers et irréductibles Marrons libertaires, instigateurs et bras de la Révolution de 1789. Notre dignité a été bafouée, trahie, mutilée par les propres fils de notre Terre ou par des ennemis masqués en amis. Notre courage légendaire peut sembler vaciller, pourtant elle demeure intacte dans les fibres les plus profondes de notre être collectif. Elle vit dans chaque cicatrice héritée de l’esclavage, chaque souffle de résistance, chaque cellule trempée du sang et de la sueur de nos ancêtres. Dans cet héritage de siècles de lutte pour la survie gît notre force.
Nous l’avons prouvé en 1804. Une nation d’esclaves, un regroupement de nègres réduit à l’état de meubles, a défié les empires pour proclamer au monde la liberté universelle. Nous le prouverons encore, car Haïti de tous les impossibles doit une fois de plus étonner le monde. Mais que chacun entende cette mise en garde : si nous échouons à cette heure, si nous nous abandonnons au chaos et à la trahison, ce sera l’effacement, la nuit définitive.
Haïti ne disparaîtra pas, puisque la Loi fondamentale vit encore, et de sa voix sacrée jaillira la renaissance. Au moment où les peuples vacillent, l’Hayti de Jean-Jacques Dessalines doit redevenir ce flambeau qui éclaire l’humanité. Voilà l’heure du combat ultime. Reprendre notre destin, restaurer notre Constitution de 1987 non amendée, et livrer, fils et filles de la Rédemption, la bataille pour la vraie libération.
Devant !
Contact de l’auteure : savannahsavary@yahoo.com | +509 36 49 57 37