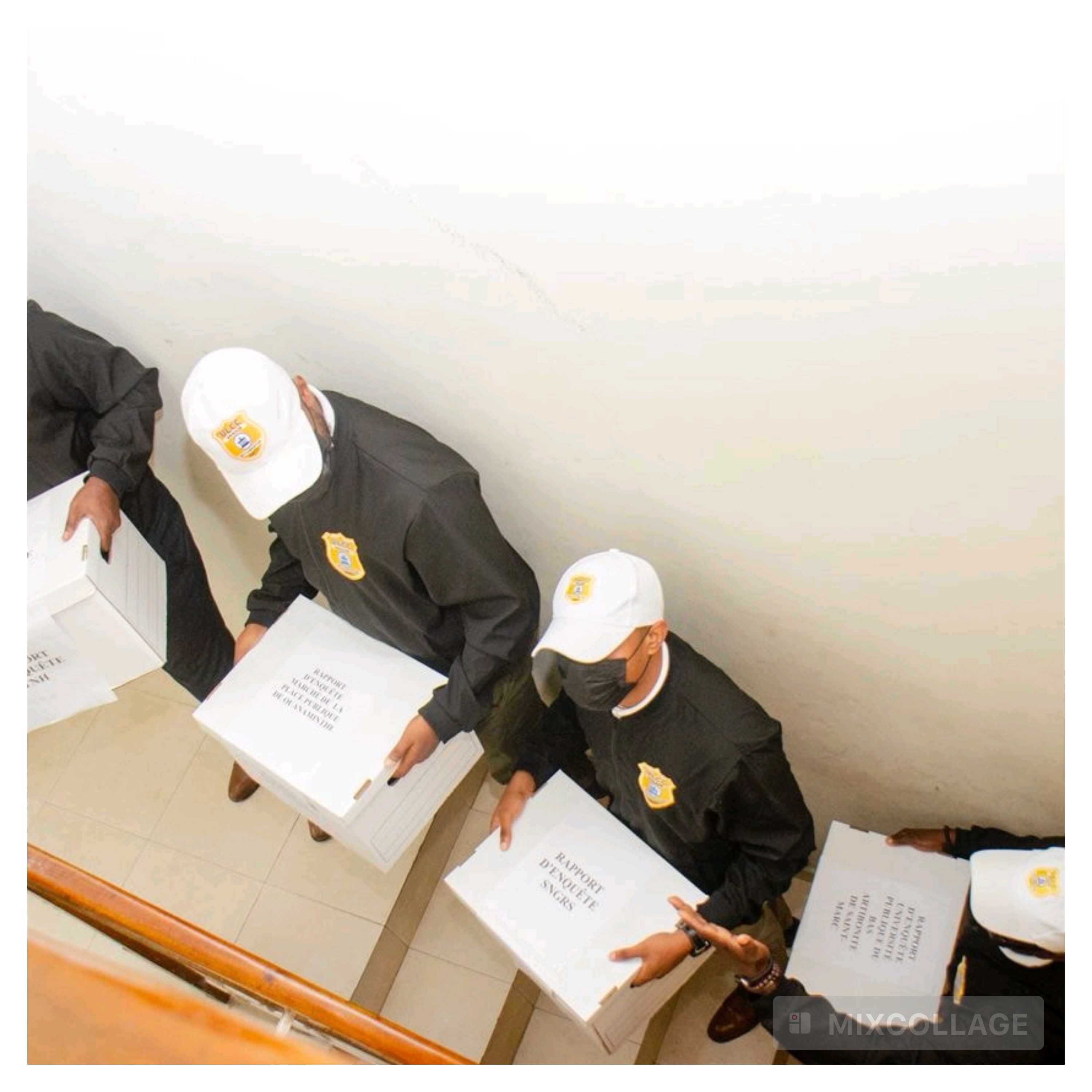Ce texte est un résumé-analyse de l’interview accordée par l’économiste et politologue Joseph Harold Pierre à la journaliste Marie-Lucie Bonhomme à la Radio Vision 2000, le mercredi 24 septembre.
L’action des États-Unis dans la crise sécuritaire haïtienne, bien que déterminante, présente un ensemble de limites qui en réduisent la portée et la crédibilité, tant sur le plan militaire que politique, économique et éthique.
Sur le plan structurel et militaire, Washington dispose des moyens nécessaires pour neutraliser rapidement les gangs armés qui contrôlent une grande partie de Port-au-Prince. Toutefois, il privilégie une approche de « leadership à distance », c’est-à-dire le financement et la coordination diplomatique, mais sans intervention directe de troupes. Si cette stratégie réduit les risques politiques et militaires pour le gouvernement américain, elle limite cependant l’efficacité opérationnelle de la Mission multinationale d’appui à la sécurité (MMAS). De plus, le refus des Etats-Unis de porter tout le fardeau financier de la quête de solution à la crise sécuritaire d’Haïti, bien que compréhensible, va ralentir le déploiement de l’éventuelle Force de Suppression des Gangs (FSG). Cette position peut exercer des conséquences négatives sur la réussite de ladite force, il n’est pas réaliste que les autres partenaires financiers vont aborder plus ressources à la FSG qu’à la MMAS.
Sur le plan politique et diplomatique, l’action américaine se caractérise par une inconstance stratégique. Les États-Unis se positionnent comme moteur de l’initiative sécuritaire, mais se désengagent dès lors qu’il s’agit d’assumer une responsabilité totale. Cette posture alimente une crise de confiance : d’un côté, certains acteurs haïtiens voient Washington comme indispensable à toute solution durable ; de l’autre, une partie de l’opinion publique haïtienne dénonce une ingérence récurrente, rappelant les interventions passées, notamment celles de 1915 à 1934, de 1994 à 2000 ou encore l’implication américaine dans la MINUSTAH entre 2004 et 2017. L’image des États-Unis oscille donc entre celle d’un allié incontournable et celle d’un partenaire ambigu, ce qui mine leur crédibilité diplomatique.
Sur le plan économique et sécuritaire, un paradoxe majeur fragilise l’action américaine. Alors que Washington soutient une mission internationale de lutte contre les gangs, il demeure le principal pays d’origine des armes et munitions qui alimentent ces groupes. Selon un rapport du Conseil de sécurité des Nations unies en 2023, plus de 80 % des armes saisies en Haïti proviennent directement ou indirectement du territoire américain, souvent par l’intermédiaire de la Floride et des réseaux de la diaspora. L’absence de contrôle rigoureux sur les circuits d’exportation, combinée à la porosité des frontières haïtiennes, réduit à néant les efforts sécuritaires. À cela s’ajoute une autre limite : l’aide américaine reste fortement conditionnée aux équilibres géopolitiques mondiaux. Les priorités stratégiques, qu’il s’agisse de la rivalité avec la Chine, de la guerre en Ukraine ou des tensions au Moyen-Orient, relèguent Haïti au second plan et peuvent rendre l’appui américain fluctuant.
Jennifer Louis, étudiante en 4e année à l’Université Publique du Sud-Est à Jacmel (UPSEJ)
Mackenson Jean-Simon, Mastérant en Education à l’Université Publique du Sud aux Cayes (UPSAC)